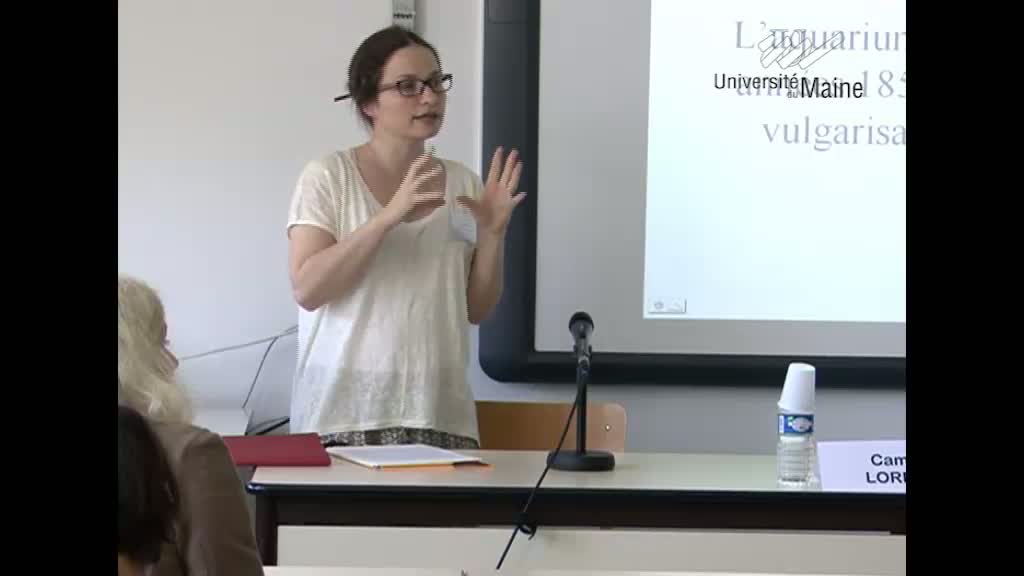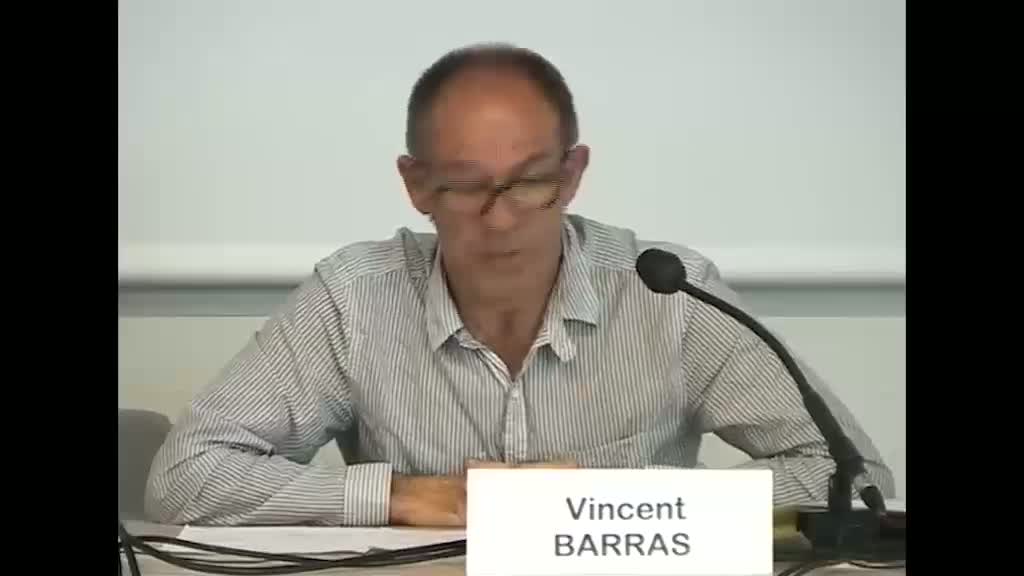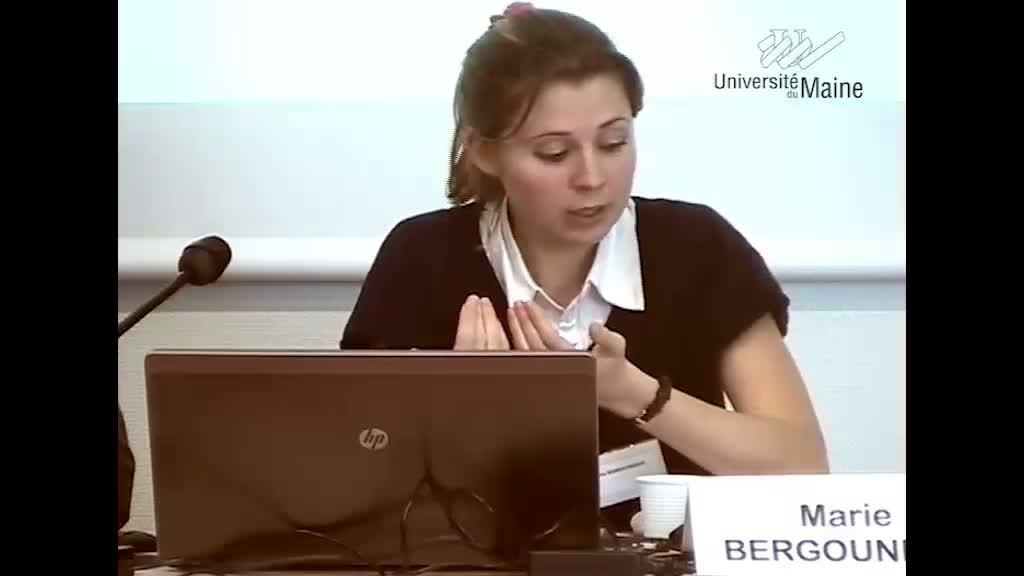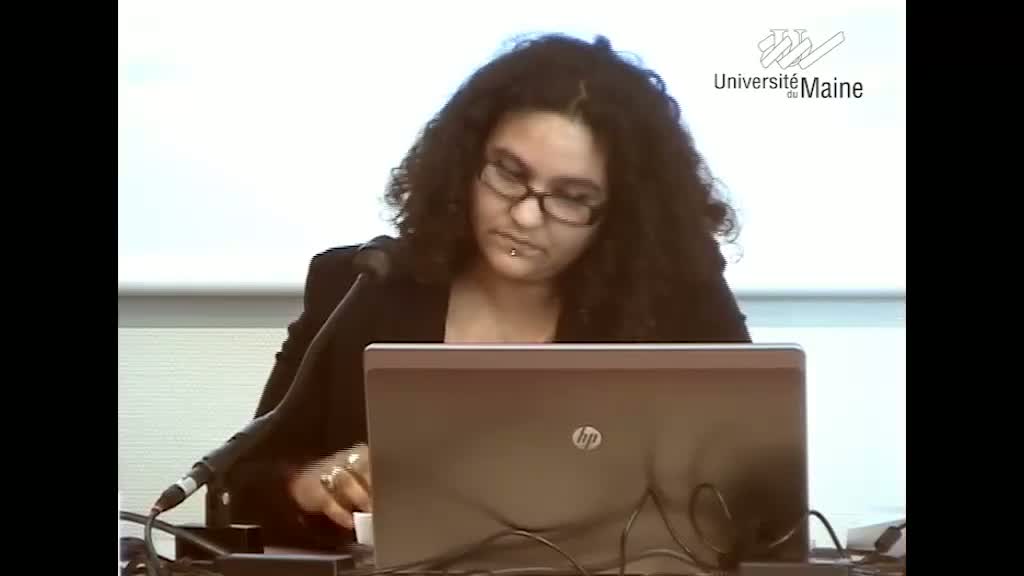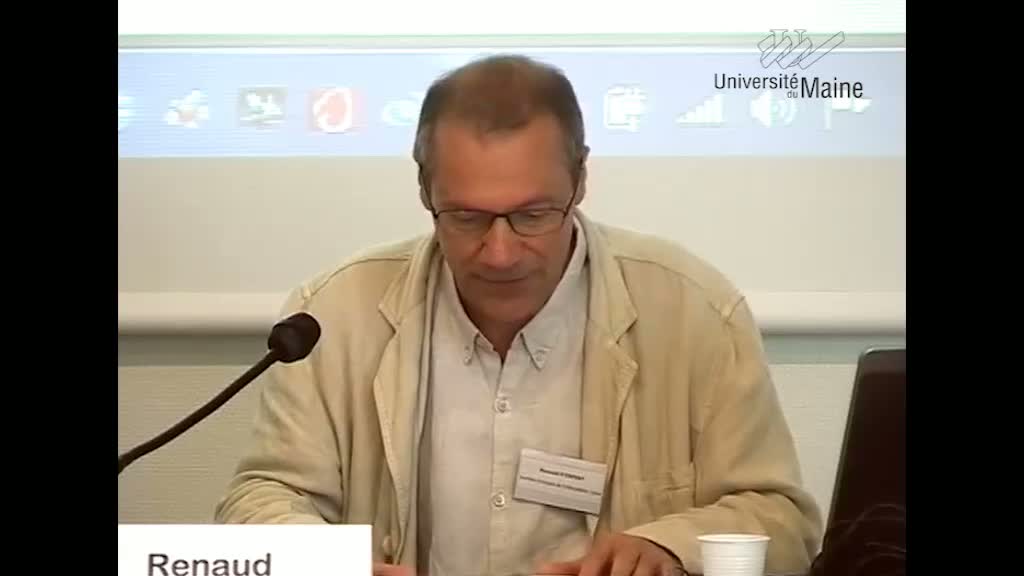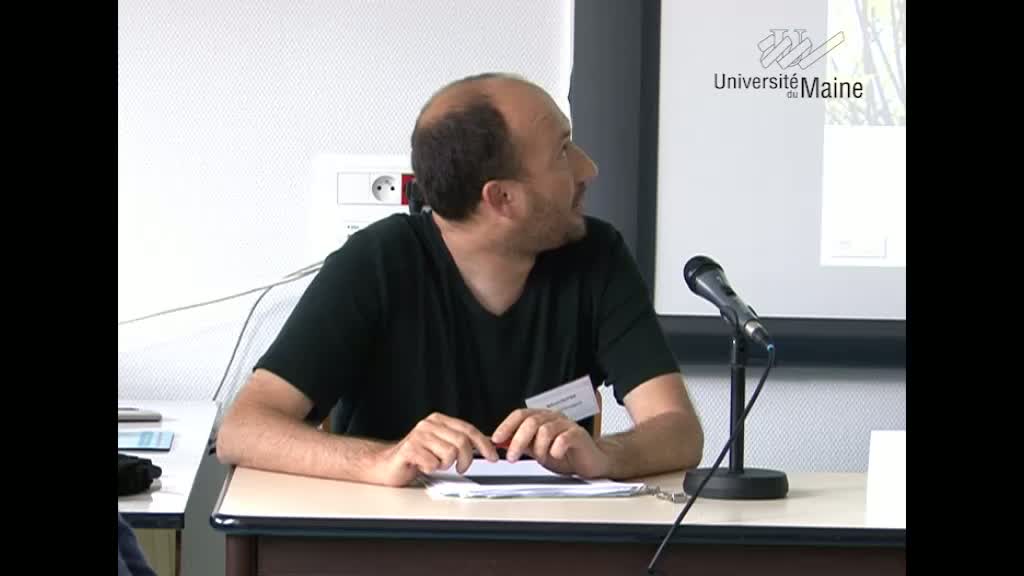Notice
Les manuels scolaires de sciences : une source pour histoire par « en bas » ?
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Dans le champ des études sur la science, les pratiques amateurs ont trouvé droit de cité ; les catégories sociales généralement invisibles, marginalisées, ou placées en position d'infériorité sont devenues des objets d'étude qui ont permis d'interroger la construction de la démarcation entre activités socialement reconnues comme scientifiques et celles considérées comme non scientifiques. Dans leur « troisième vague », les Science and Technology Studies (STS) ont introduit un questionnement sur la légitimité de la parole scientifique, notamment face à celle des profanes et la contribution de ces derniers à l'élaboration des connaissances scientifiques a ainsi été soulignée. Une diversification des acteurs de la science qui ont, après les « grands hommes », trouvé une place dans l'histoire des sciences s'est ainsi opérée. Pour autant, ce qui a fait entrer ces acteurs dans l'histoire des sciences est bien leur contribution originale à la construction du savoir scientifique. Apparentés à des chercheurs de « plein air », les profanes contribuent à la production de connaissances et les sciences en viennent à se confondre avec la recherche. La « majorité silencieuse » demeure quant à elle absente de ces récits.
Pourtant, dans des sociétés où la pratique scientifique est reconnue par le plus grand nombre et où il est attendu que chacun possède des connaissances de type scientifique, cette majorité silencieuse pourrait être objet d'histoire. Une piste pour tenter de saisir le devenir de cet ensemble hétérogène que rien de spécifique ne caractérise (il ne s'agit ni d'activistes, ni de professionnels particuliers) consiste à s'intéresser aux médias généralistes et populaires qui construisent et véhiculent des discours sur la science. Parmi ceux-ci, les textes associés à l'enseignement des sciences (programmes et manuels) occupent une place particulière à la fois parce qu'ils sont devenus, en parallèle de la généralisation de la scolarité, des productions médiatiques qui s'imposent à la grande majorité de ces individus ordinaires, et parce qu'ils sont aussi souvent perçus comme des « sources autorisés » du savoir. Dès lors, leur position dans le cadre d'une histoire des sciences « par en bas » nécessite d'être étudiée. À partir de l'exemple de différents manuels scolaires (certains publiés sous l'égide de « grands noms » de la science, d'autres rédigés au contraire par des enseignants de filières et d'établissements peu prestigieux) cette communication invite à s'interroger sur l'usage qui peut être fait de ces textes dans le cadre d'une histoire « par en bas » et sur la place que peuvent y tenir les personnels de l'enseignement. Elle s'appuie sur l'histoire de l'éducation pour déterminer à quelles conditions il est possible de les intégrer et montre l'intérêt qu'il y a à prendre en compte dans ce cadre conceptuel ces enseignants et ouvrages jusqu'à présent peu étudiés par les historiens des sciences et de l'enseignement.
Thème
Documentation
Liens
Dans la même collection
-
Le docteur Boissarie et les 'guéris' de Lourdes face aux experts de la Salpêtrière et de l'école de…
GuiseAntoinetteLorsque Lourdes devient un sanctuaire thérapeutique (années 1870) après avoir fait son entrée dans l'actualité comme lieu d'apparitions (1858), le monde médical évoque volontiers la manipulation. Il
-
Voyageurs et militaires dans la construction des études préhistoriques. Un exemple : l'invention de…
CataldiMaddalenaLa Vallée des Merveilles est un site archéologique majeur. Situé à Tende (Nice, Alpes-Maritimes), et daté entre l'âge du Cuivre et l'âge du Bronze, il présente près de 40.000 figures gravées
-
La protection des animaux en France entre science, vulgarisation et morale (1845–1914)
PierreÉricLa protection des animaux se structure en France dans les années 1840-1850 avec la fondation de la SPA en 1845 et le vote de la loi Grammont en 1850. Elle repose alors sur le double objectif de lutte
-
L'aquarium en France dans les années 1850–1860, un outil de vulgarisation scientifique ?
LorenziCamilleNous proposons d'étudier ici la façon dont l'aquarium, pur outil de laboratoire à l'origine, a été diffusé auprès du public comme un outil d'étude par les naturalistes, et la manière dont il a été
-
-
« À certains moments, il semblait se rendre compte de son état, il disait ‘Je ne veux pas devenir f…
ThifaultMarie-ClaudePerreaultIsabelleFace aux dits et aux écrits parfois délirants, irrationnels et poétiques des patients psychiatriques, comment mettre en narration historique ces discours singuliers, ces transcriptions ou
-
L'épilepsie dans la bande dessinée. L'ascension du haut mal, David B
BergouniouxMarieLeconteGauvinAppréhender l'histoire des sciences, et a fortiori de la médecine, « par en bas », c'est donner la parole non plus aux médecins ou à la théorie médicale, mais aux malades et à leur famille. Tel sera l
-
« L'ancien sentiment est trop avantageux à notre sexe pour céder sans combattre» : savoirs médicaux…
HanafiNahemaLes médecins du siècle des Lumières ont tant critiqué les savoirs féminins en matière de santé qu'une image très négative nous est parvenue : fruits de croyances ancestrales, de gestes superstitieux
-
Le point de vue des patients du peuple : approche des parcours thérapeutiques au XVIIIe siècle
ZanettiFrançoisL'histoire des pratiques thérapeutiques du peuple à l'époque moderne est difficile à mener. Les documents du for privé et les correspondances renseignent bien davantage sur les élites sociales et
-
L'enseignement « populaire » des mathématiques au XIXe siècle : Quels acteurs ? Quelles mathématiqu…
EnfertRenaud d'Lorsqu'ils s'intéressent à l'histoire de l'enseignement, les historiens des sciences des XIXe et XXe siècles focalisent bien souvent leur regard – et leurs recherches – sur les degrés supérieurs du
-
Les pratiques du passé sous la Restauration et la Monarchie de Juillet : appropriations populaires
LemoineGrégoireL'histoire prend dès les années de Restauration une place décisive dans le débat public : les Ultras favorisent les manifestations de deuil et d'expiation visant à rejeter en bloc les années
-
Une revalorisation du rôle des acteurs modestes de l'agronomie à travers deux exemples de la France…
OlivierSylvainFabreEricDe nos jours, la science agronomique émane des chercheurs et est relayée vers les producteurs par des conseillers agricoles sous la forme d'un savoir technique spécialisé. Ce triomphe des élites,