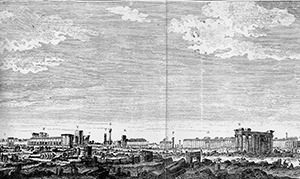Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre ;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
– Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal (1857)