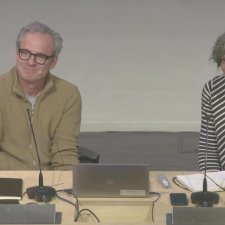Colloque international : Expériences sensibles, fabrique et critique des territoires en mutation
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
- document 1 document 2 document 3

Descriptif
Colloque international : Expériences sensibles, fabrique et critique des territoires en mutation. Colloque à l’initiative du laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités sous la direction de Rachel Thomas.
La collection présente 6 vidéos en séance plénière : L'introduction, la conférence d'inauguration, les duo et la synthèse.
Comment les approches sensibles qui ne cessent de monter en puissance dans le champ de la recherche architecturale, urbaine et paysagère peuvent-elles enrichir les débats actuels sur les mutations profondes qui bouleversent le quotidien des territoires, tant sur le plan social que politique, climatique, énergétique, numérique, etc. ? De manière plus précise, comment ces approches sensibles opèrent-elles et contribuent-elles à renouveler les postures et les méthodologies de la recherche dans ces champs ?
Ces deux questions naissent d'un constat et d'une hypothèse. La recherche architecturale, urbaine et paysagère francophone apparaît marquée ces dernières décennies par le déploiement d'une pluralité de cadres théoriques et de postures méthodologiques qui ont toutes contribué à théoriser le sensible et à renouveler par ce biais la compréhension et la fabrique des territoires. Polysémiques, ces approches ont notamment mis l'accent sur les interrelations non seulement senties mais aussi ressenties entre les entités humaines et non-humaines, Elles ont pu, en outre, se mettre parfois au service de l'opérationnel, en œuvrant par le biais d'expérimentations ou de prototypages (architecturaux, ambiantaux, numériques...) à une meilleure prise en compte des dimensions sociales et incarnées des rapports ordinaires aux lieux.
Mais les transformations profondes et multiples qui touchent les espaces habités, comme l'incertitude qu'elles créent, mettent à l'épreuve ces approches sensibles en les interpellant: que peuvent-elles en dire ? En quoi leur perspective, recourant à l'expérience quotidienne comme méthode et objet d'investigation, constitue-t-elle une vole féconde pour aborder ces mutations à l'échelle du territoire et dans leurs retentissements affectifs ? Autrement dit, peut-on faire l'hypothèse que leur effort pour articuler la description fine du monde et sa conceptualisation, reposant sur la conviction que l'attention au grain menu des phénomènes donne à penser, dessine une vole pertinente pour aborder les territoires en transformation, tant dans leur diagnostic que dans leur évolution possible ?
Ce colloque, qui fait suite au cycle de Rencontres AAU¹, se donne un double objectif: D'une part, il se propose d'analyser la fécondité et les difficultés d'aborder par le prisme du sensible les manières d'habiter et de fabriquer les territoires, actuellement affectés par de profondes transformations. Comment les approches sensibles permettent-elles de questionner non seulement leurs devenirs possibles mais aussi les façons de les projeter? D'autre part, il se propose de mettre en débat la capacité des outils conceptuels, méthodologiques et opérationnels mobilisant le sensible à se saisir des enjeux suscités par ces mutations. Comment la prise en considération de ces mutations les oblige-t-elles à se déplacer et dessine-telles en leur sein des perspectives de travail nouvelles ?
Comité scientifique :
Jean-François AUGOYARD, ENSA Grenoble, AAU, UMR CNRS 1563
Alia BEN AYED, École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis, ERA
Bruce BÉGOUT, Université de Bordeaux 3, SPH
Jennifer BUYCK, Université Gustave Eiffel, Lab'Urba
Eric CHAUVIER, ENSA Versailles, Léav
Joanne CLAVEL, LADYSS, UMR CNRS 7533
Emmanuel DOUTRIAUX, ENSA Paris-Val de Seine, unité de recherche EVCAU
Olivier GAUDIN, École de la nature et du paysage, Blois (Insa Centre Val de Loire), CITERES, UMR CNRS 7324
Catherine GROUT, École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille, LACTH
Laurent MATTHEY, Université de Genève, AAU, UMR CNRS 1563
Virginie MILLIOT, Université de Paris Nanterre, LESC
Magali PARIS, ENSA Versailles, Léav
Anthony PECQUEUX, Centre Max Weber, UMR CNRS 5283
Anne RUAS, Université Gustave Eiffel, COSYS
Ola SÖDERSTRÖM, Université de Neuchâtel
Jean-Paul THIBAUD, ENSA Grenoble, AAU, UMR CNRS 1563
Yves WINKIN, CNAM Paris et Université de Liège
Comité d'organisation AAU
Céline BONICCO-DONATO, ENSA Grenoble
Laure BRAYER, ENSA Grenoble
Laurent DEVISME, ENSA Nantes
Céline DROZD, ENSA Nantes
Rainer KAZIG, ENSA Grenoble
Thomas LEDUC, ENSA Nantes
Théa MANOLA, ENSA Grenoble
Perrine POUPIN, ENSA Grenoble
Elise ROY, ENSA Nantes
Myriam SERVIERES, ENSA Nantes
Rachel THOMAS, ENSA Grenoble
Nicolas TIXIER, ENSA Grenoble
Soutien technique et administratif AAU
Administration systèmes: David ARGOUD & Laurent CHARRIEAU
Ressources documentaires: Françoise ACQUIER & Laurence BIZIEN
Communication: Véronique DOM
Média et expérimentations: juL MCOISANS & Cédric PICHAT
Gestion administrative et financière: Laurence FROISSARD & Noëlle GUYON
Vidéos
Ouvertures
Ouvertures du colloque par son organisatrice et par les représentantes du CNRS et le Ministère de la Culture
De la sensibilité atmosphérique
Conférence inaugurale du Colloque international Expériences sensibles, fabrique et critique des territoires en mutation
En deçà et par-delà la maîtrise du projet
Premier duo du Colloque international Expériences sensibles, fabrique et critique des territoires en mutation.
Formes d’expression des mondes en transformation
Deuxième duo du Colloque international Expériences sensibles, fabrique et critique des territoires en mutation
Écologie et approches sensibles
Troisième duo du Colloque international Expériences sensibles, fabrique et critique des territoires en mutation
Regards croisés
Propositions de synthèse du Colloque international Expériences sensibles, fabrique et critique des territoires en mutation
Intervenants et intervenantes
Directrice de recherche au CNRS, Directrice de l'UMR Ambiances Architectures Urbanités (en 2022)
Docteur en sciences et techniques, spécialité architecture à Nantes en 2000.
Directrice de recherche CNRS, sociologue
Spécialiste en architecture, directrice de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Marne-la-Vallée, aujourd'hui Ecole d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est (2015-....)
Sociologue et urbaniste. - Directeur de recherche au CNRS, Centre national de la recherche scientifique, au Cresson, Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, UMR 1563 / École nationale supérieure d'architecture de Grenoble (en 2013). Son domaine de recherche couvre la théorie des ambiances urbaines, la sensibilité aux mondes de la vie, la perception ordinaire en milieu urbain, l'anthropologie sociale du son et l'ethnographie sensorielle des lieux publics. Il a dirigé le laboratoire de recherche CRESSON et a fondé le Réseau Ambiances International (www.ambiances.net). Jean-Paul Thibaud a publié de nombreux articles sur les ambiances urbaines et a co-édité plusieurs ouvrages sur ce domaine de recherche : https://cv.archives-ouvertes.fr/jean-paul-thibaud.
Auteur d'une thèse de doctorat en urbanisme et aménagement (Grenoble 2, 1992)
Architecte DPLG, docteur et Habilité à Diriger des Recherches. Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, en Théories et Pratiques de la Conception Architecturale et Urbaine, il enseigne aussi à l’École Supérieure d’Art Annecy Alpes et à l’Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine. Chercheur au Cresson, Il mène parallèlement une activité de projet au sein du collectif BazarUrbain (lauréat du palmarès des jeunes urbanistes 2007). De 2003 à 2010, il a été chargé de mission scientifique au Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère au Ministère de la Culture et de la Communication. De 2009 à 2022, il a été président de la Cinémathèque de Grenoble. Depuis 2018, il est directeur du Cresson et directeur adjoint de l’UMR Ambiances, Architectures, Urbanités.
Architecte (diplômé ENSA Paris Villemin 1989) et enseignant. - Crée, en 1990, avec Pierre Schall, l'agence Lortie & Schall, basée à Paris, dissoute en 2007. - Crée, en 2007, l'agence André Lortie Architecture. - Cofondateur, en 2009, de l'agence Les Trois Ateliers
Architecte et urbaniste, fondateur de l'agence d'architecture SATHY (2024)
Enseignant-chercheur, professeur à l’ensa Nantes, laboratoire Ambiances, Architectures, Urbanités, équipe CRENAU, 2022. Enseignant en sciences de l'espace des sociétés à l'École d'architecture de Nantes (en 2005). - Membre du LAUA, Laboratoire Architecture, usage, altérité, Nantes (en 2005). - Docteur en aménagement-urbanisme (Université François Rabelais, Tours, 2001).
Examinateur lors d'une thèse soutenue à l'INSA Lyon en 2022
Architecte, diplômée ENSA Versailles 2013
A fait des études de philosophie générale et un master « Éthique et Développement durable » à l’Université de Lyon 3 et il travaille désormais à l’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise. Il y développe des méthodes d’urbanisme sensible et collaboratif dans le cadre des ateliers d’innovation en urbanisme. En 2012, il rejoint le POLAU-pôle arts et urbanisme. Il accompagne dès lors différentes démarches artistiques et culturelles intégrant des enjeux sociaux et territoriaux. Il intervient dans différentes régions françaises et pour le compte de commanditaires variés (SEM, aménageurs, collectivités, État, etc.) en développant des réponses pratiques aux demandes d’évolution structurelle et méthodologique de ceux et celles qui font les villes et les campagnes.
Titulaire d'un master 2 en Etudes cinématographiques et audiovisuelles de l'Université Paris 3 - Sorbonne nouvelle
Thèmes
- Conception et construction
- Sens et sensations
- Expériences
- Affect
- Changement climatique
- Interdisciplinarité
- Aménagement du territoire
- Environnement
- Théorie du care
- Urbanisme
- Ambiance visuelle
- Aménagement
- Anthropocène
- Art et sciences
- Attention
- Bioacoustique
- Cartographie
- Changements climatiques
- Changements climatiques
- Droit social
- Enquêtes de terrain (ethnologie)
- Nature -- Protection -- Droit
- Politique publique
- Quotidienneté (philosophie)
- Sols