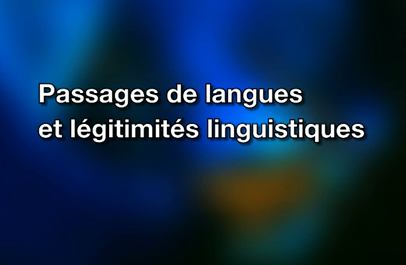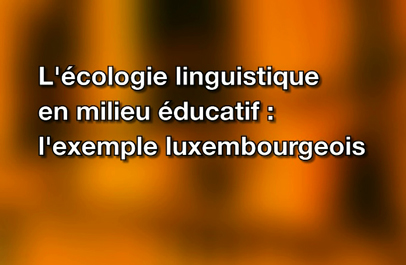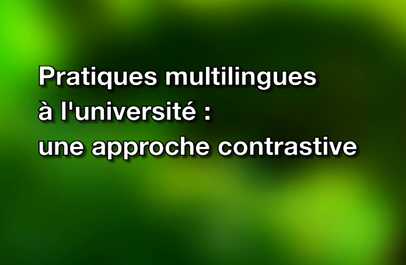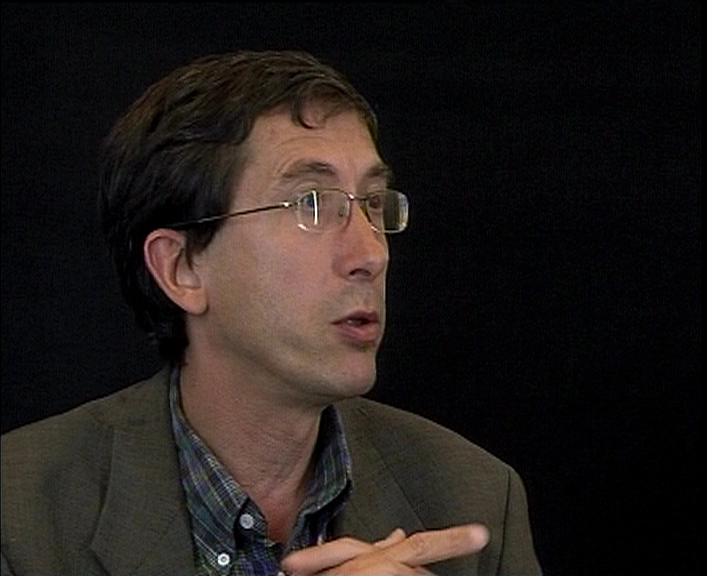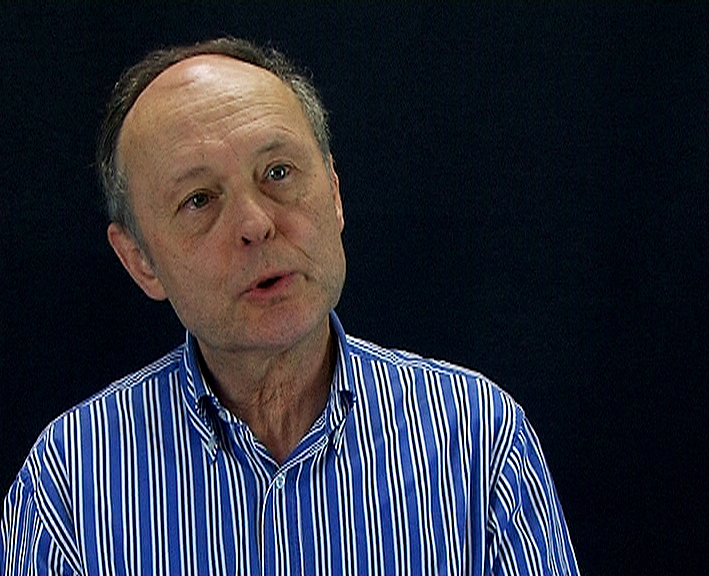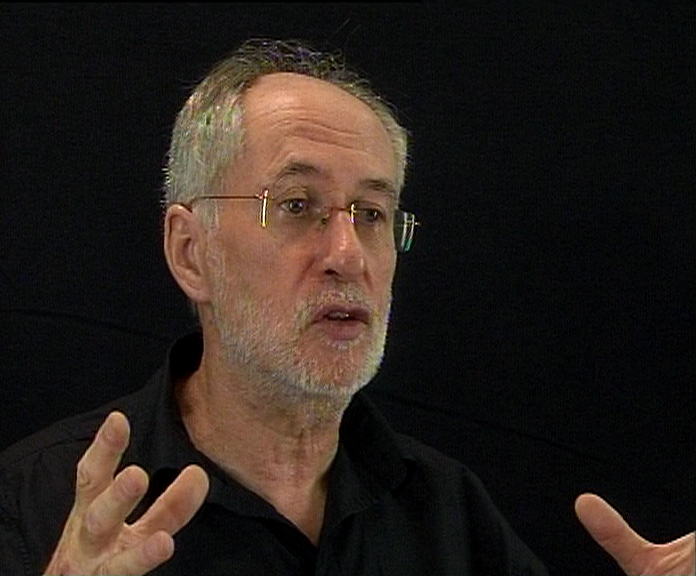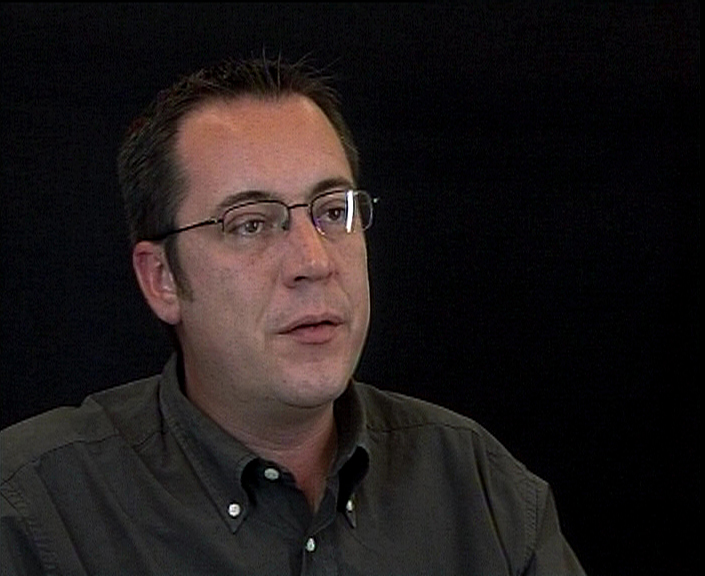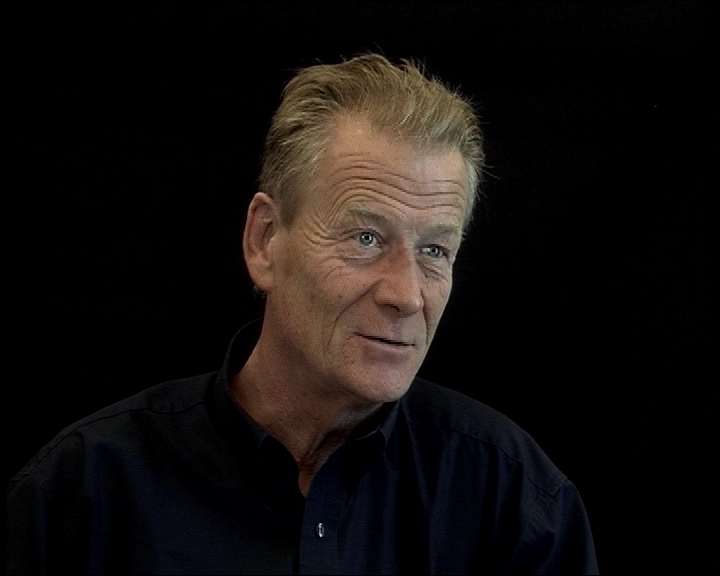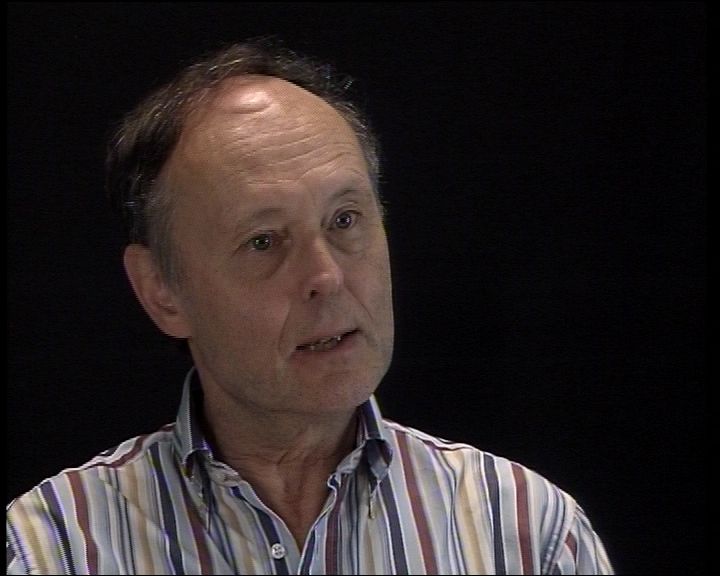Chapitres
- Introduction02'55"
- La construction sociale des marchés26'42"
- Les approches relationnelles du marché27'50"
- Les formes de coordination02'31"
- La coordination par l'intérêt05'46"
- La coordination par la qualité - confiance05'20"
- La coordination par l'information03'42"
- La ccordination par la gestion09'54"
- Le marché comme assemblage25'25"
- Conclusion05'47"
Notice
Introduction à une socio-anthropologie des marchés
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Une coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités
Première partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? ». Les auteurs vous proposent de rencontrer le sociologue Jean-Yves Trépos pour une introduction à la socio-anthropologie des marchés.
L'approche socio-anthropologique du marché qui est présentée ici, tout en se situant par rapport à certaines théories usuelles, économiques, voire sociologiques (notamment ce qu'on appelle la Nouvelle Sociologie Economique), cherche surtout à combiner ce qui fait le point fort des approches sociologiques récentes (le caractère construit et encastré du marché) et ce qui fait le point fort de certaines théories économiques (la spécificité "autoréférentielle" du marché), sans oublier de souligner que tous ces discours croisés sur le marché sont aussi actifs sur ce qu'il est et devient.
Intervention
Thème
Documentation
Exercices et Etudes de cas,Bibliographie
Introduction à une socio-anthropologie des marchés
Etudes de cas et propositions de travail
Etude de cas n°1 - Etude de cas n°2 - Etude de cas n°3 - Etude de cas n°4
Exercice n°1 et son corrigé - Exercice n°2 et son corrigé
Etude de cas n°1 [haut de page]
Le texte proposé n’est pas disponible en accès libre en ligne.
Il s’agit de :
HOLM Petter & NOLDE NIELSEN Käre, « Framing fish, making markets : the construction of Individual Transferable Quotas (ITQs) ». Dans : CALLON M., MILLO Y., MUNIESA F. (eds), Market Devices , Oxford, Blackwell ( The Sociological Review Monographs), 2007.
Pour travailler ce document, l’aide offerte ici est d’abord un résumé étoffé (qui devrait permettre de faciliter la lecture du texte en anglais), puis une série de questions avec des indications de recherche.
1. Résumé de l’article
L’article expose un cas de construction d’un marché de quotas de pêche en Norvège. Il fait la narration pas à pas (il se présente lui-même comme un récit, a story) des implications de différents protagonistes dans cette construction.
a) La situation initiale
*Une gestion culturelle des pêches côtières
Jusqu’en avril 1989,
- les côtes norvégiennes sont des « communs »;
- les pêcheurs sont des exploitants libres (des « commoners »);
- les poissons (essentiellement des morues) sont une propriété commune.
Cette situation fait l’objet d’une régulation surtout culturelle et faiblement législative.
**Des institutions de régulation et leurs dispositifs de mesure
Mais l’Etat norvégien s’est doté d’une institution de conseil – The Advisory Committee on Fishery Management (ACFM) – disposant d’un instrument de mesure des stocks : le Virtual Population Analysis (VPA). Il s’agit d’un modèle structuré selon des critères générationnels, qui définit une mortalité due aux pêches ( fishery mortality) pour la distinguer de la mortalité naturelle des poissons ( natural mortality). Ce modèle a été mis à jour par « guesstimation » (collage de guess et d’ estimation, qu’on pourrait traduire par « pifomètre systématique »).
L’ACFM diagnostique une crise de ressources : le Taux de croissance constaté des jeunes morues n’arrive qu’à la moitié des prévisions. Il recommande une diminution forte du volume de pêche autorisé – le Total Allowable Catch (TAC) - qui passerait de 530 000 t à 330 000 t
Ces conseils sont destinés à une institution d’opérationnalisation, The Joint Norwegian-Russian Fishery Commission (JNRFC), qui peut les traduire en dispositions contraignantes pour tout le Nord-Est de l’Atlantique (par exemple : elle décide du TAC).
Cliquer sur l'image pour la voir en grand format
b) La situation transitoire
*Un coup d’arrêt spectaculaire
Le 18 avril 1989, la pêcherie de Lofoten en Norvège est mise en arrêt, au nom de l’application de cette norme internationale, alors que certains petits bateaux n’ont même pas encore commencé à pêcher et que la poisson est abondant cette année-là. Pour la première fois, la gestion du stock de morues prend le dessus sur les intérêts immédiats des pêcheurs. Les acteurs prégnants prennent pourtant conscience d’un risque induit : les ravages professionnels résultant d’une concurrence faussée (les gros bateaux sont capables de prendre la mer plus tôt dans la saison et atteignent très vite le TAC à eux seuls).
**Les débuts d’un marché
« Les-autorités-norvégiennes » – il s’agit d’une appellation globale que nous donnons pour simplifier – définissent en 1990 les bases d’un marché (c’est-à-dire qu’ils définissent des conditions restrictives d’accès à la ressource), sur la base d’une norme : l’Individual Vessel Quotas (IVQ), supposée être l’instrument de mesure de la quantité pêchée, parce qu’elle définit pour chaque navire un quota de pêche spécifique.
Mais c’est d’emblée un marché hybride :
- seuls les bateaux du Groupe 1 (ce sont des professionnels à plein temps ; leur volume de pêche antérieur est rapporté à leur taille) sont soumis aux IVQ ;
- les autres bateaux (Groupe 2) ont libre accès à la ressource.
Comment éviter les méfaits de ce que les pêcheurs ont appelé la « pêche olympique », qui entraîne notamment une surcapacité de pêche ?
c) La stabilisation de la situation
*L’invention d’un marché des quotas
Les-autorités-norvégiennes proposent en 1991 de rendre les IVQ transférables sans transaction monétaire directe : elles inventent les Individual Transferable Quotas (ITQ), selon un modèle inspiré par le modèle théorique de l’économie des ressources, utilisé aussi en Islande et en Nouvelle-Zélande. Le pêcheur, considéré comme propriétaire rationnel d’un quota IVQ, jugera s’il est préférable de pêcher lui-même ou de céder ce droit à un autre. Si le marché fonctionne comme le dit la théorie, les quotas iront aux plus efficients (qui pourront offrir le meilleur prix).
**Une hostilité bien tempérée
Les ITQ sont alors pratiqués sans transaction monétaire de quotas (vente et revente des bateaux avec leurs quotas et non de quotas seuls). Ils sont rejetés d’emblée par les organisations professionnelles, comme par le Labour Party. L’argument est double : refus de la concentration ; craintes quant à l’arrivée des navires de la Communauté Européenne sur ce marché. Mais, en arrière-plan, ce sont des standards culturels (des habitudes communautaires) et politiques (une rhétorique anti-capitaliste) qui semblent les plus forts. La controverse est animée entre les critiques (qui dénoncent monopolisation par une élite, la privatisation d’un bien commun) et les supporteurs (qui estiment qu’il n’y a pas de transaction sur des quotas et donc pas de privatisation).
***La formalisation du marché
Les-autorités-norvégiennes, en Janvier 2004, créent un cadre légal pour une partie de ce marché informel des quotas : le Structural Quota system (SQ).
- Pour un 15-28m : pas plus de 3 quotas par bateau ; le bateau « donneur » est détruit ; ils doivent appartenir à la même pêcherie, au même groupe, au même comté ; et 20% du montant sont redistribués.
- Les moins de 15m n’y participent pas mais reçoivent une partie des quotas non utilisés ou récupérés.
Ces restrictions (de quantité de quota/bateau ; de transaction entre Gr1 et Gr2 ; de transaction hors frontières), chaudement débattues, s’efforcent de réguler les excès.
2. Indications de travail
Question d’approfondissement de la lecture :
A qui faut-il attribuer cette construction du marché des quotas ?
a) On peut imaginer un Léviathan (cette appellation, communément utilisée depuis Hobbes pour désigner un Etat tout-puissant, conviendrait particulièrement ici puisque la Bible fait du Léviathan un monstre marin redoutable, capable de changer l’ordre du monde). Ce pourrait être : la JNRFC ou plus largement Les-autorités-norvégiennes.
b) Les auteurs parlent « plutôt » d’une co-contruction des actants :
« L’histoire des ITQ en Norvège se prête à une interprétation en termes de co-construction d’actance (1) ( agency ) et de dispositifs de marché, plutôt qu’à l’hypothèse d’un programme, par lequel une actance pré-existante créerait un ordre. Notez le pluriel : au lieu d’un Léviathan et d’un programme unique, la circulation de différentes actances et de différents dispositifs. Bien que notre intention ne soit pas de présenter ce qui suit comme une liste exhaustive des co-constructions de ce type qui sont impliquées dans notre récit, elle illustrera la diversité des mécanismes qui y étaient à l’œuvre. Elle peut aussi démontrer la difficulté de conserver d’un bout à l’autre une division stricte entre ce qui est actance et ce qui est dispositif ; entre la cuisine et la recette. » (P. Holm, K. Nolde Nielsen, op. cit., p. 190) [traduction J.Y.T.]
[ (1) Note du traducteur : Le néologisme « actance » a été choisi pour adapter plus que pour traduire le terme « agency ». Ce terme a une grande souplesse en anglais, langue dans laquelle son utilisation abstraite comme concept sociologique (concept qui renvoie à l’engagement effectif d’actes par des personnes, des collectifs ou des êtres non-humains) n’est jamais loin de son utilisation concrète comme mot signifiant à la fois « puissance d’agir » (presque : liberté), « performance » et « agence » (comme dans : agence de renseignements).]
Ils ont en effet mis en place des dispositifs puissants (un algoritme et un outil) :
L’algorithme-TAC, qui constitue une puissance de Leviathan du nouveau régime océanique, à mesure qu’elle se constitue elle-même.
- Il produit l’accès sélectif au pêcheries ;
- Il fournit la métrologie qui convertit les quotas en marchandises. L’outil-TAC, découpé en IVQ / ITQ, a la capacité de transformer des entités et d’en introduire d’autres.
- Ex : la « disponibilité » du poisson, dépend de critères environnementaux, qui interagissent avec l’IVQ, d’une manière qui reste imprévisible.
D’où la transformation des pêcheurs eux-mêmes :
« Sur un plan pratique, les IQ ont eu des répercussions immédiates sur les pêcheurs, en l’espèce : la planification des opérations de pêche, l’investissement dans des équipements et des bateaux, la taille des équipages et leur organisation. En plus, la valeur marchande des quotas elle-même a donné aux pêcheurs accès à un nouveau type d’actance, à savoir la possibilité d’être acteurs sur le marché des quotas. Comme nous l’avons vu, l’introduction des quotas transférables a aussi transformé l’actance politique des pêcheurs. Au lieu d’être des usagers de la côté – des visiteurs dans un biens collectif – ils sont devenus des propriétaires de ressources et, en tant que tels, ont été particulièrement motivés à défendre leurs gains privés (…) Simultanément, la Machine T.A.C. et les I.Q. font passer la pêche d’un mode de vie à une manière de faire une vie. Il va sans dire que ce processus soumet beaucoup plus le secteur au management. » ( op. cit., p. 191) [traduction J.Y.T.]
Et, pour aller plus loin dans la métaphore culinaire, on peut suivre les auteurs qui imaginent le chef cuisiné :
« A la fin de ce récit, nous pouvons penser que nous commençons à voir les contours d’un Léviathan, un manager qui serait en position de surveiller et de contrôler le secteur par le moyen de marchés de quotas (…) Dans notre histoire, il est réellement plus approprié de dire que c’est le bouilli qui a fait la cuisine, plutôt que l’inverse »
(Holm, Nolde Nielsen, op. cit., p. 191) [traduction J.Y.T.]
Et que penser du rôle des économistes ?
« Les économistes ont incontestablement fait partie des cuisiniers qui ont préparé le bouilli que nous avons appelé un marché à quotas. Mais cela a pris plus de temps qu’ils ne l’espéraient et cela n’a pas tout à fait tourné comme ils le voulaient. Tout compte-rendu (critique ou d’autocélébration) qui mettrait trop l’accent sur le rôle direct de la ressource économique dans cette transformation courrait le risque de simplifier à l’excès le récit et de conduire à des interprétations inappropriées. Dans le cas norvégien tout au moins, la contribution des économistes, quelque peu critiquée par d’autres acteurs prégnants, s’est inscrite dans un mouvement plus large qu’ils pouvaient difficilement maîtriser. A coup sûr, ils n’étaient pas seuls dans la cuisine. »
(Holm, Nolde Nielsen, 2007, in fine) [traduction J.Y.T.]
On peut résumer toutes ces forces qui sont à l’œuvre par la schéma suivant (voir : « Un dispositif d’intéressement »)
Un regard extérieur à l’article
Michel Callon : Les marchés sont des assemblages hétérogènes
« Cette triple convergence (un dés-enchevêtrement des biens et des actances ; un formatage d’actances en individus ; ou bien une ignorance ou bien une production de capacités de calcul injustement réparties) ne conduit pas à l’imposition de marchés homogènes. Elle impose néanmoins une certaine forme d’économie / economy / qui, de plus en plus, est réduite à la question‘du’ marché et qui tend à confondre la pluralité éventuelle des marchés et des formes de compétition avec un modèle anthropologique hautement compatible avec l’économie / economics / néo-classique. Derrière la convergence, existent manifestement des divergences. (…) les marchés réels sont des assemblages hétérogènes qui sont intégrés à plus ou moins haut degré et qui sont en permanence susceptibles de se désassembler localement. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de logique d’ensemble, grâce aux luttes de performation (2) . Ce sont précisément ces luttes de pouvoir entre des programmes en compétition qui rendent possibles ces assemblages et dés-assemblages, lesquels nécessitent des investissements atteignant la valeur de ceux qui ont servi à formater les marchés réels (…) ».
CALLON M., « What Does It Means to Say That Economics Is Performative ? ». Dans : MACKENZIE D. & MUNIESA F. (eds), Do Economists Make Markets ? On the Performativity of Economics , Princeton, Princeton U. Press, 2007 – traduction J.Y.T.
[ (2) Note du traducteur : Callon remplace « performativité » (notion souvent reprise en sciences sociales pour désigner la capacité d’un discours à faire exister une réalité) par « performation » : processus par lequel des agencements socio-techniques sont mis en œuvre pour constituer des niches écologiques à l’intérieur desquelles, entre lesquelles des énoncés circulent et sont vrais (ou du moins ont un haut degré de vraisemblance). Il considère que, pour prendre en compte les aspects coopératifs et compétitifs, la notion de « performation » pourrait avantageusement être remplacée par celle de « co-performation » : tous les maillons de la chaîne de performation y participent, ceux qui la font fonctionner comme exécutants autant que ceux qui la conçoivent ou que ceux qui l’équipent institutionnellement.]
Etude de cas n°2 [haut de page]
1. L’article
GARCIA-PARPET Marie-France, « La construction sociale d’un marché parfait. Le marché au cadran de Fontaine-en-Sologne », Actes de la Recherche en Sciences Sociales , n°65, 1986. Disponible en ligne
2. Questions d’orientation du travail après lecture
a) En quel sens peut-on dire que ce marché est « socialement construit » ?
Conseils :
- rechercher des informations sur le constructivisme en sciences sociales (voir par exemple : CORCUFF P., Les nouvelles sociologies , Paris, Nathan, 1995) ;
- être bien attenti(f)(ve) à la diversité des niveaux pouvant être qualifiés de « sociaux ».
b) Comment les individualités et les collectifs ont-ils articulé leur action ?
Conseils :
- éviter une opposition trop simpliste entre « individu » et « société ».
- prêter attention à la conceptualisation proposée par l’auteure (notions d’intérêt et de champ, inspirées par BOURDIEU ; voir : Questions de sociologie , Paris, Minuit, 1980)
- pour une autre conceptualisation des engagements dans l’action, reposant sur la notion de « collectifs », voir : BARBIER R., TREPOS J.-Y., « Humains et non-humains. Un bilan d’étape de la sociologie des collectifs », Revue d’Anthropologie des Connaissances, n°1, 2007. Disponible en ligne
c) Un économiste rechercherait, concernant ce marché concret, la part de coordination par le marché, par les organisations, par le réseau, voire par le don. Essayez de dégager ces trois éléments. Sont-ils présents ? Agissent-ils distinctement, simultanément, voire réciproquement ?
Conseils :
- rechercher ces trois standards du raisonnement économique dans un manuel de SES de lycée ;
- si, comme c’est probable, vous rencontrez les trois occurrences, ne vous contentez pas d’en faire la liste mais essayez de voir comment chacune des formes de coordination agit lorsque l’une des autres (voire les deux) est présente.
Remarque : cette question est une variante de la précédente, prise à partir d’un autre point de vue.
Etude de cas n°3 - Sur la sociologie de la comptabilité [haut de page]
Importante chez Marx et Weber à un niveau macro, réapparue dans les années 50 à un niveau micro, elle commence, selon Peter Miller (2002) depuis les années 80 à contester cette dualité pour s’inscrire dans :
- son environnement institutionnel ;
- une ethnographie des pratiques ;
- une économie politique ;
- un assemblage de réseaux.
[ (3) Note de l’auteur : Mon exemplaire étant dépourvu de la bibliographie, je n’ai pu exploiter les auteurs cités par Miller. Ils sont donnés ici pour mémoire.]
Pour en donner un bref aperçu :
- L’ensemble des conventions techniques de la comptabilité des Etats modernes est un « mythe institutionnel rationnel » (Meyer, Rowan, 1977, cité par Miller), qui explique à ses exécutants le sens de ce qu’ils font (4). Ces règles doivent plus à l’environnement institutionnel (la rationalisation de l’Etat moderne) qu’à des contraintes techniques internes.
[ (4) Note de l’auteur : L’un des exemples les plus récents serait la perplexité des agents lors de la mise place de la LOLF en France. Cf. une analyse moins culturaliste, par C. Eyraud en annexe c.]
- D’un point de vue d’économie politique, plusieurs auteurs ont essayé de montrer que la comptabilité n’est pas un instrument neutre, mais un langage partisan et qui sert des intérêts de classe. Braverman (1974) a souligné la naissance de ce corps de clercs (les comptables) chargé de « représenter la valeur » au sein du capitalisme monopoliste, ce qui fait que « le processus de production dans la société disparaît au sein d’un fleuve de papier ». On en arrive à ce que la quantité de travail dévolue à la comptabilité atteint et dépasse celle qui est consacrée à la production des biens et des services qu’elles mesurent. Plus encore, selon Braverman, le principe fondamental de la comptabilité moderne c’est la « présomption de malhonnêteté » (symbolisée par la comptabilité analytique en partie double), qui nourrit une nouvelle profession, celle d’auditeur, « profession de l’honnêteté » comme dit ironiquement Braverman. Ce « vaste empire de papier » est devenu aussi réel que le monde physique et le domine progressivement. Sur cette base, de nombreuses études ultérieures ont cherché à montrer les nuances d’un pays à l’autre (Armstrong, 1985), d’une politique à l’autre et aussi les possibilités liées à une « comptabilité émancipatrice » (Tinkler, 1985) (5).
[ (5) Note de l’auteur : Voir une étude intéressante de la déprofessionnalisation de la profession comptable au Canada, comme outil de fonctionnement des grands groupes (Bernard, Hamel, 1982) – non citée par Miller.]
- D’un point de vue ethnologique, on a cherché à décrire l’expérience vécue des acteurs de cet univers et comment elle contribue à la production et à la reproduction de la vie organisationnelle (Roberts et Scapen, 1985). Par exemple, l’apparition d’une nouvelle culture organisationnelle basée sur la comptabilité (Dent, 1991), la fabrication des budgets (Preston, 1992), l’impact de nouvelles données comptables dans de petites unités (hôpitaux : Chua, 1992).
- Interprétations en termes d’assemblages et de réseaux. Ici, on récuse le dualisme comptabilité / environnement : l’environnement « traverse » la comptabilité et celle-ci l’influence en retour. Cherchant à comprendre les circonstances de l’apparition de la catégorie comptable de « valeur ajoutée », Burchell et al. (1985) ont examiné l’interpénétration de trois « arènes » (la mise en place d’une comptabilité standard, le management de l’économie nationale, le système des relations industrielles) qui forment la « constellation de la comptabilité ». L’« événement valeur ajoutée » est l’effet d’un champ où interfèrent : des relations entre les institutions, des processus économiques et administratifs, des corpus de connaissances, des systèmes de normes et de mesures et des techniques de classification. Robson (1991) a cherché à appliquer la sociologie de la traduction à cet univers, en particulier pour comprendre le changement de procédure comptable en GB. Miller et O’Leary (1996) en ont fait de même pour la modernisation d’une usine : nouvelles machines, nouvelles dispositions, nouveaux flux de production, nouvelles pratiques comptables et nouvelles relations du travail sont imbriqués et cela dépasse le cadre de l’usine.
Référence
MILLER, P., 2002, « How and why sociology forgot accounting ? », communication à Accounting, Organizations and Society 25th Anniversary Conference, University of Oxford, July 2000. Papier présenté aux Premières journées de sociologie de la quantification, mai 2002, SciencesPo Paris.
Etude de cas n°4 - Remarques épistémologiques sur la sociologie économique [haut de page]
1. Le paradoxe de Faulhaber et Baumol
2. Les trois tournants du constructivisme
3. De la prophétie auto-réalisatrice à la co-performation
5. Références bibliographiques de cette étude de cas
Texte de référence :
Callon, M., 2007, « What Does It Means to Say That Economics Is Performative ? ». In : MacKenzie, D. & Muniesa, F. (eds), Do Economists Make Markets ? On the Performativity of Economics , Princeton, Princeton U. Press.
Question d’orientation :
En quoi pourrait-on parler d’un nouveau tournant de la sociologie économique ? Autrement dit : y a-t-il une nouvelle « Nouvelle sociologie économique » ? Cette question suppose qu’après la première sociologie économique (celle de Simiand, chez les durkheimiens ; celle de Weber ou de Marx), la nouvelle sociologie économique (celle de Granovetter, de Bourdieu, qui redimensionnent Polanyi), on peut voir apparaître une troisième façon de faire.
Callon donne en exergue une citation de Mauss :
« L’homo economicus n’est pas derrière nous, il est devant nous ; comme l’homme de la morale et du devoir ; comme l’homme de la science et de la raison. L’homme a été très longtemps autre chose ; et il n’y a pas bien longtemps qu’il est une machine, compliquée d’une machine à calculer ».
Mauss, Essai sur le don , p.272
1. Le paradoxe de Faulhaber et BaumolLe paradoxe de Faulhaber et Baumol [sommaire étude de cas n°4]
Faulhaber et Baumol (1988) sélectionnent neuf innovations notablement à l’œuvre dans l’activité économique et se demandent quelle part y ont prise les économistes.
- Les innovations
Ce sont :
- l’analyse marginaliste ;
- l’utilisation de la valeur actuelle nette pour la budgétisation du capital ;
- la fixation des prix « peak load » ;
- la prévision économétrique ;
- le modèle de sélection portfolio et le coefficient β ;
- le modèle de fixation des prix de Black et Scholes ;
- le modèle de Ramsey ;
- le test de coût « stand alone ».
Comment catégoriser ces réussites ?
- La catégorisation
Quatre cas se présentent, selon Faulhaber et Baumol.
- Les économistes ont inventé la technique et contribué au processus d’innovation (économétrie, coefficient β ; coût « stand alone »).
- Les économistes ont aidé au processus d’innovation à partir d’une invention qui s’est produite dans un autre unkivers (valeur actuelle nette ; Ramsey).
- Les économistes ont fourni une formule pour un concept issu d’une version initiale intuitive imparfaite (« peak-load pricing »).
- Les économistes ont agi comme disséminateurs d’idées des autres (analyse marginale).
- Le dilemme
- D’un côté, l’économie en tant que science sociale n’a pas à justifier son existence par son taux de contribution à l’activité économique.
- Mais, d’un autre côté, peut-on admettre l’absence d’intérêt des agents économiques pour les contributions des économistes académiques ?
- Remarques critiques
Les deux auteurs n’ont retenu que des technologies économiques compatibles avec le modèle de l’agent rationnel, ce qui biaise l’analyse. La conception que Faulhaber et Baumol se font de la science économique place celle-ci devant deux possibilités, on le voit, inégales : ou bien, dans quelques cas, elle fournit l’input décisif de l’innovation ou bien, dans la majorité, elle décrit et analyse à distance et a posteriori des processus économiques qui se déroulent sans elle. La science économique, pour la plupart des économistes orthodoxes, est un luxe (au mieux, elle comprend bien ce qui se passe et c’est pour cela que ses descriptions sont justes). Pourtant, ces mêmes agents économiques ne peuvent se passer des ressources des ingénieurs, biologistes, chimistes : pourquoi pas des économistes ?
Mais surtout, les deux auteurs sont, selon Callon, victimes d’une conception linéaire de l’innovation : si on retient le modèle interactif et itératif, on voit au contraire qu’aucune innovation n’est dépourvue de contribution académique.
Selon Callon, le concept de performativité est la seule façon d’échapper à ce paradoxe. Il note ici qu’il faut aller plus loin que l’usage métaphorique qu’il en faisait dans Callon, 1998 : il y définissait comme performatif un discours qui contribue à la construction de la réalité qu’il décrit.
2. Les trois tournants du constructivisme [sommaire étude de cas n°4]
La notion de performativité, liée au constructivisme, doit beaucoup à des évolutions majeures des sciences et de la philosophie du langage. Or, selon Callon, trois tournants ont marqué l’histoire récente de la matrice conceptuelle linguistique.
- Le tournant pragmatique
Morris (1938) distinguait la syntaxe (rapport des signes entre eux), la sémantique (rapport entre les signes et leur dénotation) et la pragmatique (rapport entre les signes et leur contexte d’usage.
Mais Austin (1962), après avoir distingué entre le constatif et le performatif – ce qui allait plus loin – concluait à l’impossibilité de trouver des énoncés purement constatifs et ne retenait que des actes illocutionnaires.
- Le tournant sémiotique
Il fait apparaître la notion d’énonciation (Greimas, 1982).
Toute discipline scientifique contient, à côté des « énoncés universels » qui formulent ses lois (« pour tout », « quelle que soit… »), des « énoncés existentiels singuliers » (« il existe au moins un … »), qui comportent des références au monde et aux dispositifs permettant d’activer ces lois. En d’autres termes, l’énoncé existentiel singulier est inséparable de son contexte de pertinence. Et inversement.
- Le tournant de l’acteur-réseau
Les relations entre les énoncés et leur monde ne sont pas qu’une affaire de mots, ce sont des « agencements » (Deleuze, Guattari, 1980) où on ne peut séparer un agenceur et un agencé. Reprenant ce terme chez Deleuze et Guattari, Callon explique – ce qui nécessaire puisqu’il s’adresse à un public anglophone – comment distinguer des termes proches comme « assemblage », « bricolage » et « agencement » : plutôt que d’imaginer un vendeur qui « agence » sa vitrine au moment des soldes, c’est-à-dire qui dispose à sa guise des objets, avec pour seules contraintes en retour des assemblages impossibles (de formes, de couleurs, de styles, etc.), il ne faut, dit Callon, rien imaginer « avant » l’agencement. Il est une configuration où tous les éléments interagissent, y compris donc le discours qui les désigne comme agencements. L’agencement contient son prototype d’interprétation. Callon se réfère à MacKenzie (2003), à propos justement de l’équation de Black et Scholes. Il montre que cette équation suppose un monde particulier sans lequel elle ne marcherait pas et que ce monde, lui non plus ne marcherait pas sans l’équation. C’est un monde :
- dans lequel les prix ont un cheminement aléatoire observable ;
- où les biais constatés seront ultérieurement calculés et ré-injectés dans la formule du prix ;
- dans lequel le logiciel (Autoquote) permet la production d’une cotation continue, même pour les options avec faibles liquidités ;
- avec son vocabulaire, ses critères d’évaluation, où la notion de volatilité impliquée est mesurable et calculable.
Au paradigme de la vérification (les événements du monde vérifient la formule), il faut substituer celui de l’ actualisation : c’est un long processus d’essais et d’erreurs, de reconfigurations et de reformulations, au cours duquel la formule acquiert de la précision, du poids, de la robustesse, grâce à son équipement. La « condition de félicité » (comme disait Goffman) d’un énoncé performatif, c’est son ajustabilité, qui n’est jamais donnée d’avance et toujours produite en cours de route. La formule performative a l’air d’être constative quand son monde agit conformément à elle. Lorsqu’adviennent des événements indésirables (crises), de nouveaux ajustements sont réalisés (ici : via le biais de volatilité), nécessitant des professionnels et des équipements quotidiennement voués à cette tâche.
3. De la prophétie auto-réalisatrice à la co-performation [sommaire étude de cas n°4]
L’avantage de la notion de performativité, selon Callon, c’est qu’elle nous sort du paradigme de la représentation (Pickering, 1995). Pourtant, là encore, diverses conceptualisations s’offrent à nous.
a) Les prophéties auto-réalisatrices
- Faulhaber et Baumol suggèrent d’appliquer à la formule de Black et Scholes la théorie mertonienne de la self-fulfilling prophecy (SFP) : elle n’a pas besoin d’être vraie pour être efficace, il suffit que tout le monde y croie. C’est un outil de coordination permettant des attentes croisées. C’est ainsi parce que nous sommes des êtres humains et cela ne s’appliquerait donc pas aux lois de la nature.
- Mais, selon MacKenzie (2007), si la formule de Black et Scholes n’a pas permis de prévoir la crise de 1987, ce n’est pas par manque d’adhésion (insuffisance de SFP), mais par manque de prise en compte de l’agencement. On peut parler ici de « contreperformativité » (MacKenzie), là où Popper parlait de « réfutation » et où Callon lui-même parle de « débordement » ( overflowing) : le fait d’imposer des dispositifs conçus pour réaliser un énoncé entraîne la prolifération d’autres mondes d’énoncés par réaction à cette performation. Les effets non-voulus de la formule révèlent d’autres mondes qui nécessitent des ajustements et donc de nouveaux agencements socio-techniques
b) La prescription
La notion est souvent employée pour marquer le rôle médiateur des institutions (on parlera de « marchés à prescripteurs », lorsque des experts institutionnels sont en position de jouer cette fonction de stabilisation et d’orientation des consommateurs sur le marché, sur la base d’une conception très abstraite réalisée en amont – [voir Karpik, 2000 : un très bel exemple d’analyse d’un prescripteur sur un marché à prescripteur, celui de la consommation gastronomique (le Guide Rouge)] – ; on dira aussi que la BCE est un prescripteur du marché monétaire, sur la base des conceptions friedmaniennes). Si on considère par exemple la firme comme un réseau de contrats et si on met en place des procédures pour les stabiliser et les expliciter, la firme devient un réseau de contrats.
- Mais, estime Callon, la « prescription » est un cas particulier de la performation (cas d’une situation complètement stable). On peut le voir en pratiquant une relecture de Marshall Sahlins (1985), qui distingue les sociétés à structures « performatives » et à structures « prescriptives ». Dans les premières, les identités sont accomplies dans l’action en situation d’incertitude, alors que dans les secondes, elles correspondent à des rôles strictement définies par des codes culturels. Sahlins considère qu’il y a une dialectique de ces deux structures, comme le montre l’exemple du Capitaine Cook à Hawaï : cette société « froide » prescrit que, l’étranger étant un dieu (voir le « culte du cargo »), les femmes se donnent à lui dans un espoir de procréation ; mais, dès lors qu’il apparaît que l’étranger ne se comporte pas comme un dieu, la société devient provisoirement « chaude » et élabore de nouvelles normes par performativité.
Toutefois, selon Callon, cette distinction n’est pas très féconde, moins en tout cas que celle qui sépare les situations « ouvertes » des situations « fermées ». La prescription est une performation en situation fermée, où la pure répétition est possible. Cela s’appliquerait aussi bien à certaines situations des pays développés.
c) Performance, performativité et performation
Callon mentionne la position de Judith Butler (théoricienne du genre), selon laquelle il faudrait radicaliser la conception goffmanienne de la « performance » : si l’on annule la distinction entre la scène et les coulisses, on peut concevoir une identité qui se construit au travers de performances et n’est modifiée par une mise en scène qu’à la marge. L’identité de genre s’accomplit dans des situations variées, elle n’est donc pas unique, mais contrastée et culturellement variable.
Annemarie Mol (2002) fait remarquer que cette conception en termes de performance laisse de côté le corporel : le corps (donc le vagin et le pénis) n’est pourtant pas recouvert par la performance sociale, mais il en fait partie, il participe à la conformation des identités comme les autres matérialités. En outre, même dans les « sociétés prescriptives », les identités ne sont pas définitivement stables. Mol parle d’activation ( enactment). Pour éviter toute confusion avec les significations données par la linguistique, Callon propose de remplacer « performativité » par « performation » : il s’agit du processus par lequel des agencements socio-techniques sont mis en œuvre pour constituer des niches écologiques à l’intérieur desquelles entre lesquelles des énoncés circulent et sont vrais (ou du moins ont un haut degré de vraisemblance) : c’est ce qui prend tour à tour les formes de la SFP, de la prescription ou de la performance.
4. Les luttes de performation [sommaire étude de cas n°4]
Avant d’expliquer la vier de ces mondes de performation, Callon souhaite redéfinir ce qu’on peut entendre par « économistes ».
a) La « science économique au sens large »
Les académiques n’ont pas le monopole de la performation : les professionnels du marché aussi.
Trois raisons pour étendre la notion d’« économistes » :
- la distinction sciences / techniques sert à disqualifier, alors que tout montre que les « techniciens » produisent aussi de la théorie (voir plus loin le cas des « économistes expérimentalistes » face à ceux qui se réclament de la théorie des jeux ;
- c’est l’ensemble de l’agencement qui « fait » l’économie ( economy), donc c’est aussi les « professionnels » et les non-humains (télescripteurs, logiciels, téléphones portables, etc.) ;
- c’est l’ensemble des énoncés qui fait le mécanisme invoqué – [une formulation qui demeure proche d’une formulation structuraliste comme celle de Lévi-Strauss : le mythe c’est l’ensemble de ses versions ; chez Lévi-Strauss, pour d’autres raisons, toute recherche de la version originelle du mythe n’avait pas de sens] – et non telle ou telle partie d’entre eux, y compris donc les énoncés déviants.
L’économiste c’est donc tout agent participant à la transformation du marché économique : chercheur académique, responsable d’institution internationale, professionnel du marché, organisation de consommateurs…
Callon considère que, dans ces conditions, la notion de « performation » pourrait avantageusement être remplacée par celle de « co-performation » : tous les maillons de la chaîne de performation y participent, ceux qui la font fonctionner comme exécutants autant que ceux qui la conçoivent ou que ceux qui l’équipent institutionnellement.
b) La co-performation comme procès historique
Callon renvoie à la mise au point que fait Marie-France Garcia-Parpet lors de la traduction en anglais de son fameux texte sur le marché au cadran (signé Marie-France Garcia en 1986) : quand les circonstances changent, même le « marché parfait » (i.e. ici : construit selon les lois de l’économie) se dé-réalise.
Pour analyser le processus de performation comme historique, Callon propose de considérer
plusieurs études de cas. On n’en retiendra ici que deux.
- La co-performation coopérative
Il se réfère ici à Holm & Nolde Nielsen, 2007 et à Holm, 2007. Ces auteurs montrent, selon Callon, comment le monde présupposé par l’économie néo-classique (avec des individus égoïstes et calculateurs) est actualisé, dans le cas du monde norvégien de la pêche. Le changement de performation qui fait advenir ces individus typiques (en gros les pêcheurs norvégiens modernes), est indissociable de celui qui transforme des poissons invisibles et fuyants (comme ceux que traque l’amateur ou l’artisan), sans propriétés ni droits, en « cyber-poissons », traçables, identifiables (et dénombrables) et contrôlables (et pouvant être liés à des quotas), conférant des droits de propriété. Cela a nécessité un énorme effort de documentation, une flotte de bateaux d’observation, des cohortes de statisticiens, des avions d’observation des pêcheurs, des outils de traçabilité, des institutions internationales et des négociations pour s’assurer que les décisions nécessaires sont prises.
« Quand les pêcheurs se transforment en homini economici, ils ne peuvent bien vivre et calculer leurs intérêts que lorsque les océans sont reconfigurés en aquariums » (Callon, op. cit.)
Techno-sciences, politique et économie co-performent le monde de la pêche, en rendant possible la co-existence de nouvelles entités (nouveaux pêcheurs, mais aussi nouveaux poissons), mais aucun d’entre eux n’y suffit. Pour autant, il ne faut pas s’imaginer que tout cela soit linéaire et sans altercations : le Quota Individuel Transférable (ITQ) a d’abord été rejeté « rituellement », conformément aux traditions revendicatives des pêcheurs côtiers norvégiens et, à ce moment-là, les économistes ont dû accepter de jouer le mauvais rôle des « anti-héros », ceux du libéralisme. Le fait qu’un marché à quotas ait finalement été mis en place ne doit pas être interprété de façon monolithique :
« Les économistes ont incontestablement fait partie des cuisiniers qui ont préparé le ragoût que nous avons appelé un marché à quotas. Mais cela a pris plus de temps qu’ils ne l’espéraient et cela n’a pas tout à fait tourné comme ils le voulaient. Tout compte-rendu (critique ou d’autocélébration) qui mettrait trop l’accent sur le rôle diret de la ressource économique dans cette transformation courrait le risque de simplifier à l’excès le récit et de conduire à des interprétations inappropriées. Dans le cas norvégien tout au moins, la contribution des économistes, quelque peu critiquée par d’autres acteurs prégnants, s’est inscrite dans un mouvement plus large qu’ils pouvaient difficilement maîtriser. Certainement, ils n’étaient pas seuls dans la cuisine » (Holm, Nolde Nielsen, 2007, in fine).
Callon mentionne aussi, dans le même style, les « cyber-cornichons » d’E. Didier : tant qu’ils sont inséparables de leur producteur, leur existence est en quelque sorte invisible ; il faut les en détacher pour leur permettre de circuler plus facilement (Didier, 2007).
- La co-performation concurrentielle
L’exemple porte ici sur la transformation du marché d’attribution des fréquences de télécommunications aux Etats-Unis (Mirowski & Nik-Khah, 2007 ; Guala, 2007). La Federal Communication Commission (FCC) se propose de mettre fin au mode d’attribution en vigueur (arrangements bilatéraux) pour « réconcilier efficacité économique, innovation technologique et justice sociale ». Pour mettre en place cette nouvelle règle du jeu, elle se tourne d’abord vers les économistes les plus théoriciens (théorie des jeux – GT), mais ceux-ci reconnaissent qu’ils n’ont pas de solutions toutes prêtes, notamment du fait que les biens échangés sont interdépendants, ce qui est ignoré par la GT. Du coup, on assiste à une prolifération rapide d’autres acteurs proposant leur solution. Les deux acteurs prégnants finissent par être les GT (tout de même) et les économistes expérimentalistes (EE), qui eux utilisent des technologies informatiques. Selon Mirowski et Khah, il y a un gouffre entre ces deux agencements :
- concernant les compétences supposées des agents (GT : capables ou non d’apprentissage bayésien ; EE : capables ou non de réviser leurs préférences)
- concernant le rôle et les effets des algorithmes confrontant les biens et les agents (EE cherchent à atteindre un équilibre compétitif ; GT se représentent le marché comme des jeux de Bayes-Nash) ; en conséquence, les GT veulent augmenter la quantité d’information donnée aux agents et les EE cherchent à accroître les capacités du processus informationnel ;
- le soumissionnaire qui gagne, dans le modèle GT, c’est celui qui crée le plus de valeur en détenant la licence ; alors que dans le modèle EE, c’est celui qui attribue la plus haute valeur à la licence au début ;
- comme les EE pensent que ce sont les algorithmes qui font les calculs, alors que les GT pensent que ça se passe dans les têtes, les agencements envisagés sont différents : les EE proposent des enchères combinatoires et les GT un système d’enchères simultanées indépendantes à plusieurs tours (SMRI). Ces deux mondes socio-techniques (on n’aura garde d’oublier que chacun y déploie des armées d’économistes) ne sont pas seulement en lutte l’un contre l’autre, mais aussi contre tous les autres. [On notera qu’une interprétation bourdieusienne en termes de champ reste possible : il est clair que les EE sont en position dominée dans le champ de production savante de l’économie, alors que les GT sont en position dominante. Mais la contestation prophétique dont les EE sont porteurs est finalement circonvenue par le compromis qui, en excluant la masse des autres, consacre des pairs. Cette interprétation aurait requis d’autres éléments d’observation et documents. Cependant, elle peine à décrire les dispositifs techniques autrement que comme arguments rhétoriques, alors qu’ici, ils sont pleinement agissants.] Pourtant, l’agencement final (provisoirement) est un compromis entre les deux modèles. C’est certes le SMRI des GT qui est choisi, mais les EE ont pu modifier les algorithmes et les procédures (en principe c’était exclu dans le modèle GT). Les vrais perdants de cette affaire, ce sont les autres agencements non retenus.
Pour conclure :
« Cette triple convergence (un dés-enchevêtrement des biens et des actants ; un formatage d’actants en individus ; ou bien une ignorance ou bien une production de capacités de calcul injusteement réparties) ne conduit pas à l’imposition de marchés homogènes. Elle impose néanmoins une certaine forme d’économie /economy/ qui, de plus en plus, est réduite à la question ‘du’ marché et qui tend à confondre la pluralité éventuelle des marchés et des formes de compétition avec un modèle anthropologique hautement compatible avec l’économie /economics/ néo-classique. Derrière la convergence, existence manifestement des divergences. Comme le montrent de manière très détaillée les différents chapitres de ce livre, les marchés réels sont des assemblages hétérogènes qui sont intégrés à plus ou moins haut degré et qui sont en permanence susceptibles de se déassembler localement. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de logique d’ensemble, grâce aux luttes de performation. Ce sont précisément ces luttes de pouvoir entre des programmes en compétition qui rendent possibles ces assemblages et dés-assemblages, qui nécessitent des investissements qui atteignent la valeur de ceux qui ont servi à formater les marchés réels (…) »,
Callon, op. cit.
5. Références bibliographiques de cette étude de cas [sommaire étude de cas n°4]
AUSTIN J.L., 1970, Quand dire c’est faire, Paris, Seuil.
CALLON M. (ed), 1998, The Laws of the Markets, Oxford, Blackwell.
CALLON M., 2007, « What Does It Means to Say That Economics Is Performative ? ». In : MacKENZIE, D. & MUNIESA, F. (eds), Do Economists Make Markets ? On the Performativity of Economics, Princeton, Princeton U. Press.
DELEUZE G., GUATTARI, F., 1980, Mille Plateaux. Capitalisme et Schizophrénie – II –, Paris, Minuit.
DIDIER E., 2007, « Do Statistics ‘Perform’ the Economy ?. In : MacKenzie, D. & Muniesa, F. (eds), Do Economists Make Markets ? On the Performativity of Economics, Princeton, Princeton U. Press.
FAULHABERG.R. & BAUMOL W.J., 1988, « Economists as Innovators : Practical Products of Theoretical Research », Journal of Economic Literature, 26.
GREIMAS A.J., COURTES J., 1979, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la Théorie du Langage, Paris, Hachette.
GUALA F., 2007, « How to Do Things with Experimental Economics ? ». In : MacKENZIE, D. & MUNIESA F. (eds), Do Economists Make Markets ? On the Performativity of Economics, Princeton, Princeton U. Press.
HOLM P., 2007, « Which Way is up on Callon ? ». In : MacKENZIE D. & MUNIESA F. (eds), Do Economists Make Markets ? On the Performativity of Economics, Princeton, Princeton U. Press.
HOLM P., NOLDE NIELSEN K., 2007, « Framing fish, making markets : the construction of Individual Transferable quotas (ITQs) ». in : CALLON M., MILLO Y., MUNIESA F. (eds), Market Devices, Oxford, Blackwell.
KARPIK, L., 2000, « Le Guide rouge Michelin », em>Sociologie du travail, No.42.
LEVI-STRAUSS C., 1958, Anthropologie Structurale, Paris, Plon.
MacKENZIE D., 2003, « An Equation and its Worlds : bricolage, Examplars, Disunity and Performativity in Financial Economics », Social Studies of Science, 33.
MacKENZIE D., 2007, « Is Economics Performative ? Option Theory and the Construction of Derivative Markets ». In : MacKENZIE D. & MUNIESA F. (eds), Do Economists Make Markets ? On the Performativity of Economics, Princeton, Princeton U. Press.
MIROSWKI P., NIK-KHAH E., 2007, « Markets Made Flesh : Performativity and a Problem in Science Studies, Augmented with Consideration of the FCC Auctions ». In : MacKENZIE D., MUNIESA F. (eds), Do Economists Make Markets ? On the Performativity of Economics, Princeton, Princeton U. Press.
MOL A., 2002, The Body Multiple, Durham, Duke University Press.
MORRIS C.W., 1938, Foundations of the Theory of signs, Chicago, The University of Chicago Press.
PICKERING A., 1995, The Mangle of Practice. Time, Agency, and Science, Chicago, Chicago U.P.
SAHLINS M., 1985, Islands of History, Chicago, Chicago U.P.
Sujet de réflexion et de dissertation n°1[haut de page]
Indications de prolongement :
1. Réunissez des documents de presse (par exemple dans : Le Monde de l’Economie) à propos d’un marché et essayez de retrouver les assemblages et dés-assemblages d’acteurs (ou plus largement : d’actances) qui lui donnent à la fois son aspect désordonné et formaté. La crise financière du 2ème semestre 2008 pourrait en être le terrain, en raison de la profusion d’article auxquels elle a donné lieu.
2. Sujet de réflexion : Les marchés sont-ils rationnels ?
Pour une application aux marchés financiers, voir : André Orléan, « Les marchés financiers sont-ils rationnels ? ». En ligne
Sujet de réflexion et de dissertation n°2 [haut de page]
Enoncé : « Tout échange social n’est-il que marché ? »
Corrigé :
1. Remarques de préparation
Le sujet est formulé d’une manière qui suggère une réponse : face à « n’est-il que », il est difficile de résister à la demande implicite de répondre « non ». L’étudiant doit donc faire apparaître qu’il est sensible à un arrière-plan qui ne lui permet pas de simplement répondre à une question, mais l’oblige à faire apparaître un enjeu. En gros, si cette question est posée, c’est que certains théoriciens (sociologues, économistes et anthropologues) ont modifié la manière habituelle de traiter de la place du marché dans l’ensemble des institutions d’une société. Cette manière habituelle consistait à séparer nettement ce qui était organisé en marché et ce qui ne saurait y être réduit, même aux yeux des spécialistes du marché. L’économiste s’occuperait alors du marché et le socio-anthropologue s’occuperait des autres relations sociales. Cette opposition disposait d’une alternative commode (« marchand » / « non-marchand ») et se parait de proclamations vertueuses (le monde n’est pas une marchandise). L’effraction est venue de ceux qui, depuis Marcel Mauss (par l’analyse du don) jusqu’à Bourdieu (théorisant le marché des biens symboliques), en passant par Lévi-Str,
Références
- ABOLAFIA M., 1996, Making Markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, Cambridge, Harvard U.P.
- AKERLOF G., 1970, « The Market for ‘Lemons’. Quality Uncertainty and the Market Mechanism », Quarterly journal of Economics, 78 (3).
- CALLON M., 1998, « The embeddedness of economic markets in economics ». In : CALLON M. (ed.), The Laws of the Markets, Oxford, Blackwell.
- COCHOY F., 2004, La captation des publics. C’est pour mieux te séduire, mon client, Toulouse, Presses universitaires du Mirail.
- COCHOY F., Dubuisson-Quellier, S., 2000, « Introduction. Les professionnels du marché : vers une sociologie du travail marchand », Sociologie du Travail, 42 (3).
- DI MAGGIO P., LOUCH H., 1998, « Socially Embedded Consumer Transactions : For What Kind of Purchases Do People Most Often Use Networks ? », American Sociological Review, 63 (4).
- ECCLES R., White, H., 1988, « Price and Authority in Inter-Profit Center Transaction », American Journal of Sociology, 94 (supplement).
- FAVEREAU O., 1989, « Marché interne, marché externe », Revue économique, 40 (2).
- FAVEREAU O., BIENCOURT O., EYMARD-DUVERNAY F., 2002, « Where Do Markets Come From ? From (Quality) Conventions ! ». In : FAVEREAU O. LAZEGA E. (eds), Conventions and Structures in Economic Organization. Markets, Networks and Hierarchies, Cheltenham, Elgar.
- FLIGSTEIN N., 1992, The Transformation of Corporate Control, Harvard, Harvard U.P.
- FLIGSTEIN N., 2001a, The Architecture of Markets. An Economic Sociology of Twentieth Century Capitalist Societies, Princeton, Princeton University Press.
- FLIGSTEIN N., 2001b, « Le mythe du marché », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°139.
- GAO B., 1998, « Efficiency, culture, and politics : the transformation of Japanese management in 1946-1966 ». In : CALLON M. (ed.), The Laws of the Markets, Oxford, Blackwell.
- GARCIA-PARPET M.-F., 1986, « La construction sociale d’un marché parfait : le marché au cadran de Fontaine-en-Sologne », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°65.
- GRANOVETTER M., 1993, « The Nature of Economic Relationships ». In : SWEDBERG R. (ed), Explorations in Economic Sociology, New-York, Sage.
- GRANOVETTER M., 2000, Le marché autrement, Paris, Desclées de Brouwer.
- GUESNERIE R., 1996, L’économie de marché, Paris, Flammarion.
- HATCHUEL A., 2000, « Quels horizons pour les sciences de gestion ? Vers une théorie de l’action collective ». In : DAVID, A., HATCHUEL A., LAUFER R. (dir.), Les nouvelles fondations des sciences de gestion. Eléments d’épistémologie de la recherche en management, Paris, Vuibert.
- KARPIK L., 1995, Les avocats. Entre l’Etat et le marché. XIIIème – XXème siècles, Paris, Gallimard.
- ORLEAN A., 2002, « Le tournant cognitif en économie », Revue d’Economie Politique, 112 (4).
- SHILLER R.J., 1993, Macro Markets. Creating Institutions for Making Society’s Largest Economic Risks, Oxford, Oxford U.P.
- SMELSER N., SWEDBERG R. (eds), 1994, The Handbook of Economic Sociology, Princeton, Princeton University Press.
- STEINER P., 2005a, « Le marché selon la sociologie économique », Revue européenne de sciences sociales, vol. 132.
- STEINER P., 2005b, « L’héritage égalitaire comme dispositif social », Archives Européennes de Sociologie, 46 (1).
- UZZI B., 1996, « The Source and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organization : The Network Effect », American Sociological Review, 61 (4).
- WEBER F., 2002, « Transactions marchandes, échanges rituels, relations personnelles. Une ethnographie économique après le Grand Partage », Genèses, 41.
- WHITE H., 1992, Identity and Control, Princeton, Princeton U.P.
- ZELIZER V.A., 1983, Morals and Markets. The Development of Life Insurance in the United States, Columbia University Press.
- ZELIZER V.A., 1985, Pricing the Priceless Child. The Changing Social Value of Children, New-York, Basic Books.
- ZELIZER V.A., 2001, « Transactions intimes », Genèses, 42.
Liens
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (1/3) - Passages de langues et l…
TréposJean-YvesEhrhartSabinePolzin-HaumannClaudiaVenohrElisabethReissnerChristina« Passages de langues et légitimités linguistiques » est la première partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme. Il est utile d’aborder les
-
Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (2/3) - L'écologie linguistique …
TréposJean-YvesEhrhartSabinePolzin-HaumannClaudiaVasco CorreiaSarahVenohrElisabethReissnerChristina« L'écologie linguistique en milieu éducatif : l'exemple luxembourgeois » est la deuxième partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme. L’intervention
-
Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme (3/3) - Pratiques multilingues à…
TréposJean-YvesEhrhartSabinePolzin-HaumannClaudiaVenohrElisabethReissnerChristina« Pratiques multilingues à l'université : une approche contrastive » est la troisième partie de la Grande Leçon Arts de dire et formes de contrôle en situations de plurilinguisme. Rappelons que le
-
La consommation culturelle
KutyOlgierdMontebelloFabriceLeverattoJean-MarcDeuxième partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - L’économie
-
La flexibilité
KutyOlgierdPichaultFrançoisXhauflairVirginieLeverattoJean-MarcQuatrième partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - L’Etat
-
La négociation contemporaine
KutyOlgierdLeverattoJean-MarcCinquième partie de l'Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l'Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - La
-
L'innovation
TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcPremière partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - Introduction
-
Justice et management : enjeux et défis
KutyOlgierdSchoenaersFrédéricLeverattoJean-MarcTroisième partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - Le nouveau
-
L'Etat social actif
KutyOlgierdMacquetClaudeVranckenDidierLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Quatrième partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? » Les auteurs vous
-
Le nouveau management public
KutyOlgierdSchoenaersFrédéricLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Troisième partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? ». Les auteurs vous
-
L'économie des singularités
KutyOlgierdKarpikLucienLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Deuxième partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? » Les auteurs vous
-
La négociation
KutyOlgierdLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Cinquième et dernière partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? » Les