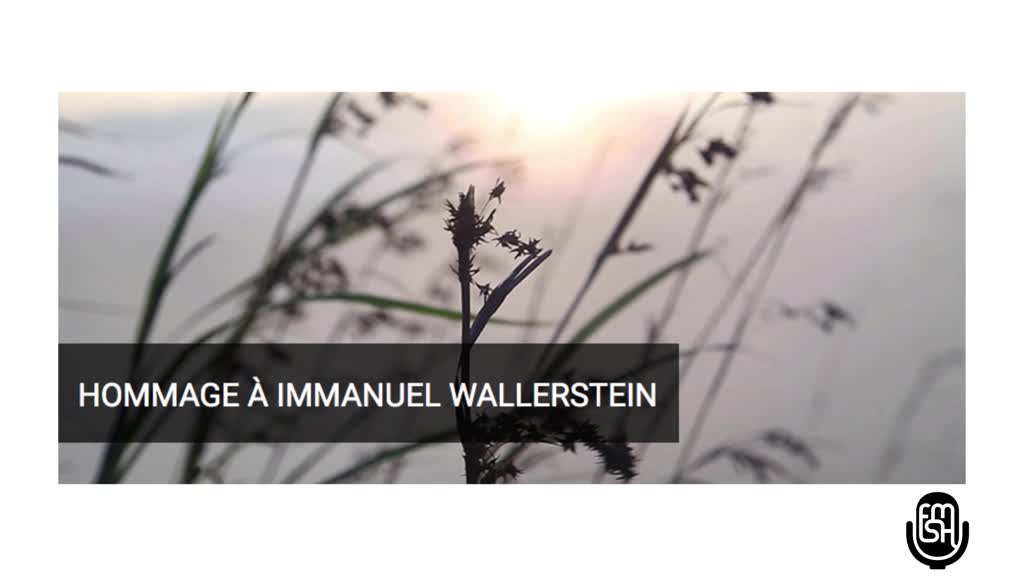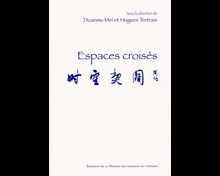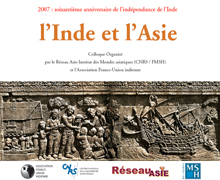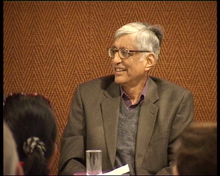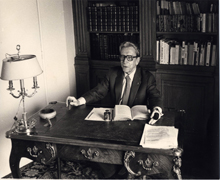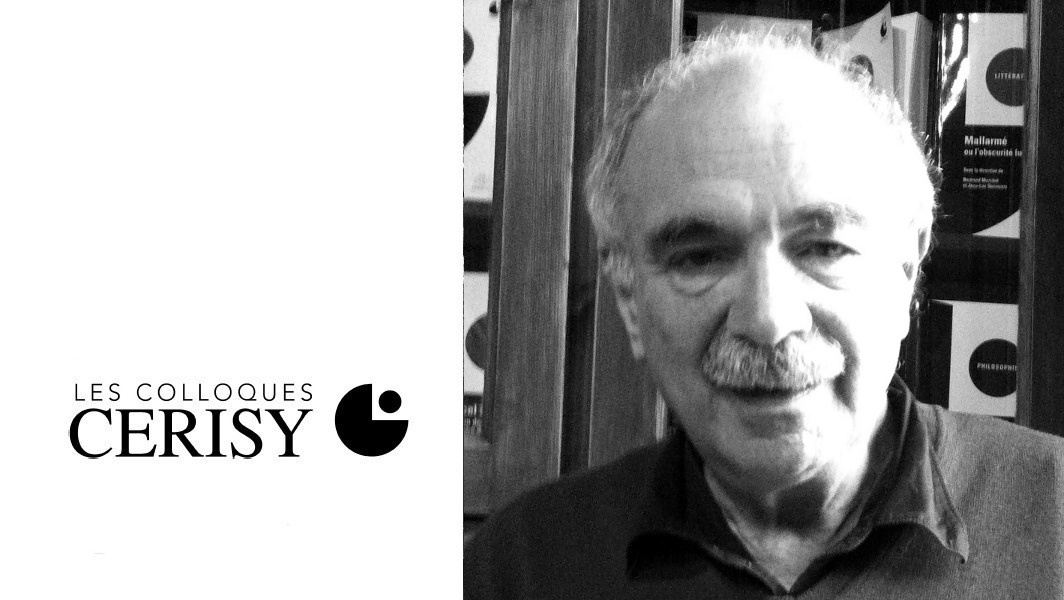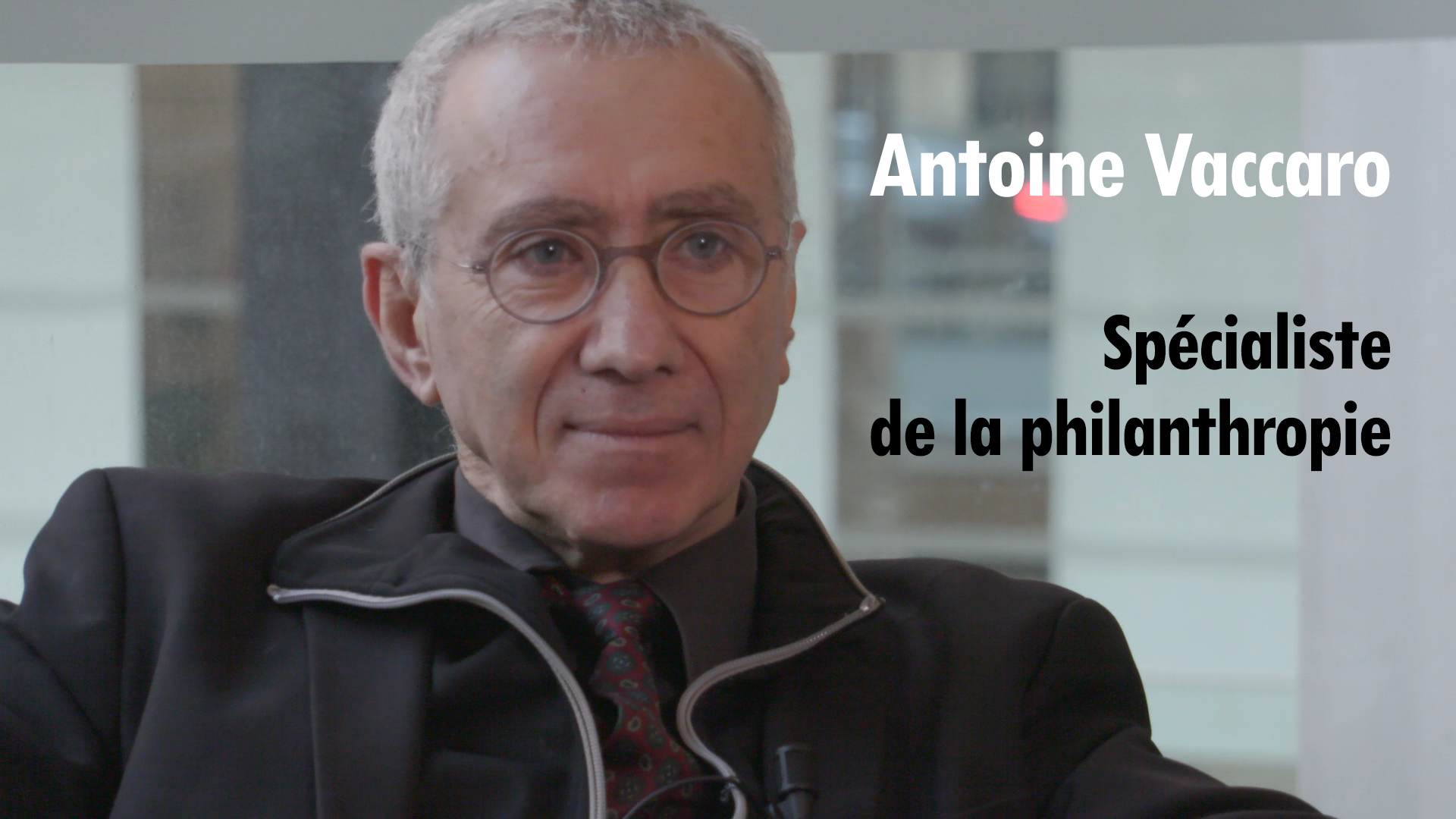Chapitres
Notice
Qu'est ce qu'une maison des sciences de l'homme ? 14h-16h30
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Deuxième partie de la journée d'étude sur "Qu'est-ce qu'une maison des sciences de l'homme ?", organisée à la Maison Suger le 1er février 2023.
Cette deuxième partie comprend :
14h-16h30
Présidence : Maurice Aymard (EHESS, CRH)
« La valse des étiquettes : quelques réflexions sur les manières de grouper et de différencier les "sciences humaines" et les "sciences sociales" dans la France des années 1944-1970 »
Olivier Orain (CNRS, Géographie-Cités, EHGO)
La Maison des sciences de l’homme et la Fondation du même nom ont vu le jour en 1963 à l’issue de nombreuses tractations dont l’histoire est relativement connue depuis les travaux de Brigitte Mazon (1988), Giuliana Gemelli (1995) et Ludovic Tournès (2011). Pourtant, peu d’enquêtes se sont spécifiquement penchées sur les différentes étiquettes (hyperonymiques) qui ont été alors promues, défendues, contestées, etc., et plus largement sur la question des catégorisations qui avaient alors cours. Pourtant, le choix final de « sciences de l’homme » n’était sans doute pas le plus évident, eu égard aux acteurs concernés et aux choix des institutions alors chargées de penser/classer cet ensemble de disciplines et de savoirs. Le propos de cette communication est justement de revenir sur l’ensemble des choix faits dans les politiques scientifiques françaises de l’après-guerre et des débats qui les ont précédés, accompagnés ou suivis. Les années 1944-45 ouvrent justement une période où l’État adopte, pour une vingtaine d’années, le label « sciences humaines » comme cadre global de sa politique de développement et de soutien parcimonieux à ce domaine du savoir, moment d’homogénéisation provisoire lié à un « modernisme » relatif et à une volonté —sans doute — d’œcuménisme (Reubi, 2020). Pour autant, cette politique se fit en dialogue avec des interlocuteurs qui avaient d’autres cadrages : pour les Fondations américaines, les « sciences sociales » étaient bien plus significatives, tandis que certains acteurs français pouvaient parier sur la promesse qu’elles incarnaient, rêve américain ou héritage des années d’entre-deux-guerres. On s’interrogera aussi chemin faisant sur le sens et sur la vocation des hyperonymes, mais aussi et surtout sur leur fluctuation dans le temps et selon les groupes et individus.
« Des projets enchevêtrés ? Les prémices de la MSH et les études sur les "aires culturelles" »
Ioana Popa (CNRS, Institut des Sciences sociales du politique, UMR 7220)
Cette communication entend interroger l’association et les chevauchements partiels – qui ont pu être présentés comme allant de soi – entre deux projets scientifiques et institutionnels : la MSH et les études sur les aires dites « culturelles », telles qu’elles sont institutionnalisées à travers notamment la Division des Aires culturelles de la 6e Section de l’EPHE. L’amorce de ces projets est en effet quasi-simultanée (même si les temporalités de leur mise en œuvre proprement dite sont distinctes). Ils sont par ailleurs portés par des acteurs individuels identiques ou proches, adossés à des dynamiques institutionnelles et à des visées scientifiques qui se veulent convergentes, enfin, ils sont soutenus financièrement par des fondations philanthropiques américaines. Il s’agira cependant d’aller au-delà de ces affinités, en interrogeant aussi les voies distinctes empruntées par ces projets, a fortiori compte tenu de leurs redéfinitions successives et de la configuration plus large d’acteurs impliqués. Certains de ces derniers œuvrent en effet aussi sur le terrain des « aires culturelles », des études sur des espaces étrangers et/ou des relations internationales, à l’instar de l’IEP-la FNSP (et en particulier, du CERI) et des Langues O. La communication interrogera donc à la fois le contenu d’une « symbiose » et les contours d’un espace différencié de producteurs de savoirs sur les aires dites « culturelles », qui sont par ailleurs impliqués dans l’amorce de la MSH.
Plus d'informations sur le site de la FMSH en cliquant ici.
Intervention
Thème
Dans la même collection
-
Qu'est-ce qu'une maison des sciences de l'homme ? - 17h/19h
BruhnsHinnerkCharleChristopheBillaudBaptisteTroisième partie de la journée d'étude sur "Qu'est-ce qu'une maison des sciences de l'homme ?", organisée à la Maison Suger le 1er février 2023
-
Qu'est-ce qu'une maison des sciences de l'homme ? - 9h30/12h30
TournèsLudovicBenestSergeFournierMarcelPremière partie de la journée d'étude sur "Qu'est-ce qu'une maison des sciences de l'homme ?", organisée à la Maison Suger le 1er février 2023
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
Autour de l'oeuvre d'Immanuel Wallerstein - Interviews
WallersteinKatharineCoquery-VidrovitchCatherineVergèsFrançoiseBalibarÉtienneAymardMauriceLe colloque Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale : autour de l’œuvre d'Immanuel Wallerstein qui s'est tenu le 11 et 12 septembre 2023, a donné lieu à
-
Ouverture du colloque Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle global…
AymardMauriceCohenAntoninWallersteinKatharineDans le cadre de ses 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l'homme organise le colloque international "Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale : autour de
-
Table ronde 1 / L'historien et le sociologue : Braudel et Wallerstein
AymardMauriceTable Ronde 1 | Synthèse de l'œuvre d'Immanuel Wallerstein Intervenants : Maurice Aymard, L'historien et le sociologue : Braudel et Wallerstein Modérateur : Thierry Paquot
-
Intervention de Alessandro Martini et Maurice Aymard - Journée d'étude Nuto Revelli 5e partie
MartiniAlessandroAymardMauriceDans le cadre du programme de manifestations à Paris organisé par la Fondation Nuto Revelli à l'occasion du centenaire de Nuto Revelli, la FMSH accueille une journée d'étude autour de Nuto Revelli,
-
Immanuel Wallerstein : comprendre le monde — et le changer
WieviorkaMichelBoyerRobertAymardMauriceHugotYves DavidL’Association des Amis de la FMSH, en partenariat avec la Fondation Maison des sciences de l'homme, a organisé le 26 novembre 2019, une rencontre autour de l’apport d’Immanuel Wallerstein, figure
-
1. Séance inaugurale
AymardMauriceHoullierFrançoisLandyFrédéricSinghArun KumarMarcFrançoisThis Saint-JeanIsabelleVinçonPhilippeQuelle sécurité alimentaire en Inde ? Dilemmes économiques, socio-politiques et environnementaux. Une mise en miroir francilienne. Colloque organisé par l’Association France-Union Indienne
-
Passé, présent
DescolaPhilippeWallersteinImmanuel MauriceAymardMauriceIribarneAlain d'GardenMauriceColloque international PENSER GLOBAL Internationalisation et globalisation des sciences humaines et sociales À l’occasion de son 50e anniversaire, la Fondation Maison des sciences de l’homme invite
-
Produire, éditer, transmettre.
ChengAnneLamourouxChristianAymardMauriceBergeret CurienAnnieCharleChristopheClavienAlainDuan muMeiFourrierNathalie李宏图TertraisHuguesThivolleJean-ClaudeWeiAoyuShenJian"Produire, éditer, transmettre", table ronde autour de l’ouvrage Espaces croisés (Éditions de la Maison des sciences de l'homme), sous la présidence de Duanmu Mei (SCEHF) et Hugues Tertrais (Paris I),
-
Conclusion de Maurice Aymard (président de séance)
AymardMauriceLongtemps stéréotype du sous-développement, l’Inde a désormais fait son entrée dans le peloton de tête des pays émergents. Vieille civilisation, jeune nation qui célèbre le soixantième anniversaire de
-
Changer le monde ?
AymardMauriceLe thème de ce colloque académique euro-chinois, réuni en septembre 2008 dans le cadre des Rendez-vous de Shanghai, a été établi en correspondance avec l’Université d’automne franco-chinoise qui s
-
Autour du livre de Rajmohan GANDHI : "GANDHI, sa véritable histoire"
SemelinJacquesAymardMauriceGandhiRajmohanMarkovitsClaudeNé en 1935, Rajmohan GANDHI a écrit sur le mouvement de l'indépendance de l'Inde, sur les relations Indo-pakistanaises, sur les droits de l'homme et la résolution des conflits. Après un ouvrage sur l
-
Charles Morazé. Un historien engagé
RevelJacquesAymardMauriceChevènementJean-PierreCollombBertrandSirinelliJean-FrançoisRivièreFrançoiseLefrancPierreA l'occasion de la sortie du livre posthume de Charles Morazé, Charles Morazé. Un historien engagé, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme et l’Association France-Union Indienne (AFUI) ont
Sur le même thème
-
Qu'est-ce qu'une maison des sciences de l'homme ? - 17h/19h
BruhnsHinnerkCharleChristopheBillaudBaptisteTroisième partie de la journée d'étude sur "Qu'est-ce qu'une maison des sciences de l'homme ?", organisée à la Maison Suger le 1er février 2023
-
Qu'est-ce qu'une maison des sciences de l'homme ? - 9h30/12h30
TournèsLudovicBenestSergeFournierMarcelPremière partie de la journée d'étude sur "Qu'est-ce qu'une maison des sciences de l'homme ?", organisée à la Maison Suger le 1er février 2023
-
Missions et élites urbaines dans les Andes aux XVIe et XVIIe siècles
Dans le dernier tiers du XVIe siècle, la Couronne espagnole accroît son contrôle sur les territoires américains, au détriment des conquistadors, devenus pour la plupart des encomenderos. C'est
-
Retour au sens — repenser l'universel
Les valeurs universelles sont depuis longtemps critiques et de façon souvent très pertinente; de quelle manière et avec quels outils conceptuels pouvons-nous les reenchanter ?
-
« MIGRATION » OF SCHOLARS AT RISK, WHAT PERSPECTIVES OF COOPERATION FOR THE PHILANTHROPIC SECTOR?
WieviorkaMichelProcoliAngelaLaborierPascaleLohéacLauraWorkshop - 2019 EFC conference The Fondation Maison des sciences de l’homme and the Pause Program organize a discussion on « Migration » of scholars at risk, what perspectives of
-
Antoine Vaccaro, spécialiste de la philanthropie - Interview
VaccaroAntoineAntoine Vaccaro est un spécialiste de la collecte de fonds et de la philanthropie. A l'occasion de la sortie du livre de Fabrice Jaumont "Partenaires inégaux", il répond à nos questions : 1-Que
-
5. Les stratégies de RSE
QuairelFrançoiseDans cette vidéo, Françoise Quairel-Lanoizelée présente la diversité des stratégies de RSE mises en oeuvre au sein des entreprises, en distinguant les stratégies "hors business" des stratégies
-
Mobilité et coopération culturelles européennes
"Regards croisés sur la mobilité artistique et culturelle en Europe" donne à voir la manière dont les structures culturelles et les réseaux investissent cette question. Loin de minimiser les entraves
-
Comment construire sur des sols mous sans fondations ?
CognonJean-MarieQuand il s'agit de construire un ouvrage en Bretagne sur du granit, l'ingénieur n'a pas de problème pour réaliser les fondations. Par contre, s'il veut construire sur du sol mou (de la vase jusqu'à la