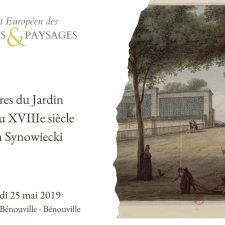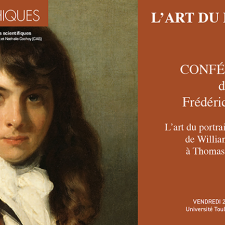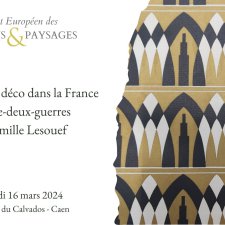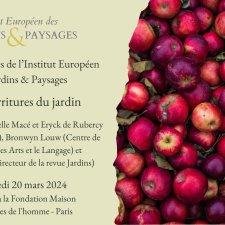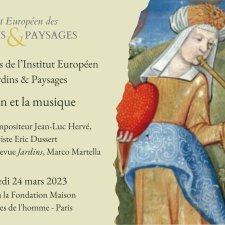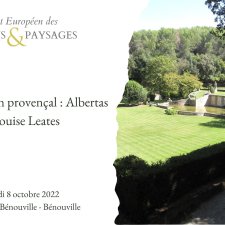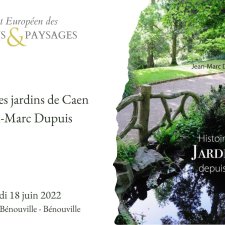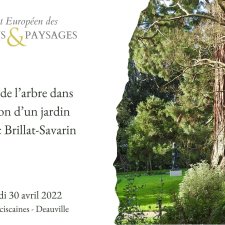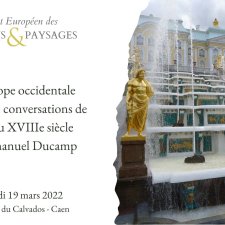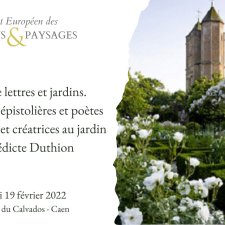Notice
Paris est un jardin. La nature en ville au XVIIIe siècle
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Royaux ou princiers, les jardins de Paris au XVIIIe siècle devaient offrir à la population urbaine des îlots salvateurs face aux exhalaisons et aux miasmes de la ville. Ainsi, loin d’être figés dans un écrin de verdure éternel et de représenter des enclaves champêtres au cœur de la ville, ces espaces étaient fermement insérés dans le tissu urbain. Ils en partageaient les pollutions et les nuisances, tout comme ils dépendaient de réseaux d’approvisionnement en eau et en plantes provenant de la ville et, souvent, d’un arrière-pays qui s’étendait au-delà des limites de Paris. Paris en ses jardins, publié en mai 2021 aux éditions Champ Vallon, propose ainsi une histoire environnementale et une véritable microphysique de la nature parisienne, des dégâts causés par les taupes et les chenilles au bouturage du buis et à l’élagage des arbres.
L’histoire matérielle et vivante des jardins parisiens du XVIIIe siècle permet ainsi de restituer avec le plus de fidélité possible un monde composé de micropartages faisant la part belle aux conflits entre juridictions concurrentes, aux régulations policières ainsi qu’aux tensions entre les différents usages sociaux et publics de ces espaces. Les conflits entre les usages récréatifs des jardins et leur conservation comme espaces naturels dessinent un ensemble d’asymétries que les autorités monarchiques et urbaines s’efforcent de contrôler, sans jamais parvenir à imposer leur marque sans provoquer résistances et contestations.
Ce travail met donc en lumière les processus par lesquels les jardins deviennent des lieux cristallisant les débats sur l’appropriation de l’espace public et l’usage des ressources, impliquant aussi bien le pouvoir que les riverains et les promeneurs. Il insiste enfin sur les différenciations sociales importantes qui régissent l’accès aux jardins, avant que la Révolution française ne consacre définitivement l’utilité publique de ces espaces et leur ouverture indistincte à l’ensemble des citoyens.
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
Sur le même thème
-
L’art du portrait en Angleterre : de William Hogarth à Thomas Lawrence
OgéeFrédéricCochoyNathalieL’école anglaise de peinture apparaît pour la première fois au XVIIIe siècle. Son thème principal est la nature, ce qui explique que depuis cette époque elle s’est spécialisée quasi exclusivement dans
-
Regarder ensemble, être ensemble
RasmiJacopo"Regarder ensemble, être ensemble" Jacobo Rasmi présente son travail sur le cinéma, les moments de réception de ce média, et sur comment devenir un public spécifique ?
-
Jeu de balles
MilliotVirginiePrendre soin des lieux / les lieux qui prennent soin", troisième volet de ce séminaire Sensibilia, est abordé par Virginie Milliot, anthropologue des cultures urbaines, à travers son étude du marché
-
Jardins et Art déco dans la France de l’entre-deux-guerres
LesouefCamilleConférence du 16 mars 2024
-
Les Rencontres de l'Institut Européen des Jardins et Paysages
MartellaMarcoMacéMarielleLouwBronwynRubercyEryck deRencontres du 20 mars 2024
-
Aperçu sur un chef-d’œuvre du Patrimoine Mondial méconnu, les Jardins de Wörlitz
SéguinDanielleConférence du 9 septembre 2023
-
Les Rencontres de l'Institut Européen des Jardins et Paysages
MartellaMarcoHervéJean-LucDussertÉricRencontres du 24 mars 2023
-
-
-
-
De l’Europe occidentale à la Russie : conversations de jardins au XVIIIe siècle
DucampEmmanuelConférence du 19 mars 2022
-
Femmes de lettres et jardins. Romancières, épistolières et poètes comme guides et créatrices au jar…
DuthionBénédicteConférence du 19 février 2022