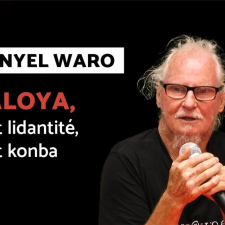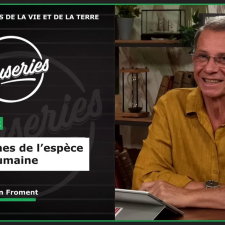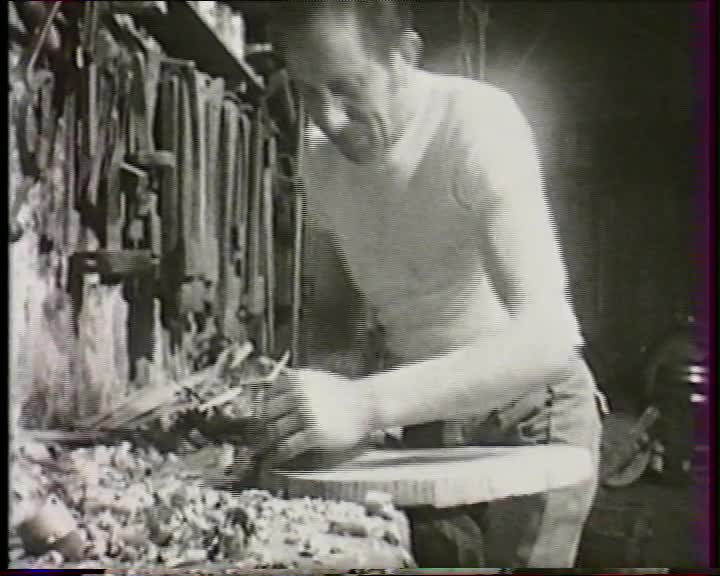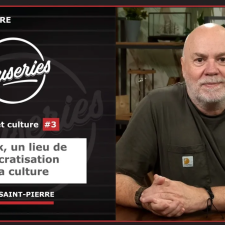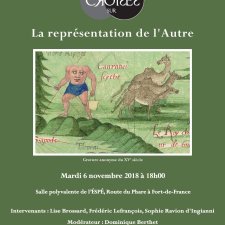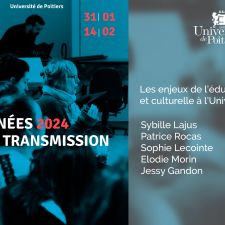Notice
CCIC, Cerisy-la-Salle
La pensée sauvage / des sauvages: enjeux philosophiques et anthropologiques
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Dans un monde dont l'unité et l'homogénéité métaphysique se resserre en permanence, l'anthropologie demeure l'une des rares disciplines intellectuelles prêtes à reconnaître que la "réalité" a été appréhendée à travers des concepts très divers, et peut toujours être prise en charge en des termes différents de ceux qui sont devenus dominants. Cette mise à distance de nos catégories fondamentales était déjà sensible dans la réaction d'un informateur Canaque à l'une des questions de Maurice Leenhardt ("L'esprit? Bah, vous ne nous avez pas apporté l'esprit. Ce que vous nous avez apporté, c'est le corps"), et c'est toujours celle qui est à l'œuvre dans le travail des anthropologues à propos de concepts fondamentaux comme ceux de nature, de culture, de vérité et de liberté.
Et pourtant, en dépit de sa pertinence critique, et y compris lorsqu'elle s'approche des préoccupations de la philosophie en discutant ces notions, l'anthropologie reste à l'écart des discussions qui y sont menées. Ces débats philosophiques se déroulent en effet le plus souvent sans véritablement prendre en considération (y compris après la "déconstruction de la métaphysique occidentale") d'autres formes de pensée, et les effets en retour qu'elles pourraient avoir sur la tradition occidentale, comme si cette dernière se suffisait à elle-même. Que peut-on attendre d'une anthropologie qui s'engagerait dans la production de concepts (post-)philosophiques? Que deviendrait la philosophie en intégrant ces concepts (et donc en cessant d'être entièrement "grecque")? En quoi le dispositif comparatif est-il essentiel à ce projet ?
Ce colloque a rassemblé des anthropologues, des philosophes, comme des chercheurs issus d'autres disciplines comparatives, venus de France, du Royaume-Uni, du Brésil, des Etats-Unis ou d'autres pays, et que ces interrogations animent tous sans qu'ils soient à l'heure actuelle en contact direct.
Présentation de l'intervenant
Philippe Descola, né en 1949 à Paris, a d'abord fait des études de philosophie à l'École normale supérieure de Saint-Cloud avant de se former à l'ethnologie à l'université Paris X et à l'EPHE (VIe section). Chargé de mission par le CNRS, il mène une enquête ethnographique de 1976 à 1979 chez les Jivaros Achuar de l'Amazonie équatorienne dont il étudie plus particulièrement les relations à l'environnement, sujet de la thèse de doctorat d'ethnologie qu'il soutient en 1983 sous la direction de Claude Lévi-Strauss. Après avoir enseigné à l'université de Quito, il est visiting scholar au King's College de Cambridge et attaché de recherche à la Maison des sciences de l'homme, puis rejoint l'École des hautes études en sciences sociales (maître de conférences en 1984, directeur d'études en 1989) où il développe au fil des ans lors de son séminaire hebdomadaire une anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains.
Professeur au Collège de France depuis 2000 dans la chaire d'Anthropologie de la nature, Philippe Descola y dirige depuis cette date le Laboratoire d'anthropologie sociale (UMR 7130, laboratoire mixte du Collège de France, de l'EHESS et du CNRS) tout en conservant une direction d'études à l'EHESS. Il a été professeur invité, parfois à plusieurs reprises, dans les universités de Göteborg, São Paulo, Vienne, Rio de Janeiro, Chicago, Mexico, Buenos Aires, Louvain, Pékin, Montréal, Saint-Pétersbourg, Uppsala et à la London School of Economics et fellow de la Carl Friedrich von Siemens Stiftung de Munich en 2007-2008 ; il a en outre donné des conférences dans une quarantaine d'universités ou académies étrangères, notamment la Beatrice Blackwood Lecture à Oxford, la George Lurcy Lecture à Chicago, la Munro Lecture à Edinburgh, la Radcliffe-Brown Lecture à la British Academy, la Clifford Geertz Memorial Lecture à Princeton, la Jensen Lecture à Francfort et la Victor Goldschmidt Lecture à Heidelberg. Il est président de la Société des Américanistes depuis 2002, a présidé le conseil scientifique de la Fondation Fyssen de 2001 à 2009, et a été membre de nombreux conseils scientifiques.
Thème
Documentation
Actes du colloque
Comparative metaphysics
Pierre Charbonnier, Gildas Salmon, Peter Skafish (dir.)
Rowman & Littlefield International — 2016
ISBN : 978-1-7834-8857-5 (HB)
Sur le même thème
-
Master Classes – Culture - Danyel Waro - « Maloya : nout lidantité, nout konba »
LamraniSalimWaroDanyèlDanyel Waro - « Maloya : nout lidantité, nout konba »
-
L'Homme #1 - La place de l'Homme dans la Nature
Brunet-MalbrancqJoëlleFromentAlainCauseries des Sciences de la Vie et de la Terre - L'Homme #1 - La place de l'Homme dans la Nature
-
L'Homme #2 - Aux origines de l'espèce humaine
Brunet-MalbrancqJoëlleFromentAlainLes Causeries Sciences de la Vie et de la Terre - L'Homme #2 - Aux origines de l'espèce humaine
-
Le Tonnelier
AccollaPatrickGeffroyYannickEnquête ethnographique auprès d'un tonnelier sur la chaîne opératoire de la réalisation de tonneaux, à Ollioules (Var) en 1971
-
Echange des gestes religieux dans le Sud de la Thaïlande : L'espace rituel
HorstmannAlexanderLaboratoire d'Anthropologie et de Sociologie Mémoire Identité et Cognition Sociale , Séminaire 2009-2010 , Anthropologie du Geste.
-
Vent et ville
GoffetteCharlotteCharlotte Goffette, chercheuse en design, anime une matinée consacrée à son travail sur le vent.
-
Le Bisik, un lieu de démocratisation de la culture
Brunet-MalbrancqJoëlleLes Causeries de la Culture - Institutions et culture #3 – Le Bisik, un lieu de démocratisation de la culture - Pascal Saint-Pierre
-
La représentation de l'Autre. Discussions
LefrançoisFrédéricRavion-D'IngianniSophieBerthetDominiqueBrossardLiseEchanges et discussions faisant suite aux interventions de Lise Brossard, Sophie Ravion-D'Ingianni et Frédéric Lefrançois lors de la conférence "La représentations de l'Autre".
-
Rencontre avec Julia Roux
RouxJuliaÉtudiante de la promotion 2022-2024 de la mention "Études sur le genre" de L’École Universitaire de Recherche (E U R) Gender and Sexuality Studies (GSST) (EHESS/INED).
-
Les enjeux de l’éducation artistique et culturelle à l'Université
MorinElodieGandonJessyLajusSybilleRocasPatriceLecointeSophieLes enjeux de l’éducation artistique et culturelle à l'Université
-
Danse(s), transmission, création
JennyClairePichonStéphanieLamotheIsabelleComment transmettre les conditions d'une expérience dansée ? Seront notamment abordés le travail avec les amateur.e.s, et le rapport entre individualisation et création collective.
-
1-5 - Les autres projets collaboratifs de recherche
Cette vidéo présente les projets collaboratifs existants pour la recherche. Principalement financés dans le Pilier 2 d'Horizon Europe, ils couvrent des domaines tels que la culture, la créativité et