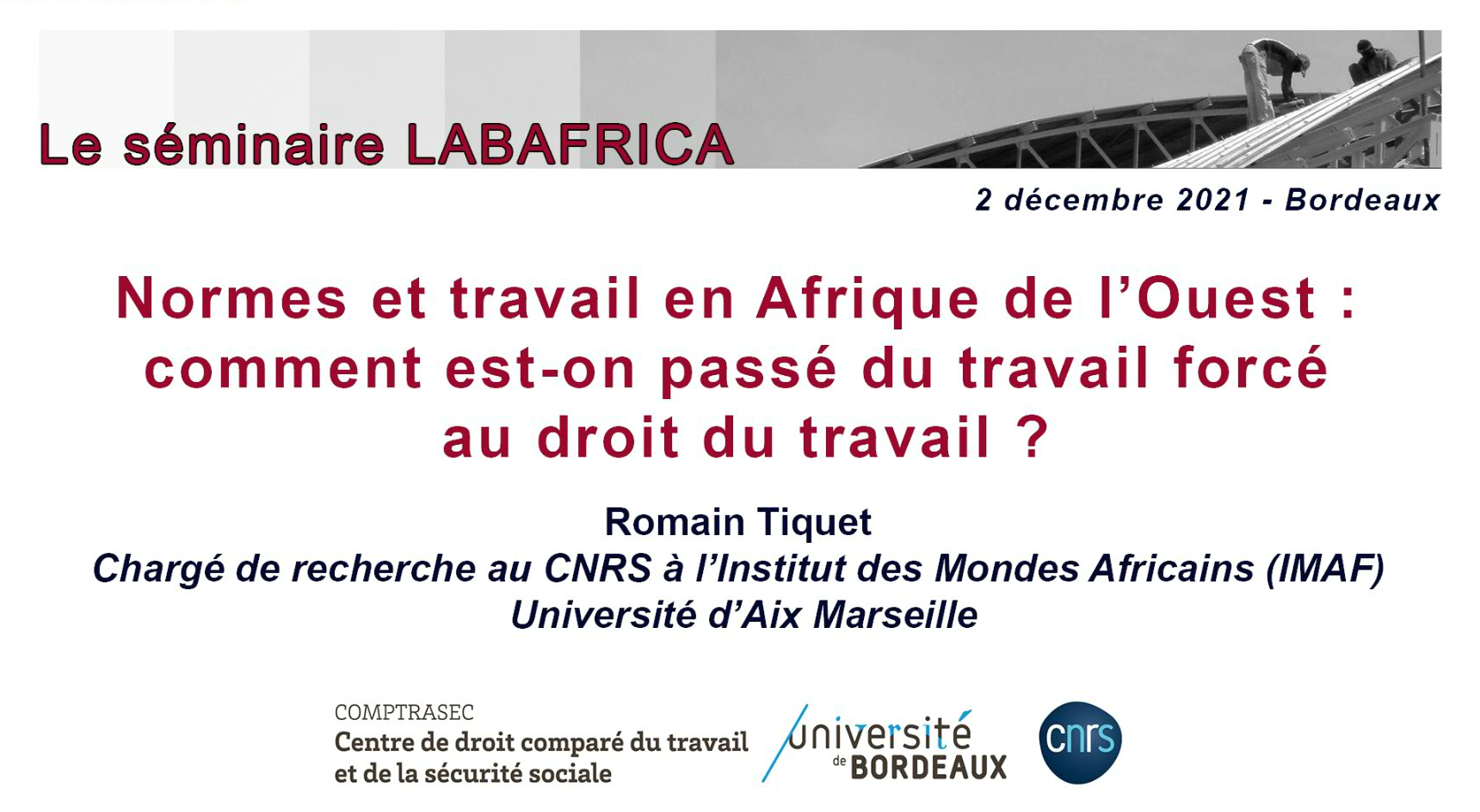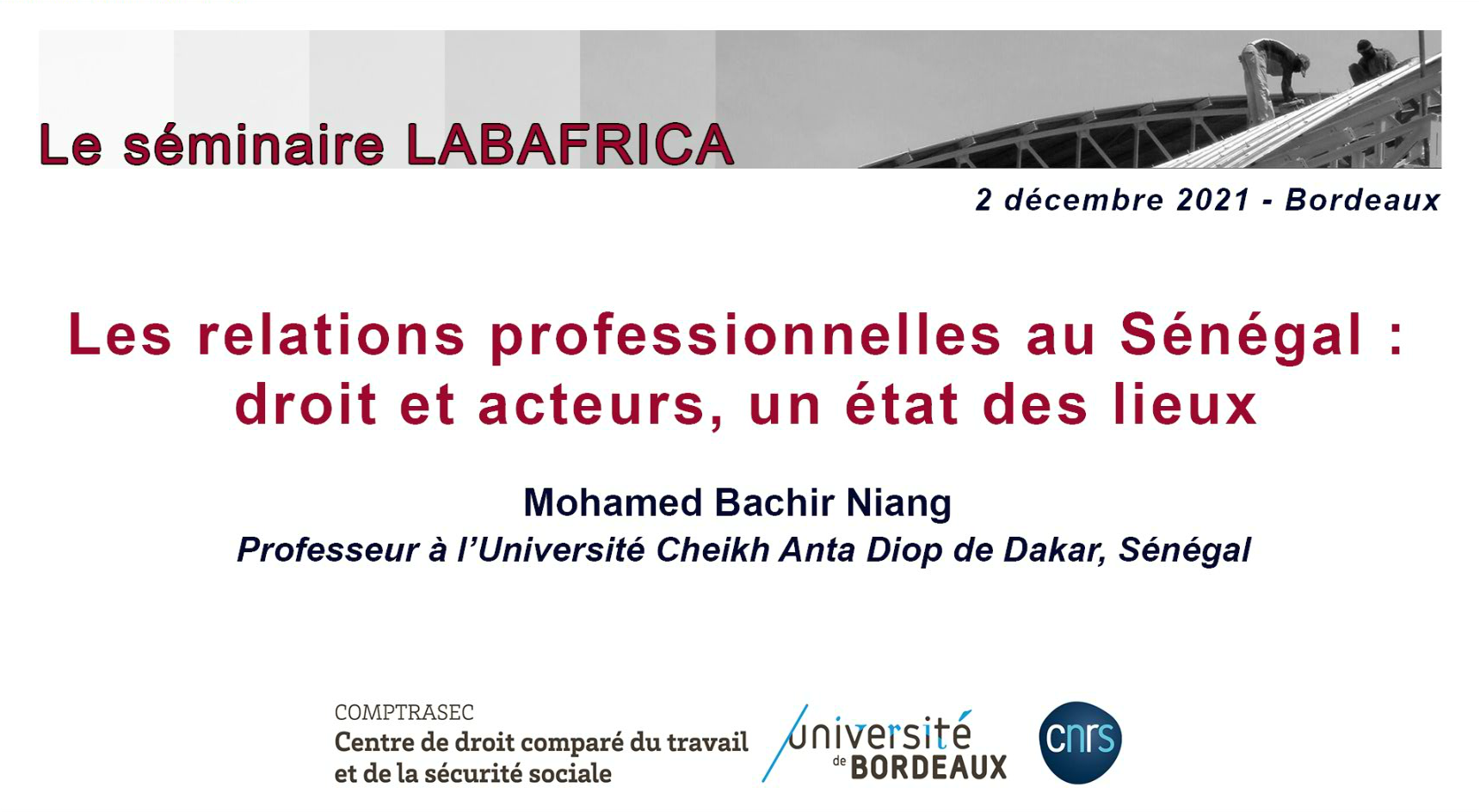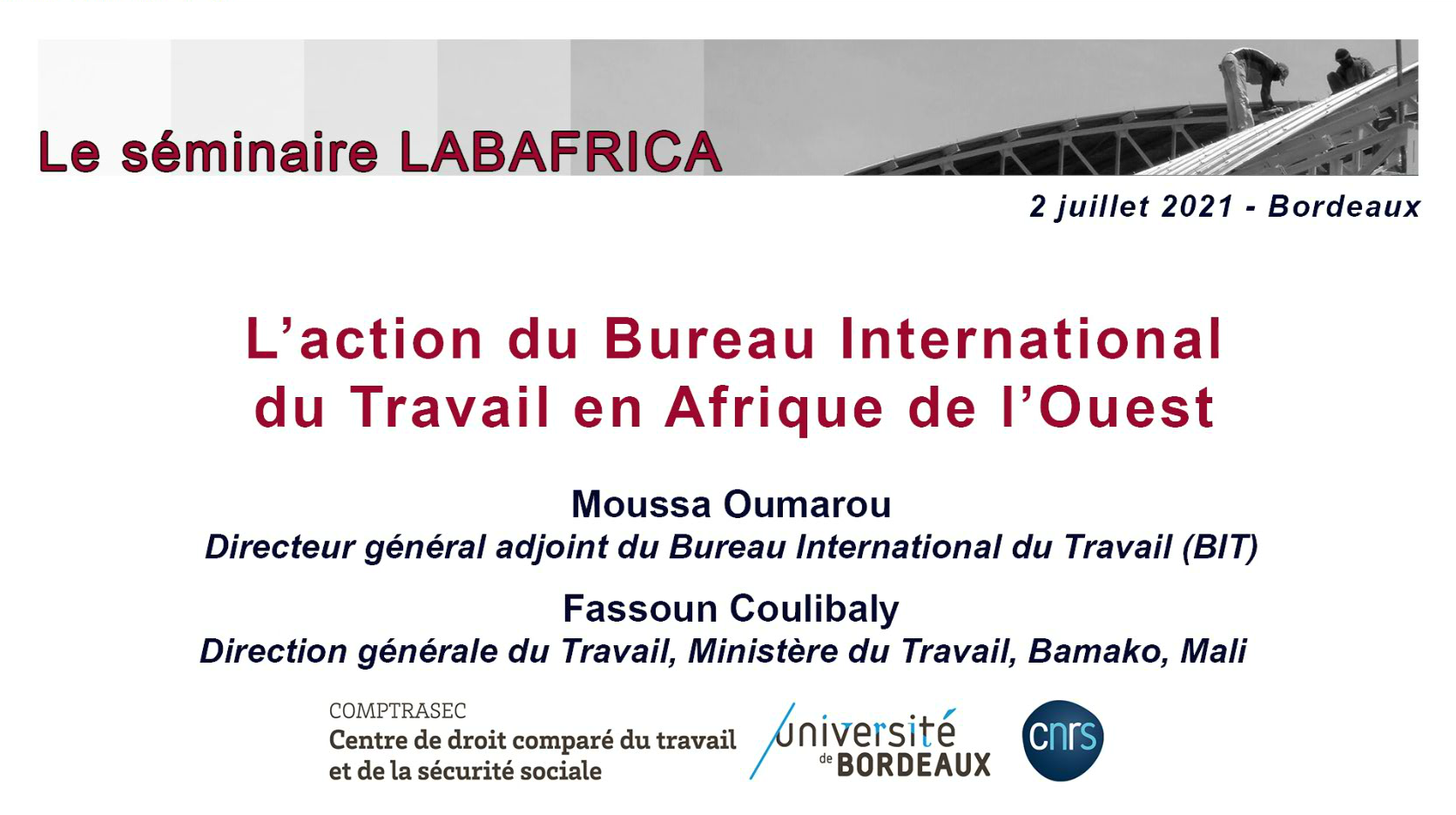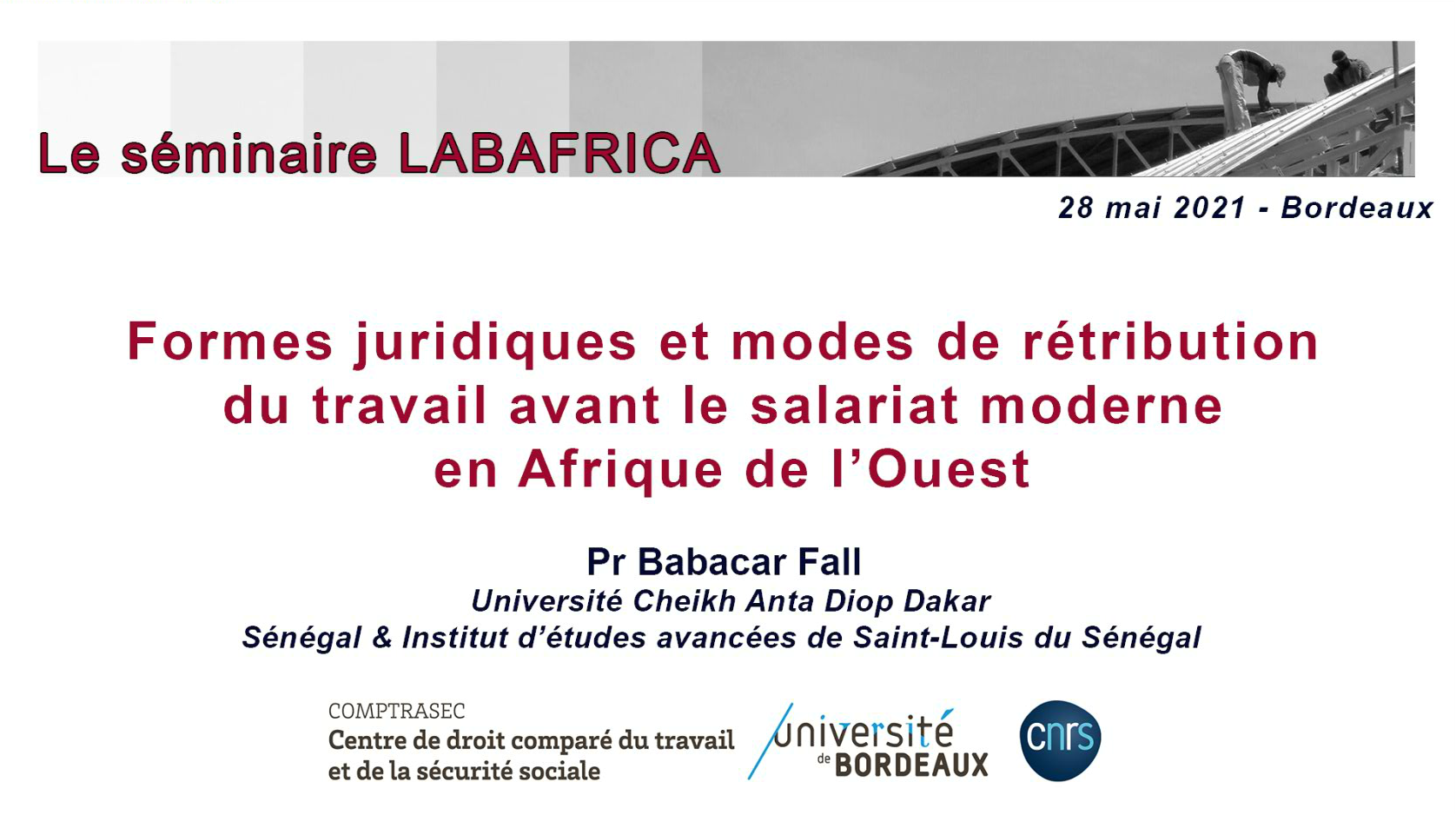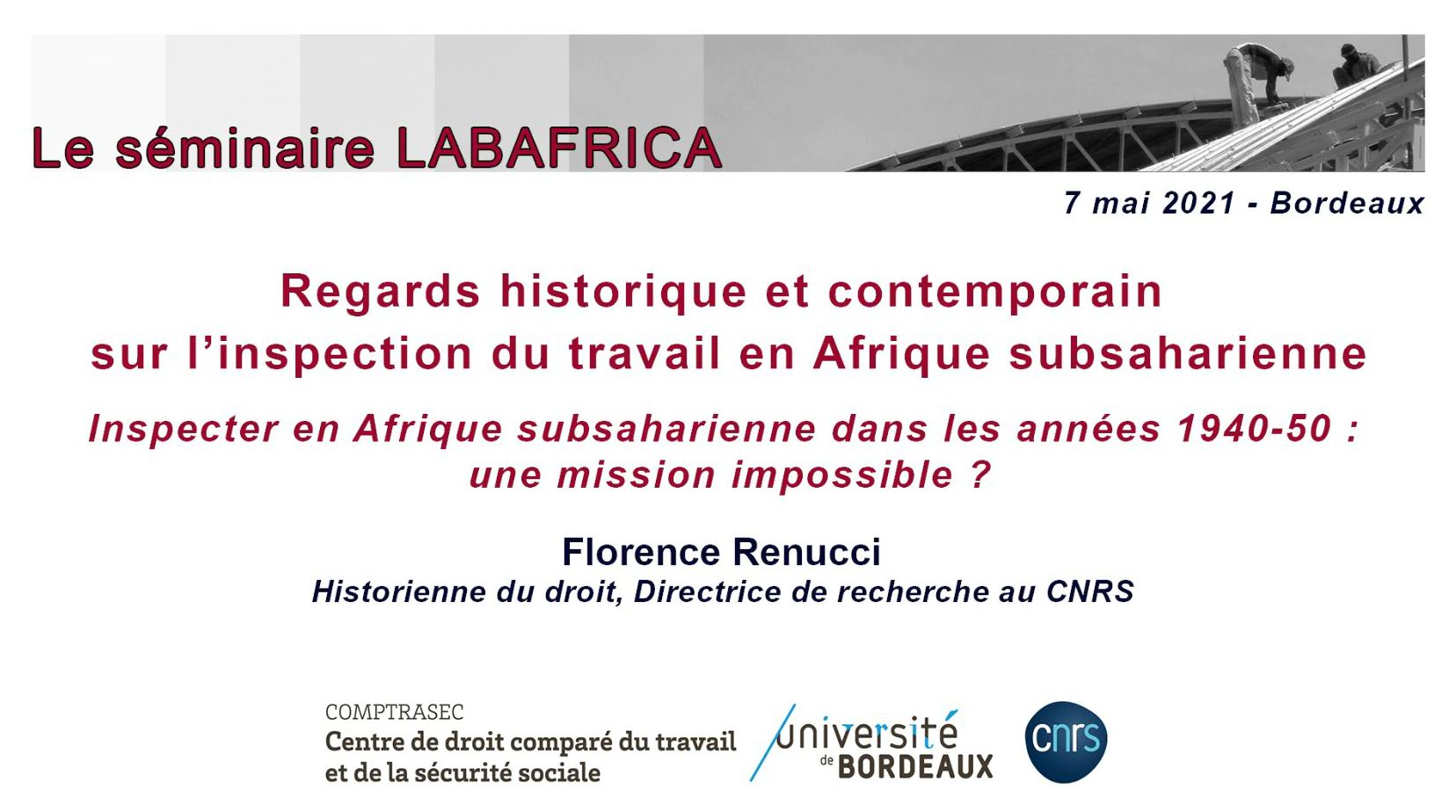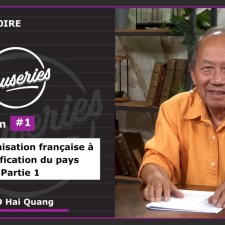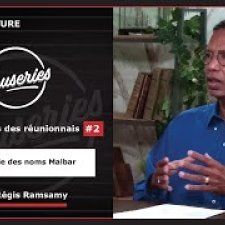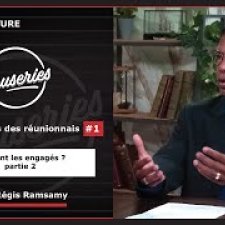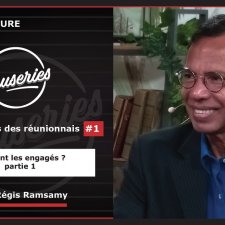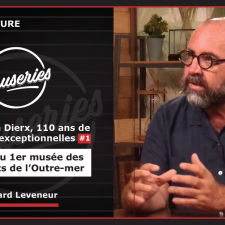Notice
Du travail forcé au travail subordonné : quelle histoire juridique du travail dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne avant le Code du travail d'Outre-mer de 1952 ?
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Une première perspective peut être celle du rapport de l’ethnologie naissante à la question du travail des populations colonisées. En effet, la mise au travail de ces populations a été au cœur de l’entreprise coloniale. Les débuts de la colonisation ont été marqués par la mise en place de l’exploitation de la main-d’œuvre africaine. Les pratiques d’exploitation ont alors pris appui sur un ensemble d’études et d’enquêtes sur les populations. Les populations ont ainsi été catégorisées et classées en fonction de leur appartenance ethnique et de leurs aptitudes à servir le projet colonial.
Une deuxième perspective concerne la mise en place et l’évolution de l’encadrement juridique de l’explication. Comment s’est construite la réglementation du « travail indigène » ? À quels besoins a répondu l’élaboration d’une réglementation du travail spécifique au travail dans les colonies françaises ? Quelles en ont été les sources juridiques, les thèmes ? Plus largement, l’évolution de la législation française répond-t-elle a une évolution plus globale au niveau international de la question du travail dans les colonies, ainsi que semble l’indiquer l’adoption en 1939 de deux conventions de l’OIT sur le travail indigène (C064 sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939 et C065 sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939) ?
Une troisième perspective concerne la production et la mise en œuvre des réglementations coloniales du travail. Quels sont les acteurs déterminants ? Dans quelle mesure le contrôle et la sanction de ces réglementations a-t-elle effectivement pu prendre appui sur l’administration coloniale ? Dans ce contexte, quels ont été les rapports entre administration coloniale centrale (métropolitaine) et administrations coloniales sous-régionales et/ou locales ?
>> Jean-Pierre Le Crom, Historien du droit, Directeur de recherche au CNRS, Université de Nantes
Dans la même collection
-
Domesticité, exploitation économique et maltraitance : cas des travailleuses domestiques à Dakar
Les séminaires LabAfrica
-
-
Normes et travail en Afrique de l’Ouest : comment est-on passé du travail forcé au droit du travail…
Cette communication analyse 2 moments clés de la période d’après-guerre. Dans un premier temps, du 30 janvier au 8 février 1944 se tint la célèbre conférence de Brazzaville qui se positionna certes
-
Les relations professionnelles au Sénégal : droit et acteurs, un état des lieux
Un droit des relations professionnelles encore ancré dans la séparation entre travail subordonné et travail indépendant avec le constat d’une attraction que le salariat exerce toujours sur les
-
Les relations professionnelles en Côte d'Ivoire : un état des lieux
Les relations professionnelles concernent les rapports des organisations de salariés et d’employeurs ou l’employeur et la collectivité de travail au sein de l’entreprise. S’agissant d’un État membre
-
L’action du Bureau international du Travail en Afrique de l’Ouest
1 – La fabrique de l’action du BIT en Afrique de l’Ouest Comment est organisé, structuré le BIT pour traiter des questions concernent les Etats ouest-africains ? Comment se construit, se structure l
-
Informalité et marché du travail, mise à l’épreuve d’une catégorie analytique
« L’informel » (économie informelle, de l’ombre, grise, etc.) est un phénomène prépondérant dans les pays en développement et notamment en Afrique sub-saharienne où elle représente en moyenne près de
-
Formes juridiques et modes de rétribution du travail avant le salariat moderne en Afrique de l'Ouest
Dans un contexte économique marqué par les activités agro-pastorales, les sociétés en Afrique de l’Ouest ont connu diverses formes d’organisation du travail et des modes variés de rétribution qui ont
-
Inspecter en Afrique subsaharienne dans les années 1940-50 : une mission impossible ?
Cette intervention analyse le rôle méconnu et pourtant primordial de l’inspection générale du travail (et des lois sociales) de la France d’Outre-mer en Afrique au sortir de la guerre jusqu’aux années
-
Difficultés récurrentes et enjeux particuliers des services d’inspection du travail des pays membre…
Après avoir tenté d’identifier les caractéristiques communes des services d’inspection du travail des pays francophones de l’UEMOA, on se propose d’identifier quelques possibles réponses à leurs
-
La réception de la catégorie de "travail subordonné" dans les états africains
Cette présentation a été donnée dans le cadre du séminaire mis en place par le groupe de travail LabAfrica, porté par plusieurs centres de recherche bordelais (COMPTRASEC, GRETHA et LAM).
Sur le même thème
-
Colonies spatiales et visions du futur. Vers une société de contrôle ?
JeanninHélèneSéminaires de master 2023 – 2024 – Anthropologie Fondamentale : aux limites de l’humain
-
Le Vietnam, de la colonisation française à la réunion du pays partie 1
LamraniSalimHoHai QuangCauseries de l’Histoire Vietnam 1 partie 1
-
Les Garamantes aux portes de l'Empire romain
SchörleKatiaC’est à la fin du IIIe siècle avant J.-C. que les Romains vont commencer la conquête de l’Afrique du Nord. Les enjeux sont d’assurer la maîtrise du bassin occidental de la Méditerranée et aussi de
-
Les Italiens à Bône (XVIIIe-XXe siècles)
VermerenHugoLa côte est du Maghreb est une zone maritime particulièrement riche en ressources diverses. A côté de la pêche de produits alimentaires s’est développée très tôt une pêche spéculative, la pêche du
-
L’Administration protectorale en Tunisie et au Maroc
PerrierAntoineA la fin XIXe et du début XXe siècles, la France établit un « protectorat » en Tunisie et au Maroc. Ces traités de droit international mettent en place, selon l’objet affiché, une relation quasi «
-
SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE "UNE PRISON POUR MÉMOIRE, MONTLUC DE 1944 À NOS JOURS"
AndréMarcLantieriFrédériqueÀ l'occasion de la parution de Une prison pour mémoire. Montluc, de 1944 à nos jours de Marc André, le 22 septembre dans la collection "Sociétés, espaces, temps" d'ENS Éditions, la Fondation Maison
-
Découvrez l’origine de certains noms de famille réunionnais ! Explications d'un historien
Brunet-MalbrancqJoëlleRamsamyJean-RégisLes Causeries de la culture : Les origines des réunionnais #2 - La galaxie des noms Malbar
-
Quelle différence entre un engagé et un esclave ? Explications d'un historien
Brunet-MalbrancqJoëlleRamsamyJean-RégisLes Causeries de la Culture : Les origines des Réunionnais #1 - Qui sont les engagés ? partie 2
-
On sait enfin quand sont arrivés les premiers travailleurs indiens à La Réunion !
Brunet-MalbrancqJoëlleRamsamyJean-RégisLes Causeries de la culture : Les origines des réunionnais #1 - Qui sont les engagés partie 1
-
Une prison pour mémoire. Montluc, de 1944 à nos jours - Interview de Marc André
AndréMarcInterview de Marc André, dans le cadre de la sortie du livre « Une prison pour mémoire. Montluc, de 1944 à nos jours » publié le 22 septembre 2022.
-
Le musée Léon Dierx et le patrimoine créole 2/4
Brunet-MalbrancqJoëlleLeveneurBernardLes Causeries de la culture : Le Musée Léon Dierx, 110 ans de collections exceptionnelles #2 - Le patrimoine créole
-
Le Musée Léon Dierx, le 1er musée des beaux arts de l’outre mer 1/4
Brunet-MalbrancqJoëlleLeveneurBernardLes Causeries de la culture : Le Musée Léon Dierx, 110 ans de collections exceptionnelles #1 - Histoire du premier musée des beaux-arts de l’outre-mer