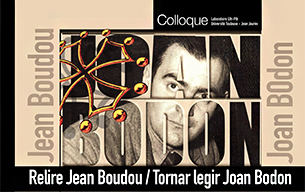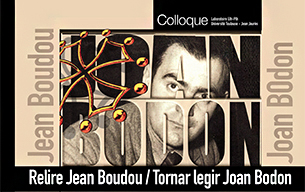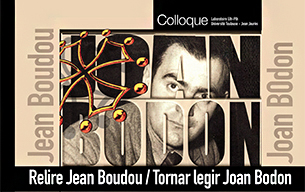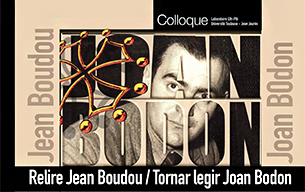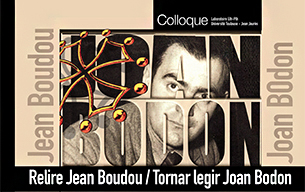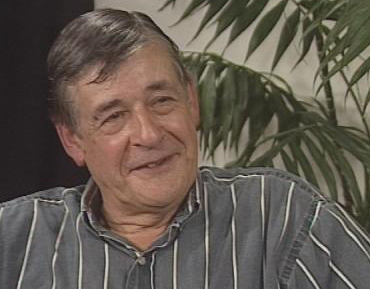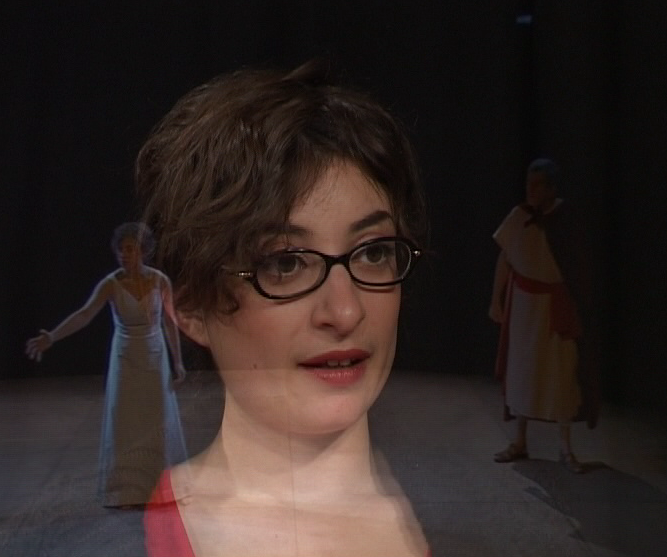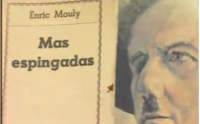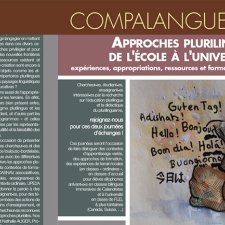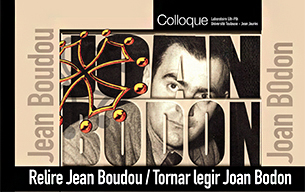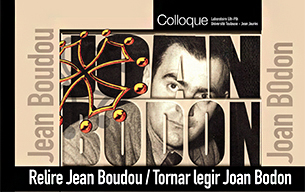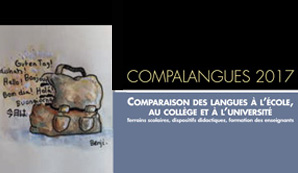Notice
Entretien avec Michel Chadeuil (Michèu Chapduelh)
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
L’œuvre en langue occitane de Michèu Chapduèlh (Michel Chadeuil) est riche d’ouvrages divers en langue occitane toujours teintés de pointes d’ un humour mordant. Ayant été, avec Marcelle Delpastre et Jan dau Melhau, un des fondateurs de la revue « Lo Leberaubre », il est un inclassable poète (Lo còr e las dents, L'Òme, pas mai, L'emplumat), romancier (De temps en temps, La segonda luna, etc…), créateur de chansons (Chançons) et écrivain de chroniques (Colèras) d’études et de textes de fiction profondément influencés par ses recherches ethnographiques (Cuisine paysanne en Périgord, Proverbes limousins, Grizzly John, etc…). Eric Fraj, compositeur et interprète, entraîne Miquèu Chapduelh dans une évocation de son parcours voué à l’écriture.
Interview de Michel Chadeuil par Eric Fraj (Université de Toulouse-Le Mirail, janvier 2009, en présence de l’écrivain Jean Gagnaire) Traduction et transcription : Joëlle Ginestet.
Thème
Documentation
Transcription,Traduction
Entrevista de MICHÈU CHAPDUELH per Eric Fraj
(genièr 2009, en preséncia de Joan Ganhaire)
Eric Fraj – Michèu Chapduèlh, nos coneissèm dempuèi longtemps. Mes, bon, me sembla qu’es malaisit de parlar de qualqu’un e de son òbra sens presentar un pauc son contèxte e doncas me pensi que nos cal parlar un pauc del tiu contèxte : doncas quin es ton monde, d’ont sortisses ?
Michèu Chapduèlh – Vene dau mitan dau bòsc, en plena campanha, lonh de tot, donc d’un mitan occitanofòn dins las annadas cinquanta : sei nascut en 47, dins las annadas 50. Lo mitan èra occitanofòn mai que mai. Auviá mon pair que parlava francés, tot lo mond alentorn que parlavan occitan. Pasmens auviá un reir grand-pair que parlava francés, que sabiá plan parlar lo francés e lo francés ipercorrèct, fòrça academic, a l’imperfach dau subjonctiu, e tot aquò, veiquí.
E. F. – Mes sabiá parlar occitan tanben ?
Michèu Chapduèlh - A ben, sabiá, òc, e finament.
E. F. – Mes ton paire, non.
Michèu Chapduèlh – Compreniá, mas òc, parlava pas, lo chantava.
E. F. – Perqué lo parlava pas ?
Michèu Chapduèlh – O, perque aviá una istòria personala mai complicada : èra ben lemosin d’origina, mas aviá viscut en zòna sentongesa e aviá perdut en cors de rota.
E.F. – A ! d’acòrdi, d’acòrdi. Doncas es un mitan del campèstre, aquò te marquèt ?
Michèu Chapduèlh – A, ben segur ! E demòre enquera dins la maison onte sei nascut.
E.F. - …que se sòna « Le Vaure ».
Michèu Chapduèlh – Non, « Lo Clauselon ».
E.F. – « Lo Clauselon » ?
Michèu Chapduèlh – A, « Lo Vaure » perque li seis vengut ! Es pas aquela, non es una autra.
E.F. – …es una autra.
Michèu Chapduèlh – Òc.
E.F. – D’acòrdi, bon. Donc ès peiregòrd. E èi legit que parlas e escrives le parlar del país de Peireguèrs e de Brantòsme. Es aquò ?
Michèu Chapduèlh - Òc.
E.F.- Es un jos-dialècte lemosin.
Michèu Chapduèlh - E ben òc. Exactament.
E.F.- Doncas…
Michèu Chapduèlh - Es complicat de far comprene au monde de chaz n’autres que quò es lo lemosin perque disen « n’autres, sèm pas lemosins, sèm peiregòrds, donc parlam peiregòrd ». En realitat lo Peiregòrd, i a lo Peiregòrd lengadocian e lo Peiregòrd lemosin. N’autres sèm pas lemosins, mas sèm de parlar lemosin.
E.F.- D’acòrdi e, bon, parlas - l’ausissèm - , escrives, aquò ba sabèm dempuèi longtemps, e parlas sovent en public, ès estat professor, de còps conferencièr, sustot contaire, e escrives doncas dempuèi longtemps de poèmas, de novèlas, de romans, de cançons, de cronicas de tota mena, de còps de cronicas encoleridas. Escrives tanben d’estudis, per exemple suls mimologismes, sul chin, es a dire sul can, sul gos - en lemosin -, sus la cosina, sus l’ortalha e le biais de la conservar, sus la formacion dels mots. Alavetz, Michèu… Bon, que te sabi encara… Alavètz, Michèu…
Michèu Chapduèlh - … suls provèrbis…
E.F.- Òc, suls provèrbis, coma dins ton darrièr libre en çò de Christine Bonneton a Paris, es aquò ?Doncas, èi enveja de te demandar… Òc, perque quitament... quitament ès tanben un onirograf : es a dire qu’as escrit tos raives, coma disètz en lemosin, tos sòmis e, amès, as la tissa de les publicar. Sufís pas de les escriure, les cal publicar. E doncas bon, ès un òme multifacetic, prolific, e me sembla que desiras èsser a l’encòp l’indigèna que viu, que crèa, e l’etnològ o l’etnograf que l’estúdia. Me sembla que siás, o : ès, a l’encòp l’indian en via de desaparicion e le Levis Strauss. Es vertat aquò ?
Michèu Chapduèlh - Manca que Levis Strauss aviá dich que se podiá far d’etnografia, de l’etnologia nonmàs en defòra, mes i a qualqu’un que a segut aquela dralha abans io, quò es Delpastre que a fach l’etnografia de son país, de sa familha e que l’a fach çò vertadierament coma auriá pogut la far un observator estrangièr que se seriá botat dedins, mas a l’encòp observator estrangièr, mas pasmens present… enfin per çò que nosautres…, lo mond que fan de l’etnologia, de l’etnografia dins l’exagòn, van far aquò en Africa, en America del sud e tot aquò. Qui va far de l’etnografia en cò nòstre ? I a pas fòrça mond per lo far. Partèm dau principi que tot çò qu’es interessant es alhors. Ai agut lo plaser un còp de rencontrar un etnològ malgach que veniá far de l’etnografia en Peiregòrd.
E.F. – Òc, bon, mas çò que voliái dire tanben es que, bon, parlas, contas, escrives de tot, òm pòt dire, o quasiment de tot, benlèu pas de matematicas, mes qui sap, un jorn vendrà benlèu ! Es que as pas una set, una fam de dire tot, es qu’as pas aquela tissa de voler dire tot e, si es vertat, si as tu aquesta talent, aquesta fam, d’ont ven aquel voler, aquel desir d’abraçar tot, de dire tot ?
Michèu Chapduèlh – Lo sabe pas ! Qu’ei coma de minjar, de beure, de pissar… Qu’es parièr.
E.F. – Doncas, es quicòm de vital per tu d’escriure…
Michèu Chapduèlh – Òc, i a l’expression personala, lo roman, la poësia, la chançon, qu’es l’expression personala, e lo demai quò es l’expression dau mitan d’onte sei nascut, çò que queu mitan a a dire. I a mon expression a io e sei tanben lo que pòrta la paraula de sa tribú.
E.F. – Doncas finalament tas expressions son complementàrias, qué ?
Michèu Chapduèlh – Me sembla.
E.F. – Tu, ès totjorn en ligam ambe çò que t’enròda, ambe ton país, ta cultura.
Michèu Chapduèlh – Lo país e la lenga que son pas de separar.
E.F. – Finalament, ès a l’encòp subjectiu mes collectiu, individual, mes pas individualista qué ?
Michèu Chapduèlh – Exactament.
E.F. – Bon.
Michèu Chapduèlh – Pas individualista, non.
E.F. – Bon.
Michèu Chapduèlh – Fau partida de la collectivitat…
E.F. – Òc.
Michèu Chapduèlh – Que a pas la paraula, donc que coma io tene la paraula, sei lo pòrta- paraula de quela collectivitat qu’es de mai en mai redusida, malurosament.
E.F. – Alavetz, bon, comencères per escriure de poèmas, si me trompi pas…
Michèu Chapduèlh – Coma tot lo monde.
E.F. – Òc. E le primièr poemari fosquèt editat en 1968.
Michèu Chapduèlh – Òc, lo primièr poèma fuguèt…
E.F. – « Lo Còr e las Dents ».
Michèu Chapduèlh – Los primièrs poèmas en revista foguèron publicats en 62 o 3, quauque ren atau. E lo prumièr escrit en occitan, lo primièr escrit en francés, simbolicament benlèu, sabi pas, e !, aviá 7 ans quand ai començat d’escriure de la poësia en francés e en occitan. Un jorn ai escrit 2 poèmas en francés, 2 poèmas en occitan. E, a partir de queu jorn, ai contunhat d’escriure de mens en mens en francés, de mai en mai en occitan.
E.F. – Alavetz, bon, en 1970 se publica le tieu poëmari que s’apelha « L’Òme pas mai », puèi en 1971 « L’Emplumat », e tornèri legir aquò per aquesta entrevista, tot aquò, e sabi - n’avèm parlat dejà, mes bon - mas sabi que dins aquelis poëmas de joïnessa, se pòt dire, i a un cèrt militantisme, coma se ditz, militantisme qu’es le rebat de l’epòca, una epòca de reivindicacions, de cambiaments, bon. Aquò se pòt pas denegar, per exemple, « L’Emplumat » s’acaba sul vèrs : « Los tractors an barrat l’estrada dau solelh » : un vèrs, un poèma que cantèt lo nòstre amic Joan-Pau Verdier.
Michèu Chapduèlh – Un vèrs que fuguèt marcat sovent a la pintura negra un pauc pertot dins la campanha d’en cò nòstre amb ma signatura debàs : çò que fa que la polícia de temps en temps veniá me demandar… e disiái « Non ! es simplament una citacion, i pòde res. »
E.F. – Alavetz, ça que la, ieu me sembla, que dejà dins aquelis poëmaris militants occitanistas de la debuta…, me sembla, e me vas dire çò que ne pensas, i a dejà l’anóncia de çò que serà l’òbra ulteriora. Me sembla que i a dejà implicitament de tèmas que vendràn ulteriorament, que seràn aprigondits ulteriorament, benlèu una votz dejà… Per exemple, vau legir qualques vèrses tirats del recuèlh « L’Emplumat », d’un poèma que se sona « Dire ». Es tu que dises aquò :
Aimarai coma un còp èra
O n’aimarai pus jamai
E sens regret me’n irai
Me far aubre, me far tèrra.
E dins un autre poèma que se ditz « Lo grand planh de la loba » :
E pasmens demòra la votz.
Vint còps l’an boirada a l’auratge
Creda sa fam per las sasons,
Creda chada nuèch per l’aubratge
Lo gèst que trebla sa rason.
A tots, los òmes, los enfants,
Ne’n a mai dich que los jornaus
E a las dròllas de l’ostau
Mai que las letras d’un amant.
Alavetz, lo país se morís, les joves se’n van a París : es çò que se disiá a l’epòca. Mes dins tos poèmas demòra la votz de la loba. La loba, es pas aquí dejà la votz de la natura que punteja e qu’anóncia quicòm d’ulterior ? La votz d’un autre monde irracional que nos parla encara e que ditz de causas e… Le poèma o ditz :
Ne’n a mai dich que los jornaus
E a las dròllas de l’ostau
Mai que las letras d’un amant.
Alavetz, qué ditz ? Qué disiá dejà aquesta loba ?
Michèu Chapduèlh – La primièra citacion m’interèssa mai. La loba, d’acòrdi, es simbolica mas…
E.F. – Simbolica de qué ?
Michèu Chapduèlh - …de tornar un pauc en arrièr dins… la natura ; èra tornar en arrièr, perque la poësia, la lenga occitana, quand sei arribat aquí dedins, èra una natura d’opereta que se trobava dedins. Donc prene la poësia militanta, èra se demarcar d’aqueu mond que fasián de l’opereta de convencion, « les clichés sur la ruralité », tot aquò donc. E io lor disiái de tornar mai en arrièr, per tornar trobar la veritat de la natura. E lo prumièr poèma donc, « Se far aubre, se far tèrra » : un còp, èra a Limòtge, i aviá un chantaire occitan qu’es mòrt auvan, que s’apelava Dòstramont, que chantava queu tèxte que per lo presentar a dich : « se far aubre, se far tèrra », qu’ei una vielha expression lemosina plan coneguda per dire « morir ». E io pensave, onestament, aver creat quela idèa de « se far aubre e se far tèrra », io li vesiái pas una mòrt, mas li vesiái una metamorfòsa, una assimilacion, l’aubre, la tèrra, l’eau, me tornar a l’umús, pas vertadièrament morir. E donc me sei dich : « mas io coneissiái pas quela expression e pasmens l’ai emplejada ». A partir de queu moment me sei dich, ai benlèu quauque res dins la memòria qu’ei mai fòrt que io, qu’ei la memòria collectiva, qu’ei per quò que me disen pòrte-paraula de tota una tribú, perque ai una memòria que vai mai lonh que ma memòria. Efectivament, ai un frair, demandèt a ma mair : « quò se ditz se far aubre, se far tèrra » ? Li a dich : « òc, quò vòu dire ‘morir’ ».
E.F. – Es extraordinari. Vòl dire qu’es una mòrt qu’es pas una fin. Es una mòrt qu’es le començament de quicòm mai, d’autra causa.
Michèu Chapduèlh – Quò qu’ei pas de la metempsicòsi, e !
E.F. – Non, mes bon, es un novèl cicle que debuta, que comença.
Michèu Chapduèlh – Alara, çò que òm pòt pensar aquí, es que a d’un moment ai rencontrat de monde qu’avián una idèa un pauc semblabla. Òc, lo coneissiái pas quand ai escrich queu tèxte, aviái pas enquera rencontrat Marcèla Delpastre que començava unicament d’escriure en occitan a queu moment, aviá escrich d’abòrd de la poësia en francés, e Joan Dau Melhau, qu’ai rencontrat aprèp, que son dau monde que avián parièra memòria e qu’avián un lengatge, un messatge quasiment identic a dire, qu’avèm… avèm pas format una escòla mas nos sèm apercebuts que èrem mai que cosins.
E.F. – Dins la revista Leberaubre, disètz que finalament avètz causit una mena de tresena via : es a dire, pas le trobar clus, pas coma disiás totara la literatura d’opereta, de folclòre, mas le fantastic, l’animisme, le paganisme… E disètz qu’aquò es mès pròche de l’anma lemosina.
Michèu Chapduèlh – Òc, èra pas… una proclamacion a la creacion d’una escòla, èra quauque res que veniam de constatar en nos legir los uns los autres, los tres en question. E de veire que n’i aviá d’autres qui avián un pauc parièra sensibilitat… Bon, Lo Leberaubre, quò fuguèt segur Melhau, Delpastre e io, mas n’i a quauques autres que son alentorn : per exemple, un grafista : Jean-Marc Simeonin, un autre poèta : Joan Claudi Rollet…
E.F. – Òc…
Michèu Chapduèlh – …mai distanciat, benlèu, mas que a parièra sentida.
E.F. – Mes, doncas, vos sètz botats a l’unisson de l’anma lemosina… Es a dire qu’avètz aculhit quauque res, quicòm, qu’èra dejà sus plaça mes que s’ausissiá pas mès. E finalament avètz ausida aquesta votz coma dins le poèma : « E pasmens demòra la votz »… Es aquò, finalament.
Michèu Chapduèlh – Òc, la votz de la loba, la lebe…
E.F. – Es a dire qu’avètz pas creat, enfin avètz creat, mes en vos metent, en vos botant, a l’escota…
Michèu Chapduèlh – Òc, es aquò. Es a dire qu’avèm agut l’intencion, la pretencion, lo desei, o simplament quò s’ei fach espontanèament, de far una literatura modèrna en desfugir quela literatura artificiala de « clichés » que li aviá avant. Enfin, que n’a de valor de tota faiçon : quand lo monde escrivon a la pala coma fasián, i a totjorn un chap d’òbra au mitan. M’enfin, nosautres pensàvem far una literatura modèrna mas que seriá vertadièrament una literatura dau país, que seriá pas unicament lemosina per la lenga mas tanben pel contengut. E donc per quò, faliá gratar lo « cliché » de la literatura precedenta e aquò nos menava a tornar lonh en arrièr dins los mites, dins los contes popularis, dins las cresenças, dins las expressions, dins tot çò que lo monde disián e vivián mas que los autres, los autors d’avant, nos disián pas.
E.F. – Mes, es aquò que m’interèssa, es… e qu’interèssa le mond que vos aprecian, es a dire que, finalament, sètz a l’escota de quicòm que – coma as dit, coma acabas de dire - le monde pensavan, cresián, vivián, es a dire que aquel mond fantastic… - perque, bon, ton òbra es marcada pel fantastic - es pas un monde de farlabica, es l’amna lemosina per vosautres.
Michèu Chapduèlh – Òc, lo fantastic es un biais d’expression, lo fantastic es pas un genre, coma dins lo cinemà american, per far paur. Lo fantastic es una expression e dins lo fantastic se pòt tot dire, e se pòt dire completament liberat.
E.F. – Alavetz i a Todorov, Tzvetan Todorov, que ditz que per el le fantastic es, enfin…, i sèm, arriba unicament quand sèm dins l’esitacion, le trantòlhament, dins l’incertitud, quand sabèm pas si sèm dins le monde de las leis naturalas o dins un monde de leis subrenaturalas. Per el doncas le fantastic consistís a-n’aquel temps d’incertitud e si causissètz…, si causissèm – perdon -, ditz Todorov, una responsa o una autra, daissam çò fantastic per dintrar dins çò estranh o çò meravelhós. E qué ne pensas tu ?
Michèu Chapduèlh – La diferéncia essenciala entre lo fantastic e lo meravilhós : lo meravelhós, degun va i creire. D’afars de princessa e de bergièrs, l’òrra bèstia que se muda en prince, e tot aquò, degun vai i creire d’aquò. Lo fantastic, efectivament, es quauque ren que se pòt creire : sèm entre dos. Sèm a nos demandar s’es possible o pas possible.
E.F. – Doncas, es l’ambigüitat.
Michèu Chapduèlh – L’ambigüitat, òc.
E.F. – Òc.
Michèu Chapduèlh – Mas lo fantastic es finalament… un biais populari de parlar de metafisica tanben : çò que nos despassa es lo fantastic.
E.F. – Mes per vosautres, la còla de la revista Lo Leberaubre, familha e aligats coma se ditz, le fantastic es pas sonca un pretèxte literari, es pas aquò quand disètz que sètz a l’escota de l’èime lemosin ? Ieu vesi que i a, efectivament, i a mès qu’aquò, i a tota una metafisica, i a una faiçon d’abordar le monde, de sentir le monde e aqueste monde que le fantastic ne duèrb la pòrta, existís o pas ?
Michèu Chapduèlh – A ben, fau demorar dins l’incertitud, e !
E.F. – Òc.
Michèu Chapduèlh – Es a dire, bon, la figura emblematica per nos es lo leberon, l’òme-lop, mas i a dau mond que van dire : « mas l’ai jamai rencontrat ! ». Benlèu si, benlèu si, mas benlèu es defòra, benlèu es exteriorizat, mas si es pas exteriorizat, de tota faiçon es aquí, es present, l’avèm en nos.
E.F. – Òc.
Michèu Chapduèlh – Sèm tots un pauc leberon.
E.F. – Òc.
Michèu Chapduèlh – Los uns mai que los autres.
E.F. – Òc.
Michèu Chapduèlh – Donc, Lo Leberaubre, i a fòrça monde que son abonats e que sabon pas çò que vòu dire « lo leberaubre ». Es un mot-valisa entre lo leberon que ten au còp de l’òme e de la bèstia, e l’aubre es lo vegetau. E Marcèla Delpastre me faguèt remarcar que mancava la pèira, es a dire lo minerau per far… lo pancosmic, qué…
E.F. – A, òc!
Michèu Chapduèlh – Auriá fach un mot-valisa un pauc tròp long, podiá pas téner sus una cobèrta tan estrecha.
E.F. – Doncas finalament, lo pancosmic, coma dises, es aquò l’èime. Enfin, es a-n’aquò que crei l’èime lemosin ?
Michèu Chapduèlh – Òc.
E.F. – E es que correspond finalament al rapòrt de l’òme, enfin de l’uman lemosin, a la natura ?
Michèu Chapduèlh – Òc, lo que vertadièrament a aqueu sentit. Mas, bon, es coma per la lenga, i a de mai…, i a de mens en mens de monde per parlar aquela lenga e per aver aqueu sentit. E i a la semblança sovent, es a dire, çò que tornèm trobar, es çò que i aviá abans lo crestianisme. Lo crestianisme en Lemosin, en Lemosin Naut, dins lo país de Melhau e de Marcèla Delpastre, sembla talament present que degun pòt pas i creire. Per exemple, quand vesèm las ostentacions en Lemosin, òm se ditz qu’es pas possible o quand vesèm lo nom de comunas que son Sent « quauque ren » en Dordonha, es pas possible, n’i a tròp, n’i a tròp, lo mond ne fasián tròp. Qu’èra mai que mai decoratiu. E quand gratèm un pauc, vesèm que lo biais de viure lo crestianisme èra pas exactament ortodòx. Es a dire que lo mond dins lo crestianisme contunhavan de viure lo paganisme e l’animisme.
E.F. – A, d’acòrdi, òc.
Michèu Chapduèlh – Per exemple, los sents son los intercessors, mas lo culte daus sents es mai viu que lo culte tot cort, es a dire que… en francés, se ditz « Il vaut mieux s’adresser au bon Dieu qu’à ses saints », non, pas en Lemosin… Los intercessors an mai de poder que Dieu. Dieu, sabem pas tròp çò qu’es. Mas los sents si, per çò que d’aver lo culte daus sents que perdura, qu’ei contunhar de viure lo politeisme primitiu.
E.F. – Òc, es çò que cercavas finalament – aquel rapòrt a la natura, al monde – es çò que cercavas dins la poësia ? Sens o saber ?
Michèu Chapduèlh – Non, sabe pas. Enfin, aquò m’arriba sovent de dire (es pas una colhonada, quand lo mond me disen : « perqué escrives ? ») : « Simplament, escrive », dise, « escrive per me tornar legir per saber çò que pense ». Es a dire que l’escritura bota au nivèu dau conscient çò qu’es inconscient avant. E, efectivament, quand comence d’escriure quauque ren, bon, pas per un expausat sus la lenga o un afar coma aquò, mas de la creacion literària, aquí sabe pas en començar tot çò que va i aver. Ai un plan : per exemple, se es un conte, ai la trama, mas tot çò que i a dedins ven en escriure. Me tòrne legir aprèp per veire çò que ai trobat : çò que ai tornat far montar de mon inconscient o subconscient, inconscient, pensi donc, l’inconscient per io seriá quauque ren coma la memòria collectiva.
E.F. – Doncas, seriás puslèu del costat de Jung que del costat de Freud.
Michèu Chapduèlh – Òc.
E.F. – D’acòrdi, bon. Aquò’s una responsa neta. Doncas parlèm justament d’aquò. L’inconscient, fa pensar al sòmi, entr’autras causas, al raive, coma disètz en lemosin. E doncas quina es l’importància del raive ? Perqué escrives tos raives e les publicas ?
Michèu Chapduèlh – Qu’es plan curiós per çò que, aquí, me dise que quí, l’esperit es completament desliurat de tot çò que a après. Mas non, es pas exactament aquò, mas raive çò que ausariái pas d’escríver. E torne legir per veire çò que ai escrich. E los raives an quò d’extraordinari : si me lève pas per escriure mon raive, l’endeman matin, coma tot lo mond, me’n sovene pas mai. Mas curiosament quand torne legir las nòtas qu’ai presas, es exactament coma si èra lo tèxte d’un autre. Me sovene pas que l’ai escrich, me sovene pas que l’ai raivat. Quitament la prumièra publicacion que n’ai fach quand ai tot sasit sus l’ordinator, tot èra una novèla descobèrta, aviái l’impression de sasir lo tèxte d’un autre. Quauque temps aprèp l’impremeire me tòrna las espròvas per las correccions e me sei dich : « mas es pas possible, es pas io qu’ai escrit aquò ! ».
E.F. – Plan interessant. E i a encara aquesta idèia de dobla vida, finalament : i a çò que sèm oficialament, çò que sèm conscientament, e puèi sembla qu’i aja una autra realitat pus inconscienta, pus prigonda.
Michèu Chapduèlh – E alara aquel afar de raive a plan interessat los lectors, los que m’an tornat escriure : ai agut mai de letras per quò que per tot los autres libres, pasmens una publicacion teunha. Enfin, n’i a un autre bocin que va sortir lèu dins la setmana aquí benlèu. I a fòrça monde que m’an escrich : prumièrament qu’aimarián escriure tanben lors raives, mas que i arriban pas. E n’i a que se son estonats per çò que dins mos raives tròben pas çò que esperavan. Per exemple, n’i a que m’an dich : « mas coma se fai que ajas pas mai de raives premonitòris ? ». Aquí respondrai que benlèu n’i a, mas los sabe pas deschifrar. E n’i a d’autres que m’an dich : « perqué i a pas mai…, qu’es pas possible, deves te censurar, perqué i a pas mai d’expression de la sexualitat ? ». Aquí pòde respondre « benlèu, perque sei mai del costat de Jung que de Freud ».
E.F. – O benlèu perque es una question de deschiframent tanben ?
Michèu Chapduèlh – Tanben.
E.F. – La sexualitat es pas totjorn clara ni genitala tanpauc.
Michèu Chapduèlh – Efectivament.
E.F. – Mes son rapòrt ambe’l mite. Perque tanben t’interèssas fòrça al mite. Es quicòm que metètz en avant. Es que le raive a quicòm a véser ambe’l mite ?
Michèu Chapduèlh – Ai pas enquera trobat la solucion. Ai agut de raives mitics e un que me’n sovene per çò que aqueu es extraordinari, que a quauque ren de mitic. E pasmens es un raive que m’es demorat en memòria, lo mai vièlh, e que dins ma consciéncia l’ai pas pogut contar sul moment perque sabiái pas parlar.
E.F. – A bon ?
Michèu Chapduèlh – Donc es un raive que… mon mai vièlh sovenir, un sovenir davant ma presa de paraula, èra un raive que me’n sovene e que l’ai pas oblidat. Èra quauqu’un que teniá un chavau per la còrda e a d’un moment lo chavau peta la còrda e s’envòla ende las alas coma aquò e !, dins l’èr. Èra vertadierament un raive mitic. Bon, d’onte veniá ? D’onte veniá ? Io ai pas… Escotave parlar lo monde segur, mas io sabiá pas enquera parlar.
E.F. – Doncas finalament per tu le…, cossí dire, l’uman es una mena de « medium », de passatge, un pauc coma le poèta o l’escriveire qu’es a l’escota de Lemosin, qu’es a l’escota de la natura, enfin de la prigondor d’un mond que vòl pas crebar, qu’es a l’escota del mite, es a dire, coma disiás abans, de la memòria collectiva…
Michèu Chapduèlh – Collectiva òc, e un biais d’entrar dins l’universalitat, per çò que vesèm qu’a l’encontrari de çò que disián lo mond de d’avant n’autres qu’avián collectat « Les contes de… », « Les jolis contes de notre province », e tot aquò, non !, los contes son de pertot. Los mites se van tornar trobar benlèu un pauc diferents mas, vertadièrament, los mites que avèm, d’autres los an e son quasiment identics. I a una civilizacion diferenta, i a una geografia diferenta, i a de diferenças dins lo mite, mas lo mite, las estructuras dels contes, tot aquò qu’es universal. Anèm pas parlar d’« un conte dau Lemosin », si, « mon conte dau Lemosin », perque io soi dau Lemosin, contaire dau Lemosin, mas queu conte, las idèas que pòrta, son dins la tèrra entièra e benlèu dins l’univèrs, se i a dau monde sus una autra planeta.
E.F. – Compreni. Doncas tu, pensas que l’òme, aquò existís, es pas solament una vision de l’esperit. I a un òme universal ? I a un uman universal ?
Michèu Chapduèlh – I a un uman universal mas en mème temps queu òme es pas desseparat de sa mair que viu. Es a dire que l’ensemble de tot çò que viu es unic tanben. I a un òme unic dins lo monde, mas fai partida d’una vita unica que ten tota vita.
E.F. – Es a dire que, aquesta unicitat de l’òme, aquesta universalitat se manifèsta totjorn dins la particularitat d’un lòc, d’una cultura…
Michèu Chapduèlh – Evidentament, e dins la lenga locala. Pòu pas s’exprimir dins una lenga que degun coneitriá. E mai tard, ai descubèrt de tèxtes que, fin finala, èran quasiment identics a çò que nosautres disiam. Èran los tèxtes d’indians d’America. Quan parlèm daus escrits, pas los escrits perque es pas eu que zo a escrit mes, siá de Chief Seattle, siá de Sitting Bull tanben, avián quauque ren de comun amb nosautres.
E.F. – Aquò’s le vielh fons de l’umanitat finalament.
Michèu Chapduèlh – E ben òc.
E.F. – Es l’umanitat primièra. E finalament ton idèia – enfin… es pas sonque la tia mes… - es que… aquesta umanitat primièra, per delà las apariéncias, contunha.
Michèu Chapduèlh – Contunha, mas se refusa sovent.
E.F. – Se refusa ? Contunha dificilament alavetz ?
Michèu Chapduèlh – Contunha dificilament, òc ben. Mas lo mond acceptan pas… l’acceptan pas aqueu vielh fons d’umanitat. Acceptan pas d’aver… que lo cervèu se siá format en sègre lo millenari e abans l’umanitat ! I a lo cervèu reptilian, i a…, e tot aquò part d’aquí e mai benlèu d’avant. E lo mond accepten pas quò, voldrián que lo cervèu siá fach de la velha per èsser bien dins la nòrma actuala.
E.F. – Mentre que vosautres, le monde que sètz del Leberaubre, vos metètz, vos botatz dins la durada. Podètz pas fèr autrament, finalament. La vòstra logica es una logica… Venèm de parlar d’umanitat primièra que contunha dificilament mes que ça que la contunha, doncas la vòstra logica es una logica de durada, es pas… Pòt pas èsser quicòm de la mòda, del jorn, de l’aire del temps ?
Michèu Chapduèlh – Òc, io dise sovent « aurai viscut la meitat d’una eternitat, au mens ». Aprèp sabe pas. Mas ai viscut la meitat d’una eternitat, qu’es a dire lo monde dempuèi qu’a començat e benlèu quand èra lo caòs, pas lo moment de la creacion, mas abans, e que s’arrestarà a ma mòrt. E enquera ne soi pas segur, donc ai, dins ma memòria, la meitat d’una eternitat.
E.F. – Parlèm un pauc d’aquò. Arrestèm-nos un pauc sus aquò, si vòls plan, perque justament te voliái interrogar sul rapòrt al temps. Es que me cal dire « rapòrt al temps » o « rapòrt a l’eternitat », perque es benlèu pas la meteissa causa ? E… Marçaudon, per exemple (es lo personatge de ton libre « De temps en temps »), mes es tanben, se tròba dins lo monde de « La segonda luna » ; donc, Marçaudon viatja pel temps, mes es que viatja pel temps o es que sortís del temps ? E viatja tanben per las òbras del Michèu Chapduèlh… Aquò m’a fòrça interessat, aquesta continuitat d’un libre tieu a un autre. Doncas Marcaudon, finalament, es lo simbòl de…, cossí dire ?, d’una vida umana fòra del temps, non ?
Michèu Chapduèlh – Bon, es una òbra quasiment d’adolescéncia : i a un moment qu’aquò dura. Per io, -mas l’autor es totjorn despassat per çò qu’escriu-, per io, a-n’aqueu moment, èra simplament quauqu’un que voliá trobar un ideau, que lo vesiá pas dins lo present. Arribava pas a se lançar devèrs l’avenidor per veire si l’ideau se podiá realizar dins lo futur e que pensava que l’ideau èra darrièr e anava visitar tot aquò. Donc simbolicament, marchar en arrièr, es a dire en recular dins lo temps, per tornar trobar son ideau dins lo passat. E jamai lo trobava e lo tròba pas o en defòra dau temps. Mas lo lector, qu’es un pauc mai conscient que eu – perque es un òme…a un sentit mas intellectualiza pas tròp – lo lector deu comprene que a mancat son ideau, que l’aviá aquí present a costat de eu e que l’a pas saubut reconéisser. Donc aquò’s exactament una òbra d’adolescença. Mas, après, lo monde m’an explicat que i aviá mai qu’aquò. Mas accèpti aquela fòrma de critica, aquí : de dire « as botat dins ton libre quauque ren que z’as pas comprés, tu, e que lo mond… ». N’i a que m’an explicat çò que i aviá dins mon libre. Io quand ai tornat legir après, ai tornat descubert d’afars qu’ère pas conscient d’i botar quand l’ai escrit.
E.F. – D’acòrdi mas, bon, insisti, perque som un pauc obsessional coma diriá le psicanalista, mes bon… Marçaudon, finalament, sortís del temps, non ?
Michèu Chapduèlh – Òc, mes bon… Sès mai fòrt en filosofia tu que io, e la question es quò que lo temps passa. Nosautres, que passèm…
E.F. – Es que passa ?
Michèu Chapduèlh – Me sembla pas.
E.F. – Es aquò que, finalament, se legís dins ton òbra, me sembla, coma dins las revistas, dins d’autres tèxtes, d’autres autors dins Leberaubre ? Es que, finalament, i a benlèu la vida de la mobilitat e, puèi, sembla que i aja l’autra vida de l’immobilitat ? Aquel vièlh fons d’umanitat sembla que bolègue pas, que se remene pas.
Michèu Chapduèlh – Si, avançava, avançava d’un pas d’òme. Auvan, avancèm d’un pas de T.G.V., se òm pòt dire « un pas de T.G.V. »…
E.F. - Mes, benlèu per esclairar un pauc mès las causas, i a le temps cronologic, le temps de la sciéncia, i a le temps subjectiu, enfin, e tanben le temps sociau. Mes… bon, me dises que finalament dins ton òbra, i a lo temps pr’aquò, ça que la, malgrat tot, mes quin temps es, es le temps del mite ? Es un temps lent, es aquò ?
Michèu Chapduèlh – Òc, lent, segur, mas que passa pas, mai que lent, es immobil benlèu. Me sembla, soi pas tròp fòrt io, ai pas una granda cultura scientifica, mas me sembla que i a de scientifics que son quasiment a nos far la pròva que nosautres aviam rason e que lo temps es immobil. Que sèm a veire lo passat de la tèrra actualament dins la galaxia. Donc es ben un biais scientific de far pauc a pauc la pròva que lo temps passa pas. Lo temps passa pas, es en expansion coma l’univèrs, mas passa pas.
E.F. – E es que seriás d’acòrdi per dire que…
Michèu Chapduèlh – Mas nosautres, passèm.
E.F. – Nosautres passam, òc. Es que seriás d’acòrdi per dire que, finalament, es una maquina anticartesiana, tota aquela òbra ?
Michèu Chapduèlh – E… au sens que lo monde dona a cartesian.
E.F. – Perque ai legit…
Michèu Chapduèlh – Ai pas pro legit Descartes per dire si sei anticartesian. O sabe pas. Mas soi segur que Descartes èra mens cartesian que los cartesianistas.
E.F. – Òc, es sovent aquò, le mèstre sovent, es… es mens, cossí dire ?, mens aisit, mens simplàs, que çò que dison les epigònes. Mes bon, es que ça que la dins qualques tèxtes tieus que teorizan, perque teorizas tanben… Ai legit que çò qu’escrives, çò que pensas, çò qu’escrivetz, çò que pensatz – te meti pas al despart de la còla que formatz – es ça que la una remesa en causa de çò qu’apelam, dins l’Occident, la racionalitat. Mes si pensam al mite…
Michèu Chapduèlh – Mas la racionalitat es benlèu pas racionala.
E.F. – Òc, es aquò. Si pensam al mite, es que le mite es pas una autra fòrma de racionalitat ?
Michèu Chapduèlh – Possible.
E.F. – Es que, vòli dire…, es que i a pas una logica ?
Michèu Chapduèlh – Possible. Ma logica personalament, veses, se m’arriba quauque ren que pòde dire fantastic, aquò arriba a tot lo monde, quand ne parlam aprèp sopar, lo monde te dison d’afars extraordinaris que lor son arribats, qu’an viscut. Mas si an « l’esperit cartesian » coma disián, entre verguetas, e !, sabi pas tròp, te van dire : « Bon, es lo azard ». Ben, io dise que los racionalistas son de monde d’una granda inocença. I a pas quauque ren que siá mens clar, mens racionau, que lo azard. Finalament, lo mite, e lo fantastic, per io es mai racionau que de dire : « quò es lo azard qu’es causa de tot aquò ».
E.F. – Perque le mite, e le fantastic, es un biais de donar un sens e de racionalizar de causas que les cartesians de cada jorn tròban sens cap de sens finalament ?
Michèu Chapduèlh – Òc, lo mite balha un sens. Qu’es çò qu’ai gardat de mas originas paisanas. Es a dire que lo paisan coma l’ai conegut enquera dins las annadas 50, es quauqu’un que voliá donar un sens a tot, tot çò que fasiá, lo mendre gèste de la… de la jornada. Dins son trabalh, dins sas activitats, èra…, aviá un sens dirèct, aquí, mes en mème temps un sens metaforic terrible. Preniá una valor de leiçon per l’umanitat. E podiá anar enquera mai lonh qu’aquò, podiá devenir metafisic, cosmic e tot çò que voletz.
E.F. – Les gèstes de l’uman, mes tanben çò que se passava dins la natura, èra pas jamès un còp d’azard, èra totjorn un signe…
Michèu Chapduèlh – … totjorn besonh de legir. Tot es signe… Tot es signe, vòu pas dire que tot es presatge. Èran pas l’augure que fai rire, mas tot a una significacion. A nosautres de la saber legir. Benlèu nos anèm enganar, en la legir, mas enfin tot a una sens. Donc lo raive a un sens e escriure lo raive es un biais de trobar dau sens. Mas quauque res, sai pas io : quauque res que deuriá pas tombar e que tomba, qu’es pas un presatge exactament – qu’es lo monde supersticiós que disen « es un presatge » -, mas tot aquò a un sens, quauque res que vai contra la lei de la fisica, qu’es un signe, quò a un sens.
E.F. – Finalament, si i a un mal modèrne seriá, me diràs çò que ne pensas, seriá benlèu que l’uman actual sap pas pus legir les signes que son al sieu entorn ?
Michèu Chapduèlh – Òc, çò que fai que per fòrça monde auvan, l’existéncia a pas de significacion. A una significacion superficiala, per exemple : arrestar lo trabalh pro tòst per anar veire la telé mai lèu, o ben ganhar de sòus a la fin dau mes. Mas tot aquò balha pas una significacion a l’existéncia.
E.F. – E es qué se pòt envisatjar un uman que siá pas en contacte, en comunicacion ambe la tèrra, ambe la natura, amb aqueste monde que contunha de nos parlar, quitament si li respondèm pas ? Un uman « hors sol », es qu’es possible ?
Michèu Chapduèlh – Òc, segur. Sabes que n’i a fòrça.
E.F. – Mes, es que es encara un uman per tu ?
Michèu Chapduèlh – A !, aquí la question se pausa. Ai pensat un temps que çò que se pòt trobar benlèu dins L’Emplumat, un poëma que… « Betum », que l’ai dich sovent en seradas – fasiái de slam abans que quò siá de mòda –, dins « Betum », donc, disiái que l’òme es un tren de venir una maquina. En realitat, en avisar çò que se passa actualament, sei benlèu un pauc mens desesperat mas un pauc mai inquièt tot parièr per çò que, vertadièrament, sembla pas que l’òme siá a venir una maquina e… Seriá mai que mai a tornar un animau en tota l’agressivitat, lo biais de se… d’anar contra l’autre, de voler èsser victoriós de l’autre, coma si deviá tuar son vesin per se noirir un còp de mai…
E.F. – A òc, òc, una mena d’antropofagia, que… e te voliái…
Michèu Chapduèlh – … mas d’antropofagia pas clanica, pas rituala. Una antropofagia qu’es un suicidi perque una comunitat que practica l’antropofagia per se noirir es una comunitat fotuda. Pòt pas contunhar de viure. Lo darrièr que demorarà se vai engolar…
E.F. – Amin Maalouf, un escriveire francés d’origina libanesa, ditz a prepaus de l’identitat umana, ditz : avèm pas de rasics perque, les umans, sèm pas d’arbres. Qué’n pensas, tu ?
Michèu Chapduèlh – Me sembla qu’ai daus sovenirs dau temps qu’ère aubre, sei pas mai aubre, non, mas…
E.F. – A, te’n sovenes ?
Michèu Chapduèlh – Me’n sovene, òc.
E.F. – Es una polida, polida responsa. Bon, e te voliái parlar tanben de l’amor e de la femna dins ton òbra perque som estat marcat per las paginas fòrtas que dedicas a l’amor e a la femna. Ai notat aquesta diferéncia que fas, aquesta distincion prigonda, a mon vejaire, que fas entre la copulacion, finalament, e l’acte sexual d’amor, e… e sovent dises, i a un adjectiu que torna, es l’adjectiu « mecanic », « mecanica ». Doncas i a la sexualitat mecanica e puèi i a la sexualitat de l’amor, i a la carnalitat amorosa e, es que me’n pòdes, nos en pòdes dire qualques mots d’aquò ?
Michèu Chapduèlh – Aquí dirai… Aime tant dire aquí de tornar legir çò qu’ai escrit aquí dessús, que data un pauc de tota faiçon. Ai agut besonh d’escriure aquí dessús a d’unes moments de ma vita per èsser segur, coma disiá l’autre còp, de çò qu’èra dins mon idèia, de çò que pensave per de bon. E… « mecanic », bon. Avem tornat veire, i a pas longtemps, a la television, lo film de…, sus Casanova.
E.F. – Òc.
Michèu Chapduèlh – Casanova, es segur, es una mecanica.
E.F. – D’acòrdi.
Michèu Chapduèlh – Quitament pas una bèstia, perque una bèstia…
E.F. – O fa per besonh.
Michèu Chapduèlh – Òc. Non, es una mecanica. E a pas lo temps de conéisser deguna de sas conquistas. A pas lo temps de saber quala èra.
E.F. – Bon, nos cal acabar Michèu. Le monde me fan signe, doncas…
Michèu Chapduèlh – Aurem oblidat quauque res de terrible…
E.F. – Aurem totjorn oblidat quicòm e benlèu es melhor atal…
Michèu Chapduèlh – Non, mas i a quauque res que n’am pas parlat per çò que lo monde que son a nos escotar aquí se van dire : « E ben, son òbra deu pas èsser…, quò deu far pensar, te prene la tèsta, te prene lo cap end’aquò.
E.F. – Non, avèm pas parlat de l’umor, mes a t’ausir, en t’escotant, le monde an comprés que i a fòrça umor dins ton òbra e i a tanben çò que fas, i a tanben ton « actualitat », coma se ditz ara. E ton actualitat es benlèu etnografica, « actualament » ?
Michèu Chapduèlh – E mai i a tanben l’actualitat politica. Lo monde que an legit Colèra o que sèguen la publicacion de ma Colèra, la cronica colerica coma disiái au començament, saben que l’umor es plan important. L’umor es çò que, es lo... – coma disiá l’autre, l’autre, sabi pas lo quau, perque l’an prestat a mai d’un – « la politesse du désespoir ». Bon, avèm besonh de l’umor, mas aquí tanben quauque res que se pèrd, me sembla.
E.F. – E tu aimas plan cachar fòrt e ont fa mal. E aquò es sanitós.
Michèu Chapduèlh – E aime plan l’umor qu’es pas tròp cartesian, coma disiam l’autre còp.
E.F. – E ben, m’estona pas. Es logic !
Michèu Chapduèlh – Aime plan la derision e tanben l’autoderision.
E.F. – Bon, ben…
Michèu Chapduèlh – Avèm besonh de marcar una distància coma aquò, per pas dire au monde : « vesètz coma ai una granda pensada », e tot aquò… N’avèm besonh de l’umor e pense que avèm parlat de Jan dau Melhau e de Marcèla Delpastre, e dau monde que ne mancavan pas. E los que an conegut Marcèla Delpastre, per exemple, çò que lor demòra lo mai, es son rire.
E.F. – Bon ben, escota, me demòra pas pus qu’a remandar tot aquel monde, les auditors e les que nos gaitan tanben, a-n’aquelas òbras de Marcèla Delpastre, de Jan dau Melhau e de tu. Mercés Michèu, e a un autre còp !
Michèu Chapduèlh – A un autre còp. E vau notar aquò, e !
Transcription : Joëlle Ginestet
,Interview de Michel Chadeuil par Eric Fraj
(Université de Toulouse-Le Mirail, janvier 2009, en présence de l’écrivain Jean Gagnaire)
Eric Fraj – Michel Chadeuil, nous nous connaissons depuis longtemps. Mais, bon, il me semble qu’il est difficile de parler de quelqu’un et de son œuvre sans présenter son contexte et donc je pense qu’il faut que nous parlions un peu de ton contexte : quel est ton monde, d’où viens-tu ?
Michel Chadeuil – Je viens du milieu du bois, en pleine campagne, loin de tout, donc d’un milieu occitanophone dans les années cinquante : je suis né en 1947, dans les années 50. Le milieu était occitanophone, principalement. J’entendais mon père qui parlait français, et tous les gens autour qui parlaient occitan. Cependant j’entendais un arrière grand-père qui parlait français, qui savait bien parler français et le français hypercorrect, très académique, à l’imparfait du subjonctif, et tout ça, voilà.
E. F. – Mais il savait parler occitan aussi ?
Michel Chadeuil – Eh bien, il savait, oui, et finement.
E. F. – Mais ton père, non.
Michel Chadeuil – Il comprenait, mais oui, il ne parlait pas, il le chantait.
E. F. – Pourquoi ne le parlait-il pas ?
Michel Chadeuil – Oh, parce qu’il avait une histoire personnelle plus compliquée : il était bien limousin d’origine, mais il avait vécu en zone saintongeaise et il l’avait perdu en cours de route.
E. F. – Ah! d’accord, d’accord. Donc c’est un milieu campagnard, cela t’a marqué?
Michel Chadeuil – Ah, bien sûr ! Et j’habite encore dans la maison où je suis né.
E. F. – …qui s’appelle « Lou Vaouré » ?
Michel Chadeuil – Non, « Lou Claousélou ».
E. F. – « Lou Claousélou » ?
Michel Chadeuil – Ah, « Lou Vaouré » parce que tu y es venu ! Ce n’est pas celle-là, non, c’est une autre.
E. F. – …c’est une autre.
Michel Chadeuil – Oui.
E. F. – D’accord, bon. Donc tu es périgourdin. Et j’ai lu que tu parles et écris le parler du pays de Périgueux et de Brantôme. C’est cela ?
Michel Chadeuil - Oui.
E. F. – C’est un sous-dialecte limousin.
Michel Chadeuil – Eh bien oui. Exactement.
E. F. – Donc…
Michel Chadeuil – C’est compliqué de faire comprendre aux gens de chez nous que c’est du limousin parce qu’ils disent : « nous, nous ne sommes pas limousins, nous sommes périgourdins, donc nous parlons périgourdin ». En réalité en Périgord, il y a le Périgord languedocien et le Périgord limousin. Nous, nous ne sommes pas limousins, mais nous sommes de parler limousin.
E. F. – D’accord et, bon, tu parles – nous l’entendons - , tu écris, cela nous le savons depuis longtemps, et tu parles souvent en public, tu as été professeur, parfois conférencier, surtout conteur, et tu écris depuis longtemps des poèmes, des nouvelles, des romans, des chansons, des chroniques de toutes sortes, parfois des chroniques coléreuses. Tu écris aussi des études, par exemple sur les mimologismes, sur le chien, sur la cuisine, sur les légumes et la façon de les conserver, sur la formation des mots. Alors, Michel…Bon, il y a d’autres choses encore… Alors, Michel…
Michel Chadeuil – …sur les proverbes…
E. F. – Oui, sur les proverbes, comme dans ton dernier livre chez Christine Bonneton à Paris, c’est cela ? Donc, j’ai envie de te demander… Oui, parce que même… tu es même un onirographe : c’est-à-dire que tu as écrit tes rêves et, en plus, il t’est venu la forte envie de les publier. Il ne suffit pas de les écrire, il faut les publier. Et donc, bon, tu es un homme multifacétique, prolifique, et j’ai l’impression que tu désires être à la fois l’indigène qui vit, qui crée, et l’ethnologue ou l’ethnographe qui l’étudie. Il me semble que tu es à la fois l’indien en voie de disparition et Lévi Strauss. C’est vrai, ça ?
Michel Chadeuil – Sauf que Lévi Strauss avait dit que l’on ne pouvait faire de l’ethnographie, de l’ethnologie, que du dehors ; mais il y a quelqu’un qui a suivi cette voie avant moi, c’est Delpastre, qui a fait l’ethnographie de son pays, de sa famille, et qui l’a fait vraiment comme aurait pu la faire un observateur étranger qui s’y serait immergé, à la fois observateur étranger mais néanmoins présent… enfin, par ce que nous…, les gens qui font de l’ethnologie, de l’ethnographie dans l’hexagone, vont en faire en Afrique, en Amérique du Sud et tout ça. Qui va faire de l’ethnographie chez nous ? Il n’y a pas beaucoup de gens pour le faire. Nous partons du principe que tout ce qui est intéressant est ailleurs. J’ai eu le plaisir une fois de rencontrer un ethnologue malgache qui venait faire de l’ethnographie en Périgord.
E. F. – Oui, bon, mais ce que je voulais dire aussi c’est que, bon, tu parles, tu contes, tu écris de tout, on peut le dire, ou quasiment de tout, peut-être pas des mathématiques, mais qui sait un jour ça viendra peut-être ! Est-ce que tu n’as pas une soif, une faim de tout dire, est-ce que tu n’as pas cette forte envie de vouloir tout dire et, si c’est vrai, si tu as cet appétit, d’où vient cette volonté, ce désir de tout embrasser, de tout dire ?
Michel Chadeuil – Je ne le sais pas ! C’est comme de manger, de boire, d’uriner… C’est pareil.
E. F. – Donc, c’est quelque chose de vital pour toi d’écrire ?
Michel Chadeuil – Oui, il y a l’expression personnelle, le roman, la poésie, la chanson, tout ça c’est l’expression personnelle, et le reste c’est l’expression du milieu où je suis né, ce que ce milieu a à dire. Il y a mon expression à moi et je suis aussi celui qui porte la parole de sa tribu.
E. F. – Donc, finalement, tes expressions sont complémentaires, quoi ?
Michel Chadeuil – Il me semble.
E. F. – Toi, tu es toujours en lien avec ce qui t’entoure, avec ton pays, ta culture.
Michel Chadeuil – Le pays et la langue, qui ne peuvent être séparés.
E. F. – Finalement, tu es à la fois subjectif mais collectif, individuel mais pas individualiste, quoi ?
Michel Chadeuil – Exactement.
E. F. – Bon.
Michel Chadeuil – Pas individualiste, non.
E. F. – Bon.
Michel Chadeuil – Je fais partie de la collectivité.
E. F. – Oui.
Michel Chadeuil – Qui n’a pas la parole, donc comme moi je tiens la parole, je suis le porte-parole de cette collectivité qui est de plus en plus réduite, malheureusement.
E. F. – Alors, bon, tu as commencé par écrire des poèmes, si je ne me trompe pas…
Michel Chadeuil – Comme tout le monde.
E. F. – Oui. Et le premier recueil de poèmes a été édité en 1968.
Michel Chadeuil – Oui, le premier poème a été…
E. F. – « Lo còr e las dents »
Michel Chadeuil – Les premiers poèmes en revue ont été publiés en 62 ou 63, quelque chose comme ça. Et le premier écrit en occitan, le premier écrit en français, symboliquement peut-être, je ne sais pas, hein !, j’avais 7 ans quand j’ai commencé à écrire de la poésie en français et en occitan. Un jour j’ai écrit 2 poèmes en français, 2 poèmes en occitan. Et à partir de ce jour-là j’ai continué à écrire de moins en moins en français, de plus en plus en occitan.
E. F. – Alors, bon, en 1970 est publié ton recueil intitulé L’òme pas mai , puis en 1971 L’emplumat , et j’ai relu tout ça per cette entrevue, tout ça, et je sais – on en a déjà parlé mais bon…- mais je sais que dans ces poèmes de jeunesse, on peut le dire, il y a un certain militantisme, comme on dit, militantisme qui est le reflet de l’époque, une époque de revendications, de changements, bon. Cela est indéniable, par exemple L’emplumat finit sur le vers : Los tractors an barrat l’estrada dau solelh… , un vers, un poème qu’a chanté notre ami Jean-Paul Verdier.
Michel Chadeuil – Un vers qui a souvent été marqué à la peinture noire un peu partout dans la campagne de chez nous avec ma signature dessous : ce qui fait que la police de temps en temps venait me demander… et je disais : « Non ! c’est simplement une citation, je n’y peux rien. »
E. F. – Alors, quand même, à moi il me semble que déjà dans ces recueils de poèmes militants occitanistes du début…, il me semble, et tu vas me dire ce que tu en penses, qu’il y a déjà l’annonce de ce qui sera l’œuvre ultérieure. Il me semble qu’il y a déjà implicitement des thèmes qui viendront ultérieurement, qui seront approfondis ultérieurement, peut-être une voix déjà…Pour exemple, je vais lire quelques vers tirés du recueil L’emplumat , d’un poème qui s’appelle « Dire ». C’est toi qui dis ceci :
Aimarai coma un còp èra
O n’aimarai pus jamai
E sens regret me’n irai
Me far aubre, me far tèrra.
Et dans un autre poème qui se nomme « Lo grand planh de la loba » :
E pasmens demòra la votz.
Vint còps l’an boirada a l’auratge
Creda sa fam per las sasons,
Creda chada nuech per l’aubratge
Lo gèst que trebla sa rason.
A tots, los òmes, los enfants,
Ne’n a mai dich que los jornaus
E a las dròllas de l’ostau
Mai que las letras d’un amant.
Alors, la pays se meurt, les jeunes s’en vont à Paris : c’est ce qui se disait à l’époque. Mais dans les poèmes demeure la voix de la louve. La louve, ce n’est pas déjà ici la voix de la nature qui pointe et qui annonce quelque chose d’ultérieur ? La voix d’un autre monde, irrationnel, qui nous parle encore et qui dit des choses et… Le poème le dit :
N’en a mai dich que los jornaus
E a las dròllas de l’ostau
Mai que las letras d’un amant.
Alors, que dit-elle ? Que disait-elle déjà cette louve ?
Michel Chadeuil – La première citation m’intéresse davantage. La louve, d’accord, elle est symbolique mais…
E. F. – Symbolique de quoi ?
Michel Chadeuil – … de revenir un peu en arrière dans… la nature ; c’était revenir en arrière, parce que la poésie, la langue occitane, quand je suis arrivé là dedans, c’était une nature d’opérette qui s’y trouvait. Donc prendre la poésie militante, c’était se démarquer de ces gens qui faisaient de l’opérette de convention, les clichés sur la ruralité, tout ça donc. Et moi je leur disais de revenir plus en arrière, pour retrouver la vérité de la nature. Et le premier poème donc, « Se faire arbre, se faire terre » : une fois, c’était à Limoges, il y avait un chanteur occitan, qui est mort maintenant, qui s’appelait Dostromont, qui chantait ce texte, et qui a dit pour le présenter : « ‘se faire arbre, se faire terre’, c’est une vieille expression limousine bien connue pour dire ‘mourir’ ». Et moi je pensais, honnêtement, avoir créé cette idée de « se faire arbre, se faire terre », moi je n’y voyais pas une mort, mais j’y voyais une métamorphose, une assimilation, l’arbre, la terre, l’eau, mon retour à l’humus, pas vraiment mourir. Et donc je me suis dit : « mais moi je ne connaissais pas cette expression et pourtant je l’ai employée ». A partir de ce moment-là je me suis dit : j’ai peut-être quelque chose dans ma mémoire qui est plus fort que moi, qui est la mémoire collective, c’est pour cela que l’on me dit porte-parole de toute une tribu, parce que j’ai une mémoire qui va plus loin que ma mémoire. Effectivement, j’ai un frère, il a demandé à ma mère : « ça se dit ‘se far aubre, se far tèrra’ ? ». Elle lui a dit : « Oui, ça veut dire ‘mourir’ ».
E. F. – C’est extraordinaire. Cela veut dire que c’est une mort qui n’est pas une fin. C’est une mort qui est le commencement d’autre chose.
Michel Chadeuil – Mais ça n’est pas de la métempsycose, hein !
E. F. – Non, mais bon, c’est un nouveau cycle qui commence.
Michel Chadeuil – Alors, ce que l’on peut dire ici, c’est qu’à un moment j’ai rencontré des gens qui avaient une idée un peu semblable. Oui, je ne les connaissais pas quand j’ai écrit ce texte, je n’avais pas encore rencontré Marcelle Delpastre qui commençait tout juste à écrire en occitan à ce moment-là, elle avait écrit d’abord de la poésie en français, et Jan Dau Melhau, que j’ai rencontré après, qui sont des gens qui avaient une mémoire semblable et qui avaient un langage, un message quasiment identique à dire, et nous avons… Nous n’avons pas formé une école mais nous nous sommes aperçus que nous étions plus que cousins.
E. F. – Dans la revue « Leberaubre » vous dites que finalement vous avez choisi une sorte de troisième voie : c’est-à-dire pas le « trobar clus » , pas non plus comme tu disais tout à l’heure la littérature d’opérette, de folklore, mais le fantastique, l’animisme, le paganisme… Et vous dites que tout cela est plus proche de l’âme limousine…
Michel Chadeuil – Oui, ce n’était pas… une proclamation à la création d’une école, c’était quelque chose que nous venions de constater en nous lisant les uns les autres, les trois en question.. Et en voyant qu’il y en avait d’autres qui avaient une sensibilité un peu semblable… Bon, Lo leberaubre, ça a été bien sûr Melhau, Delpastre et moi, mais il y en a quelques uns qui sont autour : par exemple, un graphiste : Jean-Marc Siméonin, un autre poète : Jean-Claude Rollet…
E. F. – Oui…
Michel Chadeuil – …plus distancié, peut-être, mais qui a une sensibilité analogue.
E. F. – Mais, donc, vous vous êtes mis à l’unisson de l’âme limousine… C’est-à-dire que vous avez accueilli quelque chose qui était sur place mais qui ne s’entendait plus. Et finalement vous avez entendu cette voix, comme dans le poème : « E pasmens demòra la votz »… C’est ça, finalement.
Michel Chadeuil – Oui, la voix de la louve…
E. F. – C’est-à-dire que vous n’avez pas créé, enfin : vous avez créé, mais en vous mettant à l’écoute…
Michel Chadeuil – Oui, c’est ça. C’est-à-dire que nous avons eu l’intention, la prétention, le désir, ou simplement ça s’est fait spontanément, de faire une littérature moderne en fuyant cette littérature artificielle de « clichés » qu’il y avait avant. Enfin, qui a de la valeur de toute façon : quand les gens écrivent à la pelle comme ils faisaient, il y a toujours un chef d’œuvre au milieu. Mais enfin, nous on pensait faire une littérature moderne mais qui serait vraiment une littérature du pays, qui ne serait pas uniquement limousine par la langue mais aussi par le contenu. Et donc, pour cela, il fallait gratter le cliché de la littérature précédente et cela nous amenait à remonter loin en arrière dans les mythes, dans les contes populaires, dans les croyances, dans les expressions, dans tout ce que les gens disaient et vivaient mais que les autres, les auteurs d’avant, ne disaient pas.
E. F. – Mais, c’est cela qui m’intéresse, c’est… et qui intéresse les gens qui vous apprécient, c’est-à-dire que finalement vous êtes à l’écoute de quelque chose que – comme tu as dit, comme tu viens de le dire – les gens pensaient, vivaient, croyaient, c’est-à-dire que ce monde fantastique… - parce que, bon, ton œuvre est marquée par le fantastique – n’est pas un monde de carton pâte, inconsistant, c’est l’âme limousine, pour vous.
Michel Chadeuil – Oui, le fantastique est une manière d’expression, le fantastique n’est pas un genre, comme dans le cinéma américain, pour faire peur. Le fantastique est une expression et dans le fantastique on peut tout dire, et on peut le dire complètement libéré.
E. F. – Alors il y a Todorov, Tzvetan Todorov, qui dit que pour lui le fantastiques est, enfin…, qu’on y est, qu’il arrive uniquement quand nous sommes dans l’hésitation, dans l’incertitude, quand nous ne savons pas si nous sommes dans le monde des lois naturelles ou dans un monde de lois surnaturelles. Pour lui donc le fantastique consiste en ce moment d’incertitude e si vous choisissez…, si nous choisissons – pardon -, dit Todorov, une réponse ou une autre, nous laissons le fantastique pour entrer dans l’étrange ou le merveilleux. Et qu’en penses-tu, toi ?
Michel Chadeuil – La différence essentielle entre le fantastique et le merveilleux : le merveilleux, personne ne va y croire. Le fantastique, effectivement, est quelque chose auquel on peut croire : nous sommes entre deux. Nous en sommes à nous demander si c’est possible ou pas possible.
E. F. – Donc, c’est l’ambiguïté.
Michel Chadeuil – L’ambiguïté, oui.
E. F. – Oui.
Michel Chadeuil – Mais le fantastique est finalement… une façon populaire de parler de métaphysique aussi : ce qui nous dépasse, c’est le fantastique.
E. F. – Mais pour vous, l’équipe de la revue Lo leberaubre, famille et alliés –comme l’on dit, le fantastique n’est pas seulement un prétexte littéraire, il n’est pas cela quand vous dites que vous êtes à l’écoute de l’âme limousine ?Moi je vois qu’il y a , effectivement, plus que cela, il y a toute une métaphysique, il y a une façon d’aborder le monde, de sentir le monde, et ce monde dont le fantastique ouvre la porte, il existe ou pas ?
Michel Chadeuil – Eh bien, il faut rester dans l’incertitude, hein !
E. F. – Oui.
Michel Chadeuil – C’est-à-dire, bon, la figure emblématique pour nous c’est le « lébérou », l’homme-loup, mais il y a des gens qui vont dire : « mais je ne l’ai jamais rencontré ! ». Peut-être que si, peut-être que si, mais peut-être est-il dehors, peut-être est-il extériorisé, mais s’il n’est pas extériorisé, de toute façon il est là, il est présent, nous l’avons en nous.
E. F. – Oui.
Michel Chadeuil – Nous sommes tous un peu hommes-loups.
E. F. – Oui.
Michel Chadeuil – Les uns plus que les autres.
E. F. – Oui.
Michel Chadeuil – Donc, Lo leberaubre, il y a beaucoup de gens qui y sont abonnés et qui ne savent pas ce que veut dire « lo leberaubre ». C’est un mot-valise entre le « lébérou » - qui tient à la fois de l’homme et de la bête – et l’arbre, le végétal. Et Marcelle Delpastre m’a fait remarquer qu’il manquait la pierre, c’est-à-dire le minéral pour faire… le pan-cosmique, quoi…
E. F. – Ah, oui!
Michel Chadeuil – Cela aurait fait un mot-valise un peu trop long, il ne pouvait pas tenir sur une couverture aussi étroite.
E. F. – Donc, finalement, le pan-cosmique, comme tu dis, c’est ça l’âme. Enfin… C’est à cela que croit l’âme limousine ?
Michel Chadeuil – Oui.
E. F. – Et est-ce que ça correspond finalement au rapport de l’homme, enfin… de l’humain limousin, à la nature ?
Michel Chadeuil – Oui, celui qui véritablement a cette sensibilité. Mais, bon, c’est comme pour la langue, il y a de plus…, il y a de moins en moins de gens pour parler cette langue et pour avoir cette sensibilité. Et il y a l’apparence souvent, c’est-à-dire que ce que nous retrouvons, c’est ce qu’il y avait avant le christianisme. Le christianisme en Limousin, en Haut Limousin, dans le pays de Melhau et de Marcelle Delpastre, semble tellement présent que personne ne peut y croire. Par exemple, quand nous voyons les ostentations en Limousin , on se dit que ce n’est pas possible ou quand nous voyons le nom de communes qui sont « Saint quelque chose » en Dordogne, ce n’est pas possible, il y en a trop, il y en a trop, les gens en faisaient trop. C’était surtout décoratif. Et quand nous grattons un peu, nous voyons que la façon de vivre le christianisme n’était pas exactement orthodoxe. C’est-à-dire que les gens dans le christianisme continuaient à vivre le paganisme et l’animisme.
E. F. – Ah, d’accord, oui.
Michel Chadeuil – Par exemple, les saints sont les intercesseurs, mais le culte des saints est plus vivant que le culte tout court, c’est-à-dire que… en français on dit : « Il vaut mieux s’adresser au bon Dieu qu’à ses saints. », non, pas en Limousin… Les intercesseurs ont plus de pouvoir que Dieu. Dieu, nous ne savons pas trop ce que c’est. Mais les saints si, parce que d’avoir le culte des saints qui perdure, c’est continuer à vivre le polythéisme primitif.
E. F. – Oui, c’est ce que tu cherchais finalement – ce rapport à la nature, au monde – c’est ce que tu cherchais dans la poésie ? Sans le savoir ?
Michel Chadeuil – Non, je ne sais pas. Enfin… ça m’arrive souvent de dire (c’est pas une blague, quand les gens me disent : « pourquoi tu écris ? ») : « J’écris simplement », je dis, « j’écris pour me relire, pour savoir ce que je pense ». C’est-à-dire que l’écriture met au niveau du conscient ce qui est inconscient avant. Et, effectivement, quand je commence à écrire quelque chose, bon, pas un exposé sur la langue ou une affaire comme ça, mais de la création littéraire, là je ne sais pas en commençant tout ce qu’il va y avoir. J’ai un plan : par exemple, si c’est un conte, j’ai la trame, mais tout ce qu’il y a dedans vient en écrivant. Je me relis après pour voir ce que j’ai trouvé : ce que j’ai fait remonter de mon inconscient ou subconscient, plutôt inconscient, je pense, l’inconscient serait pour moi quelque chose comme la mémoire collective.
E. F. – Donc, tu serais plutôt du côté de Jung que du côté de Freud.
Michel Chadeuil – Oui.
E. F. – D’accord, bon. C’est une réponse nette. Donc parlons justement de cela. L’inconscient, ça fait penser au rêve, entre autres choses. Et donc quelle est l’importance du rêve ? Pourquoi écris-tu tes rêves et les publies-tu ?
Michel Chadeuil – C’est très curieux parce que, là, je me dis que là l’esprit est complètement délivré de tout ce qu’il a appris. Mais non, ce n’est pas exactement ça, mais je rêve ce que je n’oserais pas écrire. Et je relis pour voir ce que j’ai écrit. Et les rêves ont cela d’extraordinaire : si je ne me lève pas pour écrire mon rêve, le lendemain matin, comme tout le monde, je ne m’en souviens plus ; mais curieusement quand je relis les notes que j’ai prises, c’est exactement comme si c’était le texte d’un autre. Je ne me souviens pas que je l’ai écrit, je ne me souviens pas que je l’ai rêvé. Même la première publication que j’en ai fait, quand j’ai tout saisi sur l’ordinateur, tout était une nouvelle découverte, j’avais l’impression de saisir le texte de quelqu’un d’autre. Quelque temps après l’imprimeur me renvoie les épreuves pour les corrections et je me suis dit : « Mais ce n’est pas possible, ce n’est pas moi qui ai écrit ça ! ».
E. F. – Très intéressant. Et il y a encore cette idée de double vie finalement : il y a ce que nous sommes officiellement, ce que nous sommes consciemment, et puis il semble qu’il y ait une autre réalité plus inconsciente, plus profonde.
Michel Chadeuil – Et alors cette affaire de rêve a beaucoup intéressé les lecteurs, ceux qui m’ont réécrit : j’ai eu plus de lettres pour ça que pour tous les autres livres, pourtant c’est une publication ténue. Enfin, il y en a une autre partie qui va sortir bientôt, dans le courant de cette semaine-ci peut-être. Il y a beaucoup de gens qui m’ont écrit : premièrement qu’ils aimeraient écrire aussi leurs rêves, mais qu’ils n’y arrivent pas. Et il y en a qui se sont étonnés parce que dans mes rêves ils n’y trouvent pas ce qu’ils attendaient. Par exemple, il y en a qui m’ont dit : « mais comment ça se fait que tu n’aies pas plus de rêves prémonitoires ? » Là je répondrai que peut-être il y en a, mais que je ne sais pas les déchiffrer. Et il y en a d’autres qui m’ont dit : « pourquoi n’y a-t-il pas plus… parce que ce n’est pas possible, tu dois te censurer, pourquoi n’y a-t-il pas plus d’expression de la sexualité ? ». Là je peux répondre : « peut-être parce que je suis plus du côté de Jung que de Freud. »
E. F. – Ou peut-être parce que c’est une question de déchiffrement aussi ?
Michel Chadeuil – Aussi.
E. F. – La sexualité n’est pas toujours claire ni génitale non plus.
Michel Chadeuil – Effectivement.
E. F. – Mais son rapport avec le mythe. Parce qu’aussi tu t’intéresses beaucoup au mythe. C’est quelque chose que vous mettez en avant. Est-ce que le rêve a quelque chose à voir avec le mythe ?
Michel Chadeuil – Je n’ai pas encore trouvé la solution. J’ai eu des rêves mythiques et un dont je me souviens parce que celui-là il est extraordinaire, il a quelque chose de mythique. Et pourtant c’est un rêve qui m’est resté en mémoire, le plus vieux, et dans ma conscience je n’ai pas pu le raconter parce que je ne savais pas parler.
E. F. – Ah bon ?
Michel Chadeuil – Donc c’est un rêve que… mon plus vieux souvenir, un souvenir d’avant ma prise de parole, c’était un rêve dont je me souviens et que je n’ai pas oublié. C’était quelqu’un qui tenait un cheval par la corde et à un moment le cheval casse la corde et s’envole avec les ailes comme ça, hein !, dans les airs. C’était vraiment un rêve mythique. Bon, d’où venait-il ? D’où venait-il ? Moi je n’ai pas… J’écoutais parler les gens, c’est sûr, mais moi je ne savais pas encore parler.
E. F. – Donc finalement pour toi le…, comment dire, l’humain est une sorte de médium, de passage, un peu comme le poète ou l’écrivain qui est à l’écoute du Limousin, qui est à l’écoute de la nature, enfin… de la profondeur d’un monde qui ne veut pas crever, qui est à l’écoute du mythe, c’est-à-dire, comme tu disais avant, de la mémoire collective…
Michel Chadeuil – Collective, oui, et une façon d’entrer dans l’universalité, parce que nous voyons que contrairement à ce que disaient les gens d’avant nous, qui avaient collecté « Les contes de… », « Les jolis contes de notre province », et tout ça, non !, les contes sont de partout. Les mythes vont se retrouver peut-être un peu différemment mais, vraiment, les mythes que nous avons, d’autres les ont et ils sont quasiment identiques. Il y a une civilisation différente, il y a une géographie différente, il y a des différences dans le mythe, mais le mythe, les structures des contes, tout ça c’est universel. Nous n’allons pas parler d’un « conte du Limousin », si, « mon conte du Limousin », parce que moi je suis du Limousin, conteur du Limousin, mais ce conte, les idées qu’il porte, sont dans la terre entière et peut-être dans l’univers, s’il y a des gens sur une autre planète.
E. F. – Je comprends. Donc toi tu penses que l’homme, ça existe, ce n’est pas seulement une vision de l’esprit. Il y a un homme universel ? Il y a un humain universel ?
Michel Chadeuil – Il y a un humain universel mais en même temps cet homme n’est pas séparé de sa mère qui vit. C’est-à-dire que l’ensemble de tout ce qui vit est unique aussi. Il y a un homme unique dans le monde, mais il fait partie d’une vie unique qui tient toute vie.
E. F. – C’est-à-dire que cette unicité de l’homme, cette universalité, se manifeste toujours dans la particularité d’un lieu, d’une culture…
Michel Chadeuil – Evidemment, et dans la langue locale. Elle ne peut pas s’exprimer dans une langue que personne ne connaîtrait. Et plus tard j’ai découvert des textes qui, finalement, étaient quasiment identiques à ce que nous nous disions. C’était les textes d’indiens d’Amérique. Quand nous parlons des écrits… Pas les écrits, parce que ce n’est pas lui qu’il les a écrits, mais soit de Chief Seattle, soit de Sitting Bull aussi, ils avaient quelque chose de commun avec nous.
E. F. – C’est le vieux fond de l’humanité finalement ?
Michel Chadeuil – Eh bien oui.
E. F. – C’est l’humanité première. Et finalement ton idée – enfin… ce n’est pas seulement la tienne mais… - c’est que … cette humanité première, par delà les apparences, elle continue.
Michel Chadeuil – Elle continue, mais elle se refuse souvent.
E. F. – Elle se refuse ? Elle continue difficilement alors ?
Michel Chadeuil – Elle continue difficilement, tout à fait. Mais les gens n’acceptent pas… Ils ne l’acceptent pas ce vieux fond d’humanité. Ils n’acceptent pas d’avoir… que le cerveau se soit formé tout au long d’un millénaire et avant l’humanité ! Il y a le cerveau reptilien, il y a…, et tout ça part de là et peut-être même d’avant. Et les gens n’acceptent pas ça, ils voudraient que le cerveau soit fait de la veille pour être bien dans la norme actuelle.
E. F. – Alors que vous, l’équipe du « Leberaubre », vous vous installez dans la durée. Vous ne pouvez pas faire autrement, finalement. Votre logique est une logique… Nous venons de parler d’humanité première qui continue difficilement mais pourtant elle continue, donc votre logique est une logique de la durée, elle n’est pas… Elle ne peut pas être une chose à la mode, du jour, de l’air du temps ?
Michel Chadeuil – Oui, moi je dis souvent : « j’aurai vécu la moitié d’une éternité, au moins ». Après, je ne sais pas. Mais j’ai vécu la moitié d’une éternité, à savoir le monde depuis qu’il a commencé et peut-être quand c’était le chaos, pas le moment de la création, mais avant, et qui s’arrêtera à ma mort. Et encore je n’en suis pas sûr, donc j’ai dans ma mémoire la moitié d’une éternité.
E. F. – Parlons un peu de cela. Arrêtons-nous un peu sur ça, si tu le veux bien, parce que justement je voulais t’interroger sur ton rapport au temps. Est-ce qu’il me faut dire « rapport au temps » ou « rapport à l’éternité », parce que ça n’est peut-être pas la même chose ?Et… Marçaudou, par exemple (c’est le personnage de ton livre De temps en temps, mais il est aussi, il se trouve dans le monde de La seconde lune), donc Marçaudou voyage dans le temps, mais est-ce qu’il voyage dans le temps ou est-ce qu’il est sorti du temps ? Et il voyage aussi à travers les œuvres de Michel Chadeuil… Cela m’a beaucoup intéressé, cette continuité d’un de tes livres à un autre. Donc Marçaudou, finalement, c’est le symbole de…, comment dire ?, d’une vie humaine hors du temps, non ?
Michel Chadeuil – Bon, c’est une œuvre quasiment d’adolescence : il y a un moment que ça dure. Pour moi, mais l’auteur est toujours dépassé par ce qu’il écrit, pour moi, à ce moment-là, c’était simplement quelqu’un qui voulait trouver un idéal, qui ne le voyait pas dans le présent, qui n’arrivait pas à se lancer vers l’avenir pour voir si l’idéal pouvait se réaliser dans le futur, et qui pensait que l’idéal était derrière, et il allait visiter tout ça. Donc symboliquement, marcher en arrière, c’est-à-dire reculer dans le temps, pour retrouver son idéal dans le passé. Et il ne le trouvait jamais et il ne le trouve pas ou en dehors du temps. Mais le lecteur, qui est un peu plus conscient que lui – parce que c’est un homme qui a une sensibilité mais n’intellectualise pas trop – le lecteur doit comprendre qu’il a raté son idéal, qu’il l’avait là présent à côté de lui et qu’il n’a pas su le reconnaître. Donc c’est exactement une œuvre d’adolescence. Mais, après, les gens m’ont expliqué qu’il y avait plus que cela. Mais j’accepte cette forme de critique, ici, de dire : « tu as mis dans ton livre quelque chose que tu n’as pas compris, toi, et que les gens… ». Il y en a qui m’ont expliqué ce qu’il y avait dans mon livre. Moi quand je l’ai relu après, j’ai découvert des choses dont je n’étais pas conscient de les y avoir mises quand je l’ai écrit.
E. F. – D’accord mais, bon, j’insiste, parce que je suis un peu obsessionnel, comme dirait un psychanalyste, mais bon… Marçaudou, finalement, il sort du temps, non ?
Michel Chadeuil – Oui, mais bon… Tu es plus fort en philosophie que moi, et la question est de savoir si le temps passe. Nous, nous passons…
E. F. – Est-ce qu’il passe ?
Michel Chadeuil – Il ne me semble pas.
E. F. – C’est cela qui, finalement, se lit dans ton œuvre, me semble-t-il, comme dans les revues, dans d’autres textes, d’autres auteurs dans Lo leberaubre ? C’est que, finalement, il y a peut-être la vie de la mobilité, et puis il semble qu’il y ait l’autre vie, celle de l’immobilité ? Ce vieux fond d’humanité, il semble qu’il ne bouge pas…
Michel Chadeuil – Si, il avançait, il avançait d’un pas d’homme. Aujourd’hui, nous avançons d’un pas de T.G.V., si on peut dire « un pas de T.G.V. »…
E. F. – Mais, peut-être pour éclairer un peu plus les choses, il y a le temps chronologique, le temps de la science, il y a le temps subjectif, enfin, et aussi le temps social… Mais…bon, tu me dis que finalement dans ton œuvre, il y a le temps pourtant, malgré tout, mais quel temps est-ce, c’est le temps du mythe ? C’est un temps lent, c’est cela ?
Michel Chadeuil – Oui, lent, c’est sûr, mais qui ne passe pas, plus que lent, il est peut-être immobile. Il me semble, je ne suis pas trop fort moi, je n’ai pas une grande culture scientifique, mais il me semble qu’il y a des scientifiques qui sont quasiment en train de nous apporter la preuve que nous nous avions raison et que le temps est immobile. Car nous en sommes à voir le passé de la terre, actuellement, dans la galaxie. Donc c’est bien une façon scientifique de faire peu à peu la preuve que le temps ne passe pas ; le temps ne passe pas, il est en expansion comme l’univers, mais il ne passe pas.
E. F. – Et est-ce que tu serais d’accord pour dire que…
Michel Chadeuil – Mais nous, nous passons.
E. F. – Nous, nous passons, oui. Est-ce que tu serais d’accord pour dire que, finalement, c’est une machine anticartésienne, toute cette œuvre ?
Michel Chadeuil – Eh… au sens que les gens donnent à « cartésien ».
E. F. – Parce que j’ai lu…
Michel Chadeuil – Je n’ai pas assez lu Descartes pour dire si je suis cartésien. Je ne le sais pas. Mais je suis sûr que Descartes était moins cartésien que les cartésianistes…
E. F. – Oui, c’est souvent ça, le maître souvent est… est moins, comment dire ?, moins facile, moins simple, que ce qu’en disent les épigones. Mais, bon, est-ce que cependant dans quelques-uns de tes textes qui théorisent, parce que tu théorises aussi… j’ai lu que ce que tu écris, ce que tu penses, ce que vous écrivez, ce que vous pensez, - je ne te mets pas à l’écart de l’équipe que vous formez -, est pourtant une remise en cause de ce que nous appelons, en Occident, la rationalité. Mais si nous pensons au mythe…
Michel Chadeuil – Mais la rationalité n’est peut-être pas rationnelle.
E. F. – Oui, c’est ça. Si nous pensons au mythe, est-ce que le mythe n’est pas une autre forme de rationalité ?
Michel Chadeuil – C’est possible.
E. F. – Est-ce que, je veux dire…, est-ce qu’il n’y a pas une logique ?
Michel Chadeuil – C’est possible. Ma logique personnellement, tu vois, s’il m’arrive quelque chose que je peux dire fantastique, ça arrive à tout le monde, quand nous en parlons après souper, les gens te racontent des affaires extraordinaires qui leur sont arrivées, qu’ils ont vécues. Mais s’ils ont « l’esprit cartésien », comme on disait, entre guillemets, hein, je ne sais pas trop, ils vont te dire : « Bon, c’est le hasard. ». Eh bien, moi je dis que les rationalistes sont des gens d’une grande innocence. Il n’y a rien qui soit moins clair, moins rationnel, que le hasard. Finalement, le mythe, et le fantastique, pour moi c’est plus rationnel que de dire : « c’est le hasard qui est cause de tout cela ».
E. F. – Parce que le mythe, et le fantastique, c’est une façon de donner un sens et de rationaliser des choses que les cartésiens de tous les jours trouvent absurdes, finalement ?
Michel Chadeuil – Oui, le mythe donne un sens. C’est ce que j’ai gardé de mes origines paysannes. C’est-à-dire que le paysan, comme je l’ai connu encore dans les années 50, est quelqu’un qui voulait donner un sens à tout, tout ce qu’il faisait, le moindre geste de la… de la journée. Dans son travail, dans ses activités, il était…, il avait un sens direct, là, mais en même temps un sens métaphorique terrible. Qui avait valeur de leçon pour l’humanité. Et il pouvait aller encore plus loin que ça, il pouvait devenir métaphysique, cosmique, et tout ce que voudrez.
E. F. – Les gestes de l’humain, mais aussi ce qui se passait dans la nature, ce n’était jamais un coup de hasard, c’était toujours un signe…
Michel Chadeuil – …toujours besoin de lire. Tout est signe… Tout est signe, cela ne veut pas dire que tout est présage. Ce n’était pas l’augure qui fait rire, mais tout a une signification. A nous de savoir la lire. Peut-être que nous allons nous tromper, en la lisant, mais enfin tout a un sens. Donc le rêve a un sens et écrire le rêve est une manière de trouver du sens. Mais quelque chose, je ne sais pas moi : quelque chose qui ne devrait pas tomber et qui tombe, qui n’est pas un présage exactement – ce sont les gens superstitieux qui disent : « c’est un présage » - mais tout ça a un sens, quelque chose qui va contre la loi de la physique, c’est un signe, cela a un sens.
E. F. – Finalement, s’il y a un mal moderne ça serait, tu me diras ce que tu en penses, ça serait peut-être que l’humain actuel ne sait plus lire les signes qui sont autour de lui ?
Michel Chadeuil – Oui, ce qui fait que pour beaucoup de gens, maintenant, l’existence n’a pas de signification. Elle a une signification superficielle, par exemple : arrêter le travail assez tôt pour aller voir la télé plus vite, ou bien gagner des sous à la fin du mois. Mais tout ça ne donne pas une signification à l’existence.
E. F. – Et est-ce que l’on peut envisager un humain qui ne soit pas en contact, en communication, avec la terre, avec la nature, avec ce monde qui continue de nous parler, même si nous ne lui répondons pas ?Un humain « hors sol », est-ce que c’est possible ?
Michel Chadeuil – Oui, bien sûr. Tu sais qu’il y en a beaucoup.
E. F. – Mais est-ce que c’est encore un humain, pour toi ?
Michel Chadeuil – Ah !, là la question se pose. J’ai pensé un temps que ce que l’on peut trouver peut-être dans L’emplumat, un poème qui… « Betum », que j’ai dit souvent lors de soirées – je faisais du slam avant que cela ne soit à la mode -, dans « Betum », donc, je disais que l’homme est en train de devenir une machine. En réalité, en observant ce qui se passe actuellement, je suis peut-être un peu moins désespéré mais un peu plus inquiet tout aussi bien, parce que, vraiment, il ne semble pas que l’homme en soit à devenir une machine et… Ce serait plutôt à redevenir animal, dans toute l’agressivité, la façon de se… d’aller contre l’autre, de vouloir être victorieux de l’autre, comme s’il devait tuer son voisin pour se nourrir à nouveau…
E. F. – Ah, oui, une sorte d’anthropophagie, que…et je voulais…
Michel Chadeuil – …mais une anthropophagie pas clanique, pas rituelle. Une anthropophagie qui est un suicide parce qu’une communauté qui pratique l’anthropophagie pour se nourrir est une communauté foutue. Elle ne peut pas continuer à vivre. Le dernier qui restera va s’avaler goulûment…
E. F. – Amin Maalouf, un écrivain français d’origine libanaise, dit à propos de l’identité humaine : nous n’avons pas de racines parce que nous, les humains, nous ne sommes pas des arbres. Qu’en penses-tu, toi ?
Michel Chadeuil – Il me semble que j’ai des souvenirs du temps que j’étais arbre ; je ne suis plus arbre, non, mais…
E. F. – Ah, tu t’en souviens ?
Michel Chadeuil – Je m’en souviens, oui.
E. F. – C’est une belle, belle réponse. Bon, et je voulais te parler aussi de l’amour et de la femme dans ton œuvre parce que j’ai été marqué par les pages fortes que tu consacres à l’amour et à la femme. J’ai noté cette différence que tu fais, cette distinction profonde, à mes yeux, que tu fais entre la copulation, finalement, et l’acte sexuel d’amour, et… et souvent tu dis, il y a un adjectif qui revient, c’est l’adjectif « mécanique ». Donc il y a la sexualité mécanique et puis il y a la sexualité de l’amour, il y a le charnel amoureux et… est-ce que tu peux m’en dire, nous en dire quelques mots ?
Michel Chadeuil – Là je dirai… J’aime autant dire ici de relire ce que j’ai écrit là-dessus, qui date un peu de toute façon. J’ai eu besoin d’écrire là dessus à quelques moments de ma vie pour être sûr, comme je disais tout à l’heure, de ce qui était dans mon idée, de ce que je pensais pour de bon. Et… « mécanique », bon… Nous avons revu, il n’y a pas longtemps, à la télévision, le film de…, sur Casanova.
E. F. – Oui.
Michel Chadeuil – Casanova, c’est sûr, est une mécanique.
E. F. – D’accord.
Michel Chadeuil – Même pas une bête, parce qu’une bête…
E. F. – Le fait par besoin.
Michel Chadeuil – Oui. Non, c’est une mécanique. Et il n’a le temps de connaître aucune de ses conquêtes. Il n’a pas le temps de savoir qui elle était.
E. F. – Bon, il nous faut finir, Michel. On me fait signe, donc…
Michel Chadeuil – Nous aurons oublié quelque chose de terrible…
E. F. – Nous aurons toujours oublié quelque chose et peut-être que c’est mieux ainsi…
Michel Chadeuil – Non, mais il y a quelque chose dont nous n’avons pas parlé, parce que les gens qui sont en train de nous écouter, là, vont se dire : « Eh bien, son œuvre ne doit pas être…, ça doit faire penser, te prendre la tête, te prendre la tête avec ça ».
E. F. – Non, nous n’avons pas parlé de l’humour, mais en t’entendant, en t’écoutant, les gens ont compris qu’il y a beaucoup d’humour dans ton œuvre et il y a aussi ce que tu fais, il y a aussi ton « actualité », comme on dit maintenant. Et ton actualité est peut-être ethnographique, « actuellement » ?
Michel Chadeuil – Et en plus il y a aussi l’actualité politique. Les gens qui ont lu Colèra ou qui suivent la publication de ma Colèra, la chronique colérique évoquée au début, savent que l’humour est très important. L’humour est ce qui, c’est le… - comme disait l’autre, l’autre, je ne sais pas lequel, parce qu’on l’a prêté à plus d’un – « la politesse du désespoir ». Bon, nous avons besoin de l’humour, mais voici là aussi quelque chose qui se perd, me semble-t-il.
E. F. – Et toi tu aimes bien appuyer fort et où cela fait mal. Et c’est salutaire.
Michel Chadeuil – Et j’aime bien l’humour qui n’est pas trop cartésien, comme nous disions tout à l’heure.
E. F. – Eh bien, cela ne m’étonne pas. C’est logique !
Michel Chadeuil – J’aime bien la dérision et l’autodérision.
E. F. – Bon, bien…
Michel Chadeuil – Nous avons besoin de marquer une distance comme ça, pour ne pas dire aux gens : « vous voyez comme j’ai une grande pensée », et tout ça… Nous en avons besoin de l’humour et je pense que nous avons parlé de Jan dau Melhau et de Marcelle Delpastre, et de ceux qui n’en manquaient pas. Et les gens qui ont connu Marcelle Delpastre, par exemple, ce qui leur reste le plus, c’est son rire.
E. F. – Bon, bien, écoute, il ne me reste plus qu’à renvoyer tout le monde, les auditeurs et ceux qui nous regardent aussi, à ces œuvres de Marcelle Delpastre, de Jan dau Melhau, et à la tienne. Merci Michel et à une prochaine fois !
Michel Chadeuil – A la prochaine. Et je vais noter tout ça, hein !
Traduction : Joëlle Ginestet
Dans la même collection
-
Joan Bodon e son obra dins "La Festa" de Robert Lafont / Fritz Peter Kirsch
KirschFritz PeterJoan Bodon e son òbra dins La Festa de Robert Lafont / Fritz Peter Kirsch
-
Joan Bodon, Prépauses d'un occitan / Patrick Couffin
CouffinPatrickJoan Bodon, Prépauses d'un occitan / Patrick Couffin, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir Joan Bodon", organisé par l'Équipe Littérature et Herméneutique du laboratoire
-
Qué nos dison los escambis epistolaris amb Robert Lafont (1951-1974) / Michel Pédussaud
PedussaudMichelQué nos dison los escambis epistolaris amb Robert Lafont (1951-1974) / Michel Pédussaud, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir Joan Bodon", organisé par l'Équipe Littérature et
-
Lenga de país, lenga d'autor, lenga comuna : la morfologia de las òbras de Bodon / Patrick Sauzet
SauzetPatrickLenga de país, lenga d'autor, lenga comuna : la morfologia de las òbras de Bodon / Patrick Sauzet, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir Joan Bodon", organisé par l'Équipe
-
« Aquel mond uèi s'es escapat » : estudi de semantica temporala dins un còrpus d'òbras de Bodon / M…
BrasMyriamSibilleJean« Aquel mond uèi s'es escapat » : estudi de semantica temporala dins un còrpus d'òbras de Bodon / Myriam Bras -en présence de Jean Sibille, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir
-
Entretien avec Jean Ganiayre (Joan Ganhaire)
GinestetJoëlleJoan Ganhaire (Jean Ganiayre), écrivain du Périgord né à Agen en 1941, est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles et romans en langue occitane. Son premier recueil de nouvelles Lo Reirlutz a été
-
Voix d'Ariège
SauzetPatrickEliane Estaque, locutrice naturelle née en Ariège près du Mas d'Azil évoque la vie du village de Sabarat, les foires, les bêtes, la vie religieuse, le dialecte languedocien et le dialecte gascon
-
Rencontre avec Aurélia Lassaque
GinestetJoëlleLassacaAureliàRencontre avec une jeune poètesse occitane qui explique son entrée littérature et en poésie et offre la lecture de quelques uns de ses poèmes, en occitan.
-
Le musée campanaire de l'Isle-Jourdain
GinestetJoëlleRivièreVincentMusèu campanari de l'Isla de Baish est un document réalisé par des étudiants de 2e année de Deug d'Occitan auprès d'un guide locuteur naturel en occitan, dialecte gascon. L'interviewé de L'Isle
-
Voix des Landes
SauzetPatrickBernadette Lapoutge, locutrice naturelle née dans les Landes à la limite du département du Gers évoque la langue et les comptines qu'elle a apprises dans sa famille. Elle parle de traditions et de son
-
Escapade avec Henri Mouly
GinestetJoëlleMoulyEnricEspingadas amb Enric Mouly est composé de lectures de chapitres d'un ouvrage de souvenirs d'une enfance rurale en Rouergue, "Mas Espingadas" publié en 1933 à Rodez et en 2000 par le Grelh Roergàs. Les
-
Charles Mouly, de Compolibat a Catinou
GinestetJoëlleCharles Mouly, né dans l'Aveyron et résidant à Toulouse, est connu dans la région Midi-Pyrénées pour être à l'origine du personnage humoristique de Catinou qui a été incarnée par le comique Dominique
Sur le même thème
-
Pourquoi des gens écrivent ils en patois ?
PisuRafaëlloÉcrire un livre ne va pas de soi, a fortiori quand il est en patois – ou parler local. Si l'objet en tant que tel ressemble à s'y méprendre à n'importe quel autre ouvrage, son objectif et son contenu
-
Accompagner des élèves de cycle 3 en école bilingue occitan-français dans l’écriture plurilingue gr…
EdoLéaLéa Edo met en place pour la 2ème année consécutive un projet autour d'un album plurilingue. L'an dernier, les élèves ont proposé une réécriture plurilingue du "Petit Chaperon rouge" en s'inspirant
-
Bodon autor e ensenhaire / Marie-Anne Châteaureynaud
ChâteaureynaudMarie-AnneBodon autor e ensenhaire / Marie-Anne Châteaureynaud, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir Joan Bodon", organisé par l'Équipe Littérature et Herméneutique du laboratoire
-
Lenga de país, lenga d'autor, lenga comuna : la morfologia de las òbras de Bodon / Patrick Sauzet
SauzetPatrickLenga de país, lenga d'autor, lenga comuna : la morfologia de las òbras de Bodon / Patrick Sauzet, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir Joan Bodon", organisé par l'Équipe
-
L'activité épilinguistique de Jean Boudou : du discours sur la langue à l'autonymie / Gilles Couffi…
CouffignalGilles GuilhemL'activité épilinguistique de Jean Boudou : du discours sur la langue à l'autonymie / Gilles Couffignal, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir Joan Bodon", organisé par l'Équipe
-
« Aquel mond uèi s'es escapat » : estudi de semantica temporala dins un còrpus d'òbras de Bodon / M…
BrasMyriamSibilleJean« Aquel mond uèi s'es escapat » : estudi de semantica temporala dins un còrpus d'òbras de Bodon / Myriam Bras -en présence de Jean Sibille, in coloque international "Relire Jean Boudou / Tornar legir
-
Comparer les langues en école et collège Calandreta : pratiques enseignantes / Émilie Chorin
ChorinEmilieComparer les langues en école et collège Calandreta : pratiques enseignantes / Émilie Chorin
-
"Sponsus" et musique / Jean-Christophe Maillard, Éric Léger
MaillardJean-ChristopheSponsus et musique / Jean-Christophe Maillard, Éric Léger. In journée d'études "Autour du drame liturgique médiéval du Sponsus", co-organisé par le Département Lettres modernes, cinéma et occitan de l
-
Entretien avec Jean Ganiayre (Joan Ganhaire)
GinestetJoëlleJoan Ganhaire (Jean Ganiayre), écrivain du Périgord né à Agen en 1941, est l’auteur de plusieurs recueils de nouvelles et romans en langue occitane. Son premier recueil de nouvelles Lo Reirlutz a été
-
Rencontre avec Aurélia Lassaque
GinestetJoëlleLassacaAureliàRencontre avec une jeune poètesse occitane qui explique son entrée littérature et en poésie et offre la lecture de quelques uns de ses poèmes, en occitan.
-
Rencontre avec Olivier Lamarque
GinestetJoëlleLamarqueOlivierRencontre avec le jeune poète occitan, Olivier Lamarque qui nous parle de son travail et de la publication de son premier recueil. Générique Interview, Transcription, traduction : Joëlle Ginestet
-
Martinets (moulins à cuivre) du Lésert
GinestetJoëlle"Les Martinets du Lésert", "Les Martineurs au travail", et "La Saint-Eloi" sont des textes en occitan extraits de l'ouvrage écrit par l'auteur Henri Mouly (né à Compolibat, Aveyron, en 1896) qui s