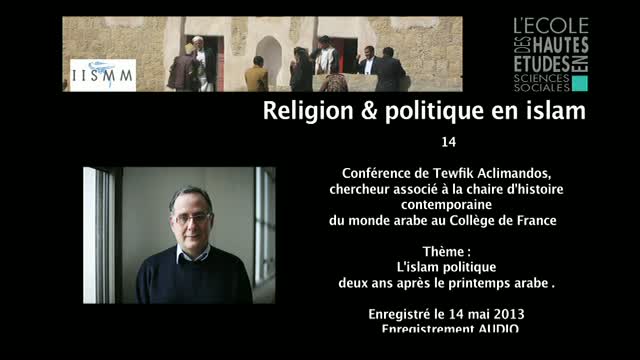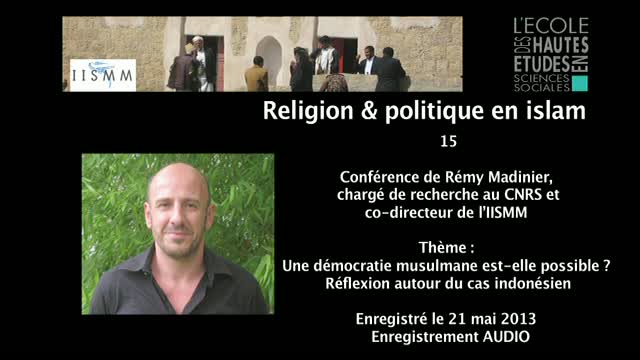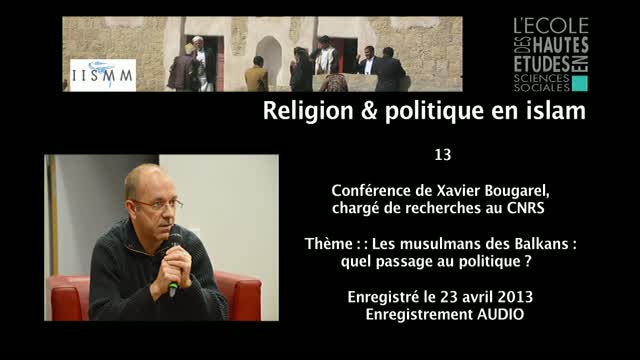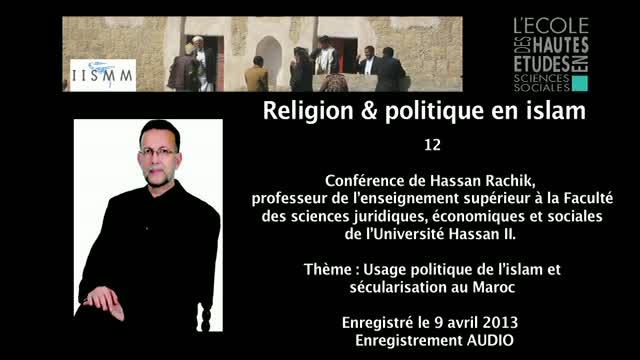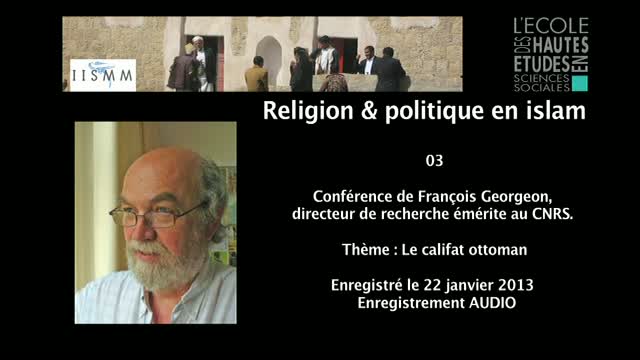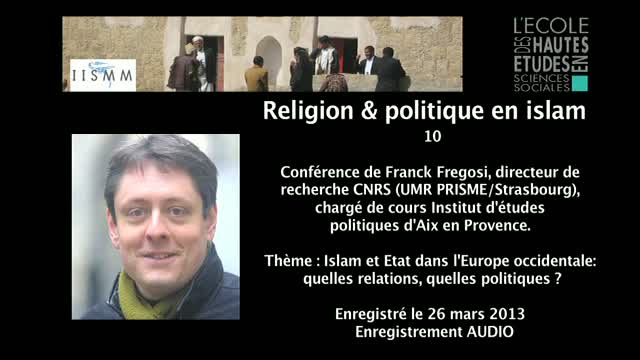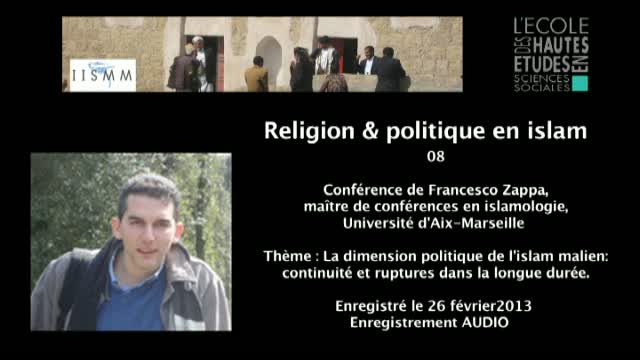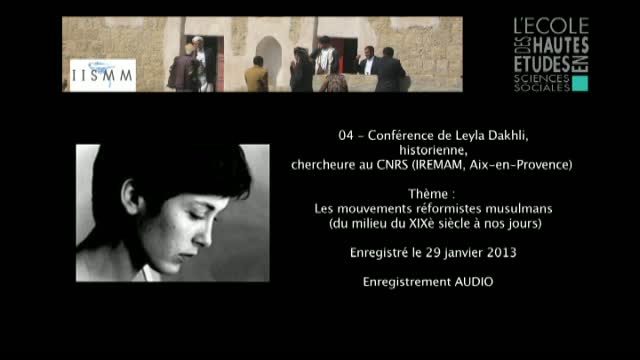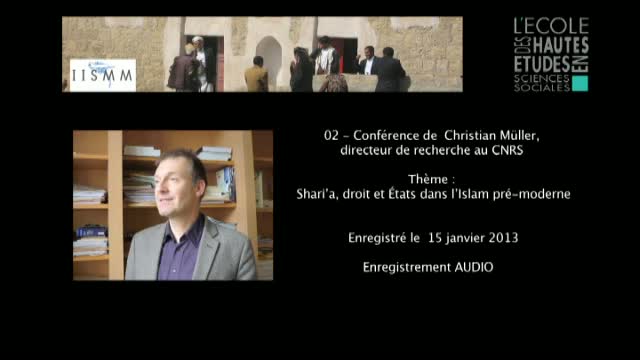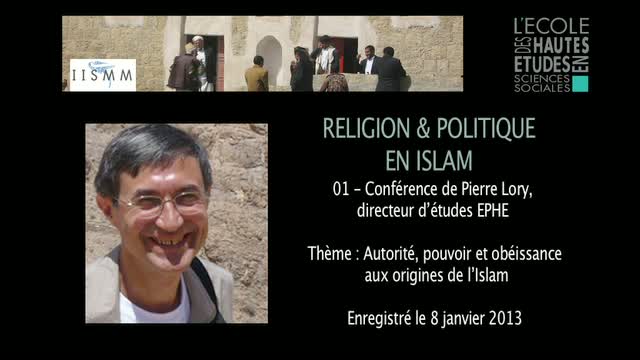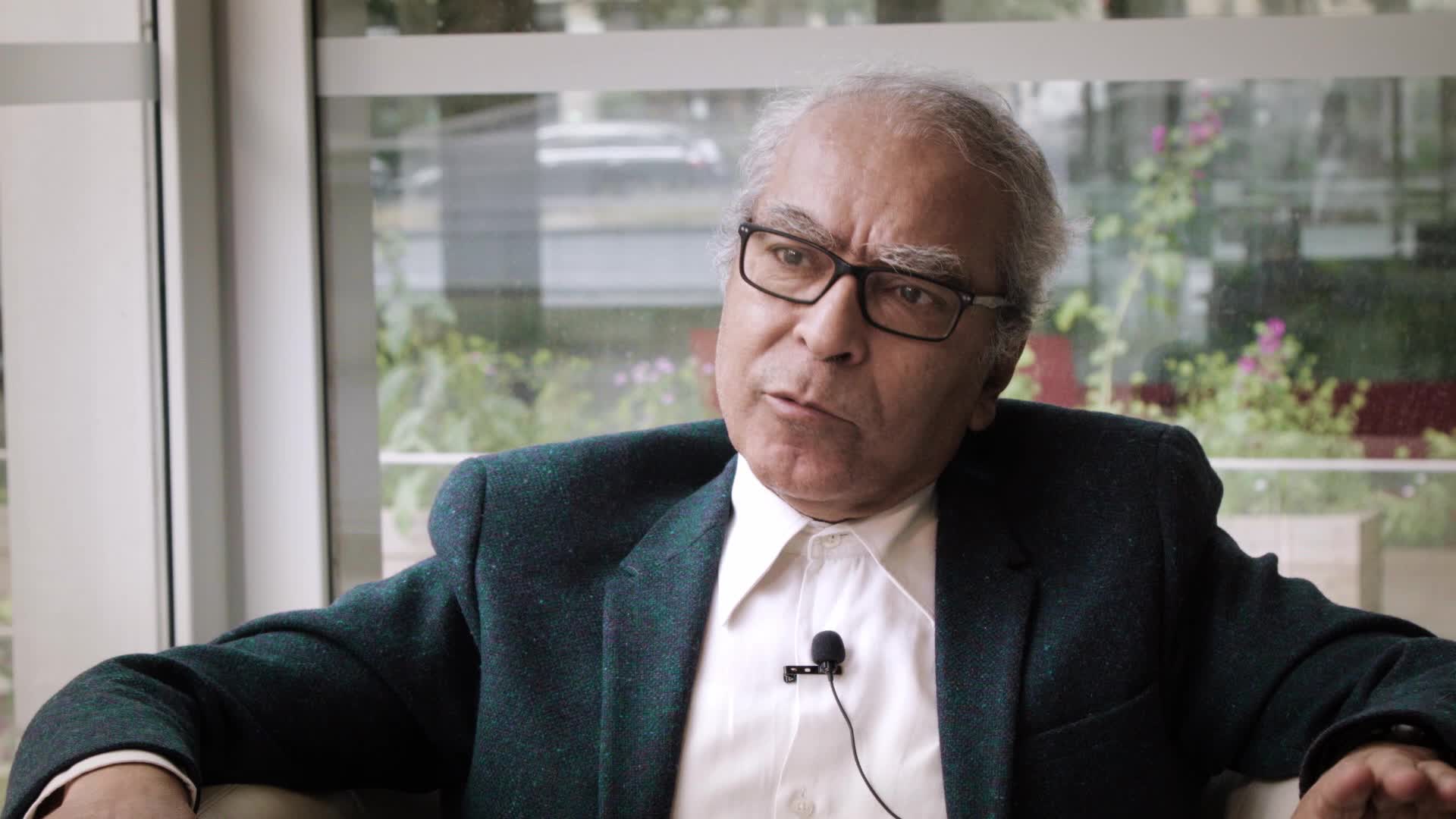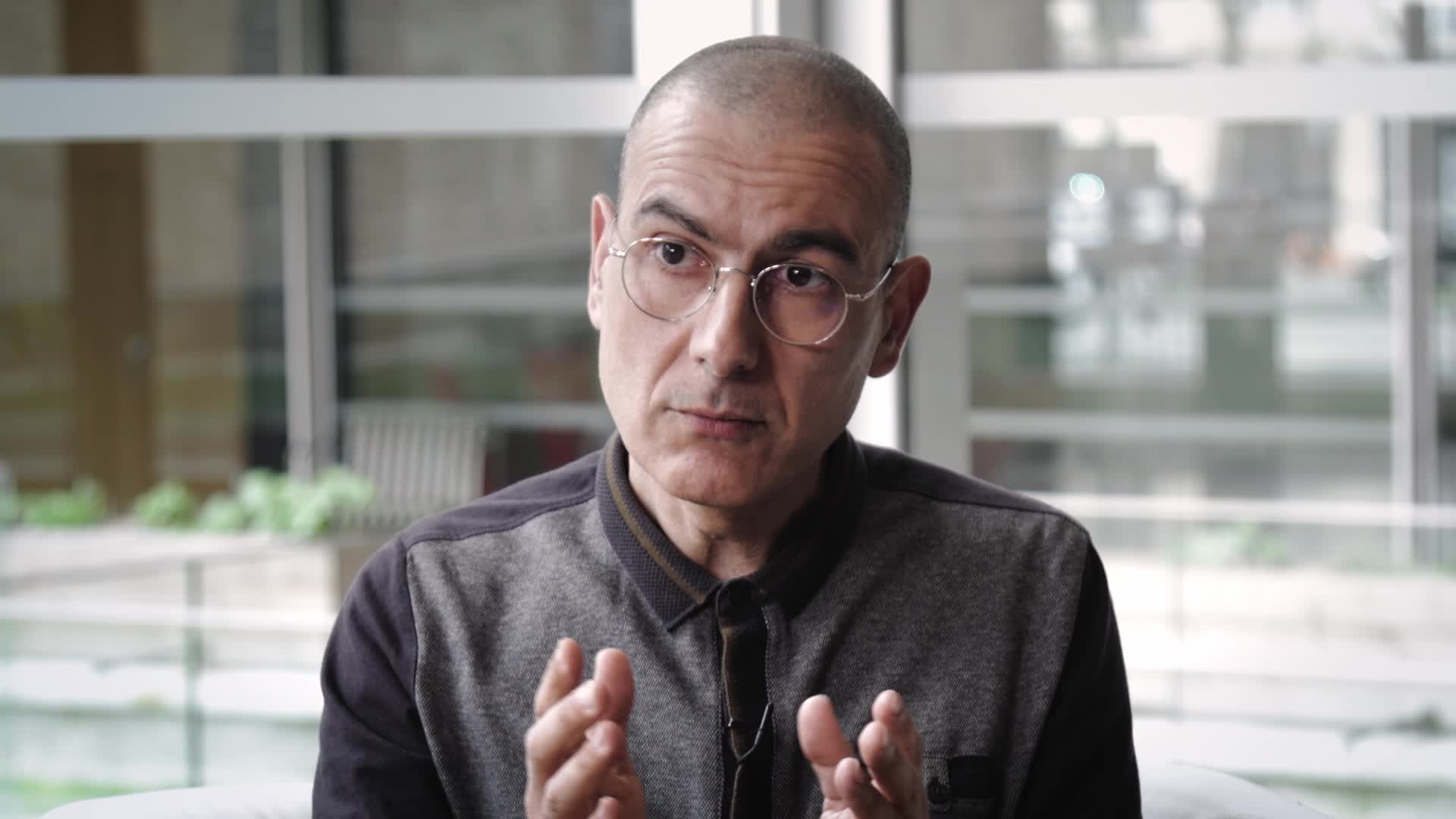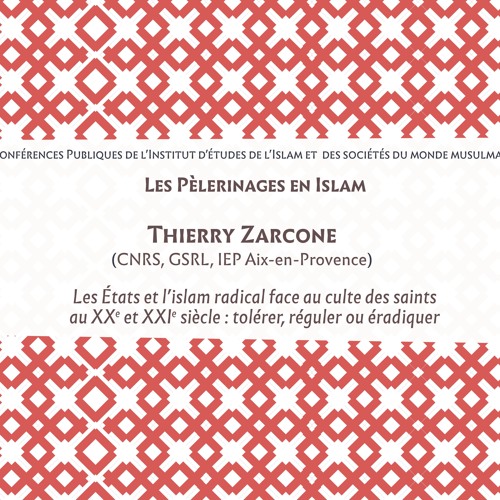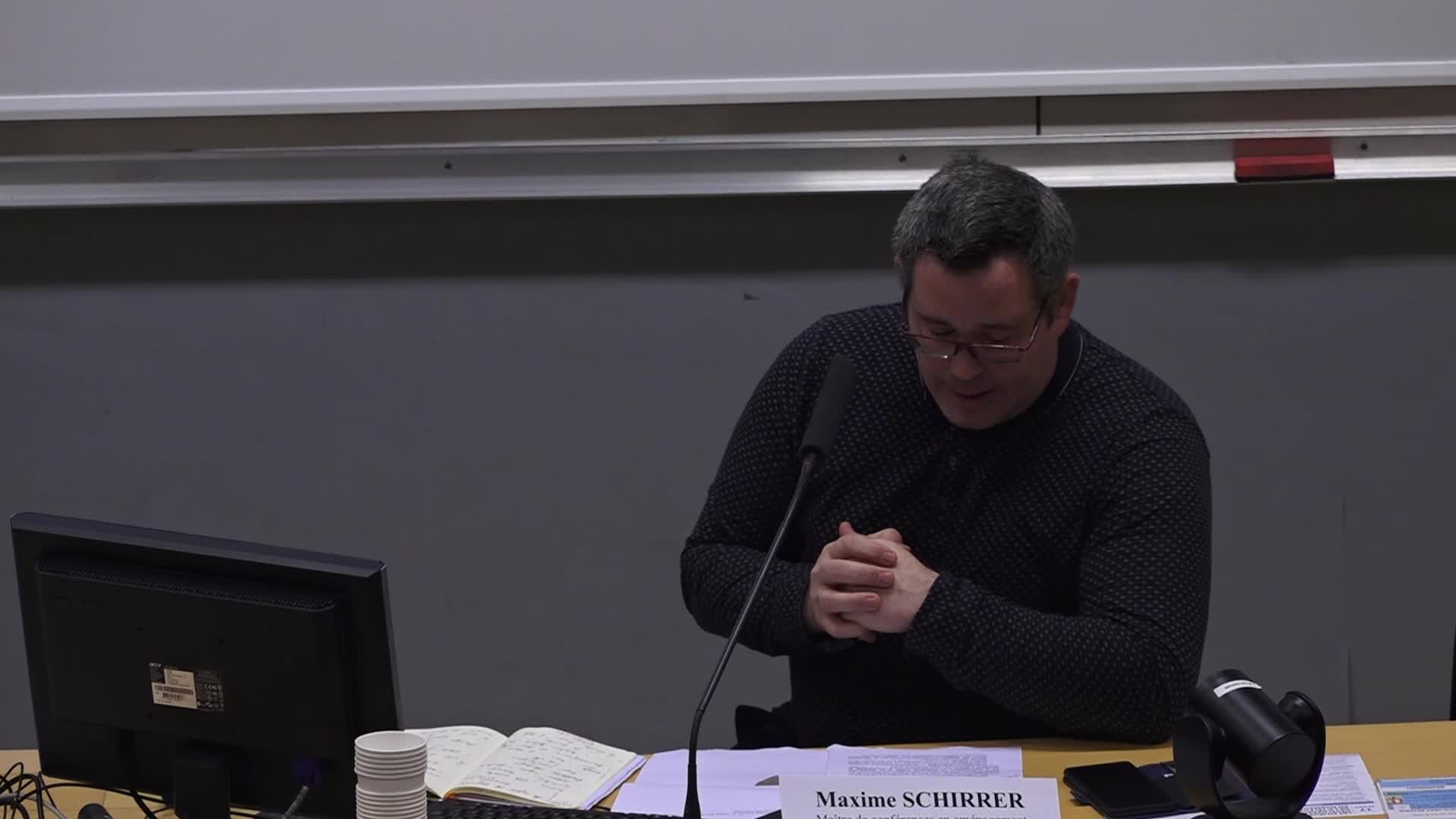Notice
11 - Conférence de Jean-Philippe Bras: Droit, islam et politique dans les printemps arabes.
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
11 - Conférence de Jean-Philippe Bras,professeur de droit public, Université deRouen, président du conseil scientifique de l’IRMC et du Centre Jacques Berque
Modérateur : Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le développementet co-directrice de l’IISMM
Date : 2 avril 2013
Thème : Droit, islam et politique dans lesprintemps arabes
Production : Direction de l’Audiovisuel/EHESS/IISMMAuteur/Réalisateur : Philippe KergraisseVidéothèque : Institut d’études de l’islam et des sociétés du mondemusulman - Ecole des hautes études en sciences sociales, en partenariat avec leCollège de France
Résume : Si l’on peut relever un point commun aux printemps arabes, c’est qu’ils sont quasiment tous porteurs de changements constitutionnels, en cours ou déjà mis en œuvre. Ils sont certes d’ampleur variable. Certaines constitutions ont été - ou vont être - amendées de manière plus ou moins étendue (Algérie, Jordanie, Maroc, Oman, Syrie) dans une démarche visant à prévenir des ruptures politiques qui auraient mis en péril les pouvoirs en place. D’autres ont été abrogées, pour laisser la place à une nouvelle constitution, dans un contexte de rupture qualifié de révolutionnaire (Egypte, Libye, Tunisie). Un dernier cas de figure est celui où la contestation populaire est porteuse d’une revendication constitutionnelle que le pouvoir refuse de satisfaire (Bahreïn). Il est remarquable que dans chacun de ces cas, l’ensemble des acteurs du jeu politique aient conféré une dimension constitutionnelle au changement politique, marquant ainsi les progrès du constitutionnalisme dans la construction des légitimités politiques.
L’ouverture du débat constitutionnel a permis de dégager une seconde tendance commune aux Etats de la région : le poids de la question religieuse dans ce débat. Comment définir la relation entre l’Etat, l’islam et les autres religions ? Quelle place accorder à la sharî’a parmi les sources du droit ? Sur quelles modalités doit-on protéger les minorités religieuses ? Quelles conditions d’ « islamicité » imposer aux institutions et aux instances dirigeantes de l’Etat? Comment assurer la compatibilité entre les droits humains et la référence à la religion islamique : égalité homme-femme ; liberté de conviction religieuse ; liberté d’expression ; protection des droits de l’enfant… ? Ce positionnement du débat constitutionnel est l’expression de la montée en puissance des forces politiques à référent islamique dans le paysage politique en cours de recomposition des Etats de la région, et de l’absence de consensus au sein des sociétés concernées sur la définition d’un socle de valeurs communes. Il met également à l’arrière-plan d’autres questions politiques, dont le traitement s’avère particulièrement difficile pour les gouvernants.
Dans la même collection
-
14 - Conférence de Tewfik Aclimandos / L'islam politique deux ans après le printemps arabe
AclimandosTewfickConférence de Tewfik Aclimandos, chercheur associé à la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France Thème : L'islam politique deux ans après le printemps arabe . Modérateur :
-
15 - Conférence de Rémy Madinier/Thème : Une démocratie musulmane est-elle possible ? Réflexion aut…
MadinierRémyConférence de Rémy Madinier, chargé de recherche au CNRS et co-directeur de l’IISMM Modérateur : Bernard Heyberger, directeur d’études à l’EHESS, directeur de l’IISMM-EHESS Date : 21 mai
-
13 - Conférence de Xavier Bougarel: Les musulmans des Balkans : quel passage au politique ?
BougarelXavier13 - Conférence de Xavier Bougarel, chargé de recherches au CNRS Thème : Les musulmans des Balkans : quel passage au politique ? Modérateur : Rémy Madinier, chargé de recherche au CNRS, co
-
12 - Conférence de Hassan Rachik: Usage politique de l’islam et sécularisation au Maroc
RachikHassan12 - Conférence de Hassan Rachik, professeur de l’enseignement supérieur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Hassan II. Thème : Usage politique de l’islam
-
03 - Conférence de François Georgeon: le califat ottoman
GeorgeonFrançoisConférence de François Georgeon, directeur de recherche émérite au CNRS. Thème: le califat ottoman Direction de l’Audiovisuel/EHESS/IISMM Auteur/Réalisateur : Philippe Kergraisse Vidéothèque :
-
10 - Conférence de Franck Frégosi / Islam et Etat dans l’Europe occidentale : quelles relations, qu…
FrégosiFranck10 - Conférence de Franck Frégosi, directeur de recherche CNRS (UMR 7354 DRES/Strasbourg), chargé de cours Institut d'études politiques d'Aix en Provence. Thème : Islam et Etat dans l’Europe
-
08 - Conférence de Francesco Zappa/La dimension politique de l'islam malien: continuité et ruptures…
ZappaFrancesco08 - Conférence de Francesco Zappa, maître de conférences en islamologie, Université d’Aix-Marseille Modérateur : Bernard Heyberger, directeur d’études EHESS et directeur de l’IISMM-EHESS et Jean
-
06-Conférence de Jean-François Bayart / Un islam républicain est-il possible ?
06 - Conférence de Jean-François Bayart, directeur de recherche au CNRS (Sciences po-CERI), Modérateur : Rémy Madinier, chargé de recherche au CNRS, co-directeur de l’IISMM-EHESS Date : 12
-
05 - Conférence de Stéphane Lacroix: Les Frères musulmans égyptiens, des origines au défi du pouvoi…
LacroixStéphaneCycle 2013 : Religion et politique en Islam S’il est un point de convergence - paradoxal - entre l’islamiste militant et l’homme de la rue occidental, c’est bien le postulat d’un Islam qui
-
04 - Conférence de Leyla Dakhli: Les mouvements réformistes musulmans (du milieu du XIXè siècle à n…
DakhliLeylaCycle 2013 : Religion et politique en Islam S’il est un point de convergence - paradoxal - entre l’islamiste militant et l’homme de la rue occidental, c’est bien le postulat d’un Islam qui
-
02 - Conférence de Christian Müller: Shari’a, droit et États dans l’Islam pré-moderne.
MüllerChristianCycle 2013 : Religion et politique en Islam S’il est un point de convergence - paradoxal - entre l’islamiste militant et l’homme de la rue occidental, c’est bien le postulat d’un Islam qui
-
01 - Conférence de Pierre Lory: Autorité, pouvoir et obéissance aux origines de l’Islam.
LoryPierreCycle 2013 : Religion et politique en Islam S’il est un point de convergence - paradoxal - entre l’islamiste militant et l’homme de la rue occidental, c’est bien le postulat d’un Islam qui ignorerait
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
Interdits religieux et normes modernes
BrasJean-PhilippeBourmeauSylvainHermon-BelotRitaRousseletKathyAssassinats de journalistes, de policiers, de citoyens juifs, marche du 11 janvier : les événements qu'a connus la France au début de cette année ont suscité un besoin d'intelligence collective.
Sur le même thème
-
-
Prière
Marongiu-PerriaOmeroComme toute religion, l’islam est défini par des caractéristiques cultuelles.
-
Chrétiens
HeybergerBernardLoryPierrePisaniEmmanuelD’après la tradition musulmane, l’islam est présenté comme l’héritier du christianisme, face auquel il s’est construit dans un jeu de miroir mais aussi d’opposition.
-
Hajj
SeuratLeïlaBoualiHassanChiffoleauSylviaLe pèlerinage vers les Lieux saints est une des prescriptions canoniques de l’islam.
-
L’Islam a-t-il (ré)inventé la carte du monde ?
ValletÉricConférence d'Éric Vallet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « L’Islam a-t-il (ré)inventé la carte du monde ? ».
-
Islam et lieux saints partagés/disputés en Méditerranée
PénicaudManoëlManoël Pénicaud est anthropologue, chargé de recherche au CNRS et membre de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne européenne et comparative (CNRS, Aix-Marseille Université).
-
Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou é…
ZarconeThierryHistorien et Anthropologue, Thierry Zarcone est Directeur de recherches au CNRS, rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcité) et chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix en
-
L'exemple du pèlerinage du Mont Tomor dans l'Albanie post-communiste
ClayerNathalieHistorienne, Nathalie Clayer est directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS rattachée au Centre d'Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (Cétobac) qu’elle a
-
Pèlerinages d’empire : l’Europe coloniale et le hajj
ChantreLucHistorien, Luc Chantre est chercheur associé au Centre français d’archéologie et de sciences sociales (CEFAS).
-
De la caravane à l’avion : l’expérience du monde dans le voyage à La Mecque
ChiffoleauSylviaChargée de recherche au CNRS et rattachée au Laboratoire de Recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) à Lyon, Sylvia Chiffoleau est historienne.
-
La Mecque, des pèlerinages tribaux au pèlerinage musulman
ChabbiJacquelineHistorienne arabisante, Jacqueline Chabbi est spécialiste des origines de l’islam.
-