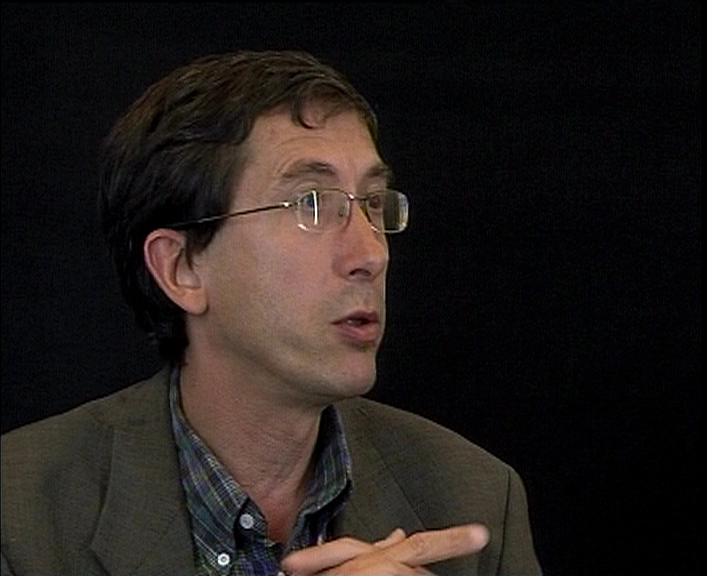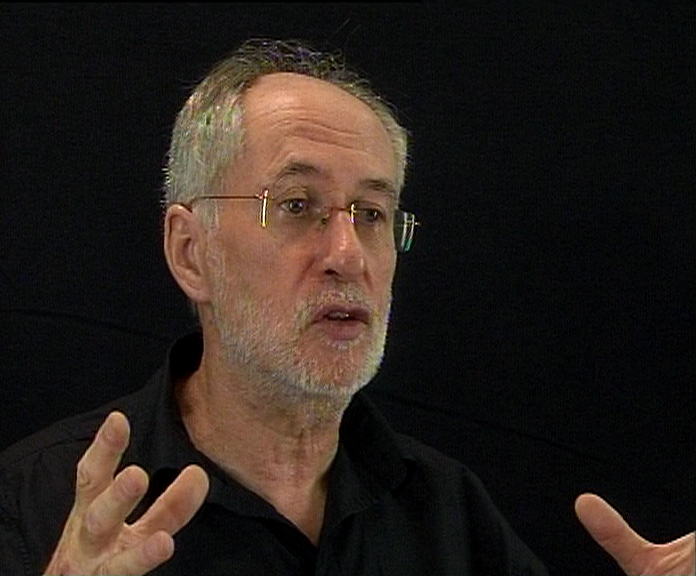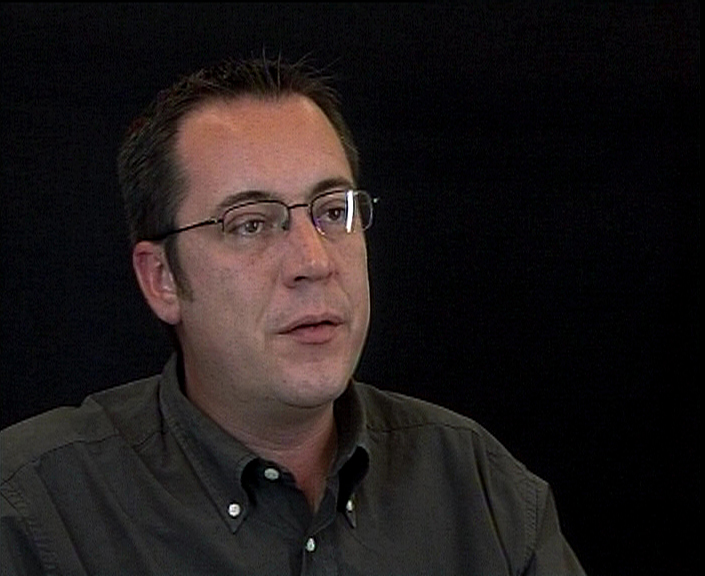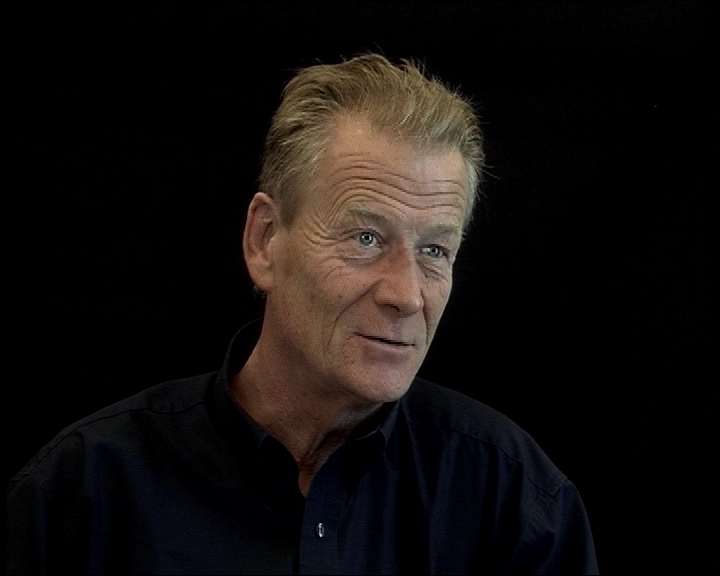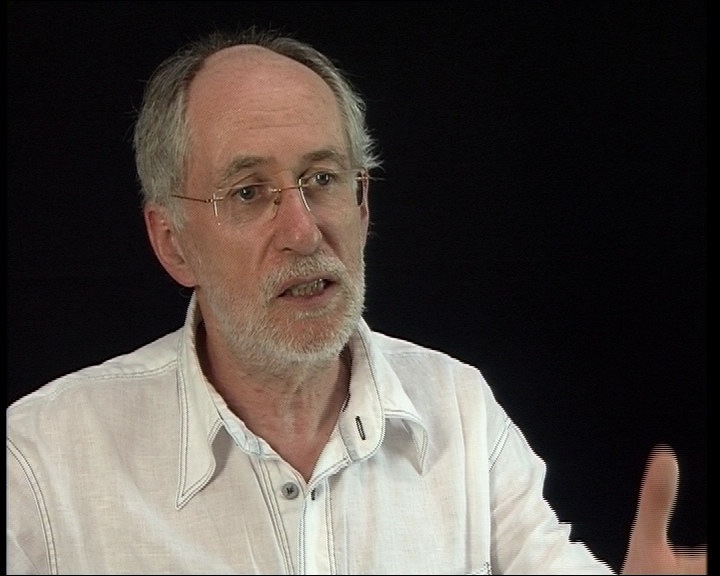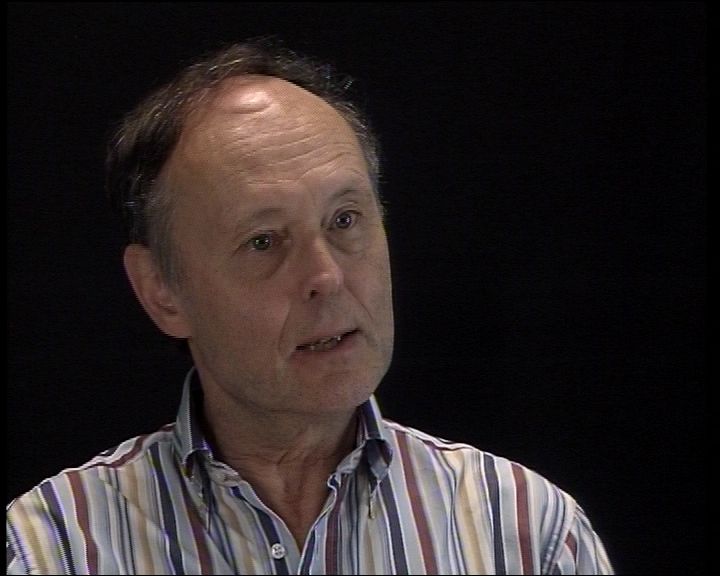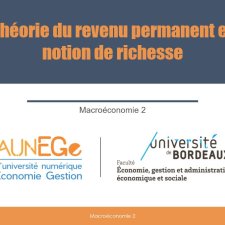Chapitres
- Préambule01'31"
- INTRODUCTION00'52"
- 1ère démonstration : les traits communs aux 3 négociations00'00"
- - A - Une définition de la négociation fondée sur l'histoire06'16"
- 2ème démonstration : les 2 niveaux des règles du jeu et la Conjoncture B04'46"
- - B - La négociation des valeurs et la nouvelle Question Normative02'32"
- - C - La bipolarité de la négociation contemporaine03'33"
- I. PARTIE EMPIRIQUE : Présentation des 8 études de cas01'16"
- - A - Négociation contrainte00'01"
- 1. Les serveurs de restaurant (Marie-Anne Dujarier)15'52"
- 2. Les "banquiers" chargés de clientèle (David Courpasson)06'57"
- 3. Les cadres rebelles (David Courpasson, Jean-Claude Thoenig)02'38"
- 4. Deux cas de néo-management : l'ISO et les ERP (Denis Ségrestin)00'00"
- - B - Coproduction normative00'59"
- 5. Les techniciennes de dossiers (Nathalie Richebé)04'19"
- 6. Les cadres rebelles (David Courpasson, Jean-Claude Thoenig)02'49"
- 7. Les nouveaux métiers de l'insertion (Jean-François Orianne)12'38"
- 8. Les Conseillers en Justice Réparatrice (Christophe Dubois)13'54"
- II. PARTIE THEORIQUE00'01"
- - A - Une nécessaire articulation avec les règles du jeu institutionnelles20'55"
- - B - Négociation contrainte, nouvelles pistes d'analyse14'31"
- - C - Retour sur la nouvelle Question Normative08'26"
Notice
La négociation contemporaine
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cinquième partie de l'Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l'Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - La négociation".
Les auteurs vous proposent de rencontrer Olgierd Kuty, Jean-François Orianne et Christophe Dubois, tous trois sociologues, pour aborder la question de la négociation contemporaine, au moment même où il est question de souffrance au travail, de stress, de violence au travail, de licenciements massifs ou d'exclusion.
L'analyse de la négociation contemporaine (depuis les années 1980), appelée aussi post-fordiste ou post-taylorienne, révèle une tension entre deux pôles microsociologiques : négociation contrainte d'un part, coproduction normative (négociation des valeurs) d'autre part, qui révèlent deux états de la régulation autonome. Elle succède à la négociation des Trente Glorieuses (1945-1975), celle des arrangements stratégiques clandestins, que les concepts de Crozier ont aidé à comprendre comme tournant autour d'une règle taylorienne. Aujourd'hui il faut approfondir davantage l'analyse dans deux directions : tout d'abord, le niveau institutionnel (méso) et son articulation au niveau micro; ensuite le monde des acteurs de la régulation de contrôle et la complexité de leurs relations internes, face à la régulation autonome.
Thème
Documentation
Citation,Bibliographie
Nota bene
Le texte qui suit est extrait de l’article « Les Formes d’organisation du travail dans les pays de l’Union Européenne » d’Edward Lorenz et Antoine Valeyre, que vous trouverez dans son intégralité ici.
« […] 1.2. Une typologie des formes d’organisation du travail en quatre classes
Les clivages mis en évidence par l’analyse des correspondances multiples se retrouvent, dans une très large mesure, dans la classification ascendante hiérarchique des salariés en fonction des variables d’organisation du travail. Cette classification permet d’établir une typologie des formes d’organisation du travail en quatre classes :
- les organisations « apprenantes » ;
- les organisations en lean production ;
- les organisations tayloriennes ;
- les organisations de structure simple.
Ces quatre classes se différencient principalement selon les deux dimensions les plus structurantes de l’analyse des correspondances multiples : d’une part, l’opposition entre les variables d’autonomie procédurale et de contenu cognitif du travail et les variables de contraintes de rythme de travail et, d’autre part, l’importance ou non accordée au travail en équipe, à la rotation des tâches et à la gestion de la qualité (cf. tableau 1).
Les organisations « apprenantes »
La première classe regroupe 39 % des salariés (9). Elle se caractérise par une sur-représentation des variables d’autonomie procédurale et de contenu cognitif du travail (apprentissage dans le travail, résolution de problèmes, complexité des tâches) et, dans une moindre mesure, des variables de gestion de la qualité (autocontrôle et normes précises), et par une sous-représentation des variables de contraintes de rythme, de monotonie et de répétitivité du travail. Elle constitue une classe d’organisations « apprenantes » du travail qui s’apparente au modèle sociotechnique suédois. Ce modèle est fondé sur le principe d’équipes autonomes de travail qui s’auto-organisent pour réaliser les objectifs établis avec la hiérarchie et dont les membres sont polyvalents sur l’ensemble des tâches des équipes. En rupture avec la conception taylorienne de division des tâches, il donne une plus grande intelligibilité au travail, ce qui conduit Freyssenet (1995) à le définir comme un modèle de « production réflexive ». Cette classe d’organisations « apprenantes » se rattache également au modèle de « travail en équipes autonomes à l’américaine » (Appelbaum, Batt, 1994) qui combine les principes du système sociotechnique suédois et ceux du management de la qualité. Relevons que cette classification conduit à des résultats surprenants : le travail en équipe ne constitue pas un élément caractéristique de cette classe d’organisation du travail et la rotation des tâches y est plutôt peu répandue. Ces résultats invitent à s’interroger sur l’accent, mis dans de nombreux travaux (10), sur l’importance des pratiques de travail en équipe et de polyvalence pour le développement des dynamiques d’apprentissage, d’initiative et d’amélioration continue dans le travail (11).
Les organisations en lean production
La seconde classe regroupe 28 % des salariés. Les pratiques de travail en équipe et de rotation des tâches et le management de la qualité (autocontrôle de la qualité et normes de qualité précises) y sont particulièrement développées. Simultanément, les salariés se voient imposer des contraintes de rythme de travail particulièrement lourdes et exécutent des tâches souvent répétitives et monotones. Si, comme dans les organisations « apprenantes », ils sont souvent confrontés à des situations d’apprentissage et de résolution de problèmes imprévus, ils bénéficient en revanche de bien moindres marges d’autonomie dans leur travail. Cette classe correspond au modèle d’organisation en lean production (MacDuffie, Krafcik, 1992 ; Womack, Jones, Roos, 1990) qui se caractérise classiquement par la polyvalence, le travail de groupe, la production en flux tendus et le management de la qualité totale. L’autonomie procédurale modérée des salariés de cette classe s’exerce sous de fortes contraintes de rythme et de respect de normes quantitatives de production et de normes de qualité précises. Elle procède donc des formes d’organisation en « autonomie contrôlée » (Appay, 1993 ; Coutrot, 1998). C’est dans cette classe que les contraintes de rythme de travail sont les plus élevées. On retrouve ainsi à échelle européenne le résultat selon lequel l’intensification du travail est particulièrement importante dans les organisations où se sont diffusés les systèmes de production en flux tendus (Valeyre [a] et [b], à paraître).
Les organisations tayloriennes
La troisième classe, qui regroupe 14 % des salariés, s’oppose dans une large mesure à la première. Comme dans les organisations en lean production, les salariés qui la composent sont soumis à d’importantes contraintes de rythme de travail, effectuent des tâches répétitives et monotones et sont astreints à des normes de qualité précises. En revanche, leur travail présente une faible autonomie procédurale, un faible contenu cognitif et l’autocontrôle de la qualité est peu répandu. Par ailleurs, le travail en équipe et la rotation des tâches y sont légèrement supérieurs à la moyenne. Cette classe correspond aux organisations tayloriennes du travail. L’importance relative du travail en équipe et de la rotation des tâches souligne l’ampleur que prennent les formes flexibles d’organisation taylorienne du travail, que ce soit sous la forme d'un « taylorisme flexible » (Boyer, Durand, 1993) ou d'un « taylorisme assisté par ordinateur » (Cézard, Dussert, Gollac, 1992 ; Linhart, 1994).
Les organisations de structure simple
Enfin, la quatrième classe, qui regroupe 19 % des salariés, tend à s’opposer à la seconde. Elle se caractérise essentiellement par une sous-représentation de presque toutes les variables d’organisation. Le travail n’y est pas très autonome, à faible contenu cognitif, peu contraint dans ses rythmes et peu répétitif, mais relativement monotone. Le travail en équipe, la rotation des tâches et la gestion de la qualité y sont peu diffusés. Cette classe s’apparente au modèle des organisations de « structure simple » (Mintzberg, 1982) caractérisées par une faible formalisation des procédures et un mode de contrôle par supervision directe exercée sur les salariés, soit par leur supérieur hiérarchique, soit par leur patron dans les petites entreprises. […] »
Lorenz E., Valeyre A., (2004), « Les formes d'organisation du travail dans les pays de l'Union européenne », Document de travail, n° 32, Centre d'Etude de l'emploi, pp. 10-14.
Notes de bas de page
9. La répartition des salariés dans les classes d’organisation du travail prend en compte la pondération des individus de l’enquête.
10. Voir notamment les travaux de Womack, John, Roos (1990), MacDuffie, Krafcik (1992) ou Osterman (1994).
11. Ces résultats peuvent aussi provenir du fait que le travail en équipe et la polyvalence sont définis de façon trop générale dans de nombreuses enquêtes. »
Bibliographie générale
- BAJOIT, M., (1988), "Exit, voice and loyalty ... and apathy". Les réactions individuelles au mécontentement", in Revue Française de Sociologie, n° 29 : 325-345.
- BELL, D., (1960), The end of ideology, New York, The Free Press.
- BELL, D., (1979), Les contradictions culturelles du capitalisme, Paris, PUF [1976].
- BELL, D., (1973), Vers la société post-industrielle, Paris, Laffont.
- BOLTANSKI L., CHIAPELLO E., 1999.- Le nouvel esprit du capitalisme. Paris, Gallimard.
- CALLON, M. (1986). Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques dans la Baie de Saint-Brieuc. L'Année Sociologique (36), 169-208.
- CHAUVENET, A., ORLIC, F., & BENGUIGUI, G. (1994). Le monde des surveillants de prison. Paris, Presses Universitaires de France.
- COHEN E., (2001), L'ordre économique mondial. Essai sur les autorités de régulation, Paris, Fayard.
- COMMAILLE J., & JOBERT B. (éds.), 1998.- Les métamorphoses de la régulation politique, Paris, LDGJ.
- COURPASSON D., 2000 - L’action contrainte. Paris, PUF.
- COURPASSON D. et THOENIG JC. (2008), Quand les cadres se rebellent. Paris, Vuibert.
- CROZIER M., 1963.- Le phénomène bureaucratique, Paris, Le Seuil.
- DALGALARRONDO, S., (2004), Sida : la course aux molécules. Paris, Editions de l'EHESS.
- DODIER, N., (2003), Leçons politiques de l'épidémie de sida, Paris, Editions de l'EHESS.
- DUBAR Cl., 2000, La crise des identités. Paris, PUF.
- DUBET F., (1994) Sociologie de l’expérience, Paris, Le Seuil.
- DUBOIS, C. (2008). Action publique en détention : décloisonnement, réinsertion et réparation Le cas d'une prison ouverte. Recherches sociologiques et anthropologiques 39 (2), 79-101.
- DUBOIS, C. (2009). La justice réparatrice en milieu carcéral : plasticité d’une fonction et malléabilité d’un concept criminologique. Thèse. Institut d'Etudes Politiques & Université de Liège, Paris, Liège.
- DUJARIER M-A., (2006), L’idéal au travail. Paris, PUF.
- FRIEDBERG, E. (1993). Le pouvoir et la règle dynamiques de l'action organisée. Paris, Le Seuil.
- GOULDNER, A.-W., (1954), Patterns of industrial bureaucracy. Glencoe, Ill., Free Press.
- GOULDNER, A.-W., (1954), Wildcat strike, New York, Antioch Press.
- GREMION, P., (2001), "L’État, l’Europe, la République", Esprit, juin, n° 275, pp. 142-156
- HIRSCHMAN A., (1972), Face au déclin des entreprises et des institutions. Paris, Editions ouvrières [1970]
- KUTY O. (1998), La négociation des valeurs. Paris-Bruxelles, De Boeck.
- KUTY O. (2008), "La naissance de la négociation (1933-1962). Mayo, Friedmann, Crozier et Reynaud" en ligne pour la revue SociologieS.
- LE BRAS, H. (1983), "L'interminable adolescence ou les ruses de la famille", in Le Débat (n° 25), pp 116-125.
- LEFEBVRE P. (2003), L’Invention de la grande entreprise. Paris, Presses universitaires de France.
- LELOUP P.-X., BARRE Ph., LEONARD E. & WALTHERY P., (2000), "La négociation collective en Belgique : Crise de l’emploi et modification du référentiel d’échange", in Recherches Sociologiques, pp 55-66).
- LINHART D. (2009), Travailler sans les autres ? Paris, Le Seuil.
- LORENZ E., VALEYRE A., (2004), "Les formes d'organisation du travail dans les pays de l'Union européenne", Document de travail, n° 32, Centre d'Etude de l'emploi.
- MARCH, J. et SIMON, H., (1963), Les organisations. Paris, Dunod [1955]
- MAZOWER, M., (2005), Le continent des ténèbres, Bruxelles, Complexe-CNRS-IHTP.
- MENDRAS, H., (dir.) (1980), La Sagesse et le désordre, Paris, Éditions Gallimard.
- MENDRAS, H., (1988), La Seconde révolution française (1965-1984), Paris, Éditions Gallimard.
- MILLY, B. (2001). Soigner en prison. Paris, Presses universitaires de France.
- MOSSE G.L., (1975), The nationalization of the masses, New York, Howard Fertig.
- MULLER, P., (1990), Les politiques publiques, Paris, PUF (Que Sais-je ?).
- ORIANNE, J.-F., & MAROY, C. (2008). Esquisse d’une profession consultante.
- Les intermédiaires du marché du travail en Wallonie. Formation Emploi, 102, 21-40.
- ORIANNE, J.-F., & CONTER, B. (2007). Les politiques d’employabilité en Belgique : traitement clinique des chômeurs et traitement statistique du chômage. Recherches Sociologiques et Anthropologiques, XXXVIII(2), 175-190.
- ORIANNE, J.-F. (2006). Politiques actives d’emploi et professionnels de l’employabilité : critique et clinique. Travail Emploi Formation, 6/2006, 53-92.
- ORIANNE, J.-F. (2005). "L’Etat social actif en action : troubles de l’employabilité et traitement clinique du chômage", in Cassiers I., Pochet P., & Vielle P., (Eds.), L’Etat social actif : vers un changement de paradigme ? (pp. 179-207). Peter Lang.
- PARSONS, T. (1967), The Structure of Social Action, Toronto Collier Mc Millan, New York, The Free Press [1937]
- REYNAUD, J-D, (1980), "Du contrat social à la négociation permanente", in MENDRAS, H., (dir.) (1980), La Sagesse et le désordre, Paris, Éditions Gallimard, pp 389-416.
- REYNAUD, J.-D., 1989, Les règles du jeu. L’action collective et la régulation sociale. Paris, Colin.
- REYNAUD, J.-D., et RICHEBE, N., (2007), "Règles, conventions et valeurs. Plaidoyer pour la normativité ordinaire", in Revue Française de Sociologie, 48-2, pp 3-36
- RICHEBE, N., (2002), "Les réactions des salariés à la "logique compétence": vers un renouveau de l'échange salarial ?", in Revue française de sociologie, 43, n° 1, pp. 99-126
- SAINSAULIEU, R., 1985, L’identité au travail. Paris, Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- SEGRESTIN, D., (2004), Les chantiers du manager, Paris, Armand Colin.
- SELZNICK, P. (1949). TVA and the grass roots; a study in the sociology of formal organization. Berkeley, Univ. of California Press.
- SIRINELLI J-F, (2005), Comprendre le XXème siècle français. Paris, Fayard.
- SPINEUX A., FRANCQ B., LELOUP P-X., BARRE Ph., LEONARD E. & WALTHERY P., Négocier l’emploi dossier 19 de l’ISST/UCL.
- TAYLOR, Ch., (1998), Les sources du moi, Paris, Le Seuil [1989].
- TOURAINE, A., (1984), Le retour de l’acteur, Paris, Fayard.
- VELTZ P., (2002), Des lieux et des liens. La Tour d'Aigues, Editions de l'Aube.
- WEBER, E., (1983), La fin des terroirs, Paris, Fayard.
- WIEBER (1967), The Search for Order (1977-1920), New York, Hill and Wang Editions.
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
La consommation culturelle
KutyOlgierdMontebelloFabriceLeverattoJean-MarcDeuxième partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - L’économie
-
La flexibilité
KutyOlgierdPichaultFrançoisXhauflairVirginieLeverattoJean-MarcQuatrième partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - L’Etat
-
L'innovation
TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcPremière partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - Introduction
-
Justice et management : enjeux et défis
KutyOlgierdSchoenaersFrédéricLeverattoJean-MarcTroisième partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - Le nouveau
-
L'Etat social actif
KutyOlgierdMacquetClaudeVranckenDidierLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Quatrième partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? » Les auteurs vous
-
Le nouveau management public
KutyOlgierdSchoenaersFrédéricLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Troisième partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? ». Les auteurs vous
-
Introduction à une socio-anthropologie des marchés
TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Première partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? ». Les auteurs vous
-
L'économie des singularités
KutyOlgierdKarpikLucienLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Deuxième partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? » Les auteurs vous
-
La négociation
KutyOlgierdLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Cinquième et dernière partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? » Les
-
A l'épreuve des inégalités culturelles
MagroRaymondLeverattoJean-MarcLa sociologie à l'épreuve des inégalités culturelles constitue le cinquième volet d'une série de cinq programmes consacrés aux inégalités sociales. Elles sont un objet récurrent pour les sociologues.
-
Sociologie de la musique et des amateurs
HennionAntoineLeverattoJean-MarcPremier volet du programme « Sociologie de l'art et de la culture », réalisé par Jean-Marc Leveratto, qui propose une introduction à l'analyse sociologique de la consommation culturelle. L'écoute de
Sur le même thème
-
Tokyo, plus grande « ville » au monde : aménager et gouverner la démesure
Languillon-AusselRaphaëlAvec ses quelques trente-cinq millions d’habitants, Tokyo est la « ville » la plus peuplée au monde, et l’une des métropoles les plus riches. Cette présentation vise à décrire, analyser et expliquer,
-
-
Les déterminants de la demande agrégée
Maveyraud-TricoireSamuelLes déterminants de la demande agrégée
-
La théorie du revenu permanent et la notion de richesse
Maveyraud-TricoireSamuelLa théorie du revenu permanent et la notion de richesse
-
Présentation du mécanisme du multiplicateur
Maveyraud-TricoireSamuelPrésentation du mécanisme du multiplicateur
-
-
Projet d'investissement : rentabilité et taux d'intérêt
Maveyraud-TricoireSamuelProjet d'investissement : rentabilité et taux d'intérêt
-
Les anticipations et la volatilité de l'investissement
Maveyraud-TricoireSamuelles anticipations et la volatilité de l'investissement
-
Les fonctions de consommation et d’épargne keynésiennes
Maveyraud-TricoireSamuelLes fonctions de consommation et d’épargne keynésiennes
-
La détermination du PIB à court terme
Maveyraud-TricoireSamuelLa détermination du PIB à court terme
-
Demande en biens et services et fluctuations conjoncturelles
Maveyraud-TricoireSamuelDemande en biens et services et fluctuations conjoncturelles
-