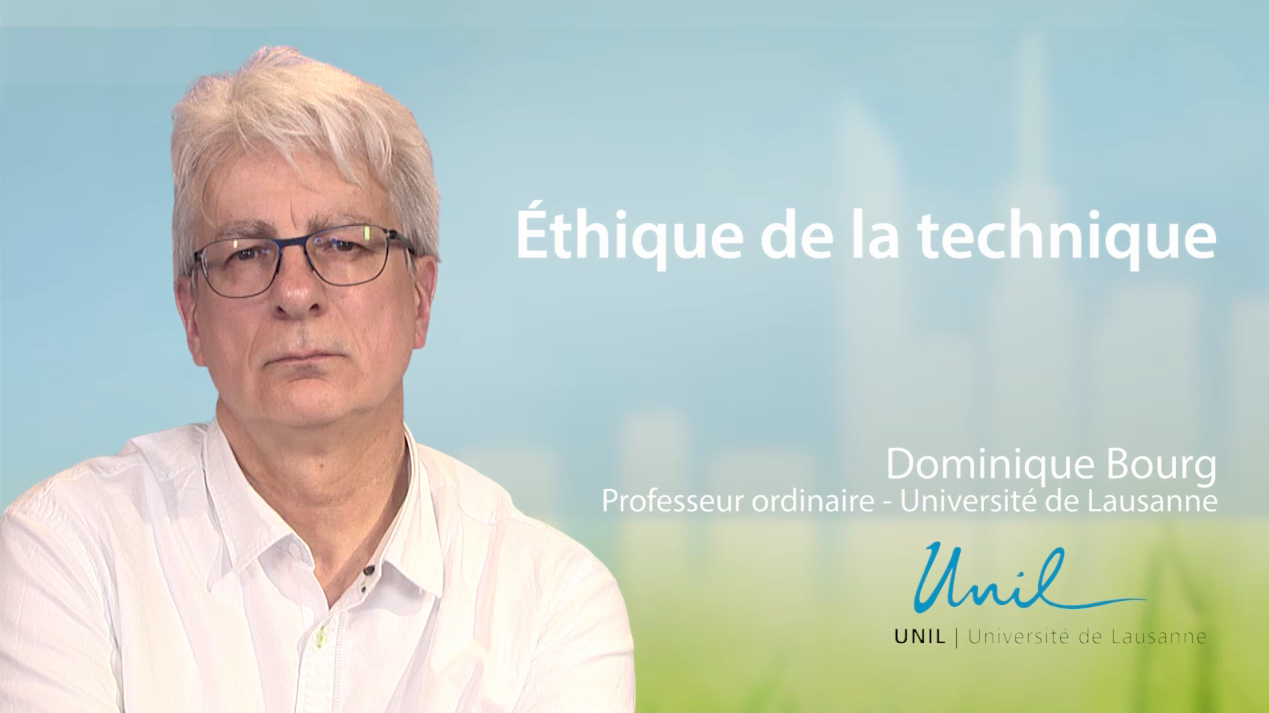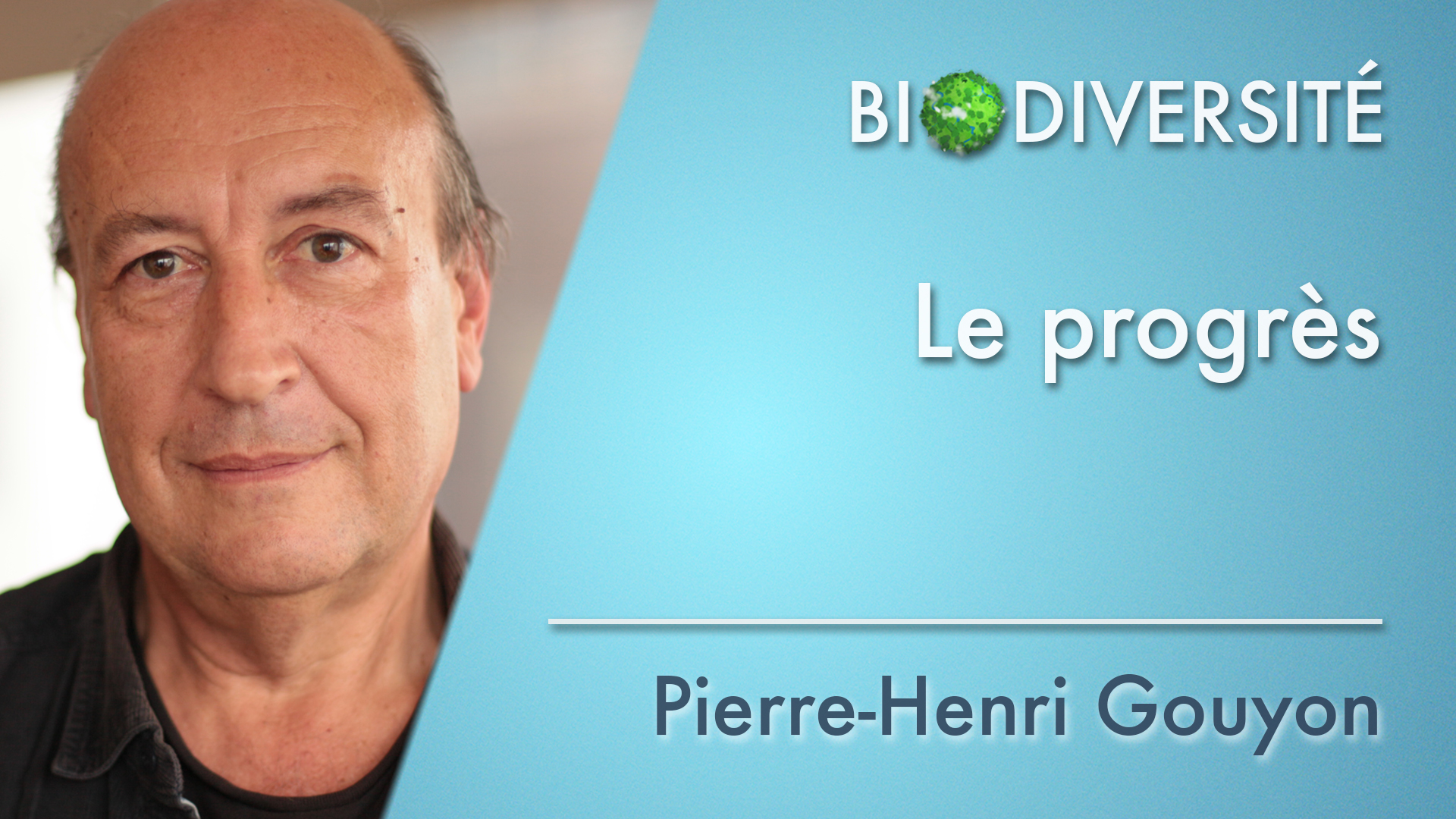Notice
02 - Évocations de la ville industrielle (1) - Anne-Céline Callens et Guillaume Gomot
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Anne-Céline Callens - La ville industrielle dans l’oeil des créateurs de l’avant-garde : liens entre photographie et cinéma dans l’Europe de l’entre-deux-guerres
EnEurope, durant l’entre-deux guerres, alorsque l’industrialisation progresse fortement, cinéastes et photographes del’avant-garde manifestent une même vision positive des avancées scientifiqueset techniques, celles-ci constituant pour eux un moyen de porter le monde versdes jours meilleurs. Au-delà d’un attrait commun pour les motifs industriels,leurs images témoignent d’une certaine proximité formelle. L’engagement enfaveur de l’industrie se traduit par une recherche d’esthétisme.
Dans Berlin,symphonie d’une grande ville (1927), Walther Ruttmann rendcompte du rythme intense de la ville en pleine expansion en juxtaposant desplans à une cadence soutenue. L’année d’après,Joris Ivens réalise un courtmétrage sur le pont du Port Royal de Rotterdam. Lemontage est dynamique : l’édifice est appréhendé par des angles basculés et desplans resserrés qui se succèdent rapidement. Cette apologie du mouvement seretrouve chez les photographes de la Nouvelle Vision qui rejettent le statisme auprofit de la vitalité à travers l’utilisation de la contre-plongée et des vuesobliques qui créent des perspectives inédites et des lignes divergentes serépétant et se croisant sans cesse. Une même fascination se manifeste pour lesarchitectures métalliques, les machines et les objets issusde la fabrication mécanique sérielle.
Au-delàd’une inspiration commune pourles formes industrielle, qui semblent propices à un traitement novateur,certains créateurs répondent aux commandes des industriels en parallèle deleurs recherches personnelles. Il en va ainsi de Joris Ivens qui réalise en1931 son court-métrage Philips Radio (Symphonieindustrielle) pourla société Philips et de photographes comme André
Kertész,Germaine Krull, Man Ray, Henry Lachéroy et François Kollar, qui travaillent demanière suivie pour l’industrie.
L’aspect inédit de toutes ces images tient à la fois au motif industriel et à l’outil. Les capacités techniques de la caméra permettent aux créateurs d’innover : arrêts sur image, surimpressions, accélérations et ralentis sont déployées dans L’Homme à la caméra (1929) de Dziga Vertov tandis que photomontages et surimpressions sont couramment expérimentés dans en studio. Les créateurs de l’avant-garde partagent une vision positive de l’outil technique : l’appareil photographique est considéré par les opérateurs de la Nouvelle Vision comme le prolongement du corps, troisième œil capable de figer l’instant et de dévoiler des pans d’une réalité inaccessibles à l’oeil nu ; dans la théorie du « ciné-oeuil », la caméra est également considérée comme un oeil machinique se combinant au regard de l’opérateur. Photographie et cinéma se rejoignent ainsi dans cette conception mécaniste d’un rapport étroit entre l’homme et la machine.
Guillaume Gomot - Hauts-fourneaux infernaux : The Deer Hunter de Michael Cimino
Parmi les nombreux films américains prenant pourcadre une ville industrielle, The Deer Hunter (Voyage au bout de l’enfer, 1978)de Michael Cimino se distingue par la puissance symbolique de sa mise en scène.En effet, on se propose de montrer dans cette contribution comment lesinventions filmiques de Cimino lui permettent de transformer la toile de fonddes usines, simple décor industriel en apparence, en un élément cardinal de sonfilm.
Dans son intrigue, The Deer Hunter entremêle des séquences se déroulant dans lapetite ville de Clairton en Pennsylvanie (dont l’économie est entièrementfondée sur la sidérurgie) et d’autres au Viêt Nam, pendant lesquelles lesjeunes ouvriers de Clairton devenus soldats sont mis à l’épreuve d’une violenceinsoutenable, qui les poursuit, et les détruit parfois, à leur retour auxÉtats-Unis.
Le film tout entier peut ainsi être compris et interprété à travers l’analysedes modes de figuration de la ville industrielle dans laquelle il se déroule,qui lui confère une chair sociale, politique mais aussi métaphysique, voiremythologique, comme on le verra (les premiers plans semblent nous plongerd’emblée au cœur des forges d’Héphaïstos).
La force visuelle de Cimino et son brio dans l’art des métamorphoses filmiques(la ville qu’il recompose n’est pas le « vrai » Clairton) concourentà créer, dans une œuvre traversée par la mort et le sacré, une poétique desusines très originale, sollicitant toutes les ressources de la mise en scènecinématographique (scénographie et mobilité du cadre, variations scalaires,montage notamment). Sur un plan politique et social, le décor industrieldétermine la vie matérielle de la communauté ouvrière d’origine russe que meten scène le film, à travers l’habitat et l’implosion des structures familialesqu’il entraîne. En contrepoint de la guerre mortifère, la ville industrielle aucinéma trouve ainsi dans The Deer Hunter une forme exceptionnelle etprofondément évocatoire.
Intervention
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
01 - Témoin à charge : quand le cinéma révèle la ville industrielle, ses aventures et mésaventures
PaquotThierryOuverture du colloque et conférence introductive Témoin à charge : quand le cinéma révèle la ville industrielle, ses aventures et mésaventures A travers cette conférence inaugurale, il est
Sur le même thème
-
Table ronde 1 / Utopistics in an Age of Uncertainty?
WilliamsGregory P.Table Ronde 1 | Synthèse de l'œuvre d'Immanuel Wallerstein Intervenant : Gregory P. Williams (par zoom), Utopistics in an Age of Uncertainty Modérateur : Thierry Paquot
-
Le temps des lumières
LiltiAntoineSebastianiSilviaCallardCarolineOrainArnaudAlors que la pandémie nous a plongés dans un présent perpétuel tandis que la crise climatique bouleverse nos représentations du futur, au moment où le passé sert de refuge à certains de nos
-
Société inclusive : une question d'actualité - Les droits comme leviers de la société inclusive
AartsenMarjaCisternas ReyesMaría SoledadHôteJean-MichelKornfeld-MatteRosaComment l’approche par les droits peut être mobilisée par la communauté internationale et nationale pour tendre vers des sociétés plus inclusives ?
-
Les risques du transhumanisme sont-ils ceux dont on parle ?
Dans les débats sur les promesses du transhumanisme on questionne l’immortalité, le contrôle de l’ humanité par la machine intelligente, ou la modification de notre génome. Il faudrait plutôt s
-
Réguler l'insondable : Le droit face à l’homme augmenté
Il s'agit ici de réfléchir à ce que veut dire le fait de "réguler" le transhumanisme, puisque nombreux sont les appels à ce que cela soit le cas, en tentant de définir le transhumanisme et en
-
Numérique et menace sur notre souveraineté anthropologique
Je partirai de la notion de souveraineté et en indiquerai les sens possibles. L’un est la souveraineté que nous exerçons au quotidien sur notre environnement et nous-mêmes. Je montrerai alors en quoi
-
5. Éthique de la technique
BourgDominiqueDans cette vidéo, Dominique Bourg discute de l'évolution des techniques et de l'avènement d'une idéologie du progrès. Face à la puissance atteinte, il souligne l'importance d'une éthique de la
-
11. Le progrès
GouyonPierre-HenriPierre-Henri Gouyon s'appuie sur un exemple - Dédale - pour montrer les effets et risques d'une conception du progrès basée uniquement sur la technologie.
-
Penser un autre futur
PeyraultMalikaMillerRielCaronJean-FrançoisMichelPatrickL’EHESS poursuit son cycle de débats "Les Agendas du Politique" sous l’égide du laboratoire d’excellence Tepsis Aux perspectives de progrès a succédé un avenir lourd de menaces : le climat se
-
FORUM MOI ET MA SANTE A METZ: "Environnement et santé : Sommes-nous menacés par le progrès ?
MargoIsabelleDate : vendredi 28 juin 2013 Horaires : 17h30 Lieu : Cinéma Palace Metz Sommes-nous menacés par le progrès ? Ondes électromagnétiques, portables, Leds, pesticides, OGM... Sommes-nous
-
L’espoir à l’épreuve du progrès
CoiffetJean-ClaudeComment aider l’homme à sortir de la désespérance où le plonge l’angoisse existentielle de nos sociétés modernes individualistes ? Par l’espoir ou par le progrès, deux réponses distinctes, pour ne pas
-
06 - Introduction de la 2ème journée
La place de la science dans la société s’est modifiée au cours des dernières décennies, à la fois du fait des scientifiques eux-mêmes, mais aussi des risques liés à l’idée de progrès qu’elle pouvait