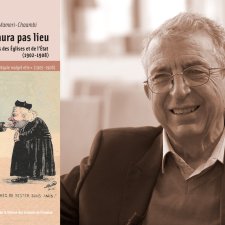Chapitres
- Présentation de l'ouvrage00'49"
- Que défendre ?00'41"
- Choix du temps partiel des chômeurs01'25"
- Modèle allemand00'57"
- Temps partiel que pour les chômeurs ?00'38"
- Intérêt du service public d'emploi00'54"
Notice
Rationner l'emploi - Interview de Hadrien Clouet
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Interview de Hadrien Clouet, dans le cadre de la sortie du livre Rationner l'emploi : La promotion du temps partiel par les services publics d'emploi allemand et français, publié le 10 février 2022 et disponible sur le site des Éditions de la Maison des sciences de l'homme.
Alors que le nombre d'inscrits dans le service public d’emploi allemand et français atteint des records historiques, cet ouvrage s’intéresse à leur prise en charge et à leur trajectoire. En comparant l’expérience respective des usagers et des conseillers dans les deux institutions, il explique pourquoi un grand nombre de chômeurs sont dirigés vers des emplois à temps partiel, alors que les conseillers ne sont pas enthousiasmés par cette idée. Il souligne ainsi le rôle du service public d’emploi (sa structuration interne, la division du travail qui y règne et les outils fournis aux conseillers) à l’égard de la précarisation sur le marché de l’emploi. Pour cela, l’auteur mobilise plusieurs mois d’immersion au sein d’agences, des dépouillements d’archives historiques et des traitements de données statistiques. Son ouvrage se singularise par rapport aux enquêtes antérieures sur le service public d’emploi : d’abord, il procède à une comparaison franco-allemande point par point, qui permet de confronter l’expérience concrète qu’en font les publics ; ensuite, il permet de comprendre comment la précarité est construite par le biais d’échanges administratifs entre quatre murs.
Intervention
Thème
Documentation
Transcription ITW Hadrien Clouet RATIONNER L'EMPLOI
Le projet est d’abord né d’un intérêt pour les questions de temps de travail en France et en Allemagne, essayer de comprendre comment on pouvait expliquer le fait que dans les deux pays, les personnes n’avaient pas du tout la même manière d’exercer leur emploi, ne travaillaient pas à la même durée, et notamment qu’il y avait des inégalités très fortes entre les femmes et les hommes d’une part, mais aussi entre les personnes au chômage et les personnes en emploi durablement. Ils ne faisaient pas les mêmes choix d’activités. Donc, c’est une première interrogation et qui s’est muée en surprise une fois arrivé sur les terrains de recherche, en immersion dans des agences, lorsque je me suis rendu compte qu’il y avait finalement assez peu de choix effectués par les chômeurs et les chômeuses. C’était rarement eux qui décidaient d’occuper un emploi à une durée donnée par semaine, souvent à temps partiel, mais plutôt des propositions qui leur étaient faites et qui étaient concentrées sur certaines personnes pour occuper certains types d’emplois.
Ce livre essaye de renverser une perspective un peu classique en sociologie, à savoir l’idée selon laquelle les individus vont sur le marché du travail, cherchent du boulot, essayent de trouver un contrat et parfois ils y arrivent, parfois ils n’y arrivent pas. J’ai la tentative inverse, c’est-à-dire qu’il me semble qu’on peut comprendre le marché de la manière suivante : ce sont les emplois qui vont aux personnes tout autant que les personnes vont aux emplois. C’est-à-dire que des institutions, des agents administratifs, des dispositifs existants amènent l’emploi aux gens, et c’est ça qui m’intéressait, de comprendre quels emplois sont proposés aux personnes et pas juste quels emplois les gens essayent de trouver par eux-mêmes.
Il y a beaucoup d’explications différentes sur le résultat principal de l’enquête. Les chômeurs prennent des emplois le plus souvent à temps partiel, en tout cas très souvent à temps partiel. Premièrement, il y a des dispositifs d’incitations financières. La manière dont l’assurance chômage est conçue les encourage à prendre de petits boulots, de petits emplois qui leur rapporteront un peu plus d’argent que leurs allocations. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles ils sont reçus par les conseillères, notamment, et les conseillers du service public d’emploi dans les deux pays conduisent à ce que certaines propositions d’offre à temps partiel soient adressées à certaines populations - les plus jeunes, notamment du côté français, les gens issus de l’immigration du côté allemand - pour des raisons qui tiennent aux contraintes qui pèsent sur les conseillères et les conseillers, qui n’ont pas beaucoup d’offres et qui sont obligés de faire avec ce qu’ils ont sur le marché pour eux-mêmes réussir à accomplir leur activité. Troisièmement, on a un rôle tout à fait marquant, mais très peu visible des dispositifs numériques, c’est-à-dire les moteurs de recherche sur les sites Internet des services publics d’emploi français et allemands qui ne permettent pas de rechercher les mêmes choses, qui ne permettent pas de rechercher exactement librement tous les emplois qu’on voudrait. Par exemple, du côté français, vous pouvez mettre le nombre d’heures par semaine que vous voulez exercer, du côté allemand, vous pouvez uniquement choisir entre temps plein et temps partiel. Donc, vous êtes tout à fait à la main des choix des employeurs et vous devez subir la manière dont eux comprennent ce qu’est une durée d’emploi lorsque vous vous rendez à l’entretien d’embauche.
Il n’y a ni modèle allemand ni modèle français. C’est un des résultats qui me semble très intéressant dans l’ouvrage. Tout va dépendre de l’agence dans laquelle sont reçues les personnes. Le service public d’emploi est donc extrêmement fragmenté, et selon les conditions dans lesquelles exercent les agents localement, le rapport aux employeurs locaux, le nombre de demandeuses et de demandeurs d’emploi qu’ils ont à gérer, les outils dont ils disposent, les indicateurs de performance qu’on leur impose, bref, tout cela constitue une marge de manœuvre très forte, en toute autonomie, d’agence en agence. Et on voit que d’un site à l’autre, lorsqu’on fait, comme j’ai procédé dans l’ouvrage, qu’on s’immerge pendant plusieurs mois dans une agence, on voit que d’un site à l’autre, ce ne sont pas les mêmes préoccupations qui animent les agents. Ils n’ont pas les mêmes manières de mener à bien leur activité. Donc, on a un éclatement. Et ce que je montre avec les quatre agences étudiées, c’est qu’en France et en Allemagne, il y a à chaque fois deux agences où le temps partiel est récurrent et deux agences où le temps partiel est bien moins fréquent.
Cette question du temps partiel ne concerne pas uniquement les chômeurs, mais l’ensemble du salariat. Parce qu’en effet, dès lors qu’on a des millions de personnes prêtes à prendre de l’emploi à temps partiel parce qu’elles sont au chômage, ça veut dire que vont être mises sur le marché des offres d’emploi à temps partiel qui sont peut-être pensées pour les chômeurs, mais vont aussi être prises par d’autres personnes, qui sont déjà en emploi, qui vont y postuler. Et généralement, on aboutit à un raccourcissement global des durées hebdomadaires de travail qui vont affecter aussi les salariés aujourd’hui en poste, mais qui peut-être demain seront au chômage, voire auront des collègues autour d’eux et autour d’elles qui passeront à temps partiel.
Le service public d’emploi n’est pas simplement le miroir de ce qui se joue sur le marché du travail. Les individus qui y œuvrent ont des marges de manœuvre, ont une capacité à accompagner les personnes. En fait, ce qui se joue dans le service public de l’emploi, c’est l’ordre de la file d’attente du chômage. C’est-à-dire qu’on a une file d’attente dans les deux pays, des gens arrivent, s’inscrivent au chômage, et très souvent, ce sont les premiers arrivés dans la file d’attente qui sont les premiers servis pour trouver des emplois, d’où le chômage de longue durée. Lorsqu’on est au chômage depuis très longtemps, on est en général dans les derniers servis et il faut vraiment qu’il y ait beaucoup d’offres d’emploi en circulation pour réussir à en avoir une. Mais ce qui se joue à l’intérieur du service public d’emploi, c’est l’ordre de ces gens, c’est-à-dire qui sera éligible d’abord à un emploi et qui, au contraire, sera parmi les derniers éligibles lorsque des offres d’emploi seront récoltées.
Dans la même collection
-
La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1…
BaubérotJeanInterview de Jean Baubérot, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1908). Tome III
-
Harlem, une histoire de gentrification
RecoquillonCharlotteInterview de Charlotte Recoquillon, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : Harlem, Une histoire de la gentrification.
-
Oksana Mitrofanova - France-Ukraine
MitrofanovaOksanaInterview de Oksana Mitrofanova, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : France-Ukraine
-
L'Impressionnisme à ses frontières
ClaassVictorInterview de Victor Claass, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : L' Impressionnisme à ses frontières
-
Fabio Viti - La guerre au Baoulé. Une ethnographie historique du fait guerrier.
VitiFabioInterview de Fabio Viti, dans le cadre de la sortie de son ouvrage La guerre au Baoulé. Une ethnographie historique du fait guerrier.
-
Les expulsés, sujets politiques
LecadetClaraInterview de Clara Lecadet, dans le cadre de la sortie de son ouvrage Les expulsés, sujets politiques.
-
L'esprit politique des savoirs
CommailleJacquesInterview de Jacques Commaille, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : L'esprit politique des savoirs », publié le 12 octobre 2023
-
Alessandro Gallicchio - Nationalismes, antisémitismes et débats autour de l'art juif
GallicchioAlessandroInterview d'Alessandro Gallicchio, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Nationalismes, antisémitismes et débats autour de l'art juif".
-
Dépouiller en toute légalité. L'aryanisation économique des biens juifs en Algérie sous le régime d…
LaloumJeanInterview de Jean Laloum, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : Dépouiller « en toute légalité », publié en septembre 2023.
-
Rémy Péru-Dumesnil - Les États-Unis en Guyane durant la Seconde Guerre Mondiale
Péru-DumesnilRémyInterview de Rémy Péru-Dumesnil, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Les États-Unis en Guyane durant la Seconde Guerre Mondiale".
-
Interview de Séverine Autesserre pour son ouvrage "Sur les fronts de la paix"
AutesserreSéverineDans Sur les fronts de la paix, Séverine Autesserre, chercheuse primée et activiste, examine l’industrie de la paix, si bien intentionnée et pourtant si défectueuse. En s’appuyant sur des cas du monde
-
Dimitri Minic - Pensée et culture stratégiques russes
MinicDimitriInterview de Dimitri Minic, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Pensée et culture stratégiques russes", en librairie le 20 avril 2023.
Sur le même thème
-
Société inclusive : une question d'actualité - L’action collective comme levier de la société inclu…
WalkerAlanAartsenMarjaHarperSarahHôteJean-MichelKornfeld-MatteRosaCisternas ReyesMaría SoledadFougeyrollasPatrickRobinJean-PierreComment les associations ou les collectifs – à travers leurs mobilisations et leurs actions quotidiennes – influencent les politiques et l’action publiques en faveur de sociétés plus inclusives ?
-
LES ORGANISATIONS FACE À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
Journée d’étude FAIR | Mercredi 14 octobre Comment suivre la prise en compte dans les stratégies des organisations des impacts de leurs activités sur la transition écologique et sociale ?
-
Le renoncement aux soins des chômeurs en France - PUDN
MalrouxInèsPrésentation publique d'un article en cours de publication, réalisé dans le cadre de la formation de l'Ecole Universitaire de Recherche des Hautes Etudes en Démographie. L'article porte sur le
-
La santé sociale des régions françaises : 2008-2016
MédaDominiqueJany-CatriceFlorenceMarlierGrégoryDans les années 2000, nous avions élaboré en région Hauts-de-France un « indicateur de santé sociale » qui estimait, pour l’année 2004, le bien-être social des régions françaises. Fruit d’un processus
-
Portrait Halage
BerdouletStéphaneL’association Halage porte des projets sur l’Ile Saint Denis permettant de répondre à des problèmes de précarité économique et de pollution environnementale.
-
Le métier d'ingénieure environnement
DelmasHélèneHélène Delmas vous présente son métier d'ingénieure environnement au sein du groupe Eiffage et elle vous explique comment elle est amenée à travailler dans le cadre du projet d'écoquartier
- Compétence
- Emploi
- Construction
- Choix de carrière (choix d'un métier, orientation professionnelle, perspectives de carrière et d'emploi)
- Génie civil (aspects techniques de l'architecture du paysage, de l'utilisation d'énergie dans la construction ; construction, génie des bâtiments et des travaux publics, moyens de communication, techniques de l'architecture du paysage, travaux publics)
-
Le métier d'experte en calcul carbone
BoyeauIsabelleIsabelle Boyeau vous présente son métier d'experte en calcul carbone au sein du groupe Eiffage et elle vous explique comment elle est amenée à travailler dans le cadre du projet d'écoquartier
-
Le métier de responsable HSQE
Berben-BonannoGuinevereGuinevere Berben-Bonanno vous présente son métier de responsable HSQE (hygiène, sécurité, qualité, environnement) au sein du SITCOM 40.
-
Le métier de responsable de la gestion des connaissances
VillanuevaDenaDena Villanueva vous présente son métier de responsable de la gestion des connaissances au sein du groupe Eiffage et elle vous explique comment elle est amenée à travailler dans le cadre du projet
-
Le métier de responsable logistique
AvrilMathieuMathieu Avril vous présente son métier de responsable logistique au sein d'un magasin HyperU.
-
Le métier de responsable de la marque Greet au sein du groupe Accor
GuémenéPascalPascal Guémené vous présente son métier de responsable de la marque Greet au sein du groupe ACCOR.
-
Le métier de chef d'unité territoriale des espaces verts
VrbovskaXavierXavier Vrbovska vous présente son métier de chef d'unité territoriale des espaces verts, exercé au sein de la Métropole de Bordeaux.