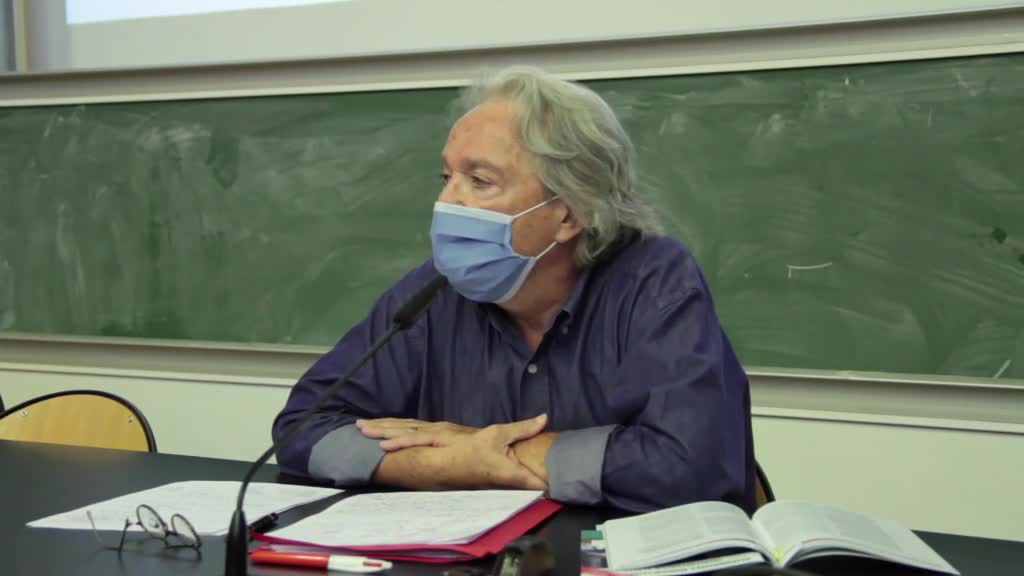Notice
Crise et catastrophes du système Terre : réflexions d'histoire et philosophie des sciences
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Dans le cadre des conférences de rentrée de l'institut SoMuM
Crise, transition ou déstabilisation durable des sociétés ? L'apport des sciences humaines et sociales
Sébastien Dutreuil
Chercheur au Centre Gilles Gaston Granger (AMU, CNRS, CGGG)
Spécialiste en philosoophie des sciences de la terre
Trois questions
1. Quelle place la question des mutations des sociétés occupe-t-elle dans vos travaux de recherche ?
Elle est méthodologiquement inscrite dans la discipline dans laquelle je travaille, l’histoire et la philosophie des sciences, ou du moins dans certains des courants de cette discipline, au sein desquels je m’inscris : ceux visant à faire une histoire des sciences « en société », inscrivant l’histoire des sciences dans une histoire plus large, et attentifs aux transformations matérielles corrélatives des transformations scientifiques. Pour ce qui est du champ plus spécifique dans lequel je travaille, l’histoire et la philosophie des sciences de la Terre et de l’environnement, on ne peut faire abstraction, par exemple, du contexte de guerre froide dans lequel les disciplines contemporaines comme la géophysique (de la sismologie à la climatologie physique) ont pris leur essor, pas plus qu’on ne peut ignorer les interactions constantes entre l’élaboration de ces savoirs sur l’environnement global et les dimensions normatives dont ils sont porteurs en termes de « politiques environnementales ».
2. Quel rôle le chercheur a-t-il dans la construction de nouvelles représentations du monde ? Doit-il participer à l’élaboration de scénarii du futur ou doit-il exercer une veille pour lutter contre les idées reçues, les mésusages et les manipulations du futur (nouveaux millénarismes, « Grand remplacement », « Collapsologie »…) ?
Evidemment la réponse à la seconde question dépend de la discipline de la chercheuse concernée : il est des disciplines pour lesquelles l’élaboration de scénario futurs est le cœur de métier ! Pour ce qui concerne les sciences humains et sociales, et l’histoire et la philosophie des sciences plus particulièrement, bien sûr que les chercheuses et les chercheurs ont un rôle important à jouer pour accompagner les déplacements ontologiques (ou de représentation) corrélatifs des bouleversements écologiques contemporains. Cela ne passe d’ailleurs pas nécessairement par un travail critique des idées influentes, mais peut aussi passer par un travail plus positif, visant à faire l’histoire du présent pour comprendre les trajectoires (matérielles comme théoriques) qui nous ont conduit dans la situation contemporaine, ou à mettre en lumière des conceptions oubliées ou négligées, à repérer des liens entre des questions considérées classiquement comme déconnectées, etc.
3. En quoi l’échelle méditerranéenne en tant que terrain d’observation peut-elle contribuer à nourrir votre réflexion ?
Je voudrais m’appuyer ici sur les travaux importants de l’historien des sciences espagnol Lino Camprubi, qui mène un travail au long cours, précisément sur cette question. À partir de ses travaux, on voit premièrement que la méditerranée a souvent fonctionné dans l’histoire des sciences comme un modèle de l’océan global. Il montre ainsi comment des savoirs élaborés sur la méditerranée, ceux de Carpenter à la fin du XIXe siècle, ou de Stommel au milieu du XXe siècle, notamment sur la circulation des masses d’eau, ont été transposés pour appréhender la circulation de l’océan global (Camprubi 2018). Ce premier point lui permet d’en souligner un deuxième, qui rejoint des thèses importantes en histoire et sociologie des sciences : la construction de savoirs globaux, ce processus actif de globalisation, se fait nécessairement depuis un point de vue particulier, et se construit, pièce par pièce. Troisièmement, la méditerranée est un exemple très représentatif du contexte de guerre froide dans lequel ont été élaborés les savoirs globaux sur l’environnement. Lorsque Kennedy a dû retirer ses missiles nucléaires de la Turquie, la méditerranée est devenue un lieu stratégique où faire circuler des sous-marins nucléaires (Camprubi 2020). Faire naviguer des sous-marins sans qu’ils ne soient détectés a nécessité l’élaboration de savoirs géophysiques complexes sur la structure physique (e.g. température et salinité) des masses d’eau. Camprubi souligne également l’importance des débats juridiques pour faire reconnaître que le détroit de Gibraltar, stratégique porte d’entrée en méditerranée, était bien en territoire espagnol et marocain, et ne relevait pas des eaux internationales. Ces questions juridiques, reposant sur le droit maritime hérité de Grotius, font émerger des questions importantes de souveraineté qui se posent aujourd’hui, sans doute d’une autre manière, mais non dénuée de liens et d’analogies avec le cas méditerranéen, lorsqu’il est question de techniques de géogingénierie visant à modifier l’océan ou l’atmosphère à une échelle globale.
Dans la même collection
-
Introduction de la conférence de rentrée 2020 et présentation de l'institut SoMuM
RenaudetIsabellePremière conférence de rentrée de l'institut SoMuM, 17 septembre 2020 Crise, transition ou déstabilisation durable des sociétés ? L'apport des sciences humaines et sociales Isabelle Renaudet
-
Réflexions en anthropologie de la santé : plis et agencements d'une pandémie en Afrique de l'Ouest
JaffréYannickPremière conférence de rentrée de l'institut SoMuM, 17 septembre 2020 - Crise, transition ou déstabilisation durable des sociales ? L'apport des sciences humaines et sociales