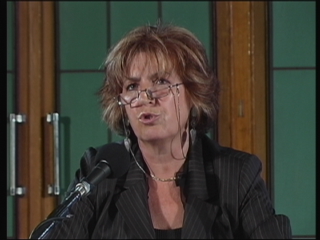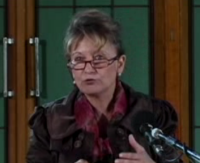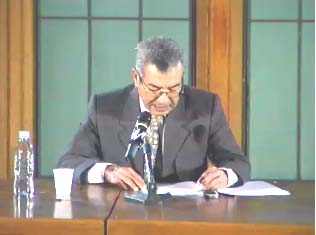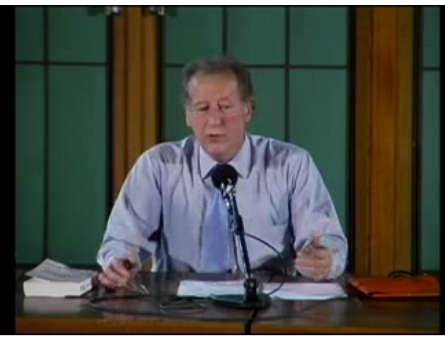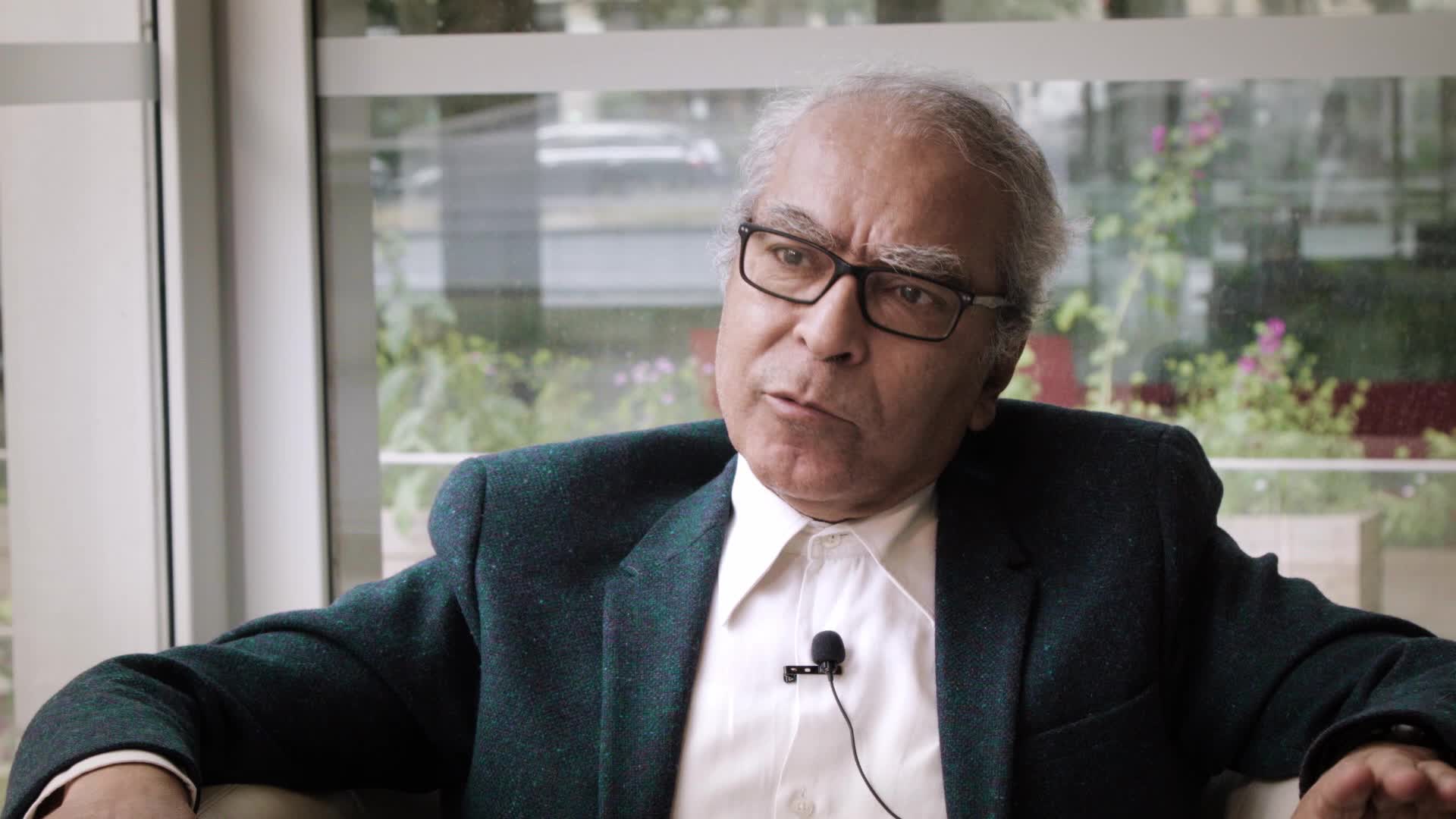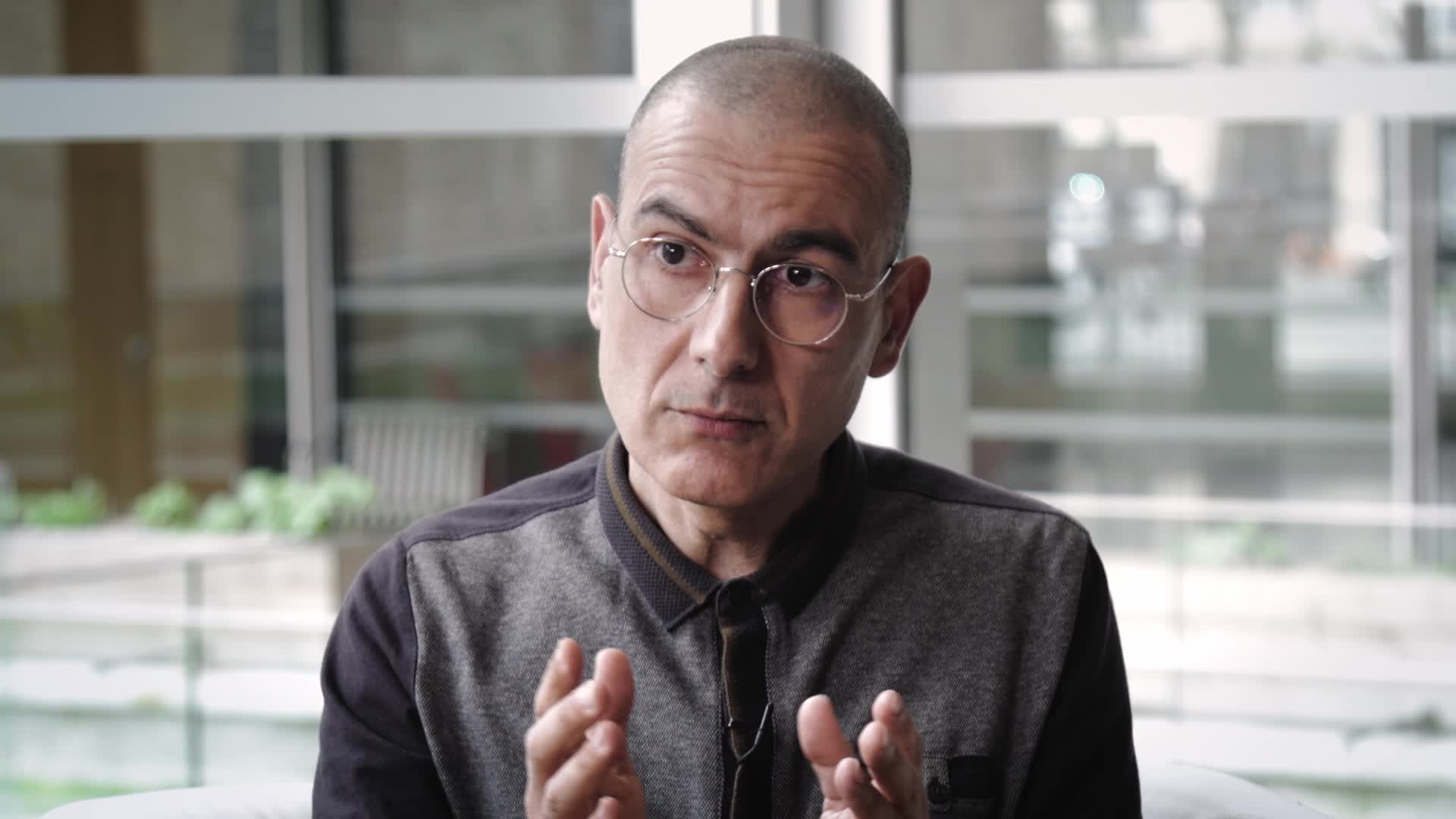Chapitres
- Présentation de Hamit Bozarslan01'23"
- Introduction de Hamit Bozarslan14'39"
- Hétérogenéité de l'islamisme08'25"
- Le nouveau radicalisme : Al Qaida19'31"
- Conclusion de Hamit Bozarslan02'59"
- Questions25'02"
Notice
L'islamisme aujourd'hui - Hamit Bozarslan
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Au tournant des années 1999-2000, un certain nombre d’ouvrages sont parus qui annonçaient la fin de l’islamisme. En France, l’un des plus marquants est celui de Gilles Kepel : Jihad, expansion et déclin de l’islamisme (2000). La thèse de l’impasse, voire de l’échec de l’Islam politique, avancée d’abord par Olivier Roy au début des années 1990, semble trouver alors sa confirmation. En effet, on assiste à ce moment précis à un essoufflement de l’islamisme qui s’était imposé comme la syntaxe politique hégémonique au Moyen-Orient depuis la Révolution iranienne de 1979.
Cette période s’achève brutalement en 2001 avec l’entrée en scène, à l’échelle mondiale, de l’organisation Al Qaida. Se met alors en place un mode d’action qui est aujourd’hui le trait distinctif d’un nouveau radicalisme islamiste : la violence auto-sacrificielle des attentats-suicides. Les transformations survenues durant les 6 dernières années ont pu surprendre les chercheurs par leur radicalité et par leur ampleur. Je voudrais ici évoquer la façon dont elles se sont opérées, ainsi que les raisons qui peuvent expliquer ces changements.
Documentation
Documents pédagogiques
Transcription* validée par l’auteur de la 650e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 5 octobre 2007
*Transcription réalisée par Guillaume Dupont
« L’islamisme aujourd’hui »
Par Hamit Bozarslan
Au tournant des années 1999-2000, un certain nombre d’ouvrages sont parus qui annonçaient la fin de l’islamisme. En France, l’un des plus marquants est celui de Gilles Kepel : Jihad, expansion et déclin de l’islamisme (2000). La thèse de l’impasse, voire de l’échec de l’Islam politique, avancée d’abord par Olivier Roy au début des années 1990, semble trouver alors sa confirmation. En effet, on assiste à ce moment précis à un essoufflement de l’islamisme qui s’était imposé comme la syntaxe politique hégémonique au Moyen-Orient depuis la Révolution iranienne de 1979.
Cette période s’achève brutalement en 2001 avec l’entrée en scène, à l’échelle mondiale, de l’organisation Al Qaida. Se met alors en place un mode d’action qui est aujourd’hui le trait distinctif d’un nouveau radicalisme islamiste : la violence auto-sacrificielle des attentats-suicides. Les transformations survenues durant les 6 dernières années ont pu surprendre les chercheurs par leur radicalité et par leur ampleur. Je voudrais ici évoquer la façon dont elles se sont opérées, ainsi que les raisons qui peuvent expliquer ces changements.
Des années 1920 à la fin des années 1970, l’islamisme était demeuré très marginal au Moyen-Orient. En dépit de la création, en 1928, par Hassan al-Banna de l’Organisation des Frères Musulmans en Egypte en 1928, qui comptera jusque 200.000 militants et sympathisants, les élites moyen-orientales de la première moitié du 20ème siècle s’inscrivent dans un projet d’occidentalisation ; celles de la deuxième moitié du siècle sont influencées par les divers courants de la gauche.
L’année 1979 est celle de la reconnaissance d’Israël par l’Egypte, de l’occupation de l’Afghanistan par l’URSS, de l’insurrection des militants islamistes à la Mecque, et de la révolution iranienne. Se substituant à la gauche qui apparaît soit comme traîtresse à sa propre cause (Egypte) soit comme colonialiste au même titre que les autres puissances (URSS), l’islamisme va devenir le paradigme dominant des conflits qui agitent le Moyen-Orient. Le projet révolutionnaire et l’inspiration anti-impérialiste vont être réinterprétés dans une optique nouvelle. Il s’agira désormais de retourner vers le Coran, source authentique, pour racheter les péchés de l’occidentalisme et du « gauchisme » du passé et d’envisager autant la libération que la sortie de l’aliénation du monde musulman. Guerre d’Afghanistan, guerre Iran-Irak, guerre civile libanaise, assassinat d’Anouar El Sadate en 1981, guerre civile en Algérie, guerre du Golfe sont autant de conflits et d’événements aux cours desquels l’islamisme gagne ses titres de noblesse révolutionnaire, consacrant le thème de la guerre sainte et glorifiant la figure du martyr.
C’est cette période commencée en 1979 qui s’achève 20 ans plus tard. On constate alors un essoufflement de l’islamisme, avec un renoncement au jihad entendu comme guerre sainte et lutte armée révolutionnaire, une acceptation autant de l’obéissance au pouvoir en place que de l’économie de marché. A la fin des années 1990, les classes moyennes sont en train d’inventer une nouvelle forme d’islamité. S’efforçant de libérer la religion de l’emprise du politique et de l’emprise de la science, les intellectuels qui se définissent comme les nouveaux penseurs de l’Islam ont de plus en plus recours à l’herméneutique pour relire le Coran et partant pour en produire une critique interne. C’est aussi l’époque où apparaissent les premiers défilés de mode islamiques.
Pourquoi cet apaisement momentané ? Tout d’abord, l’islamisme est un mouvement extrêmement hétéroclite, qui se caractérise par la diversité des classes sociales : il regroupe sous sa bannière des habitants des bidonvilles de Casablanca et du Caire, mais aussi des membres des classes moyennes, et une partie de la bourgeoisie. Diversité aussi des classes d’âge : les aspirations des adolescents nouvellement recrutés ne sont pas celles des vétérans. Dans ces conditions, il est difficile pour le courant islamiste de se reproduire dans la durée et de se doter d’une cohésion.
La deuxième raison du déclin de la fin des années 1990 :, les pays où s’est développé l’islamisme sont gouvernés par des régimes très autoritaires. Les Etats ont exercé une forte coercition à l’égard du mouvement. L’Egypte et l’Algérie, par exemple, ont pratiqué une répression massive, recourant en outre fréquemment à la torture. Cette répression n’a pas touché seulement des militants mais aussi des familles et des quartiers entiers. La mouvance s’en est trouvée considérablement affaiblie.
Parallèlement au démantèlement des organisations islamistes, de nombreux Etats ont opéré une réislamisation des mœurs. Cette évolution est particulièrement sensible dans les années 80-90 du Moyen-Orient arabe à l’Indonésie. La conséquence pour les islamistes est une perte de sens de leur mouvement. En outre, les attentats contre les civils et les touristes ont contribué à propager une peur de l’instabilité : une partie de la population a fini par soutenir les Etats, donnant ainsi raison à un adage politique qui remonte au 10ème siècle, et selon lequel « mille ans de tyrannie valent mieux qu’une minute d’anarchie ».
Comment expliquer la radicalisation de l’islamisme survenue dans les années 2000 ?
Si ce renversement a d’abord échappé à une grande partie des chercheurs, c’est parce qu’il a vu le jour dans les marges des sociétés musulmanes. Cette résurgence s’effectue en effet à l’abri du regard des Etats : les camps d’entraînement militaire où se retrouvent des intellectuels, des médecins et des ingénieurs dissidents, les camps de réfugiés, notamment, mais pas exclusivement, palestiniens, les prisons, qui deviennent de véritables universités du militantisme et d’une subjectivité vengeresse. L’exil, en particulier vers l’Europe, est également un vecteur de ce renouveau radicalisme.
Quel est l’horizon d’émancipation visé aujourd’hui par les combattants islamistes ? Il ne s’agit plus de transformer la société au nom d’un idéal universel, pas plus que de conquérir le pouvoir par la révolution. La nouvelle dissidence qui « radicalise le monde par le sacrifice » (J. Baudrillard) se caractérise par trois aspects : sa dimension charismatique, sa dimension rationnelle et bureaucratique, et sa dimension millénariste. Ces trois dimensions se retrouvent à l’intérieur même de l’organisation Al Qaida. Créée en 1988 dans le sillage de la guerre d’Afghanistan, cette structure est devenue l’inspiratrice des actions les plus violentes, dans une lutte qui se livre aujourd’hui à l’échelle mondiale.
La dimension charismatique de l’islamisme contemporain est liée à l’influence prépondérante d’un homme : Oussama Ben Laden. Tout à la fois extrêmement modeste et démesurément prétentieux, Ben Laden se présente comme quelqu’un qui a sacrifié sa fortune et son confort au profit de la Cause. S’il n’a aujourd’hui que 50 ans, il montre un corps fragile et souffrant. Par ses combats passés, dont les marques d’usure se lisent sur son visage, il illustre les changements des perceptions que le Moyen-Orient, et au-delà, le monde musulman, a du corps du chef combattant. A titre d’exemple, Arafat, qui dans les années de sa gloire apparaissait comme un militaire svelte plein d’élan, projetait la nation dans la promesse de conquête et de victoire et exigeait de ses fidaïs la prise de risque pour la cause, mais pas la suppression programmée de leur corps. Avec Ben Laden, comme avec le Cheikh Yacine, dont le corps paralysé a résumé à lui seul la violence de la deuxième Intifada palestinienne, ou jadis avec Khomeiny, c’est désormais la trace des épreuves traversées par le chef qui donne sens à la contestation– . Le corps vulnérable du leader incarne la souffrance et l’honneur bafoué de sa communauté (nationale ou religieuse), garantit l’authenticité de l’engagement et exige des sacrifices pour les valeurs dont il est le dépositaire.
Sur le plan doctrinal, s’il légitime son action en référence au Coran, le chef d’Al Qaida rompt avec la tradition islamiste classique. Les théoriciens islamistes des années 1970-1980 avaient une vision totale du monde et se prononçaient sur tous les sujets : politique, économie mais aussi logement, santé, mariage, code personnel.... Lui ne retient du Coran que quelques versets puritains et guerriers. En se débarrassant de tout ce qu’il considère comme verbiage superficiel, Oussama Ben Laden s’est forgé un style à la fois très émotionnel – la promesse du salut – et très dogmatique au sens étymologique du terme –le Bien et le Mal-.
Autre figure majeure de l’organisation Al Qaida, l’Egyptien Ayman Al-Zawahiri incarne la dimension bureaucratique de l’islamisme contemporain. Ce vétéran de la guerre d’Afghanistan semble être porté par un esprit de vengeance devenu programme. Lorsque Saïd Qutb, intellectuel membre des Frères musulmans, est exécuté en Egypte en 1966, Al-Zawahiri jure de le venger et crée sa première organisation clandestine – il n’a alors que 14 ans. En 1981, à la suite de l’assassinat d’Anouar El-Sadate, il est arrêté et sévèrement torturé au point d’être contraint de donner l’un de ses camarades, dont la vengeance, restaurateur de dignité, s’érige en devoir chez lui (il prendra d’ailleurs le nom de guerre Abd al-Mu’iz, serviteur du « pourvoyeur d’honneur » qu’est Dieu). Historiquement, il est de ceux qui ont le plus contribué à produire une pensée polémologique propre au radicalisme islamiste. C’est notamment sous son influence que la notion de martyr programmé est devenue une notion clé de la militance islamiste.
La troisième dimension, celle du millénarisme eschatologique, s’incarne dans le corps même des martyrs qui choisissent de mourir pour la Cause. Muhammed Atta, le plus connu des auteurs des attentats de 11 septembre, incarne ce type d’engagement. Le martyr d’al-Qaida a intériorisé la culpabilité du monde et l’espoir de sa délivrance : se considérant responsable d’un déclin collectif, il devient individuellement le relais de l’émancipation. Un rapide regard sur leurs biographies montre que les auteurs des attentats-suicides sont surtout issus des catégories aisées des sociétés arabes voire, au-delà du monde musulman. L’islamisme actuel représente nombre de traits d’un radicalisme de riches, infiniment plus violent et destructeur que le radicalisme des années 1960-1980, qui était porté par les couches plus pauvres de la population.
Dans ces circonstances, que peut-on craindre, et que peut-on espérer ?
L’horizon socio-politique du Moyen-Orient est extrêmement restreint : on peut difficilement voir au-delà de 24 heures. Une chose semble cependant certaine : la situation actuelle se caractérise par un clivage de plus en plus prononcé entre le monde musulman et le monde occidental. L’islamisme radical lit l’histoire à partir d’un conflit hautement symbolique : le conflit israëlo-palestinien, autour d’un lieu lui-même symbolique, Jérusalem, auxquels s’ajoute désormais d’autres terres, de l’Afghanistan à l’Irak. Plus ce nouveau radicalisme est présenté comme l’émanation du Mal, plus il se raidit et se présente lui-même comme le bras armé du Bien contre le Mal. L’islamisme reprend aussi à son compte la théorie de la guerre asymétrique, en présentant le corps des martyrs comme la seule arme à même de rompre le déséquilibre des forces. La banalisation des attentats-suicides découle également de cette perception du monde.
Un retour à la pacification observée à la fin des années 1990 n’est cependant pas impossible. Un tel scénario exige d’une part la résolution des conflits majeurs du Moyen-Orient, à commencer par le conflit israélo-palestinien, d’autre part une démocratisation des sociétés moyen-orientales. Elle suppose également un examen de conscience critique, au Moyen-Orient comme en Occident, sur le rapport que ces sociétés entretiennent entre elles et avec leurs passés respectives.
Liens
Dans la même collection
-
Autoritarisme politique et monde musulman
PicaudouNadineLa formulation même du thème proposé : « Autoritarisme politique et monde musulman », m’interroge et me trouble à la fois...
-
Islam et argent
Cheikh-RouhouMoncefLa perception de l’argent en Islam comporte certains caractères particuliers. L’argent est considéré comme un outil de mesure de la valeur et non un actif en soi.
-
Islams Africains - Eloi Ficquet
FicquetÉloiQuand l’islam, dès les premiers temps de son expansion, franchit la mer Rouge, pour conquérir d’autres terres et porter ses préceptes hors d’Arabie, ce n’est pas l’Afrique en tant que vaste
-
Femmes et droit en Islam - Sana Ben Achour
Ben AchourSanaLe propos est de montrer comment, aujourd’hui, dans les pays de culture musulmane, notamment dans les pays du Maghreb, se réarticule, se construit et se noue autour de la réforme du statut personnel
-
La charia et les transformations du droit dans le monde musulman - Jean-Philippe Bras
BrasJean-PhilippeComposante essentielle de l’Islam et de l’identité islamique, le droit musulman tire ses fondements du Coran et des hadiths rapportant les dits et actions du Prophète. Droit tributaire de la
-
Regards européens sur l’Islam (19e – 20e siècle) - François Pouillon
PouillonFrançoisIl est possible de parler de regards européens sur l’islam comme du développement, en Occident, d’une curiosité, puis d’une connaissance articulée qui, progressant avec le temps, a conduit à une
-
Le jihad - Makrâm Abbes
AbbèsMakramDepuis l’avènement du 11 septembre, d'abord en tant que donnée historique fondamentale qui a bouleversé les relations internationales, ensuite, et surtout, en tant que concept qui a permis d’isoler
-
Salafismes au 20ème siècle - Dominique Thomas
ThomasDominiqueNotre approche dans cette communication consiste dans un premier temps à déterminer les nouveaux labels et référents idéologiques de ce qu’il convient de nommer aujourd’hui le courant salafiste
-
Islam d’Extrême Orient - Andrée Feillard
FeillardAndréeLes communautés musulmanes d’Extrême-Orient, qui totalisent plus de 232 millions d’individus au sein de onze pays, ont parfois reçu une moindre attention, leur pratique de l’islam étant
-
Penser l’islam aujourd’hui - Abdelmajid Charfi
الشرفيعبد المجيدLes conditions dans lesquelles s’exerce aujourd’hui la pensée islamique sont caractérisées essentiellement par le retard historique des sociétés musulmanes dans 4 grands domaines :
-
Islam de France, Islam en France - Bernard Godard
GodardBernardL’implantation de la religion musulmane en France est une réalité qui rend le débat sur sa nature exogène ou endogène un peu dépassé. La lancinante question de son incongruité apparente dans le
-
L'islam en Europe - Moussa Khedimellah
KhedimellahMoussaHistoire européenne et histoire musulmane sont denses et souvent liées : "Sans Mahomet, Charlemagne est inconcevable" nous dit l'historien Henri Pirenne. Les liens souvent résumés à leurs aspects
Sur le même thème
-
La frontière chiites/sunnites au Moyen-Orient
BrombergerChristianChiites, sunnites, comment sont nées ces deux branches de l’Islam ? Qu’elles sont aujourd’hui leurs particularités et leurs relations dans les domaines très divers, activités religieuses, croyances,
-
Philosophie politique et société démocratique
Cruz RevueltasJuan CristóbalJuan Cristobal Cruz, enseignant-chercheur au département de philosophie de l’université autonome de l’Etat de Morelos au Mexique, nous parle de philosophie politique et de la société démocratique
-
Table ronde sur Au-Béraud l'éphémère
LefrançoisFrédéricDésertGéraldRosierJean-MarcArsayeJean-PierreTable ronde sur Au-Béraud l'éphémère, ouvrage de Jean-Pierre Arsaye, lors de l'opération en faveur de Présence Kréyol.
-
-
Prière
Marongiu-PerriaOmeroComme toute religion, l’islam est défini par des caractéristiques cultuelles.
-
La société iranienne : tensions, contradictions, cohésion
BrombergerChristianC’est à partir du XXe siècle que se construit l’unification culturelle et linguistique de l’Iran. Le Kémalisme y ajoute la centralisation qui permet la naissance d’un Etat-Nation persan qui reste une
-
Chrétiens
HeybergerBernardLoryPierrePisaniEmmanuelD’après la tradition musulmane, l’islam est présenté comme l’héritier du christianisme, face auquel il s’est construit dans un jeu de miroir mais aussi d’opposition.
-
Exposition MUCEM : Or
BouillerJean-RochMorel-DeledalleMyriameUne exposition autour d'un métal qui ne laisse pas indifférent entre convoitise, violence, expression artistique... Myriame Morel-Deledalle et Jean-Roch Bouiller, commissaires de l'exposition, nous
-
-
Bayard 150 ans / Clôture du colloque
RuffenachPascalMercierCharlesBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)
-
Bayard 150 ans / Les leçons d'une histoire
HoffnerAnne-BénédicteGuémyFlorencePelletierDenisFridensonPatrickSagazanBenoît deBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)
-
Bayard 150 ans / Vocations / Partie 2
DouyèreDavidGreinerDominiqueDumontMartinBayard dans l’Histoire / Colloque à l’occasion de ses 150 ans (1873-2023)