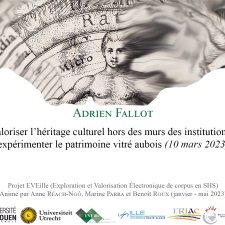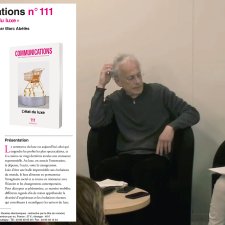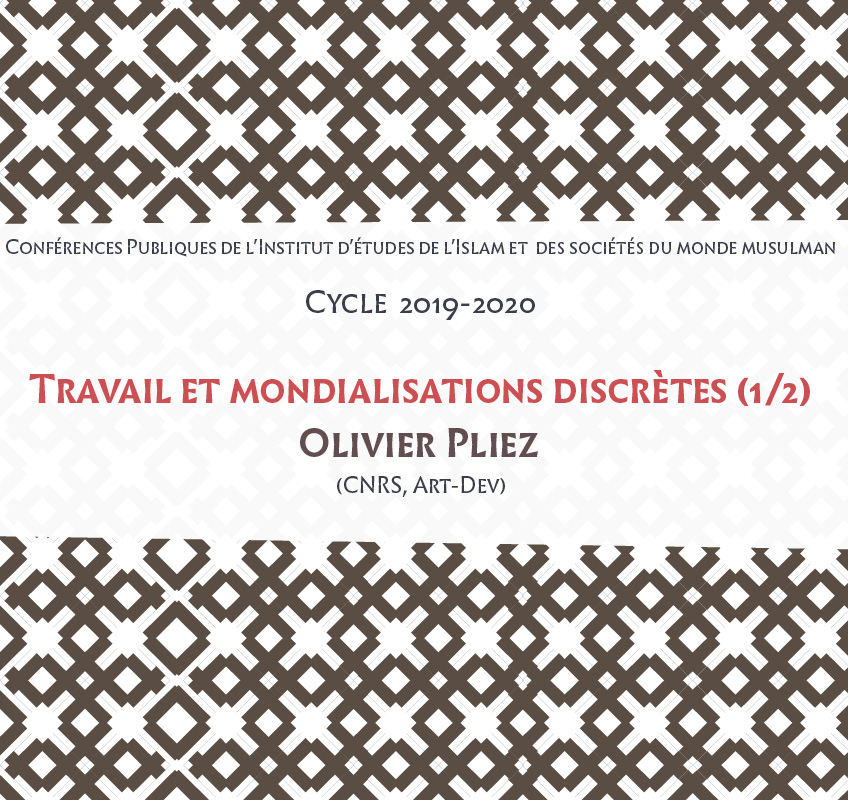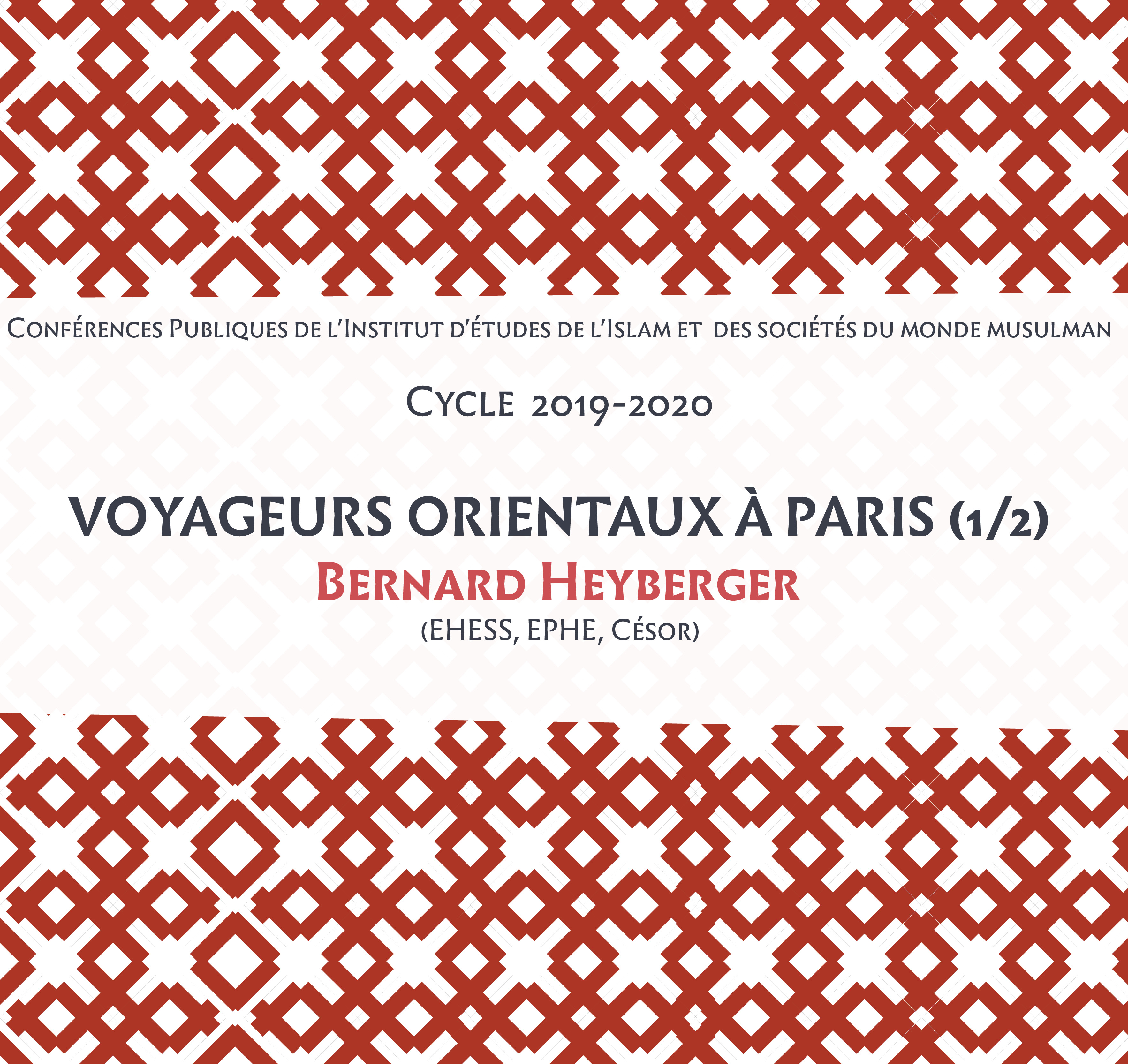Notice
Episode # 2 : Samuel Pinaud
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Qui suis-je ? Je suis liquide ou solide ; transformé en poudre, je voyage...
À Bamako, 90 % de la consommation de produits laitiers est constituée de poudre de lait importée ou de produits transformés à partir de poudre de lait importée alors même que le Mali a une longue tradition d’élevage. En analysant le déploiement au Mali de l’économie de la poudre de lait, l’article donne à voir l’influence de la capacité de conservation des aliments sur les échanges alimentaires, des années 1930 à la mondialisation contemporaine.L’analyse historique montre que la capacité de conservation de la poudre de lait offre des « prises politiques » tant sur l’espace que sur le temps alimentaire. Durant la première moitié du xxe siècle, l’envoi de poudre de lait en Afrique de l’Ouest permet de nourrir les familles de colons selon les normes alimentaires à l’œuvre à la même époque en Europe et participe ainsi à renforcer le rapport de domination colonial. Les échanges humanitaires d’aide alimentaire qui se déploient dans les décennies suivant les indépendances s’élaborent sur les mêmes bases matérielles et participent à l’attachement de la population bamakoise à l’usage de la poudre de lait. En outre, cette conserve alimentaire offre une prise sur le temps alimentaire qui se donne à voir dans la constitution de stocks publics européens destinés à réguler les prix.L’analyse sociologique des échanges contemporains de poudre de lait montre que la capacité de conservation du produit influence fortement les modalités de mise en marché du produit. La libéralisation des marchés agroalimentaires internationaux transforme les usages sociaux de la conserve alimentaire. Dans ce contexte, la capacité de conservation du produit n’est plus mise au service d’une volonté politique. En revanche, elle permet à des acteurs privés d’élaborer des stratégies spéculatives à différentes échelles. L’analyse des stratégies des commerçants bamakois montre les conditions pratiques de cette mise à profit des échanges de conserve alimentaire.Lire l'articleSamuel Pinaud est maître de conférences à l’université Paris-Dauphine, chercheur à l’Irisso. Ses travaux portent sur les transformations contemporaines des marchés et des entreprises agricoles, en France (Hauts-de-France) et en Afrique de l’Ouest (Mali, Burkina Faso).
Sur le même thème
-
Table ronde 2/ Gauches mondiales et mouvements anti-systémiques : Discussion générale
MassiahGustaveVergèsFrançoiseBojadžijevManuelaAguirre RojasCarlos AntonioEn 2023, la Fondation Maison des sciences de l’homme fête ses 60 ans. Dans ce cadre, un colloque international autour de l’œuvre de Immanuel Wallerstein et sur son impact, intitulé « Capitalisme,
-
-
La mondialisation et les transformations récentes de la société marocaine
LabariBrahimBrahim Labari nous présente une étude qui s'est appuyée sur trois cas dans la région d'Agadir : un centre d'appel, une usine d'habillement et une entreprise agricole. Il explique les facteurs
-
Istanbul, ville-monde
PeraldiMichelA Istanbul, ville monde, placée comme une sorte de pivot en Méditerranée, à la jonction de deux continents, trait d’union de multiples courants, Michel Peraldi évoque l’économie de bazar pratiquée par
-
Marrakech, ville des possibles
PeraldiMichelMarrakech, ville de tous les possibles, qui d’une petite ville provinciale est devenue un des « spots » du tourisme mondial.
-
Conservation des plantes, conservation de la nature : l'expérience des jardins parisiens au XVIIIe …
Depuis les travaux de Richard Grove, les historiens ont l’habitude de dater les premières formes de conservation des ressources et de la nature à l’époque moderne, contre l’idée d’une primauté états
-
L'état du luxe : soirée autour du numéro 111 de la revue communication
AbélèsMarcCarnevaliBarbaraD'ErcoleMaria CeciliaGuindaniSaraDarrigrandMarietteLe commerce du luxe est aujourd’hui l’un de ceux qui engendrent les profits les plus spectaculaires, et il a été marqué ces vingt dernières années par une croissance exponentielle. La
-
Se restaurer à Yiwu (Chine), les restaurants musulmans comme ancrages de la mondialisation
PliezOlivierConférence d’Olivier Pliez (CNRS, ArtDev), « Se restaurer à Yiwu (Chine), les restaurants musulmans comme ancrages de la mondialisation ».
-
L’Islam a-t-il (ré)inventé la carte du monde ?
ValletÉricConférence d'Éric Vallet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « L’Islam a-t-il (ré)inventé la carte du monde ? ».
-
Un conteur syrien à Paris en 1709
HeybergerBernardConférence de Bernard Heyberger, Historien (EHESS, EPHE, CéSor), "Un conteur syrien à Paris en 1709".
-
Le café, un marché mondialisé
JimenezJeanPouzencMichaëlCe grain nous brosse une rapide présentation de la situation caféière mondiale, surtout au plan agronomique, économique et social. Le but est de montrer quels sont les acteurs et les enjeux de la
-
Surgissement du bio comme alternative à la dérèglementation
González CabañasAlma AmaliaJimenezJeanRamirezJavierTuletJean-ChristianDelpechFranckCe grain nous explique les conditions qui ont permis la montée en puissance de la caféiculture biologique mexicaine.