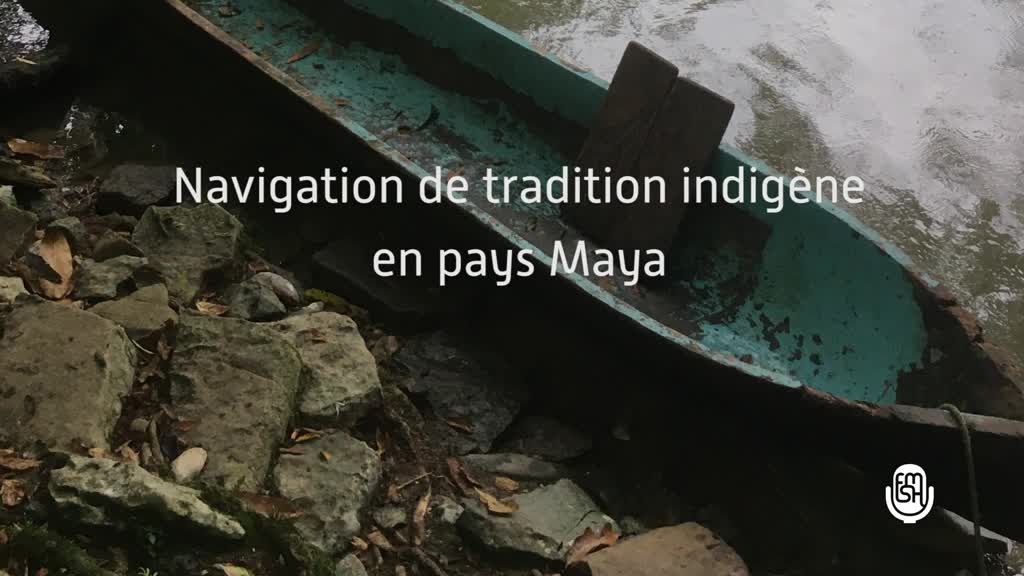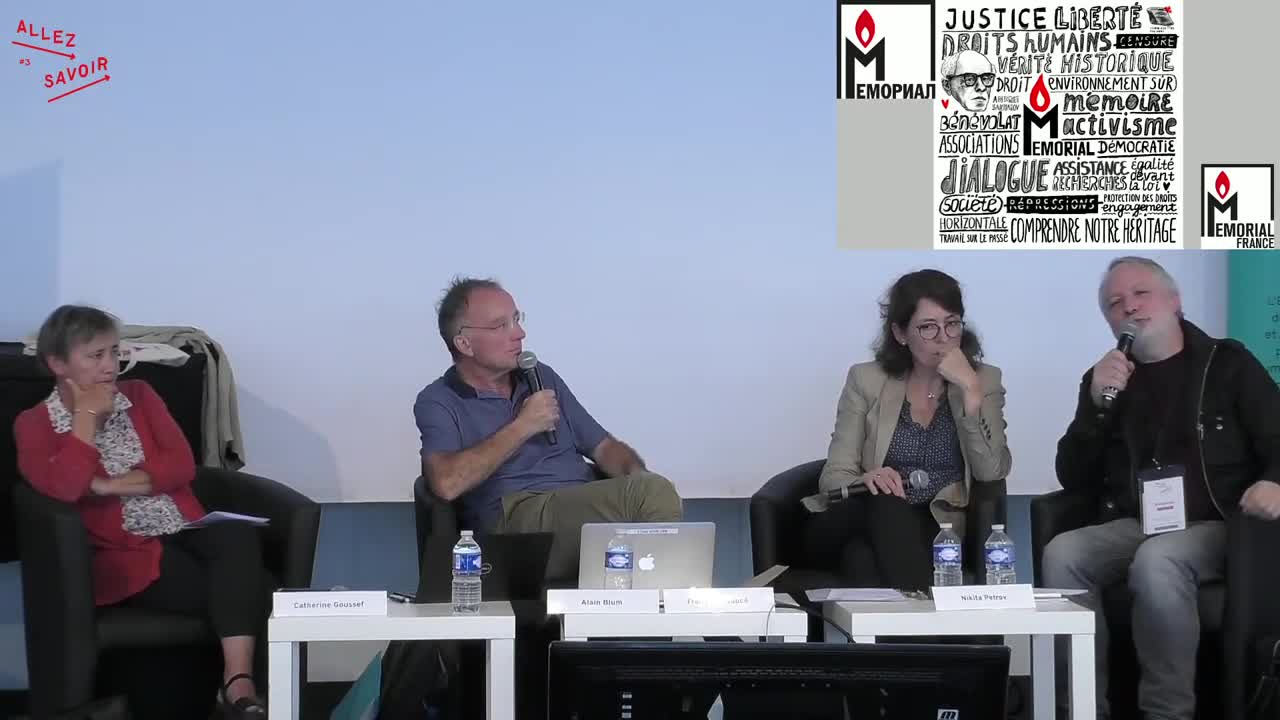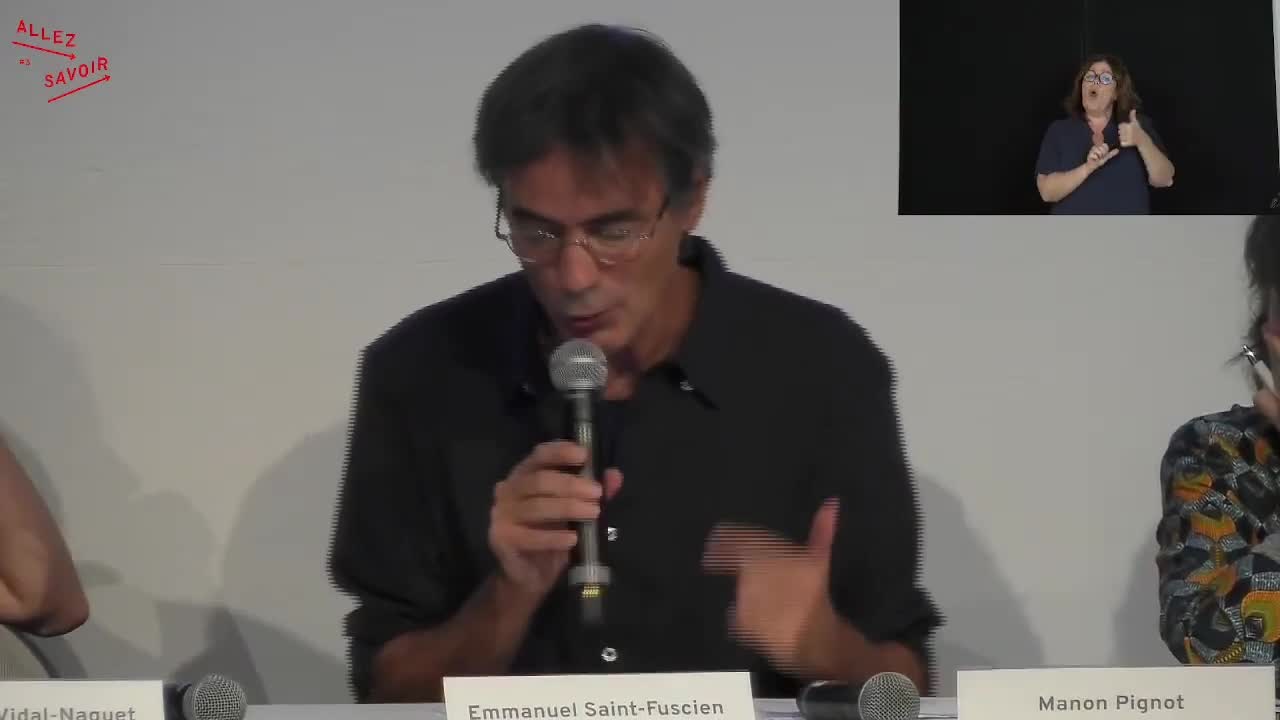Notice
PARIS
Mouvements nationalistes contemporains en Éthiopie
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Vous écoutez Histoire de mobilité, une série de podcasts produite par la Fondation Maison des sciences de l’homme. Histoire de mobilité raconte les expériences internationales de chercheurs et chercheuses que la Fondation soutient.
Dans ce nouvel épisode du podcast Histoire de mobilité, nous recevons Mehdi Labzaé, spécialiste de l’Éthiopie. Pendant l’automne de l’année 2020, Mehdi Labzaé a pu enquêter sur son terrain dans le nord-est du pays grâce à une bourse postdoctorale Atlas cofinancée par la FMSH et le Centre français des études éthiopiennes à Addis Abeba. Là-bas, il a observé la montée du mouvement nationaliste parmi la population Amhara. Ce mouvement, aux côtés du gouvernement fédéral, s’oppose violemment au Front de libération du peuple Tigréen et à ses alliés dans le conflit qui déchire l’Éthiopie. La guerre l’a surpris au milieu de son séjour, dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020. Il nous parle de ses enquêtes et de ses recherches avant, pendant, puis loin de la guerre.
Thème
Documentation
Transcription du contenu du podcast
Transcription du contenu du podcast :
Vous écoutez Histoire de mobilité, une série de podcasts produite par la Fondation Maison des sciences de l’homme. Histoire de mobilité raconte les expériences internationales de chercheurs et chercheuses que la Fondation soutient.
Dans ce nouvel épisode du podcast Histoire de mobilité, nous recevons Mehdi Labzaé, spécialiste de l’Éthiopie. Pendant l’automne de l’année 2020, Mehdi Labzaé a pu enquêter sur son terrain dans le nord-est du pays grâce à une bourse postdoctorale Atlas cofinancée par la FMSH et le Centre français des études éthiopiennes à Addis Abeba. Là-bas, il a observé la montée du mouvement nationaliste parmi la population Amhara. Ce mouvement, aux côtés du gouvernement fédéral, s’oppose violemment au Front de libération du peuple Tigréen et à ses alliés dans le conflit qui déchire l’Éthiopie. La guerre l’a surpris au milieu de son séjour, dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020. Il nous parle de ses enquêtes et de ses recherches avant, pendant, puis loin de la guerre.
...
Je m’appelle Mehdi Labzaé. Je suis sociologue. Je travaille sur le politique en Éthiopie, politique au sens large, mais en particulier les questions foncières, agraires et les questions de mobilisation nationalistes depuis plus récemment. C’est dans le cadre de ces recherches sur mobilisations nationalistes que j’avais candidaté à la Bourse Atlas et que j’ai eu la chance de l’avoir. C’était d’octobre à décembre 2020. J’ai commencé à travailler sur des groupes nationalistes Amhara en Éthiopie pour plusieurs raisons. Une raison d’abord scientifique, voire politique, qui était le fait que c’est un nouveau nationalisme, un nationalisme apparu au fil de la crise politique que l’Éthiopie traverse et qui s’est maintenant transformée en guerre civile. On peut dater environ à 2016, 2018, la formation de mouvements nationalistes très forts. Ce qui est intéressant, c’est que c’étaient des gens qui auparavant se déclaraient Éthiopiens, qui voulaient être aveugles aux différences ethno-nationales, qui avaient été les élites de cette région et de ce peuple et qui avaient été dominants historiquement. Ces élites commençaient à parler, elles aussi, le langage ethno-national qui avait été jusqu’alors un langage plutôt utilisé pour dénoncer leur domination. Ça m’intéressait beaucoup parce qu’ils avaient un discours très agressif et violent. La conversion a été assez massive. Des gens que j’avais rencontrés pendant mes années de terrain de thèse auparavant, qui avaient toujours été très vindicatifs contre les différences ethno-nationales en Éthiopie, d’un seul coup, disaient : « Nous aussi, on est Amhara. Tant que les autres peuples s’organisent sur cette base-là, nous aussi, nous devons nous organiser sur cette base ». C’est ça que j’ai voulu étudier.
La raison pratique de cette recherche, c’est que j’avais des accès au terrain relativement facilités puisque parmi ces gens qui s’étaient convertis au nationalisme Amhara, il y avait des amis à moi et des gens que j’avais rencontrés ici à Paris dans le cadre de mobilisations pour les demandeurs d’asile pour avoir des papiers. Ils m’ont donné les contacts de leur famille au pays. À partir de 2019, j’ai commencé à aller dans une région différente de là où j’avais fait ma thèse. Cette région, c’est le nord Gondar, le nord-ouest de l’Éthiopie, nord Gondar et (Armarcho), les hautes et les basses terres du nord-ouest de l’Éthiopie. C’était avant le déclenchement de la guerre, dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020. À ce moment-là, je faisais des entretiens et de l’ethnographie avec des groupes nationalistes, groupes nationalistes qui étaient à l’époque des militants et pas encore des miliciens, surtout des hommes entre 20 et 35 ans, urbains, originaires des villes de Gondar, Baher Dar, Addis Zemen, et des petites villes des environs, Sanja, Debarq. J’essayais de saisir le soutien populaire que ces gens pouvaient avoir. Ça consistait surtout à se promener en campagne et parler avec les paysans au fur et à mesure des gens qu’on pouvait rencontrer, ce qui était encore possible avant la guerre sans aucun problème. Quand la guerre a commencé, j’étais dans la ville de Soroca, à la frontière entre les régions Tigré et Amhara, toujours dans le nord-ouest de l’Éthiopie. J’étais parmi des groupes miliciens qui avaient déjà pris les armes et s’entraînaient militairement. Ils désiraient déjà reconquérir, comme ils disaient, leur pays, c’est-à-dire toutes les terres qui sont dans la région du Tigré situées à l’ouest de la rivière Tekezé, que ces militants appellent Welkait Tagada. C’est là où je les ai suivis dans leur avancée dans cette région pendant la guerre. J’y suis retourné à plusieurs reprises pour comprendre comment ils administraient les régions qu’ils avaient conquises.
Il y a bien un nettoyage ethnique en cours là-bas. Ce nettoyage ethnique est bureaucratisé et organisé par l’appareil d’État. Il y a aussi des choses intéressantes du point de vue de l’évolution des catégories identitaires que les gens utilisent pour se définir et pour agir politiquement. Les populations locales se disent beaucoup « Welkaité », c’est-à-dire de Welkait, de cette région-là. C’est une manière pour eux de critiquer les nouveaux maîtres de la région Amhara qui administrent depuis la région Amhara, et l’ancienne administration depuis le Tigré. Ce qui a été intéressant comme résultats de recherche, c’est de voir à quel point ces populations avaient déjà beaucoup de rancœur contre les nouveaux administrateurs de la région Amhara en disant que ces conquérants avaient très largement pillé quand ils étaient arrivés. Ils ne se reconnaissaient pas davantage dans cette nouvelle administration que dans la précédente, voire moins. En parlant du pillage, ils m’ont dit à plusieurs reprises : « Qu’est-ce que le TPLF, l’ancien parti au pouvoir au Tigré a fait de pire ? ». C’est une critique très importante qui n’est absolument pas audible dans le débat public éthiopien monopolisé par les nationalistes Amhara qui répètent depuis cinq ans maintenant : « Welkait est Amhara ». La principale modification, c’est une difficulté beaucoup plus grande pour se déplacer avec énormément de contrôles, de checkpoints, des difficultés de ce point de vue, c’est sûr. Une suspicion beaucoup plus forte des enquêtés aussi, même si au début de la guerre, ce n’était pas tellement le cas parce que c’étaient des gens que j’avais déjà rencontrés avant. Une fois dans le moment de la guerre, ils n’étaient pas beaucoup plus suspicieux. Ils étaient assez inquiets non seulement pour ma sécurité et aussi pour le fait d’être vus avec moi.
Je dirais que la principale modification, ce sont les entraves à la circulation et tout ce qui se passe dans l’immédiat arrière-front. C’est un état d’urgence permanent avec des miliciens et divers types d’hommes en armes qui peuvent contrôler n’importe qui à n’importe quel moment. C’est avec ça qu’il faut composer. L’autre principale difficulté qui va avec, quand on rencontre des civils, il faut vraiment faire attention à la mesure dans laquelle on ne met pas les gens en danger. C’est la première boussole pour orienter l’enquête. Une fois que la guerre avait commencé et que les mobilisations avaient été mises en place dans les campagnes, il est important de ne pas être vu avec des paysans que je ne connaissais pas. Ça aurait pu être très problématique pour eux. Le fait d’avoir eu la Bourse Atlas m’a été très utile parce que j’ai pu louer une voiture, ce qui permet d’être très mobile. C’est absolument indispensable dans ces conditions-là, de partir dès qu’on n’est pas les bienvenus dans un endroit, dès que des combats se rapprochent. J’ai travaillé avec un loueur de voitures que je connaissais depuis 2014. D’habitude, il louait plutôt des voitures aux administrations, au Bureau de la santé qui a besoin d’aller faire des vaccins en campagne ou des touristes qui venaient en Éthiopie à l’époque parce que cette région, du fait du relief, des montagnes et de la présence d’un parc national, est très visitée et aussi du fait des monuments historiques qu’on y trouve. Cet ami était sans ressource depuis un moment. C’était très bien d’en arriver et de dire : « Je te loue une voiture ». On prenait avec nous des amis d’amis ou des gens de sa connaissance qui avaient envie d’aller dans les mêmes endroits que nous et qui souvent étaient liés familialement avec des miliciens importants, avec des commandants locaux. Cela facilitait beaucoup les choses quand on était arrêté. J’ai beaucoup fait ça.
J’ai été accueillie au Centre français des études éthiopiennes, qui m’a accueilli comme un roi, comme d’habitude. C’est vraiment le plus du système des UMIFRE, je pense, et par conséquent d’une bourse comme Atlas, qui prévoit l’accueil dans un de ses UMIFRE. C’est un UMIFRE que je connaissais déjà, mais dont la directrice, Marie Bridonneau, est une collègue avec laquelle je travaille depuis longtemps. Le contexte de liberté académique dans les universités éthiopiennes n’a pas vraiment évolué depuis ce qu’on appelle l’ancien régime. C’est-à-dire depuis avant Abiy Ahmed. Abiy Ahmed n’a pas changé grand-chose dans les universités, si ce n’est empirer les choses. On a vu la semaine dernière l’Université d’Addis Abeba dire qu’il se réservait le droit de retirer leurs diplômes de manière rétroactive à des gens qui seraient considérés comme des soutiens du TPLF, donc des ennemis du gouvernement dans le cadre de cette guerre. Donc ça modifie les conditions de collaboration avec les collègues éthiopiens. Parce que, encore une fois, il s’agit aussi de ne pas mettre les gens en danger. Parce qu’en ce moment, surtout depuis l’été et encore plus depuis octobre, à chaque recul militaire de l’armée fédérale, il y a des campagnes très fortes qui assimilent cette guerre à une opération néocoloniale, par des raccourcis historiques assez hallucinants. Mais ça prend quand même. Donc être vu avec des blancs, être vu avec des étrangers, ça peut attirer des problèmes. Collaborer professionnellement avec des étrangers, ça peut attirer des problèmes. Le CFEA a fermé, l’essentiel du personnel expatrié, français a été rapatrié. Ce n’est pas tant un danger d’être sous les bombes ou tout ça, parce que moi je ne vais pas là où il y a les bombes. Mais vraiment, il faut voir tout, tout ce que la guerre entraîne en termes d’état d’exception, d’état d’urgence, de loi martiale locale et d’autoritarisme très prononcé à l’échelle locale. Ça aussi, c’est un résultat de recherche.
C’est que dans la nouvelle zone qu’ils ont conquise, au détriment du Tigré, les nationalistes Amhara ont mis en place une administration, où il y a cinq personnes qui prennent les grandes décisions. Donc à la fois très concentré du point de vue de la décision effective. Mais après, il y a énormément d’hommes en armes et presque tous les hommes adultes sont devenus miliciens. Donc, à la fois c’est très centralisé dans la prise de décisions et très diffusé dans l’exercice de la violence. C’est quelque chose. La population est en armes. Il y a énormément de corps habillés, d’uniformes de militaires. Donc les militaires de l’armée fédérale, les militaires des forces spéciales de la région Amhara et puis les militaires érythréens qui sont plus discrets parce qu’ils ne sont pas censés être là. Mais ils sont là. Ils sont là. Je pense que tous les gens qui travaillaient en Éthiopie, qu’ils soient Éthiopiens ou non, s’inquiétaient des tournures prises par la crise politique, de voir le gouvernement fédéral et le TPLF à couteaux tirés. La guerre des mots qui avait commencé depuis plus d’un an entre les deux. Le report des élections. La tenue des élections dans la région Tigré et la suspension des budgets pour la paix pour la région Tigré. Le fait que la région ait aussi été abandonnée, entre guillemets, à elle-même face à l’invasion de criquets, juste quelques semaines, quelques mois avant la guerre. Tout ça, on l’avait vu venir. Donc on savait, on tirait déjà la sonnette d’alarme, on disait déjà que c’était très grave. Mais je pense que l’essentiel des gens qui travaillaient en Éthiopie avait, et moi le premier, l’idée que ces élites n’iraient pas jusque-là, qu’elles se ressaisiraient en quelque sorte, que les investissements des élites Tigréennes, partout dans le pays et en particulier à Addis Abeba depuis 1991, auraient raison. Enfin, qu’on n’irait pas jusqu’à un affrontement militaire. Et dans les tout derniers jours, où quand j’étais parmi les miliciens sur cette frontière entre les deux régions, je les voyais, ils me le disaient. Ils étaient prêts le soir même avant que la guerre commence, ça a commencé vers minuit, aux alentours de minuit, un mardi soir. Le soir même, un milicien m’a appelé pour me dire : « Il va se passer quelque chose cette nuit. » Je ne m’attendais pas à ce que ce soit une guerre de cette ampleur qui démarre. Y compris après que la guerre a commencé, on a toujours espéré, peut être le premier mois, on a espéré que les tentatives de médiation marcheraient et aucune n’a fonctionné. Aucune n’a fonctionné.
Oui, ça fait plus d’un an que ça dure et c’est parti pour durer je crois. Puisque là, on n’a pas trop d’espoir à moyen terme de voir les choses se calmer. Il y a des divergences d’interprétation. Je pense qu’à l’époque, quand beaucoup de gens commençaient à se convertir à ce nationalisme et que j’ai voulu travailler dessus, ça recevait très peu d’attention. Donc, en ce sens-là, malheureusement, j’avais raison de m’en inquiéter. Maintenant, c’est assez bien établi que ces nationalistes Amhara, ont été responsables de crimes de guerre au Tigré. Que ce sont les nationalistes Amhara qui dictent une partie de la politique du premier ministre Abiy Ahmed. Qu’ils sont vraiment une force de blocage contre l’émergence de toute forme de négociation. Je pense qu’il n’y a, là-dessus, pas consensus, mais il y a beaucoup de collègues qui sont d’accord avec ça. Cependant, on a aussi des collègues qui vont dire qu’il faut voir la responsabilité de l’autre camp, du TPLF, dans le déclenchement de cette guerre, ce qui est tout à fait vrai. Il faut aussi la prendre en compte. Ils ont eux aussi marché à la guerre, formé des forces spéciales, fait des défilés militaires, montré leurs forces, etc. Mais depuis que la guerre a commencé, c’est bien le gouvernement fédéral qui bloque.
Et aussi on a des collègues qui nous rappellent les 30 ans d’autoritarisme du TPLF pour quelque part adopter un petit peu le discours du régime, du gouvernement fédéral qui confond les élites du TPLF et le peuple du Tigré. Et ça, moi, c’est quelque chose auquel je suis très fortement opposé, parce que derrière c’est le discours de : « Ils l’ont bien cherché. Ils nous ont gouvernés comme ça pendant 30 ans et ils se sont approprié les ressources du pays. Ils ont divisé l’Éthiopie en région ethnique, etc. Donc maintenant, si on passe six millions de personnes par les armes, ce n’est pas grave. » Et ça, on a des discours de cette forme-là qui vont rappeler l’autoritarisme passé du gouvernement du TPLF, pour justifier en creux les violences qui sont commises à l’heure actuelle sur les civils Tigréens. Et ça, ça me paraît très grave. Il faut bien voir qu’à l’heure actuelle, il y a plus de 30 000 Tigréens qui ont été arrêtés, qui sont mis dans des camps, qui sont de facto déportés vers des déserts ou vers des régions très reculées, des forêts tropicales dans le sud-ouest, des choses comme ça. Ils sont arrêtés sur l’unique base de leur ethnicité. Et ça, un policier d’Addis Abeba nous l’a dit de droit dans les yeux : « Maintenant, les Tigréens, on les arrête parce que ce sont des soutiens de la Junta. » Junta, c’est le terme qu’ils utilisent pour parler du TPLF. Donc l’assimilation de tous les Tigréens au TPLF, elle est hégémonique dans le discours gouvernemental aujourd’hui, et elle se retrouve malheureusement dans le discours de certains collègues, malheureusement.
Donc, la crainte sur nationalisme Amhara, je pense que beaucoup la partagent, mais après, d’autres gens essayent de mettre d’autres choses dans la balance pour dire les torts sont partagés. Pour le futur proche, je voudrais continuer à travailler là-dessus, sur ces nationalistes, écrire notamment. Avec les recherches que j’ai faites grâce à la Bourse, j’ai pu écrire déjà des choses. Je vais continuer à moyen terme, je pense que ce sera un terrain qui me sera fermé pour plusieurs raisons. La première et la principale, c’est que c’est qu’une fois que j’aurais écrit sur eux ce que j’ai à écrire, je pense qu’on ne sera pas bienvenue, surtout si c’est écrit en anglais, si certains d’entre eux lisent, et il y en a qui lisent. Notamment, la diaspora et qui ont de bons relais au pays. Ce ne sera pas bienvenu du tout, première chose. Deuxième chose, une des conditions que Martina Avanza mettait en avant dans son article " Comment faire de l’ethnographie quand on n’aime pas ses indigènes ? " c’est le fait que ça ne dure pas très longtemps. Je pense qu’elle a raison. D’une part parce qu’effectivement, une fois qu’on écrit, c’est fini. Mais d’autre part, parce qu’on finit par risquer de se démasquer soi-même sur ce qu’on pense au fond. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à l’entendre. Je pense qu’avant la guerre, il y en avait parmi eux qui étaient prêts à l’entendre et on pouvait parler. Mais ça, c’est fini.
...
Depuis plus de 50 ans, la fondation Maison des sciences de l’homme soutient la recherche et la diffusion des connaissances en sciences humaines et sociales. Avec les voix de Vlad Berindei et Emmanuelle Korn, ce podcast est produit et réalisé par FMSH Médias et Sciences.
Dans la même collection
-
La bande dessinée pour construire un savoir historique, par Ammar Kandeel (podcast)
KandeelAmmarDepuis les années 2000, et surtout à la suite de la publication de Palestine par l’auteur américano-maltais Joe Sacco, le conflit israélo-palestinien est de plus en plus représenté dans la bande
-
Les mobilités et l'Institut français du Proche-Orient (IFPO)
CatusseMyriamInterview de Myriam Catusse, directrice de l'IFPO à propos des programmes de mobilité internationale (programme Atlas entre autres). (Podcast)
-
Dans les archives du génocide des Tutsi, par Philibert Gakwenzire (IFRA) (Podcast)
GakwenzirePhilibertPhilibert Gakwenzire est chercheur et historien à l’Université du Rwanda. Il a orienté son étude sur le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 et fait partie de l’association IBUKA (« Souviens-toi »)
-
Mobilité et internationalisation de la recherche en sciences humaines et sociales entre l'Afrique d…
FouéréMarie-AudeMarie-Aude Fouéré est africaniste et maître de conférences à l’EHESS en anthropologie sociale et politique. Elle appartient également au laboratoire IMAF : Institut des Mondes Africains.
-
Les transports semi-collectifs à Nairobi, pratiques numériques et populations, par Teddy Delaunay (…
DelaunayTeddyTeddy Delaunay est lauréat d’une aide à la mobilité postdoctorale de courte durée Atlas, financée par le FMSH et l’IFRA Nairobi (Institut Français de Recherche en Afrique). En 2019, il s’est ainsi
-
Expressions culturelles du trauma chez les victimes de viol au regard de la psycho-clinique, par Ho…
BouzidiHoudaHouda Bouzidi est chercheuse à l'Université de Mostaganem en Algérie. En 2018, elle a bénéficié d'une aide à la mobilité de la part de la FMSH et du CASS (Conseil Arabe pour les Sciences Sociales)
-
Mobilité et internationalisation de la recherche entre la France et le Mexique, par Bernard Tallet …
TalletBernardLe géographe Bernard Tallet est directeur du CEMCA (Centre d’Etudes mexicaines et centre-américaines), un des 27 Instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) placés sous la double
-
Navigation de tradition indigène en pays Maya, par Alexandra Biar (podcast)
BiarAlexandraLa FMSH et ses partenaires à l’étranger offrent des aides à la mobilité pour des séjours de recherches en SHS à des post-doctorants. Ainsi, chaque année le programme Atlas permet à des
-
Mobilisations sociales, politique et société dans le Kirghizistan contemporain, par Asel Doolotkeld…
DoolotkeldievaAselAsel Doolotkeldieva est docteure en sciences politiques et chercheuse associée à l’OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) à Bishkek. Après avoir réalisé une partie de ses
-
Programme DEA - Laurier Turgeon : la vie des objets, entre histoire, ethnologie et patrimoine
TurgeonLaurierLaurier Turgeon est professeur titulaire en ethnologie et en histoire au département des sciences historiques de l’Université Laval.
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
Éditer la recherche en sciences humaines et sociales
BourmeauSylvainRecoquillonCharlotteBlot-MaccagnanStéphanieDeharbeKarineLabzaéMehdiMilleMurielSimioniMelchiorMachemehlCharlyLa rencontre "Éditer la recherche en sciences humaines et sociales", organisée en partenariat avec le journal AOC et présentée par Sylvain Bourmeau, s'est tenue dans le grand hall de la Fondation
Sur le même thème
-
Franquismo, identidad nacional y nacionalismo(s) español(es): apropiación, redefinición y una pesad…
Núñez SeixasXosé ManolePor primera vez en Europa, el coloquio Anatomía del franquismo (1936-1977) ofrece una síntesis colectiva de los conocimientos sobre el franquismo, elaborada por historiadores e historiadoras.
-
Franquisme, identité nationale et nationalisme(s) espagnol(s) : Appropriation, redéfinition, et un …
Núñez SeixasXosé ManoleLe colloque Anatomie du franquisme (1936-1977) proposait pour la première fois en Europe une synthèse collective des connaissances sur le franquisme, réalisée par les historiennes et les historiens
-
‘Écrire le pays’ : Les savoirs territoriaux éthiopiens dans la production cartographique européenne…
FicquetÉloiConférence de Éloi Ficquet (EHESS, CéSor), « ‘Écrire le pays’ : Les savoirs territoriaux éthiopiens dans la production cartographique européenne, du XVIIe au XIXe siècle ».
-
Dimitri Minic - Pensée et culture stratégiques russes
MinicDimitriInterview de Dimitri Minic, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Pensée et culture stratégiques russes", en librairie le 20 avril 2023.
-
"Mémorial" ou la mémoire en péril : lorsque le temps présent se heurte au temps passé en Russie
BlumAlainGousseffCatherineDaucéFrançoiseEn décembre 2021, la Cour suprême de la Fédération de Russie a décidé de dissoudre l’association Mémorial - qui garde la mémoire des violences staliniennes, écrit l’histoire des répressions politiques
-
Qu'est-ce que l'actualité politique ?
ArtièresPhilippeBoltanskiLucCallardCarolineEsquerreArnaudManiglierPatriceNous sommes, toutes et tous, plongés dans l’actualité et habitués à commenter celle afférent à la politique qui rythme notre vie quotidienne.
-
La guerre comme opérateur du temps
IngraoChristianSaint-FuscienEmmanuelVidal-NaquetClémentinePignotManonLa guerre fait émerger de nouvelles temporalités au sein des sociétés brutalement bouleversées.
-
Table ronde : Contraints à l’exil - parcours de chercheurs affectés par la guerre en Ukraine
GubertFloreLieppeGwenaëlleLohéacLauraKandakouDzianisБеловаОлгаMitrofanovaOksanaDans le cadre de la campagne de levée de fonds au profit des chercheuses et chercheurs affectés par la guerre en Ukraine, la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) a organisé, le jeudi 17
-
DES TRAÎTRES DANS LA RÉSISTANCE
GrenardFabriceDans ce podcast, Fabrice Grenard, auteur de « La Traque des Résistants », présente la manière dont les Allemands ont réussi à infiltrer des agents, français, dans la Résistance dès 1940.
-
Victimes de la répression nazie, leurs enfants parlent - Chercheurs en ville #67
Le BoulangerIsabelleDavidColetteLe BartChristianNotre invitée ce mois-ci dans Chercheurs en ville, est Isabelle Le Boulanger chercheure associée en histoire contemporaine au centre de recherche bretonne et celtique à Brest. Dans cette émission,
-
Crimes de guerre
CotteBrunoBruno Cotte, haut magistrat français, qui a présidé durant plusieurs années une chambre de première instance à la Cour pénale internationale de La Haye, intervient sur la notion de « Crimes de guerre
-
SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE "UNE PRISON POUR MÉMOIRE, MONTLUC DE 1944 À NOS JOURS"
AndréMarcLantieriFrédériqueÀ l'occasion de la parution de Une prison pour mémoire. Montluc, de 1944 à nos jours de Marc André, le 22 septembre dans la collection "Sociétés, espaces, temps" d'ENS Éditions, la Fondation Maison