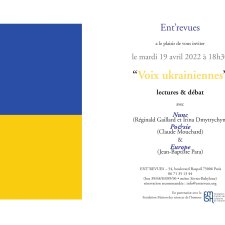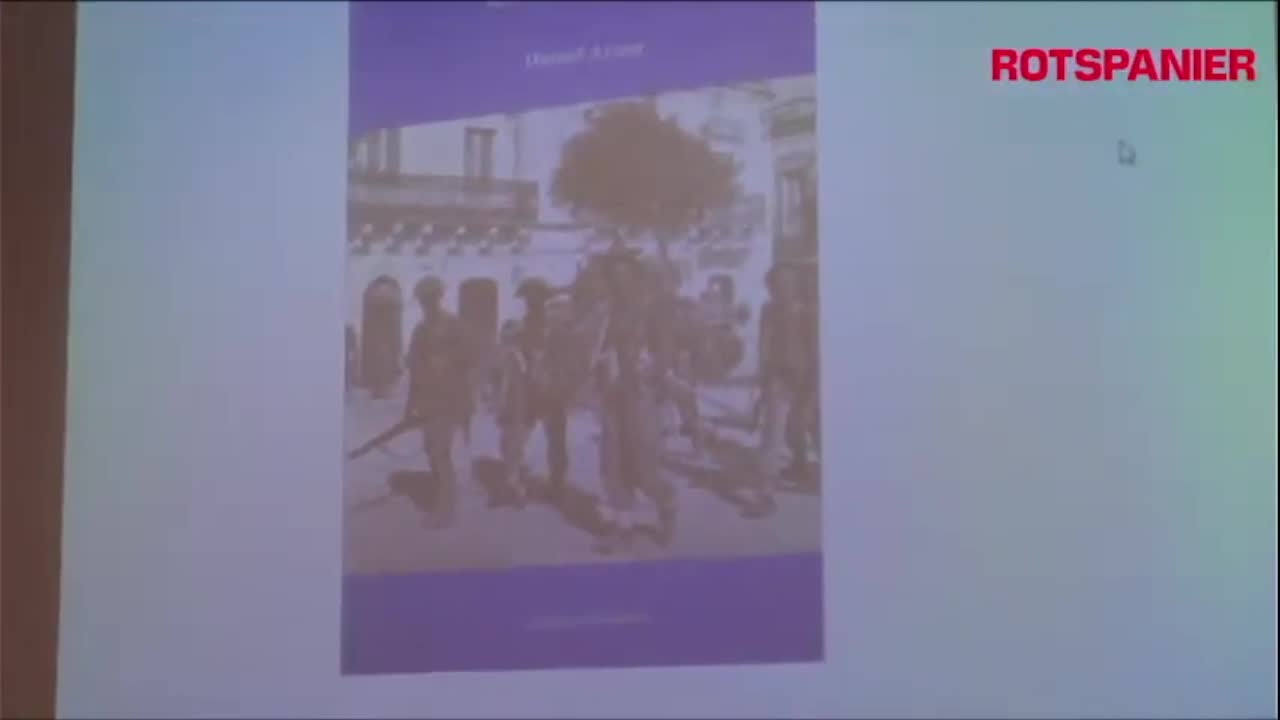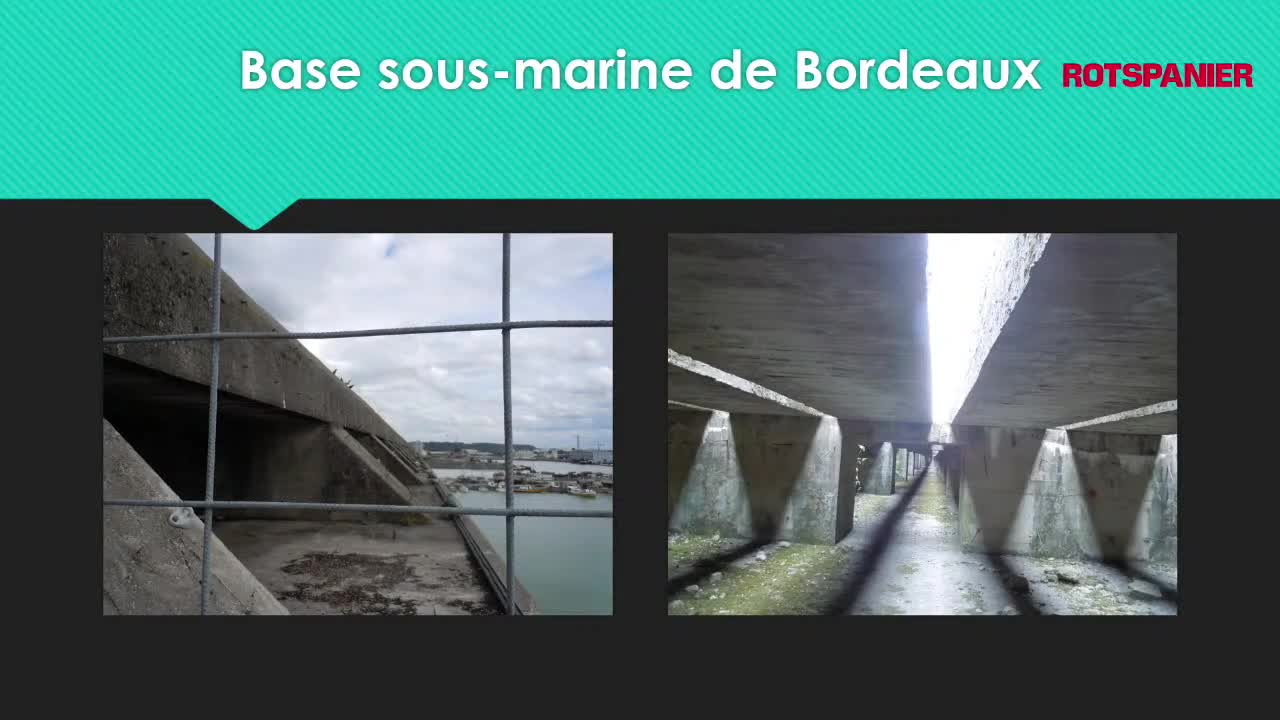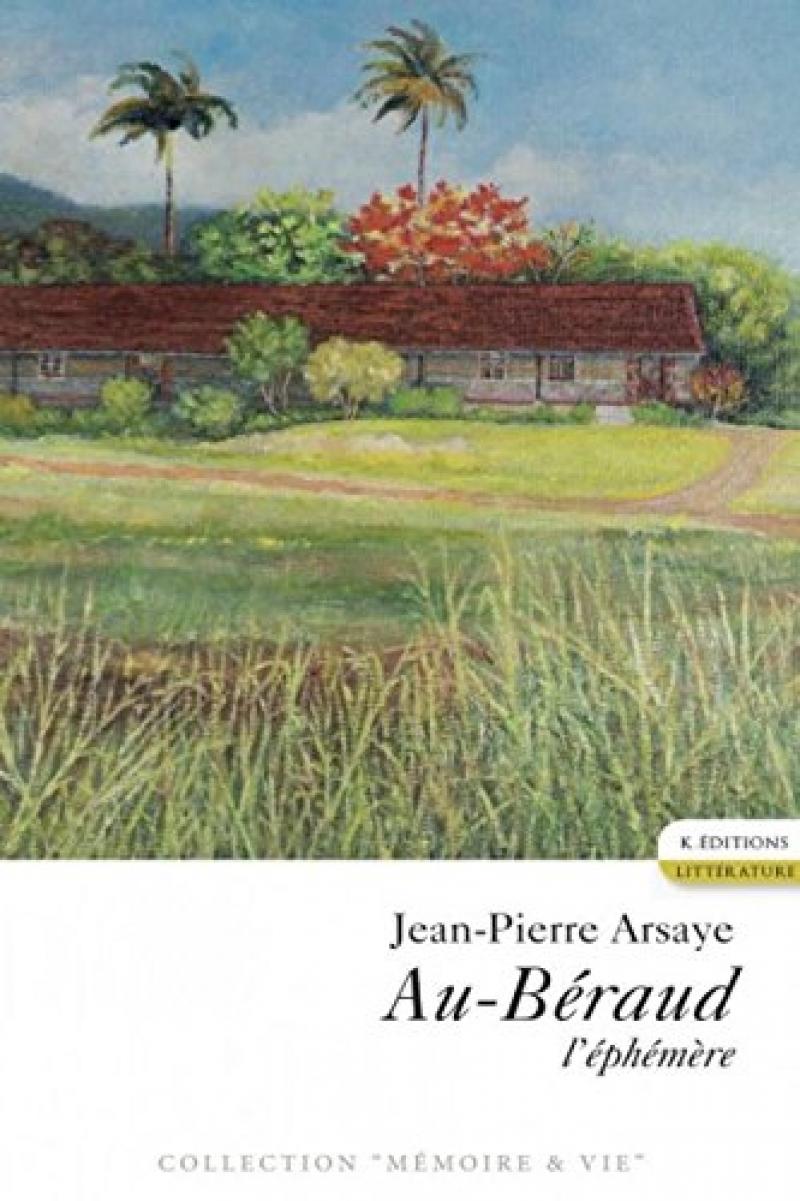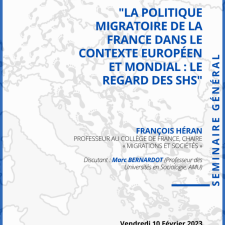Chapitres
- Présentation03'10"
- Sara Guindani03'43"
- Álvaro Vasconcelos08'42"
- Jacques Rupnik39'20"
- Iryna Dmytrychyn08'57"
- Álvaro Vasconcelos02'02"
- Jacques Rupnik12'10"
- Iryna Dmytrychyn02'10"
- Álvaro Vasconcelos01'07"
- Questions du public22'55"
Notice
Comptoir de la FMSH
Milan Kundera, un passeur entre deux Europes
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Figure du renouveau culturel des années soixante en Tchécoslovaquie, Milan Kundera quitte son pays après l'écrasement du Printemps de Prague et l'instauration de censure et de répression baptisé 'normalisation'. En France, pays qu'il choisit comme terre d'exil et dont il deviendra le citoyen, il connaît le succès littéraire avec des romans écrits en tchèque puis en Français.
Avec son célèbre essai "Un occident kidnappé ou la tragédie de l'Europe centrale" paru en 1983 (et réédité en 2022) qui connut un immense retentissement, il contribua à dépasser les frontières idéologico-politiques de l'époque et à refaçonner la carte mentale de l'Europe avant 1989. L'écrivain exilé comme passeur entre deux mondes.
Intervention
Thème
Documentation
TRANSCRIPTION
Bonjour à tous ! Merci, Alvaro, et à la Fondation d'avoir organisé cette série de conférences. Je dois parler de Kundera, qui est un cas assez atypique, mais je vais expliquer pourquoi et peut-être que ce n'est pas complètement hors sujet. Atypique ne veut pas dire hors sujet. Tu as mentionné le fait qu'il est venu en France comme écrivain, mais il a trouvé son port d'attache à l'École des hautes études en sciences sociales, dans ce bâtiment. Il a enseigné ici pendant une douzaine d'années un séminaire sur la littérature d'Europe centrale, un endroit pour lequel il y avait beaucoup d'intérêt. C'était la découverte de l'Europe centrale dans les années 1980, et Kundera y a grandement contribué. C'était l'idée de François Furet, qui était président de l'école à ce moment-là : c'est que l'école doit être une sorte de pont avec les pays de l'autre Europe, pour employer ce terme, et surtout après le coup d'État du général Jaruzelski en Pologne, aussi un lieu d'accueil pour ce qu'on imaginait être une résistance prolongée. On ne savait pas combien de temps ce système allait durer, mais il fallait une base de repli. C'était ça, l'idée. Il fallait permettre aux intellectuels, aux chercheurs, etc. Kundera en tant qu'écrivain, c'était un cas particulier, mais ça s'inscrivait dans une approche d'ensemble. Ça, c'est mon hommage à l'École où moi-même j'ai enseigné, pendant 15 ans, un séminaire sur l'Europe centrale, avec un autre exilé d'Europe centrale qui est hongrois, Pierre Kende. Il a 98 ans et habite Paris. Il est exilé de 1956 de Hongrie, venu en France. Nous avons fait ce séminaire pendant une quinzaine d'années ensemble. Après 1989, il est retourné en Hongrie. Il est revenu il y a quatre, cinq ans. Il m'a dit : "Je repars définitivement en exil à nouveau." Ça se passe de commentaires. Pour enchaîner sur l'introduction d'Alvaro qui a parlé de l'accueil, peut-être faire quelques distinctions entre migrations de population, il y a eu une énorme migration. Ce que l'on voit en Ukraine, les sept millions, c'est le plus grand déplacement de population en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, provoqué par la guerre, bien entendu, comme les grandes migrations d'après 1945 étaient dues à la Deuxième Guerre mondiale. En Europe centrale, les émigrations liées à des crises politiques, c'était en 1956 en Hongrie, 1968 en Tchécoslovaquie, Jaruzelski que j'ai mentionné, le coup d'État de 1981. Vous avez une migration de population qui peut amener des départs assez importants. En Hongrie, c'était 200 000 personnes qui ont quitté en 1956. Les Hongrois l'oublient aujourd'hui, mais ils ont été accueillis, eux aussi. Ils n'aiment pas beaucoup l'accueil de réfugiés, aujourd'hui. Il y a l'émigration et il y a l'exil. Il y a l'exil politique et l'exil littéraire. Et vous voyez que l'exil littéraire, je vais en arriver à Kundera, mais je rappelle que Paris a été un lieu privilégié de l'exil politique, en particulier d'Europe centrale. Si je mentionne les trois plus grandes revues de l'exil politique centre-européen, la revue Kultura à Paris, dirigée par Jerzy Giedroyć, établi à Paris après la guerre 1945 et resté toute sa vie à Paris, est la revue intellectuelle, politique, culturelle la plus influente en Pologne de l'après-guerre. La revue que dirigeait mon ami Kende Péter, pour le dire en hongrois, ou Pierre Kende, comme on l'appelait dans cette maison, s'appelait Magyar füzetek, les Cahiers hongrois. C'était la revue politique la plus importante de l'exil politique hongrois. À Paris, Pavel Tigrid, exilé tchèque de 1948, avait créé une revue en 1956 qui s'appelait Svědectví, Témoignage. C'est une revue qui a duré jusqu'en 1990, la plus importante et la référence à la fois culturelle et politique. Ça, c'est l'exil politique. C'est un exil qui est tourné vers le pays d'origine et qui souhaite avoir une influence dans le pays d'origine et éventuellement tourné vers le retour. Vers le retour. Puisque Alvaro a mentionné Mário Soares, je remercie Alvaro de m'avoir permis de dîner avec, à l'époque, le président Mário Soares qui, à la fin d'un dîner, nous a raconté son retour au Portugal, son retour de France magnifique en train, magnifique récit dont je ne vais pas reproduire maintenant. L'arrivée à la gare, vous avez vos sympathisants qui y croient, on est dans la révolution des Œillets. Mais ce n'était pas la force politique la plus importante à l'époque. Il regardait Alvaro Cunhal, l'autre exilé, qui revenait. Je raconte juste cette anecdote parce qu’elle m'est restée. Tout le monde disait : il faut y aller, il faut y aller ! Mais je voyais que la concurrence était rude, pour le dire comme ça. Et il y a le grand meeting sur la place à Lisbonne. Cunhal sort un discours qu'il avait préparé en exil il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas. Il commence à le lire. Et cette foule enthousiaste applaudit un peu poliment, puis progressivement s'est assoupie, silencieuse. Au fur et à mesure que Cunhal prononçait son discours terne, ennuyeux dans la langue de bois du Parti, j'ai commencé à me dire : peut-être qu'on a une chance. Effectivement, il a eu une chance magnifique. Magnifique retour de Mário Soares. Ça, c'est l'exil politique. Il y a un livre magnifique de E. H. Carr, historien anglais, The Romantic Exiles. Vous avez la rencontre à Londres, au début des années 1960, de Herzen et Bakounine. Bakounine vient de passer huit ans en prison plus quatre ans de déportation en Sibérie. Il arrive à Londres et demande Herzen : "Alors, qu'est-ce qui se passe ici ?" "C'est bien, c'est calme." "Mais en Italie ?" "La situation est stable." "Et en Autriche ?" "La situation est calme." "Et en Turquie, et à (inaudible) ?" "Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ?" Ça, c'est l'exilé politique, l'animal politique. Il veut combattre et, à peine sorti de son goulag, qui ne s'appelait pas comme ça, il ne pense déjà qu'à en découdre. Et je mentionne ça parce que je ne peux pas imaginer de cas plus opposé à ça que l'exil littéraire de Milan Kundera. Il n'y a pas de cas plus opposé, par le tempérament et par ce que signifie l'exil pour lui. Souvent, pour les écrivains exilés, j'en ai connu beaucoup d'Europe centrales, ce sont des situations difficiles. Ils n'ont plus leur public, ils sont dans des situations matérielles… Tout ça est vrai. L'histoire de l'exil littéraire, il y a certainement des séminaires dans l'École. Vous lisez Ovide relégué dans le delta du Danube, ses souffrances, sa déprime, ses regrets, tout ça. Je crois que le recueil avait été publié sous le titre L'exil et le salut. (Il est triste.) Kundera, c'est le contraire. C'est le salut par l'exil. Il a écrit un article qui s'appelle L'exil libérateur. Il est libéré dans plusieurs sens du terme. Non seulement il est libéré de la surveillance de la police qu'il avait à Prague après 1968 avec le régime de normalisation, mais parce qu'il considère que l'exil ouvre des possibilités et il s'appuie sur un texte d'une poétesse tchèque qui, elle aussi, a choisi Paris comme exil, Věra Linhartová, personnage solitaire, très bonne poète qui navigue entre Paris et le Japon, très peu à Prague. Kundera la cite parce que Linhartová a dit que l'exil est non seulement ouvert à plein de possibilités, etc., mais il permet le choix d'une autre langue. Et c'est là où c'est intéressant pour comprendre Kundera. Il faut que je retrouve la citation. Comment faire ? Kundera, c'est une sorte de profession de foi : "Quand Linhartová écrit en français, est-elle encore écrivain tchèque ? Non. Devient-elle écrivain français ? Non plus. Elle est ailleurs. Ailleurs, comme jadis Chopin. Ailleurs comme plus tard, chacun à sa manière, Nabokov, Beckett, Gombrowicz, etc." Et on a envie de dire : et comme Kundera. Bien entendu, quand il fait cette liste-là. L'exil libérateur, ce n'est pas seulement d'être libéré d'une tutelle, d'un emprisonnement, de la surveillance policière, parce qu'après 1968, évidemment, il est un écrivain censuré, interdit. Maintenant qu'on a accès aux dossiers de police, évidemment surveillance de son téléphone, tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'est pas emprisonné, ce n'est pas encore la période. Il est parti avant la période de répression la plus dure. Mais il y a ce choix de la langue, cette liberté et aussi le passage à la langue du pays d'accueil, en quelque sorte, et épouser sa culture. Ce qui complique sa relation avec le pays d'origine, vous l'imaginez, mais l'enrichit aussi. Parce que soudain, vous avez un écrivain qui non seulement a une audience européenne, mais mondiale. Encore aujourd'hui, je ne parle pas du moment où les livres sont publiés. Quand je suis au Japon et que je regarde les livres étrangers traduits, le seul écrivain tchèque traduit, c'est Kundera. La même chose à Cambridge, Massachusetts, quand je vais à Harvard Book Store, etc. Je pourrais continuer. Vous avez un écrivain qui s'est senti libéré parce qu’il n'est plus au service d'une cause, de quelque chose. L'écrivain en Europe centrale, depuis surtout le 19ᵉ siècle, a un lourd fardeau. Il doit porter la culture nationale, défendre la langue. La culture est le substitut du politique. Vous avez cette mission de l'écrivain. Et sous le communisme, soit l'écrivain est au service du Parti et de la cause communiste pour certains, et Kundera a été brièvement communiste au début du régime d'après 1948 ; ou alors l'écrivain dissident qui est au service de la cause des droits de l'homme, du combat des droits de l'homme. Mais vous êtes toujours au service de quelque chose. Et l'exil libérateur, c'est aussi l'émancipation par rapport à l'idée d'une œuvre, d'une littérature qui doit être au service de.
(Inaudible)
C'était l'introduction.
(Inaudible)
Mais il faut que tu me dises que je dois me taire. Peut-être deux choses qui sont importantes. Il n'a pas été au service du combat pour les droits de l'homme, etc. Il n'a pas été le pétitionnaire habituel et a parfois ironisé sur les pétitions dans un de ses romans. Mais il a fait pour son pays et pour la culture de l'Europe centrale quelque chose qui n'est pas de l'ordre politique : il a mis l'Europe centrale sur la carte de l'Europe. C'est quelque chose qui a une dimension d'abord culturelle, bien sûr, mais avant tout politique. Comment il est arrivé là ? Parce que l'expérience de Kundera dans son pays, dans les années 1960, c'est l'expérience de l'émancipation de la culture par rapport à l'idéologie, par rapport à la censure, par rapport au contrôle politique. Pas seulement en 1968, mais pendant toutes les années 1960. Ce n'est pas seulement la littérature, c'est le théâtre avec Václav Havel, c'est le cinéma avec Milos Forman et toute la Nouvelle Vague. Bref, c'est l'âge d'or de la culture tchèque des années 1960. Le pays en 1968, c'est l'aboutissement d'un processus, l'émancipation d'une société par la culture, par rapport à une structure communiste. Et cette expérience du primat de la culture sur la politique, c'est ce qu'il emporte avec lui en exil. Et sa réflexion sur la France, pays où il arrive, mais plus généralement sur l'Europe, sera beaucoup marquée par ça. Je ne vais pas parler de ses romans. Il y a sans doute, peut-être, j'espère, des séminaires sur la littérature d'Europe centrale dans cette maison, sinon à l'Inalco, chez vous. Je vais directement à l'essentiel, c'est-à-dire son essai La Tragédie de l'Europe centrale ou l'Occident kidnappé. Ça, vous l'avez ici. Il a été réédité maintenant. C'est intéressant, il a été réédité l'année dernière. Épuisé en un mois. Nouvelle édition. Il est traduit, maintenant, en 15 langues. La semaine dernière, en portugais. Mais aussi coréen, grec, italien… C'est intéressant. Pourquoi ? Cet essai écrit il y a 40 ans, dans un tout autre contexte, pourquoi est-il actuel aujourd'hui ? Que dit, d'abord, cet essai ? Il y a cette phrase qui résume le problème d'emblée : l'Europe centrale est culturellement à l'Ouest, politiquement à l'Est, géographiquement au centre. C'est ça, la tragédie de l'Europe centrale : elle est écartelée entre la culture et la politique et sa géographie, en quelque sorte. Qu'est-ce que 1989 ? C'est la possibilité de réconcilier la culture, la politique et la géographie. C'est ça, 89, ce que ça signifie pour les pays d'Europe centrale. Mais la raison du regain d'intérêt pour ce livre, sa réédition… essai, d'ailleurs, qui ne figure pas dans ses œuvres complètes. Il n'a pas voulu que ça figure parce que l'essai avait déclenché — c'est un essai qui a 40 pages ou 50 pages — des milliers de pages de débats autour de ça, à l'époque. Pourquoi ? Parce que certains lui reprochaient d'oublier l'Allemagne. Pourquoi il parle de l'Europe centrale et il ne parle pas de l'Allemagne ? D'autres disaient : "Il a exclu la Russie." Donc, il a pris de toutes parts et il a dit : "Je ne faisais pas un traité savant, je faisais un essai en tant qu'écrivain sur la culture. Tous les savants me tombent dessus. Les politiques me reprochent ceci. Bref, plus jamais je ne veux écrire une ligne sur l'Europe centrale." Et c'est un best-seller. C'est qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'important. La question importante, c'est le rapport entre la culture et la politique, d'abord, et c'est le rapport entre l'Europe et la Russie. Sur le premier plan, le rapport de l'Europe à la culture. Il dit : l'Europe a été divisée, Europe de l'Est et Europe de l'Ouest. Et l'Europe centrale, dont il parle, il dit : "L'Occident n'a pas ressenti cette coupure comme une mutilation." Pourquoi ? Parce que l'Europe ne se pense plus comme culture. L'Europe, à l'époque, d'ailleurs, ça s'appelait le Marché commun. L'Europe, c'est le Marché commun, avec les surplus, avec les montants compensatoires pour l'agriculture et tous les problèmes avenants. Donc l'Europe, c'est un marché commun. Et l'Europe ne se pense plus comme culture. Ça, c'était la première. Et pourquoi a-t-elle accepté si facilement ? Parce que, déjà, elle a mal nommé les choses. On parle de démocraties populaires d'Europe de l'Est. C'était l'appellation convenue. Quand j'étais étudiant, il y avait un cours, à Sciences Po, de Pierre George qui s'appelait Les Démocraties populaires d'Europe de l'Est. Kundera dit : "Trois mots, trois mensonges. Ce n'est pas des démocraties, c'est des dictatures. C'est des régimes éminemment impopulaires. Et ils ne sont même pas en Europe de l'Est, ils sont en Europe centrale." "Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde", disait Camus. Eh bien, là, rétablir, réhabiliter certaines notions. La raison pour laquelle ça a été accepté, c'est parce qu'on a abandonné, on a cessé de penser l'Europe comme un ensemble culturel. Donc, on a accepté cette division à l'Ouest. On ne l'acceptait pas à l'Est, parce que la seule façon d'appartenir à l'Ouest, c'était par la culture, justement. Donc, c'est la symétrie de la relation entre l'Est et l'Ouest et dans le rapport entre la culture et la politique. Mais l'autre grand sujet et l'autre raison pour laquelle ce texte suscite, soudain, tellement d'intérêt, c'est la Russie. L'Europe centrale, Occident kidnappé. Kidnappé par qui ? Par le grand empire de l'Est. La Russie n'est pas seulement une puissance un peu lourde qui envoie des tanks de temps en temps, tous les 12 ans, généralement. 56, 68, 80. C'est périodique. Mais Kundera pose la question : "Est-ce que le communisme est le prolongement ou la négation de l'histoire russe ?" Les Russes, les intellectuels russes pensent que c'est la négation. En Europe centrale, on pense que c'est le prolongement, qu'il y a un lien. Alain Besançon, qui enseignait dans cette maison, avait écrit un livre, Passé russe et présent soviétique. Aujourd'hui, on dirait : passé soviétique et présent russe. Le cycle se prolonge ainsi. Kundera, on lui a fait des reproches sur la Russie. Mais il dit : "C'est une autre civilisation." Il ne dit que c'est une civilisation inférieure. Il dit : "C'est une autre civilisation." Il y a, en Europe centrale, et chez Kundera en particulier, plusieurs thèmes. Il y a le thème de la Russie et de son rapport à la liberté et à la société civile. Ils n'ont pas connu de société civile. Ils n'ont jamais eu de droits. Le droit. Et pourquoi ? C'est la fusion du spirituel et du temporel. C'est l'orthodoxie. Donc, le domaine spirituel soumis au pouvoir d'État, au service du pouvoir d'État. Jamais plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Le patriarche Kirill, il faut l'écouter sur l'Ukraine. C'est quand même quelque chose, donc jamais plus au service que… En ce sens là, il y a une différence. Et c'est une différence qu'il appelle civilisationnelle, culturelle, qui a trait à beaucoup de domaines : à la notion de société civile, à la notion de droit. Je ne vais pas faire tout un récit sur le cours de l'histoire. Puis il y a la dimension impériale. La façon dont la Russie s'est européanisée, depuis Pierre le Grand, c'est par la conquête impériale. C'est par l'expansion impériale. Donc, c'est une "européanisation bien particulière". Donc, ça, c'est le point de vue de Kundera, émis à l'époque, publié dans une revue de débat, mais qui a eu un impact considérable. L'idée s'est diffusée. Il y a eu des conférences autour de ça. Le thème de l'Europe centrale est devenu important. Si je devais, comme ça, abréger un long développement, je dirais : "Par son essai, Kundera a contribué à changer la carte mentale des Occidentaux, de l'Europe occidentale." Ils ont eu une autre perception de l'Europe grâce à ça. Soudain, cet Est-Ouest et les démocraties populaires d'Europe de l'Est s'estompaient et on découvrait, derrière le régime des sociétés, dans ces sociétés, des cultures et des mouvements d'opposition, dissidence, etc., qui existaient et qui devenaient des interlocuteurs pour l'Occident et pas seulement les régimes et les États. Donc, je pense que, ça, c'était un moment très important. Il a changé la carte mentale des Occidentaux. Je donne une illustration, peut-être, du rapport. Là, je vais quand même citer. Si Alvaro me le permet, je vais quand même citer.
Si ta citation est fondamentale, alors on va l'écouter.
Oui, elle est fondamentale, si je la retrouve. C'est une conférence d'écrivains — en grande partie d'écrivains exilés, mais pas seulement — qui a eu lieu à Lisbonne, en mai 88. Je me demande si ce n'est pas Gulbenkian. C'est à vérifier. Je n'ai pas vérifié avant de venir.
C'était à la mairie de Lisbonne. C'était les villes, terres d'asile.
Mais 88.
(Inaudible.) Villes refuges.
Villes refuges ?
Oui. (Inaudible) faisait partie de cette…
Non, là, c'est une rencontre entre les écrivains d'Europe centrale et les Russes. Et les Russes uniquement. C'est autre chose. Très important, pour Kundera, la Russie, c'est le "Constitutive Other". C'est l'autre par rapport auquel on se définit. On peut comprendre que tous les Russes, les écrivains russes n'aient pas nécessairement été enthousiasmés par cette idée. Mais il y a cette conférence. Je donne juste quelques noms. Kundera ne participait pas, mais on a parlé beaucoup de Kundera. Pendant la moitié de la conférence, on a parlé de Kundera. Il y avait Czesław Miłosz, Prix Nobel de littérature, poète exilé d'abord en France, puis à San Francisco. György Konrád, écrivain hongrois non exilé. Josef Škvorecký, écrivain tchèque exilé à Toronto. Danilo Kiš, à Paris, écrivain serbe. Côté russe, vous avez Joseph Brodsky, le poète à New York, Tatyana Tolstaya, Lev Anninsky, Zinovii Zinik… vous en avez un certain nombre. Je ne peux pas tout résumer, mais, quand même, il y a quelques moments assez forts. Après avoir écouté tous les discours des écrivains d'Europe centrale, Tatyana Tolstaya dit — je vais citer ça en anglais parce que j'ai la transcription des débats en anglais : "The stubbornness with which everybody talks about Central Europe as if it were a special place which somehow unifies you, and I've even felt an apologetic sense as though it were bad to be an Eastern European…" Elle continue. Elle n'a pas apprécié les références aux contingences externes. "L'appartenance — dit-elle — à un petit pays ou la présence de l'Armée rouge — elle a cette formule —, pourquoi serais-je responsable de ça ? Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Je ne suis pas politique, je ne suis pas militaire… Je n'ai aucun pouvoir." Škvorecký, l'écrivain tchèque, lui avait répondu en citant Ján Kollár, qui était un écrivain d'il y a deux siècles, mais dont il fait la citation : "Do not use the holy name of your country for the piece of land where we live." Je crois que beaucoup d'Ukrainiens ont, aujourd'hui, cette citation présente à l'esprit ou une variante de cette citation. Konrád souligne les liens de la culture d'Europe centrale avec la culture occidentale. Il cite Kundera, etc. Et Tolstaya répond : "Now I understand, I've been asked when we are going to remove our tanks from Central Europe. Is that a question? When will I remove my tanks out of Central Europe? We're not historians. We're not people who have authority over tanks. We're writers" Et ça continue dans cette veine-là. Ensuite, il y a l'échange, peut-être le plus significatif, entre Czesław Miłosz et Brodsky, deux écrivains exilés : un Polonais, un Russe de Leningrad. Miłosz développe l'argument de Kundera. Il cite Kundera et l'attachement à l'Europe. Il dit : "On est d'autant plus attaché à l'idée européenne à sa limite, dans les confins, parce que c'est là que l'idée européenne est la plus menacée. C'est à la limite qu'on est le plus attaché." Brodsky répond. Il voit dans l'Europe centrale, selon Kundera, une manière de reléguer la Russie hors d'Europe. Brodsky dit : "In the name of literature, there is no such thing as a Central Europe. There is Polish literature, Czech literature, Slovak literature, Serbo-Croatian literature, Hungarian literature, and so forth. Tt s impossible to speak about this concept even in the name of literature. It s an oxymoron." Là-dessus, Miłosz répond : "Divide et impera. This is a colonial principle and you are for that." Brodsky répond : "Divide et impera? In what way, Czesław? I don t understand you. Could you specify?" Miłosz répond : "The concept of Central Europe is not an invention of Kundera. You have an obsession that it is an invention of Kundera. Not at all. Central Europe is an anti-soviet concept provoked by the occupation of those countries. And I should add that the conscience of a writer, for instance a Russian writer, would cope with such facts, for instance, as the pact between Hitler and Stalin and the occupation of the Baltic countries of which I am a native. And I am afraid that there is certainly a taboo in Russian literature and that taboo is empire." Empire. Problématique postcoloniale. Je ne vais pas poursuivre la lecture. L'échange fut musclé, vif, franc. "Échange franc" dans les comptes rendus des réunions communistes, généralement, ça voulait dire qu'ils s'étaient étripés complètement. Là, ce n'était pas complètement le cas. C'étaient tous de grands poètes. Brodsky, immense poète que j'ai connu à New York. J'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Et Miłosz, aussi. Deux grands poètes s'étripent sur la question de l'Empire. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est la question qui revient aujourd'hui. Beaucoup d'intellectuels ou d'écrivains russes, peut-être, ont ce problème-là. Ils n'ont pas mesuré que leur histoire, y compris l'histoire du 20ᵉ siècle, est une histoire impériale aussi et que les soubresauts post-impériaux doivent être réfléchis par eux aussi. L'interpellation entre exilés, c'était quelque chose… C'est en cela d'ailleurs que l'exil contribue… Là, il faut que j'abrège.
(Inaudible)
Ma conclusion serait la suivante : aujourd'hui, à cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle se trouve l'Ukraine, le texte de Kundera résonne à nouveau à la fois pour ce qu'il dit sur l'Europe et ce qu'il dit sur la Russie. Ce qu'il dit sur l'Europe, l'Europe qui s'est construite par l'économie, par le marché et par le droit : "Ce n'est pas assez pour tenir. Si vous voulez un projet, il faut penser le rapport de la culture et de la politique. Il faut penser les fondements des valeurs auxquelles vous êtes attachés et qui font partie de notre civilisation européenne." Prenez ce mot avec tous les guillemets que vous voudrez. Je sais que c'est un mot chargé, mais Kundera n'a pas peur de l'utiliser. Il nous rappelle cela à un moment où nous avons justement un débat sur les limites de l'Europe par le marché et par le droit, et par la question des valeurs qui nous est posée, entre autres d'ailleurs, par la défense de ces valeurs en Ukraine. Et l'autre question qui est posée est celle du rapport de l'Europe à la Russie et de l'Europe centrale. On pourrait dire qu'après 1989, le concept de l'Europe centrale qui était une Europe de la culture était une sorte de "exit from Soviet fold" imaginaire, culturel. C'était dans les esprits. On ne pouvait pas s'échapper, l'Europe était divisée, mais vous vous échappez, en gros, mentalement. Après 1989, vous pouvez réaliser l'Europe centrale. Mais non, l'Europe centrale veut aller à l'Ouest. L'Europe centrale, l'Occident kidnappé, se précipite vers l'Union européenne, vers l'Europe, l'OTAN. Il faut être dans tous les organismes. On ne veut plus discuter de l'Europe centrale. La crise ukrainienne signifie que soudain les pays d'Europe centrale découvrent qu'ils ont une sensibilité par rapport à ce qui se passe en Ukraine, peut-être différente de celle des Allemands, des Français ou des Belges, ou peut-être des Portugais, je n'en sais rien. C'est une première chose. Et le président ukrainien dit : nous voulons appartenir à l'Europe, nous appartenons à l'Europe, nous défendons les valeurs européennes", etc. Et l'Europe la plus proche de l'Ukraine, c'est l'Europe centrale. Donc, je dirais que, avec ce qui se passe en Ukraine, les Européens du Centre redécouvrent leurs spécificités au sein de l'Europe, et avec la guerre en Ukraine, l'Ukraine elle-même se découvre une sorte de vocation centre-européenne. Pas seulement parce que Lviv s'appelait Lvov et Lemberg avant, et qu'il y avait une partie de l'Ukraine qui appartenait à l'Empire des Habsbourg, ça serait la version Kundera. Mais là on est au-delà de Kundera. On est justement dans l'idée de ce que Kundera a suggéré : que l'Europe centrale est un espace qui n'est pas défini, qui n'a pas des frontières précises. C'est l'idée centrale de son propos. On ne peut pas tracer les frontières d'une civilisation et d'une culture par des tanks. Ça, c'est le propos. Et si ça, c'est le propos, les cultures peuvent évoluer. L'Europe centrale se redécouvre une vocation nouvelle dans la guerre en Ukraine. L'Ukraine penche vers l'Ouest, c'est-à-dire vers l'Europe centrale. Donc l'Europe centrale, après avoir été l'Occident kidnappé, aujourd'hui, s'élargit à l'Est avec l'Ukraine.
Merci beaucoup. Évidemment, après avoir écouté Jacques, j'ai envie de faire des commentaires, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais seulement faire un commentaire, qui peut-être pourra aider à la discussion. Sur l'exil, tu as fait la différenciation entre les exilés intellectuels, l'exil littéraire et libérateur, et les exilés politiques. Et moi, à travers mon expérience d'exilé politique ici, je ne ferais pas cette différenciation. Je pense que l'exil politique est aussi un exil libérateur. On avait accès à un monde de culture, un monde de pensée sur la politique qu'on n'avait pas dans nos pays. On s'est transformé politiquement et culturellement en tant qu'exilé politique, l'exil était aussi libérateur, au service d'une cause. Mais ça, c'est rentrer déjà dans le débat et on va écouter Irina. Mais avant, ça, dans cet exil libérateur politique, il manque une mention dans cette discussion, peut-être Irina pourra la rajouter, c'est l'impact que ces intellectuels ont dans le pays même. Le fait que la France était terre d'asile, c'était un enrichissement pour la France, comme pour tous les pays qui ont reçu des exilés et qui ont donné des contributions extraordinaires à leur culture. Alors, exil libérateur pour les exilés, peut-être, mais aussi exil libérateur (à contrecœur) pour ceux qui reçoivent les exilés. L'exil est libérateur pour tous. Sinon, on peut rentrer dans la question de la Russie.
Non, pas maintenant.
Alors, on va écouter Irina nous parler de l'exil. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup à vous. Et je tiens tout d'abord à dire ma joie, mon honneur, ma fierté d'être présente ici, à cette rencontre, aux côtés de Jacques Rupnik, qui était mon professeur à Sciences Po. Je devrais ajouter mon professeur préféré. Mais je ne serais pas original parce que c'était le professeur préféré de tous les étudiants. C'est celui qui n'avait pas besoin de faire une feuille d'émargement, etc. Les cours étaient toujours pleins. Un professeur passionné et véritablement adoré par les étudiants. Pour ce qui est de l'Ukraine et de la Tchécoslovaquie, il y a énormément de points communs, aussi bien dans l'histoire que dans l'histoire du 20ᵉ siècle. On peut peut-être commencer par dire qu'il s'agissait de deux peuples sans État, dans lesquels justement le rôle de l'écrivain était extrêmement important. Parce que dès le 19ᵉ siècle, ce sont des écrivains qui fondaient et justifiaient l'existence d'une nation, en tout cas son existence future, ses revendications futures. C'est d'ailleurs Miroslav Hroch qui a élaboré ces trois étapes de l'établissement des nations sans État : d'abord les intellectuels au début 19ᵉ s'intéressent, établissent un peu la différence et essayent de cueillir quelques bribes de folklore, des chants, etc. ; ensuite, d'autres intellectuels les systématisent, établissent une base, écrivent de romans, etc. Et tout ça sert de prodrome à de futures revendications politiques que les Ukrainiens comme les Tchèques ont pu réaliser sur les ruines des deux Empires, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe en 1917, les Ukrainiens avec moins de succès, malheureusement. Mais cette tentative a bien eu lieu. Juste pour rebondir sur Brodsky, je ne veux pas m'étendre longuement là-dessus, ce discours, cette discussion était âpre, mais elle ne touchait pas encore à la question de l'Ukraine. Le poème absolument inacceptable de Brodsky, c'est à l'indépendance de l'Ukraine. Je vous invite à retrouver ce poème, c'est un poème absolument impérialiste et haineux à l'égard de cette indépendance de l'Ukraine où il dit : "Vous voulez être indépendante, mais vous allez ramper devant nous, vous allez revenir en pleurant pour que nous, la Russie, on vous accepte." C'est vraiment un poème qui montre qu'on peut être un grand poète exilé soviétique, mais rester impérialiste, tout comme on peut, malheureusement aujourd'hui, être anti-Poutine et être impérialiste, garder cette idée impériale que l'Ukraine et la Russie peuvent, si elles veulent, prendre la Crimée, un territoire, un pays souverain, tout simplement parce qu'on en a envie, on en a la possibilité et on peut le justifier par des raisons historiques. Je reviendrai plus sur l'Occident kidnappé parce que je pense, comme vous, que ce texte, qui a 40 ans, aujourd'hui a une lumière particulière sur ce qui se passe en Ukraine. Et je commencerai par citer Kundera qui disait que la Tchécoslovaquie était au centre de l'histoire et que ce n'était pas une partie de plaisir. Aujourd'hui, l'Ukraine est au centre de l'histoire européenne, mondiale, et je confirme que ce n'est toujours pas une partie de plaisir, malheureusement. L'Ukraine peut être considérée, d'après la définition de Kundera, comme une petite nation, puisque la petite nation, dans sa définition, est la nation qui est menacée d'existence, c'est-à-dire qu'elle peut tout à fait disparaître. Et en parlant de la Tchécoslovaquie, il a dit que c'était un pays qui a connu l'antichambre de la mort. L'Ukraine aussi a été menacée de disparaître et est passée vraiment tout près justement de cette guerre, à être menacée de disparition. C'est aussi un pays dont l'existence n'était pas évidente. L'existence de l'Ukraine, vous vous souvenez des premiers livres dans les années 1990 qui ont été publiés, (Wilson) notamment, un nowhere nation, un pays venu de nulle part, qu'est ce que c'est ? Est-ce que ça va tenir ? Etc. C'est en cela que l'Ukraine est en quelque sorte le prolongement de l'Europe centrale. Devrait-on peut-être utiliser l'expression Europe orientale, qui a tout à fait son droit d'être citée, parce que son existence n'était pas évidente. Kundera commence ce texte en évoquant la Hongrie et le responsable de la presse hongroise, qui envoie un télex au monde entier en disant qu'il meurt pour la Hongrie, mais il meurt aussi pour l'Europe. Et c'est en cela que le parallèle avec l'Ukraine d'aujourd'hui est absolument évident, parce que les Ukrainiens disent qu'ils se battent pour l'Ukraine, mais ils se battent aussi pour l'Europe. Et Kundera, en prolongeant cette citation, dit que ce qui n'a pas été compris dans ce cri désespéré, c'est que, en Hongrie, c'est l'Europe qu'on attaquait. C'est exactement ce que les Ukrainiens disent : "En Ukraine, c'est l'Europe qu'on attaque, ce sont les valeurs européennes et ses aspirations." C'est le système des valeurs européennes qui est menacé. Malheureusement, vous vous en souvenez, le texte se termine par une sorte de remarque presque désespérée où il dit que probablement, ce cri n'a pas été compris. L'Europe n'a pas compris pourquoi, en parlant de la Hongrie, il évoque l'Europe. Il y a ce constat où il dit que l'Europe s'est construite d'abord sur le principe religieux. Et là, il fait la différence entre le catholicisme et l'orthodoxie. Tout ce qui est orthodoxe, pour lui, est quand même un peu éloigné de l'Europe. Là, il parle de la Bulgarie, mais pas de l'Ukraine, il y a juste une référence. Mais pour lui, d'abord c'était le ciment catholique et ensuite la culture. Pour Kundera, la culture disparaît à l'époque où il écrit ce texte. Il évoque notamment son ami philosophe qui a perdu l'ensemble de son œuvre dans une perquisition et qui s'est demandé où il devrait écrire pour réclamer la restitution de ces documents. Tous les deux, en se promenant à Prague, se disent qu'ils ne peuvent pas faire appel à un politique, il faudrait faire appel à une conscience morale, un grand écrivain. Et ils se disent qu'ils constatent amèrement qu'il n'y a plus, aujourd'hui en Europe, quelqu'un qui pourrait être ce tribun, cette référence reconnue, absolue, et dont la parole pourrait porter. Finalement, ils font appel à Sartre. Sartre fait le nécessaire, et un an plus tard — ça a mis quand même plusieurs mois —, ce philosophe peut récupérer ses manuscrits. Néanmoins, Kundera est sur sa lancée sur le fait que la culture disparaît. C'est pour cela que la disparition de l'Europe centrale, pas en Europe centrale, mais en Occident, a été vécue comme un non-événement. Finalement, ça n'a pas été une grande tragédie. Ma première question aurait été de vous demander : vous pensez que Kundera s'est trompé ? Qu'est-ce que le ciment européen aujourd'hui ? Est-ce que c'est quand même la culture, un système de valeurs ou est-ce que nous n'avons finalement plus grand-chose qui nous définit comme européens ? Je poursuivrai mon parallèle sur l'Ukraine, parce qu'en parlant de ces pays qui, pour lui, ont le droit d'être des pays européens, quand bien même étant géographiquement au centre, il donne comme trait particulier, bien sûr, (la qualification) culturelle, mais surtout les révoltes populaires. Il cite (l'échappée) de la Hongrie 56, la Tchécoslovaquie, les différentes révoltes polonaises, etc. Les traits caractéristiques, c'est que ce n'est pas une révolte par le haut, mais une révolte par le bas, qui touche l'ensemble du peuple, qui s'organise sans que quelqu'un lui dise quoi que ce soit. Là, on retrouve ce qui s'est passé en Ukraine, aussi bien avec la révolution orange en 2003 qu’avec la révolution de Maïdan en 2013. Pensez-vous que si Kundera devait écrire ce texte aujourd'hui ou faire un commentaire, inclurait-il l'Ukraine, qui est en Europe orientale, et géographiquement, réclame cette appartenance à l'Europe ? Devrait-elle être reconnue dans cette autre Europe qui a été enlevée et captive ? Si on se réfère aussi bien à Kundera qu'à Miłosz, avec l'autre Europe et la pensée captive ?
Merci beaucoup. Il est 7 h 15, on va avoir 15 minutes pour répondre aux questions que vous avez posées, et après on a une demi-heure de conversation avec le public. Peut-être ajouter à la question que tu viens de poser sur cette Europe dont Kundera faisait allusion à la culture et aux valeurs. Dans notre expérience portugaise d'exilés en France, on a été vus aussi comme une autre Europe : l'Europe de l'intégrisme catholique ; l'Europe des dictatures. Qu'est-ce qui nous faisait rêver de l'Europe ? Ce n'était pas la culture européenne au sens que nous savions très bien que la culture européenne était pleine de démons. Salazar et Franco faisaient aussi partie d'une certaine Europe. On ne se faisait pas d'illusions qu'il y avait une Europe qui était un paradis. Non. On savait que l'Europe était démocratie et dictature. C'était Staline, Hitler, Franco et Salazar. Et aussi les libertés, l'illuminisme et tout ça. Les valeurs qui nous poussaient vers l'Europe, c'était la démocratie et les droits de l'homme. On ne se posait pas la question d'une culture européenne à laquelle on voulait appartenir parce qu'on savait que c'était beaucoup plus complexe que ça.
Les petits pays ont des douleurs que les grands ignorent, donc le Portugal ne se posait pas la question de son existence.
Ne se posait pas la question de son existence. Au Portugal, on a vécu en dictature pendant 40 ans. Ce n'était pas une petite chose. C'était la démocratie, les droits de l'homme, quand on regardait l'Union européenne, c'était de ça qu'on rêvait. C'était s'intégrer dans un espace démocratique et pas dans un espace culturel. Quand même, on sentait qu'on faisait partie de la culture de l'Europe. (Inaudible.)
Oui.
Ses démons et ses défis.
Mais vous n'aviez pas la question : est-ce que le Portugal va survivre ? C'est un ancien empire. Un pays qui a l'histoire du Portugal, même si c'est une histoire qui se rétrécit dans la phase moderne ou postcoloniale, mais il y a ça. Il ne viendrait pas à un Portugais de douter de l'existence de son pays. D'ailleurs, c'est quelque chose que Havel, une fois, a cité parce que son principal rival, quand Havel était président dans les années 90, c'était Vaclav Klaus qui est devenu président après lui. Lui, c'était un nationaliste étroit. Il a fait le divorce tchécoslovaque. Très conservateur, très nationaliste, très épris de l'économie de marché. Klaus avait cette formule : "Est-ce qu'on va laisser dissoudre notre souveraineté et notre identité dans l'Europe comme un morceau de sucre dans une tasse de café ?" Havel avait répondu : "Je ne comprends pas cette phrase. C'est absurde. Je suis Praguois, je suis Tchèque, je suis Européen. Les trois éléments s'emboîtent parfaitement." Est-ce que ça viendrait à l'idée d'un Portugais de se demander : est-ce que mon identité va se dissoudre dans l'Union européenne ?
Oui, il y avait beaucoup de Portugais qui pensaient ça.
Ah, bon ?
Ils étaient contre l'intégration européenne à cause de ça.
Ils n'aimaient pas le projet politique, mais ils ne pensaient pas que l'identité portugaise allait disparaître. En tout cas, Havel imaginait que c'était une question typiquement "est-européenne", cette angoisse identitaire. C'est là où il y a vraiment le lien — vous avez parfaitement raison — entre le propos de Kundera et la situation de l'Ukraine. Dans l'essai de Kundera, c'est ça, la question : les nations qui ne vont pas de soi, dont l'existence ne va pas de soi et n'a jamais été assurée. Elle ne va pas de soi, d'abord parce qu'elles étaient incluses dans de grands empires multinationaux. Ensuite, parce qu'elles ont créé des États, mais qui ont été fragiles. 1918, vous créez, vous disparaissez 20 ans après. La Pologne disparaît à la fin du 18e siècle, réapparaît 1918, redisparaît en 39 avec le pacte Hitler-Staline, etc. "Ça se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part", Alfred Jarry. C'est un grand pays, la Pologne, comme l'Ukraine. Donc, ce n'est pas la taille, ce n'est pas numérique. C'est la même angoisse chez les Slovènes qui ont deux millions d'habitants. Donc, c'est la même chose, c'est l'idée que l'on peut disparaître et qu'il y a les deux grandes forces : la Russie d'un côté, qui, comme je l'ai dit, s'européanise par la conquête impériale, donc vous avez déjà un problème ; et de l'autre côté, l'Allemagne, la Prusse. Dans tout le 19e siècle, c'est entre le panslavisme et le pangermanisme. Voilà, vous avez ces deux. Ensuite, qui devient, au 20e siècle, l'affrontement des deux totalitarismes et, parfois, la complicité des deux totalitarismes, allemand et russo-soviétique. Vu d'Europe centrale, vous êtes une Europe (langue étrangère), vous êtes entre les deux. Les frontières varient selon les périodes. 1918, c'est une période faste, provisoirement, parce que la Russie est reléguée à cause de la révolution, temporairement. L'Allemagne a été défaite. Il y a un espace pour l'Europe centrale. Ça dure 20 ans. Donc, cette idée de la disparition possible, le lien entre la nation, la langue et la culture, c'est quelque chose de très important. Kundera fait un discours au Congrès des écrivains, en 67, où il reprend la question d'un écrivain-essayiste du 19e siècle, de la dernière partie du 19e — (Schauwer) — qui posait la question : "Est-ce que ça valait vraiment la peine de faire tout cet effort pour créer une culture, une autre culture en tchèque ?" Puisque la situation était telle… Au début du 19e, la haute culture était de langue allemande, donc le tchèque était une langue… Donc, il y a ce que vous avez dit.
Ce texte est dans ce recueil.
C'est dans ce recueil. Donc il y a cet effort qui a été fait. (Schauwer) demande : "Est-ce que ça valait vraiment la peine, tout cet effort ?" Un peu, comme ça, ton ironique. Kundera reprend la question et dit : "Ça valait la peine seulement et seulement si par cette langue et cette culture particulière, vous contribuez quelque chose d'original à la culture européenne ou à la culture universelle." L'universel par le particulier. C'est la seule justification. Ce n'est pas du tout cultiver le particularisme. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans ce texte-là, il parle de l'Europe centrale. Il dit : "Maximum de diversité dans un minimum d'espace." Vous avez le Jigsaw puzzle des ethnies, des nationalités et des langues. Ça, c'est, pour lui, la métaphore de l'Europe. Ce qu'il craindrait de l'Europe, ce serait un peu l'uniformisation. S'il y a quelque chose qu'il craindrait — je ne sais pas s'il y a des Portugais qui craignaient ça — en tout cas, ce serait ça qu'il craindrait. Mais il dit ça dès les années 60. Il craint les tendances uniformisatrices qui règnent dans le monde. Donc, à l'ère de la mondialisation, bien sûr, ça devient, là aussi, d'actualité.
(Inaudible)
Est-ce qu'il aurait… ? Oui. Justement son idée, c'est : "On ne fixe pas les frontières par les tanks." Donc, ça ne peut être une question de rapport de force. Il y a ce primat de la culture avec sa dimension religieuse, mais qui ne se limite pas à cette dimension-là. Puis, ce qu'il y a dans l'héritage de la Russie orthodoxe, c'est la religion au service de l'État, c'est l'idéologie d'État, qui est imposée, si nécessaire, par la force. Donc, c'est une espèce de messianisme, à la fois national et impérial, qui sert. Dans le cas ukrainien, il n'y aurait rien de ça. Donc, je ne peux pas parler à la place de Kundera. Il n'habite pas très loin, mais il n'est plus tout à fait en état de venir participer à nos débats. Je pense que ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine lui ferait peut-être ajouter d'autres dimensions à sa définition. Tout ne repose pas sur cette définition de la civilisation par le clivage religieux. Il y a les valeurs. Il parle de ça. L'attachement à certaines valeurs, à leur ancrage européen. Dans la mesure où l'Ukraine s'est approprié ou s'approprie ces valeurs européennes, en quelque sorte, comme je l'ai dit à la fin, l'Europe centrale, par ce fait, s'élargit, on ne sait pas jusqu'où. Je ne vais pas tracer de nouvelles frontières, ce n'est pas ça mon propos.
L'Europe est définie par la démocratie et les droits de l'homme, c'est plus facile, l'intégration de l'Ukraine (inaudible).
Tu commences par la démocratie et les droits de l'homme, absolument, mais tu dois aussi savoir que l'attachement à ces principes repose, dans ces sociétés, sur des notions plus profondes. Si tu dis "c'est la démocratie", c'est-à-dire la possibilité de faire des élections, oui, bien sûr, il y a ça, et l'état de droit. Mais si c'est seulement l'idée qu'il y a un tribunal à La Haye, à Strasbourg ou au Luxembourg, qui est le garant ultime, non. Il faut justement que cette idée des droits soit quelque chose d'intériorisé. C'est une idée qui n'a pas de sens dans l'histoire russe, le droit. Très peu de place. Il y a de brèves périodes. Il y a de brèves périodes. Alors, là, on peut discuter. Entre la fin du 19e et la Première Guerre mondiale, il y a une fenêtre d'opportunité. Richard Pipes avait écrit un livre sur Struve, un des intellectuels russes qui avait commencé comme menchevik et qui a fini comme libéral (à droite), en exil, d'ailleurs. Le premier volume, Liberal on the Left. Deuxième volume, Liberal on the Right. Il y avait cette période, avant la Première Guerre mondiale, où beaucoup en Russie, mais surtout chez les mencheviks, pensaient : il faut d'abord développer une société capitaliste bourgeoise qui établira ces notions de droit. Ensuite, nous passerons à la phase socialiste. L'idée qu'on passe du féodalisme au socialisme, c'était une mauvaise idée. D'autant que la Russie n'a pas eu vraiment de féodalisme. C'est ça, son vrai problème. Le féodalisme, en Occident, c'est un rapport entre le seigneur et son vassal. C'est codifié. Il y a des tribunaux pour arbitrer, éventuellement. La Russie n'a pas eu ça. Ils ont eu l'opritchnina, Ivan le Terrible. Tu élimines la noblesse en place et tu les remplaces par une noblesse de service, des fonctionnaires du pouvoir central. C'est ça, l'opritchnina. Donc ils n'ont pas eu le féodalisme, ils n'ont pas la société civile et ils ont une fusion entre la religion et le pouvoir. Donc ça, effectivement, c'est ce que Kundera dit : "C'est une autre civilisation." Il ne dit pas : "La nôtre est tellement supérieure." L'Ukraine est différente. L'Ukraine a été, pendant longtemps, dans le Commonwealth polono-lituanien, jusqu'à la fin du 18e. Les deux tiers de l'Ukraine, de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, faisaient partie de cet ensemble-là. Donc, ils ont eu une autre tradition. Il y a aussi la société en Ukraine. Je ne suis pas du tout un expert. Mais il y a l'idée que l'État contrôle la société. Ce n'est pas l'État qui façonne la société, c'est la société qui façonne l'État.
En fait, il faut évoquer d'abord le droit de Magdebourg qui était en Ukraine. Les trois quarts du territoire ukrainien avaient le droit de Magdebourg. Ce qui veut dire que les cités géraient, s'autogéraient. Il y avait les tribunaux, il y avait la propriété privée. Ensuite, effectivement, l'Ukraine, en étant un pays dominé, où le pouvoir était toujours soit étranger, soit hostile, a développé cette solidarité horizontale. C'est ce lien horizontal, démocratique qui a permis à l'Ukraine de s'organiser aussi rapidement aujourd'hui et de ne pas attendre, aussi bien dans l'armée que dans la société, que l'ordre vienne d'en haut. Il n'y a pas de verticalité du pouvoir en Ukraine. Il y a, au contraire, cette horizontalité en raison de cette histoire où les élites ont toujours été soit étrangères, soit hostiles au peuple. Peut-être que je réconcilierais le Portugal et Kundera, l'aspiration "est-européenne", c'est la notion de la liberté. La liberté, c'est ce dont parle Kundera justement dans ce discours au Congrès des écrivains, en disant que maintenant ce dont nous avons besoin pour créer, c'est la liberté, donc il faut avoir cette liberté pour créer. C'est aussi ce à quoi aspiraient les Portugais.
Oui, évidemment.
Mais pour mettre un point final, je citerai aussi Cioran, que Kundera cite dans ce discours. Il dit qu'on ne pense l'Europe qu'en Europe engloutie. C'est justement là où on pense qu'il n'y a plus d'Europe ou que cette Europe est dominée par d'autres forces qu'on aspire à cette Europe, qu'on la rêve, qu'on la veut et qu'on espère un jour la construire. Donc, les deux textes sont dans ce recueil publié chez Gallimard, il y a deux ans.
Merci beaucoup d’avoir réconcilié le Portugal et l'Europe centrale. Mais c'est vraiment l'idée de la liberté et l'Europe comme espace de liberté. Beaucoup plus comme espace qui se définit de façon culturelle, qui peut exclure une partie de l'Europe. On ouvre un débat. Qu'est-ce qui va définir culturellement l'Europe ? Je me rappelle la discussion avec ceux de l'Europe nordique qui disent que l'Europe du Sud n'est pas assez Europe parce qu'elle est trop catholique, parce qu'elle n'a pas fait la révolution que les protestants ont faite, elle n'a pas fait la réforme. On n'en finit pas. Il y aura dix définitions culturelles de l'Europe, opposées. Les démocrates chrétiens allemands peuvent dire : "C'est l'Europe chrétienne." "Catholique", diront quelques-uns. D'autres diront : "Les protestants en font partie. Les orthodoxes n'en font pas partie." (On n'en finit.) La liberté nous unit. La liberté, la démocratie, l'état de droit. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui et qu'on se bat en Ukraine. Je soutiens évidemment la lutte de l'Ukraine pour être une démocratie entourée par les démocraties européennes. C'est ça que la Russie ne veut pas. C'est la démocratie à ses portes. Mais ça, c'est tout un autre débat. Aujourd'hui, on est là pour parler d'exilés. Maintenant, je donne la parole à la salle.
Bonjour à tous ! Merci, Alvaro, et à la Fondation d'avoir organisé cette série de conférences. Je dois parler de Kundera, qui est un cas assez atypique, mais je vais expliquer pourquoi et peut-être que ce n'est pas complètement hors sujet. Atypique ne veut pas dire hors sujet. Tu as mentionné le fait qu'il est venu en France comme écrivain, mais il a trouvé son port d'attache à l'École des hautes études en sciences sociales, dans ce bâtiment. Il a enseigné ici pendant une douzaine d'années un séminaire sur la littérature d'Europe centrale, un endroit pour lequel il y avait beaucoup d'intérêt. C'était la découverte de l'Europe centrale dans les années 1980, et Kundera y a grandement contribué. C'était l'idée de François Furet, qui était président de l'école à ce moment-là : c'est que l'école doit être une sorte de pont avec les pays de l'autre Europe, pour employer ce terme, et surtout après le coup d'État du général Jaruzelski en Pologne, aussi un lieu d'accueil pour ce qu'on imaginait être une résistance prolongée. On ne savait pas combien de temps ce système allait durer, mais il fallait une base de repli. C'était ça, l'idée. Il fallait permettre aux intellectuels, aux chercheurs, etc. Kundera en tant qu'écrivain, c'était un cas particulier, mais ça s'inscrivait dans une approche d'ensemble. Ça, c'est mon hommage à l'École où moi-même j'ai enseigné, pendant 15 ans, un séminaire sur l'Europe centrale, avec un autre exilé d'Europe centrale qui est hongrois, Pierre Kende. Il a 98 ans et habite Paris. Il est exilé de 1956 de Hongrie, venu en France. Nous avons fait ce séminaire pendant une quinzaine d'années ensemble. Après 1989, il est retourné en Hongrie. Il est revenu il y a quatre, cinq ans. Il m'a dit : "Je repars définitivement en exil à nouveau." Ça se passe de commentaires. Pour enchaîner sur l'introduction d'Alvaro qui a parlé de l'accueil, peut-être faire quelques distinctions entre migrations de population, il y a eu une énorme migration. Ce que l'on voit en Ukraine, les sept millions, c'est le plus grand déplacement de population en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, provoqué par la guerre, bien entendu, comme les grandes migrations d'après 1945 étaient dues à la Deuxième Guerre mondiale. En Europe centrale, les émigrations liées à des crises politiques, c'était en 1956 en Hongrie, 1968 en Tchécoslovaquie, Jaruzelski que j'ai mentionné, le coup d'État de 1981. Vous avez une migration de population qui peut amener des départs assez importants. En Hongrie, c'était 200 000 personnes qui ont quitté en 1956. Les Hongrois l'oublient aujourd'hui, mais ils ont été accueillis, eux aussi. Ils n'aiment pas beaucoup l'accueil de réfugiés, aujourd'hui. Il y a l'émigration et il y a l'exil. Il y a l'exil politique et l'exil littéraire. Et vous voyez que l'exil littéraire, je vais en arriver à Kundera, mais je rappelle que Paris a été un lieu privilégié de l'exil politique, en particulier d'Europe centrale. Si je mentionne les trois plus grandes revues de l'exil politique centre-européen, la revue Kultura à Paris, dirigée par Jerzy Giedroyć, établi à Paris après la guerre 1945 et resté toute sa vie à Paris, est la revue intellectuelle, politique, culturelle la plus influente en Pologne de l'après-guerre. La revue que dirigeait mon ami Kende Péter, pour le dire en hongrois, ou Pierre Kende, comme on l'appelait dans cette maison, s'appelait Magyar füzetek, les Cahiers hongrois. C'était la revue politique la plus importante de l'exil politique hongrois. À Paris, Pavel Tigrid, exilé tchèque de 1948, avait créé une revue en 1956 qui s'appelait Svědectví, Témoignage. C'est une revue qui a duré jusqu'en 1990, la plus importante et la référence à la fois culturelle et politique. Ça, c'est l'exil politique. C'est un exil qui est tourné vers le pays d'origine et qui souhaite avoir une influence dans le pays d'origine et éventuellement tourné vers le retour. Vers le retour. Puisque Alvaro a mentionné Mário Soares, je remercie Alvaro de m'avoir permis de dîner avec, à l'époque, le président Mário Soares qui, à la fin d'un dîner, nous a raconté son retour au Portugal, son retour de France magnifique en train, magnifique récit dont je ne vais pas reproduire maintenant. L'arrivée à la gare, vous avez vos sympathisants qui y croient, on est dans la révolution des Œillets. Mais ce n'était pas la force politique la plus importante à l'époque. Il regardait Alvaro Cunhal, l'autre exilé, qui revenait. Je raconte juste cette anecdote parce qu’elle m'est restée. Tout le monde disait : il faut y aller, il faut y aller ! Mais je voyais que la concurrence était rude, pour le dire comme ça. Et il y a le grand meeting sur la place à Lisbonne. Cunhal sort un discours qu'il avait préparé en exil il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, je ne sais pas. Il commence à le lire. Et cette foule enthousiaste applaudit un peu poliment, puis progressivement s'est assoupie, silencieuse. Au fur et à mesure que Cunhal prononçait son discours terne, ennuyeux dans la langue de bois du Parti, j'ai commencé à me dire : peut-être qu'on a une chance. Effectivement, il a eu une chance magnifique. Magnifique retour de Mário Soares. Ça, c'est l'exil politique. Il y a un livre magnifique de E. H. Carr, historien anglais, The Romantic Exiles. Vous avez la rencontre à Londres, au début des années 1960, de Herzen et Bakounine. Bakounine vient de passer huit ans en prison plus quatre ans de déportation en Sibérie. Il arrive à Londres et demande Herzen : "Alors, qu'est-ce qui se passe ici ?" "C'est bien, c'est calme." "Mais en Italie ?" "La situation est stable." "Et en Autriche ?" "La situation est calme." "Et en Turquie, et à (inaudible) ?" "Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire ?" Ça, c'est l'exilé politique, l'animal politique. Il veut combattre et, à peine sorti de son goulag, qui ne s'appelait pas comme ça, il ne pense déjà qu'à en découdre. Et je mentionne ça parce que je ne peux pas imaginer de cas plus opposé à ça que l'exil littéraire de Milan Kundera. Il n'y a pas de cas plus opposé, par le tempérament et par ce que signifie l'exil pour lui. Souvent, pour les écrivains exilés, j'en ai connu beaucoup d'Europe centrales, ce sont des situations difficiles. Ils n'ont plus leur public, ils sont dans des situations matérielles… Tout ça est vrai. L'histoire de l'exil littéraire, il y a certainement des séminaires dans l'École. Vous lisez Ovide relégué dans le delta du Danube, ses souffrances, sa déprime, ses regrets, tout ça. Je crois que le recueil avait été publié sous le titre L'exil et le salut. (Il est triste.) Kundera, c'est le contraire. C'est le salut par l'exil. Il a écrit un article qui s'appelle L'exil libérateur. Il est libéré dans plusieurs sens du terme. Non seulement il est libéré de la surveillance de la police qu'il avait à Prague après 1968 avec le régime de normalisation, mais parce qu'il considère que l'exil ouvre des possibilités et il s'appuie sur un texte d'une poétesse tchèque qui, elle aussi, a choisi Paris comme exil, Věra Linhartová, personnage solitaire, très bonne poète qui navigue entre Paris et le Japon, très peu à Prague. Kundera la cite parce que Linhartová a dit que l'exil est non seulement ouvert à plein de possibilités, etc., mais il permet le choix d'une autre langue. Et c'est là où c'est intéressant pour comprendre Kundera. Il faut que je retrouve la citation. Comment faire ? Kundera, c'est une sorte de profession de foi : "Quand Linhartová écrit en français, est-elle encore écrivain tchèque ? Non. Devient-elle écrivain français ? Non plus. Elle est ailleurs. Ailleurs, comme jadis Chopin. Ailleurs comme plus tard, chacun à sa manière, Nabokov, Beckett, Gombrowicz, etc." Et on a envie de dire : et comme Kundera. Bien entendu, quand il fait cette liste-là. L'exil libérateur, ce n'est pas seulement d'être libéré d'une tutelle, d'un emprisonnement, de la surveillance policière, parce qu'après 1968, évidemment, il est un écrivain censuré, interdit. Maintenant qu'on a accès aux dossiers de police, évidemment surveillance de son téléphone, tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'est pas emprisonné, ce n'est pas encore la période. Il est parti avant la période de répression la plus dure. Mais il y a ce choix de la langue, cette liberté et aussi le passage à la langue du pays d'accueil, en quelque sorte, et épouser sa culture. Ce qui complique sa relation avec le pays d'origine, vous l'imaginez, mais l'enrichit aussi. Parce que soudain, vous avez un écrivain qui non seulement a une audience européenne, mais mondiale. Encore aujourd'hui, je ne parle pas du moment où les livres sont publiés. Quand je suis au Japon et que je regarde les livres étrangers traduits, le seul écrivain tchèque traduit, c'est Kundera. La même chose à Cambridge, Massachusetts, quand je vais à Harvard Book Store, etc. Je pourrais continuer. Vous avez un écrivain qui s'est senti libéré parce qu’il n'est plus au service d'une cause, de quelque chose. L'écrivain en Europe centrale, depuis surtout le 19ᵉ siècle, a un lourd fardeau. Il doit porter la culture nationale, défendre la langue. La culture est le substitut du politique. Vous avez cette mission de l'écrivain. Et sous le communisme, soit l'écrivain est au service du Parti et de la cause communiste pour certains, et Kundera a été brièvement communiste au début du régime d'après 1948 ; ou alors l'écrivain dissident qui est au service de la cause des droits de l'homme, du combat des droits de l'homme. Mais vous êtes toujours au service de quelque chose. Et l'exil libérateur, c'est aussi l'émancipation par rapport à l'idée d'une œuvre, d'une littérature qui doit être au service de.
(Inaudible)
C'était l'introduction.
(Inaudible)
Mais il faut que tu me dises que je dois me taire. Peut-être deux choses qui sont importantes. Il n'a pas été au service du combat pour les droits de l'homme, etc. Il n'a pas été le pétitionnaire habituel et a parfois ironisé sur les pétitions dans un de ses romans. Mais il a fait pour son pays et pour la culture de l'Europe centrale quelque chose qui n'est pas de l'ordre politique : il a mis l'Europe centrale sur la carte de l'Europe. C'est quelque chose qui a une dimension d'abord culturelle, bien sûr, mais avant tout politique. Comment il est arrivé là ? Parce que l'expérience de Kundera dans son pays, dans les années 1960, c'est l'expérience de l'émancipation de la culture par rapport à l'idéologie, par rapport à la censure, par rapport au contrôle politique. Pas seulement en 1968, mais pendant toutes les années 1960. Ce n'est pas seulement la littérature, c'est le théâtre avec Václav Havel, c'est le cinéma avec Milos Forman et toute la Nouvelle Vague. Bref, c'est l'âge d'or de la culture tchèque des années 1960. Le pays en 1968, c'est l'aboutissement d'un processus, l'émancipation d'une société par la culture, par rapport à une structure communiste. Et cette expérience du primat de la culture sur la politique, c'est ce qu'il emporte avec lui en exil. Et sa réflexion sur la France, pays où il arrive, mais plus généralement sur l'Europe, sera beaucoup marquée par ça. Je ne vais pas parler de ses romans. Il y a sans doute, peut-être, j'espère, des séminaires sur la littérature d'Europe centrale dans cette maison, sinon à l'Inalco, chez vous. Je vais directement à l'essentiel, c'est-à-dire son essai La Tragédie de l'Europe centrale ou l'Occident kidnappé. Ça, vous l'avez ici. Il a été réédité maintenant. C'est intéressant, il a été réédité l'année dernière. Épuisé en un mois. Nouvelle édition. Il est traduit, maintenant, en 15 langues. La semaine dernière, en portugais. Mais aussi coréen, grec, italien… C'est intéressant. Pourquoi ? Cet essai écrit il y a 40 ans, dans un tout autre contexte, pourquoi est-il actuel aujourd'hui ? Que dit, d'abord, cet essai ? Il y a cette phrase qui résume le problème d'emblée : l'Europe centrale est culturellement à l'Ouest, politiquement à l'Est, géographiquement au centre. C'est ça, la tragédie de l'Europe centrale : elle est écartelée entre la culture et la politique et sa géographie, en quelque sorte. Qu'est-ce que 1989 ? C'est la possibilité de réconcilier la culture, la politique et la géographie. C'est ça, 89, ce que ça signifie pour les pays d'Europe centrale. Mais la raison du regain d'intérêt pour ce livre, sa réédition… essai, d'ailleurs, qui ne figure pas dans ses œuvres complètes. Il n'a pas voulu que ça figure parce que l'essai avait déclenché — c'est un essai qui a 40 pages ou 50 pages — des milliers de pages de débats autour de ça, à l'époque. Pourquoi ? Parce que certains lui reprochaient d'oublier l'Allemagne. Pourquoi il parle de l'Europe centrale et il ne parle pas de l'Allemagne ? D'autres disaient : "Il a exclu la Russie." Donc, il a pris de toutes parts et il a dit : "Je ne faisais pas un traité savant, je faisais un essai en tant qu'écrivain sur la culture. Tous les savants me tombent dessus. Les politiques me reprochent ceci. Bref, plus jamais je ne veux écrire une ligne sur l'Europe centrale." Et c'est un best-seller. C'est qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'important. La question importante, c'est le rapport entre la culture et la politique, d'abord, et c'est le rapport entre l'Europe et la Russie. Sur le premier plan, le rapport de l'Europe à la culture. Il dit : l'Europe a été divisée, Europe de l'Est et Europe de l'Ouest. Et l'Europe centrale, dont il parle, il dit : "L'Occident n'a pas ressenti cette coupure comme une mutilation." Pourquoi ? Parce que l'Europe ne se pense plus comme culture. L'Europe, à l'époque, d'ailleurs, ça s'appelait le Marché commun. L'Europe, c'est le Marché commun, avec les surplus, avec les montants compensatoires pour l'agriculture et tous les problèmes avenants. Donc l'Europe, c'est un marché commun. Et l'Europe ne se pense plus comme culture. Ça, c'était la première. Et pourquoi a-t-elle accepté si facilement ? Parce que, déjà, elle a mal nommé les choses. On parle de démocraties populaires d'Europe de l'Est. C'était l'appellation convenue. Quand j'étais étudiant, il y avait un cours, à Sciences Po, de Pierre George qui s'appelait Les Démocraties populaires d'Europe de l'Est. Kundera dit : "Trois mots, trois mensonges. Ce n'est pas des démocraties, c'est des dictatures. C'est des régimes éminemment impopulaires. Et ils ne sont même pas en Europe de l'Est, ils sont en Europe centrale." "Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde", disait Camus. Eh bien, là, rétablir, réhabiliter certaines notions. La raison pour laquelle ça a été accepté, c'est parce qu'on a abandonné, on a cessé de penser l'Europe comme un ensemble culturel. Donc, on a accepté cette division à l'Ouest. On ne l'acceptait pas à l'Est, parce que la seule façon d'appartenir à l'Ouest, c'était par la culture, justement. Donc, c'est la symétrie de la relation entre l'Est et l'Ouest et dans le rapport entre la culture et la politique. Mais l'autre grand sujet et l'autre raison pour laquelle ce texte suscite, soudain, tellement d'intérêt, c'est la Russie. L'Europe centrale, Occident kidnappé. Kidnappé par qui ? Par le grand empire de l'Est. La Russie n'est pas seulement une puissance un peu lourde qui envoie des tanks de temps en temps, tous les 12 ans, généralement. 56, 68, 80. C'est périodique. Mais Kundera pose la question : "Est-ce que le communisme est le prolongement ou la négation de l'histoire russe ?" Les Russes, les intellectuels russes pensent que c'est la négation. En Europe centrale, on pense que c'est le prolongement, qu'il y a un lien. Alain Besançon, qui enseignait dans cette maison, avait écrit un livre, Passé russe et présent soviétique. Aujourd'hui, on dirait : passé soviétique et présent russe. Le cycle se prolonge ainsi. Kundera, on lui a fait des reproches sur la Russie. Mais il dit : "C'est une autre civilisation." Il ne dit que c'est une civilisation inférieure. Il dit : "C'est une autre civilisation." Il y a, en Europe centrale, et chez Kundera en particulier, plusieurs thèmes. Il y a le thème de la Russie et de son rapport à la liberté et à la société civile. Ils n'ont pas connu de société civile. Ils n'ont jamais eu de droits. Le droit. Et pourquoi ? C'est la fusion du spirituel et du temporel. C'est l'orthodoxie. Donc, le domaine spirituel soumis au pouvoir d'État, au service du pouvoir d'État. Jamais plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Le patriarche Kirill, il faut l'écouter sur l'Ukraine. C'est quand même quelque chose, donc jamais plus au service que… En ce sens là, il y a une différence. Et c'est une différence qu'il appelle civilisationnelle, culturelle, qui a trait à beaucoup de domaines : à la notion de société civile, à la notion de droit. Je ne vais pas faire tout un récit sur le cours de l'histoire. Puis il y a la dimension impériale. La façon dont la Russie s'est européanisée, depuis Pierre le Grand, c'est par la conquête impériale. C'est par l'expansion impériale. Donc, c'est une "européanisation bien particulière". Donc, ça, c'est le point de vue de Kundera, émis à l'époque, publié dans une revue de débat, mais qui a eu un impact considérable. L'idée s'est diffusée. Il y a eu des conférences autour de ça. Le thème de l'Europe centrale est devenu important. Si je devais, comme ça, abréger un long développement, je dirais : "Par son essai, Kundera a contribué à changer la carte mentale des Occidentaux, de l'Europe occidentale." Ils ont eu une autre perception de l'Europe grâce à ça. Soudain, cet Est-Ouest et les démocraties populaires d'Europe de l'Est s'estompaient et on découvrait, derrière le régime des sociétés, dans ces sociétés, des cultures et des mouvements d'opposition, dissidence, etc., qui existaient et qui devenaient des interlocuteurs pour l'Occident et pas seulement les régimes et les États. Donc, je pense que, ça, c'était un moment très important. Il a changé la carte mentale des Occidentaux. Je donne une illustration, peut-être, du rapport. Là, je vais quand même citer. Si Alvaro me le permet, je vais quand même citer.
Si ta citation est fondamentale, alors on va l'écouter.
Oui, elle est fondamentale, si je la retrouve. C'est une conférence d'écrivains — en grande partie d'écrivains exilés, mais pas seulement — qui a eu lieu à Lisbonne, en mai 88. Je me demande si ce n'est pas Gulbenkian. C'est à vérifier. Je n'ai pas vérifié avant de venir.
C'était à la mairie de Lisbonne. C'était les villes, terres d'asile.
Mais 88.
(Inaudible.) Villes refuges.
Villes refuges ?
Oui. (Inaudible) faisait partie de cette…
Non, là, c'est une rencontre entre les écrivains d'Europe centrale et les Russes. Et les Russes uniquement. C'est autre chose. Très important, pour Kundera, la Russie, c'est le "Constitutive Other". C'est l'autre par rapport auquel on se définit. On peut comprendre que tous les Russes, les écrivains russes n'aient pas nécessairement été enthousiasmés par cette idée. Mais il y a cette conférence. Je donne juste quelques noms. Kundera ne participait pas, mais on a parlé beaucoup de Kundera. Pendant la moitié de la conférence, on a parlé de Kundera. Il y avait Czesław Miłosz, Prix Nobel de littérature, poète exilé d'abord en France, puis à San Francisco. György Konrád, écrivain hongrois non exilé. Josef Škvorecký, écrivain tchèque exilé à Toronto. Danilo Kiš, à Paris, écrivain serbe. Côté russe, vous avez Joseph Brodsky, le poète à New York, Tatyana Tolstaya, Lev Anninsky, Zinovii Zinik… vous en avez un certain nombre. Je ne peux pas tout résumer, mais, quand même, il y a quelques moments assez forts. Après avoir écouté tous les discours des écrivains d'Europe centrale, Tatyana Tolstaya dit — je vais citer ça en anglais parce que j'ai la transcription des débats en anglais : "The stubbornness with which everybody talks about Central Europe as if it were a special place which somehow unifies you, and I've even felt an apologetic sense as though it were bad to be an Eastern European…" Elle continue. Elle n'a pas apprécié les références aux contingences externes. "L'appartenance — dit-elle — à un petit pays ou la présence de l'Armée rouge — elle a cette formule —, pourquoi serais-je responsable de ça ? Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Je ne suis pas politique, je ne suis pas militaire… Je n'ai aucun pouvoir." Škvorecký, l'écrivain tchèque, lui avait répondu en citant Ján Kollár, qui était un écrivain d'il y a deux siècles, mais dont il fait la citation : "Do not use the holy name of your country for the piece of land where we live." Je crois que beaucoup d'Ukrainiens ont, aujourd'hui, cette citation présente à l'esprit ou une variante de cette citation. Konrád souligne les liens de la culture d'Europe centrale avec la culture occidentale. Il cite Kundera, etc. Et Tolstaya répond : "Now I understand, I've been asked when we are going to remove our tanks from Central Europe. Is that a question? When will I remove my tanks out of Central Europe? We're not historians. We're not people who have authority over tanks. We're writers" Et ça continue dans cette veine-là. Ensuite, il y a l'échange, peut-être le plus significatif, entre Czesław Miłosz et Brodsky, deux écrivains exilés : un Polonais, un Russe de Leningrad. Miłosz développe l'argument de Kundera. Il cite Kundera et l'attachement à l'Europe. Il dit : "On est d'autant plus attaché à l'idée européenne à sa limite, dans les confins, parce que c'est là que l'idée européenne est la plus menacée. C'est à la limite qu'on est le plus attaché." Brodsky répond. Il voit dans l'Europe centrale, selon Kundera, une manière de reléguer la Russie hors d'Europe. Brodsky dit : "In the name of literature, there is no such thing as a Central Europe. There is Polish literature, Czech literature, Slovak literature, Serbo-Croatian literature, Hungarian literature, and so forth. Tt s impossible to speak about this concept even in the name of literature. It s an oxymoron." Là-dessus, Miłosz répond : "Divide et impera. This is a colonial principle and you are for that." Brodsky répond : "Divide et impera? In what way, Czesław? I don t understand you. Could you specify?" Miłosz répond : "The concept of Central Europe is not an invention of Kundera. You have an obsession that it is an invention of Kundera. Not at all. Central Europe is an anti-soviet concept provoked by the occupation of those countries. And I should add that the conscience of a writer, for instance a Russian writer, would cope with such facts, for instance, as the pact between Hitler and Stalin and the occupation of the Baltic countries of which I am a native. And I am afraid that there is certainly a taboo in Russian literature and that taboo is empire." Empire. Problématique postcoloniale. Je ne vais pas poursuivre la lecture. L'échange fut musclé, vif, franc. "Échange franc" dans les comptes rendus des réunions communistes, généralement, ça voulait dire qu'ils s'étaient étripés complètement. Là, ce n'était pas complètement le cas. C'étaient tous de grands poètes. Brodsky, immense poète que j'ai connu à New York. J'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Et Miłosz, aussi. Deux grands poètes s'étripent sur la question de l'Empire. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est la question qui revient aujourd'hui. Beaucoup d'intellectuels ou d'écrivains russes, peut-être, ont ce problème-là. Ils n'ont pas mesuré que leur histoire, y compris l'histoire du 20ᵉ siècle, est une histoire impériale aussi et que les soubresauts post-impériaux doivent être réfléchis par eux aussi. L'interpellation entre exilés, c'était quelque chose… C'est en cela d'ailleurs que l'exil contribue… Là, il faut que j'abrège.
(Inaudible)
Ma conclusion serait la suivante : aujourd'hui, à cause de la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle se trouve l'Ukraine, le texte de Kundera résonne à nouveau à la fois pour ce qu'il dit sur l'Europe et ce qu'il dit sur la Russie. Ce qu'il dit sur l'Europe, l'Europe qui s'est construite par l'économie, par le marché et par le droit : "Ce n'est pas assez pour tenir. Si vous voulez un projet, il faut penser le rapport de la culture et de la politique. Il faut penser les fondements des valeurs auxquelles vous êtes attachés et qui font partie de notre civilisation européenne." Prenez ce mot avec tous les guillemets que vous voudrez. Je sais que c'est un mot chargé, mais Kundera n'a pas peur de l'utiliser. Il nous rappelle cela à un moment où nous avons justement un débat sur les limites de l'Europe par le marché et par le droit, et par la question des valeurs qui nous est posée, entre autres d'ailleurs, par la défense de ces valeurs en Ukraine. Et l'autre question qui est posée est celle du rapport de l'Europe à la Russie et de l'Europe centrale. On pourrait dire qu'après 1989, le concept de l'Europe centrale qui était une Europe de la culture était une sorte de "exit from Soviet fold" imaginaire, culturel. C'était dans les esprits. On ne pouvait pas s'échapper, l'Europe était divisée, mais vous vous échappez, en gros, mentalement. Après 1989, vous pouvez réaliser l'Europe centrale. Mais non, l'Europe centrale veut aller à l'Ouest. L'Europe centrale, l'Occident kidnappé, se précipite vers l'Union européenne, vers l'Europe, l'OTAN. Il faut être dans tous les organismes. On ne veut plus discuter de l'Europe centrale. La crise ukrainienne signifie que soudain les pays d'Europe centrale découvrent qu'ils ont une sensibilité par rapport à ce qui se passe en Ukraine, peut-être différente de celle des Allemands, des Français ou des Belges, ou peut-être des Portugais, je n'en sais rien. C'est une première chose. Et le président ukrainien dit : nous voulons appartenir à l'Europe, nous appartenons à l'Europe, nous défendons les valeurs européennes", etc. Et l'Europe la plus proche de l'Ukraine, c'est l'Europe centrale. Donc, je dirais que, avec ce qui se passe en Ukraine, les Européens du Centre redécouvrent leurs spécificités au sein de l'Europe, et avec la guerre en Ukraine, l'Ukraine elle-même se découvre une sorte de vocation centre-européenne. Pas seulement parce que Lviv s'appelait Lvov et Lemberg avant, et qu'il y avait une partie de l'Ukraine qui appartenait à l'Empire des Habsbourg, ça serait la version Kundera. Mais là on est au-delà de Kundera. On est justement dans l'idée de ce que Kundera a suggéré : que l'Europe centrale est un espace qui n'est pas défini, qui n'a pas des frontières précises. C'est l'idée centrale de son propos. On ne peut pas tracer les frontières d'une civilisation et d'une culture par des tanks. Ça, c'est le propos. Et si ça, c'est le propos, les cultures peuvent évoluer. L'Europe centrale se redécouvre une vocation nouvelle dans la guerre en Ukraine. L'Ukraine penche vers l'Ouest, c'est-à-dire vers l'Europe centrale. Donc l'Europe centrale, après avoir été l'Occident kidnappé, aujourd'hui, s'élargit à l'Est avec l'Ukraine.
Merci beaucoup. Évidemment, après avoir écouté Jacques, j'ai envie de faire des commentaires, mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais seulement faire un commentaire, qui peut-être pourra aider à la discussion. Sur l'exil, tu as fait la différenciation entre les exilés intellectuels, l'exil littéraire et libérateur, et les exilés politiques. Et moi, à travers mon expérience d'exilé politique ici, je ne ferais pas cette différenciation. Je pense que l'exil politique est aussi un exil libérateur. On avait accès à un monde de culture, un monde de pensée sur la politique qu'on n'avait pas dans nos pays. On s'est transformé politiquement et culturellement en tant qu'exilé politique, l'exil était aussi libérateur, au service d'une cause. Mais ça, c'est rentrer déjà dans le débat et on va écouter Irina. Mais avant, ça, dans cet exil libérateur politique, il manque une mention dans cette discussion, peut-être Irina pourra la rajouter, c'est l'impact que ces intellectuels ont dans le pays même. Le fait que la France était terre d'asile, c'était un enrichissement pour la France, comme pour tous les pays qui ont reçu des exilés et qui ont donné des contributions extraordinaires à leur culture. Alors, exil libérateur pour les exilés, peut-être, mais aussi exil libérateur (à contrecœur) pour ceux qui reçoivent les exilés. L'exil est libérateur pour tous. Sinon, on peut rentrer dans la question de la Russie.
Non, pas maintenant.
Alors, on va écouter Irina nous parler de l'exil. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup à vous. Et je tiens tout d'abord à dire ma joie, mon honneur, ma fierté d'être présente ici, à cette rencontre, aux côtés de Jacques Rupnik, qui était mon professeur à Sciences Po. Je devrais ajouter mon professeur préféré. Mais je ne serais pas original parce que c'était le professeur préféré de tous les étudiants. C'est celui qui n'avait pas besoin de faire une feuille d'émargement, etc. Les cours étaient toujours pleins. Un professeur passionné et véritablement adoré par les étudiants. Pour ce qui est de l'Ukraine et de la Tchécoslovaquie, il y a énormément de points communs, aussi bien dans l'histoire que dans l'histoire du 20ᵉ siècle. On peut peut-être commencer par dire qu'il s'agissait de deux peuples sans État, dans lesquels justement le rôle de l'écrivain était extrêmement important. Parce que dès le 19ᵉ siècle, ce sont des écrivains qui fondaient et justifiaient l'existence d'une nation, en tout cas son existence future, ses revendications futures. C'est d'ailleurs Miroslav Hroch qui a élaboré ces trois étapes de l'établissement des nations sans État : d'abord les intellectuels au début 19ᵉ s'intéressent, établissent un peu la différence et essayent de cueillir quelques bribes de folklore, des chants, etc. ; ensuite, d'autres intellectuels les systématisent, établissent une base, écrivent de romans, etc. Et tout ça sert de prodrome à de futures revendications politiques que les Ukrainiens comme les Tchèques ont pu réaliser sur les ruines des deux Empires, l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe en 1917, les Ukrainiens avec moins de succès, malheureusement. Mais cette tentative a bien eu lieu. Juste pour rebondir sur Brodsky, je ne veux pas m'étendre longuement là-dessus, ce discours, cette discussion était âpre, mais elle ne touchait pas encore à la question de l'Ukraine. Le poème absolument inacceptable de Brodsky, c'est à l'indépendance de l'Ukraine. Je vous invite à retrouver ce poème, c'est un poème absolument impérialiste et haineux à l'égard de cette indépendance de l'Ukraine où il dit : "Vous voulez être indépendante, mais vous allez ramper devant nous, vous allez revenir en pleurant pour que nous, la Russie, on vous accepte." C'est vraiment un poème qui montre qu'on peut être un grand poète exilé soviétique, mais rester impérialiste, tout comme on peut, malheureusement aujourd'hui, être anti-Poutine et être impérialiste, garder cette idée impériale que l'Ukraine et la Russie peuvent, si elles veulent, prendre la Crimée, un territoire, un pays souverain, tout simplement parce qu'on en a envie, on en a la possibilité et on peut le justifier par des raisons historiques. Je reviendrai plus sur l'Occident kidnappé parce que je pense, comme vous, que ce texte, qui a 40 ans, aujourd'hui a une lumière particulière sur ce qui se passe en Ukraine. Et je commencerai par citer Kundera qui disait que la Tchécoslovaquie était au centre de l'histoire et que ce n'était pas une partie de plaisir. Aujourd'hui, l'Ukraine est au centre de l'histoire européenne, mondiale, et je confirme que ce n'est toujours pas une partie de plaisir, malheureusement. L'Ukraine peut être considérée, d'après la définition de Kundera, comme une petite nation, puisque la petite nation, dans sa définition, est la nation qui est menacée d'existence, c'est-à-dire qu'elle peut tout à fait disparaître. Et en parlant de la Tchécoslovaquie, il a dit que c'était un pays qui a connu l'antichambre de la mort. L'Ukraine aussi a été menacée de disparaître et est passée vraiment tout près justement de cette guerre, à être menacée de disparition. C'est aussi un pays dont l'existence n'était pas évidente. L'existence de l'Ukraine, vous vous souvenez des premiers livres dans les années 1990 qui ont été publiés, (Wilson) notamment, un nowhere nation, un pays venu de nulle part, qu'est ce que c'est ? Est-ce que ça va tenir ? Etc. C'est en cela que l'Ukraine est en quelque sorte le prolongement de l'Europe centrale. Devrait-on peut-être utiliser l'expression Europe orientale, qui a tout à fait son droit d'être citée, parce que son existence n'était pas évidente. Kundera commence ce texte en évoquant la Hongrie et le responsable de la presse hongroise, qui envoie un télex au monde entier en disant qu'il meurt pour la Hongrie, mais il meurt aussi pour l'Europe. Et c'est en cela que le parallèle avec l'Ukraine d'aujourd'hui est absolument évident, parce que les Ukrainiens disent qu'ils se battent pour l'Ukraine, mais ils se battent aussi pour l'Europe. Et Kundera, en prolongeant cette citation, dit que ce qui n'a pas été compris dans ce cri désespéré, c'est que, en Hongrie, c'est l'Europe qu'on attaquait. C'est exactement ce que les Ukrainiens disent : "En Ukraine, c'est l'Europe qu'on attaque, ce sont les valeurs européennes et ses aspirations." C'est le système des valeurs européennes qui est menacé. Malheureusement, vous vous en souvenez, le texte se termine par une sorte de remarque presque désespérée où il dit que probablement, ce cri n'a pas été compris. L'Europe n'a pas compris pourquoi, en parlant de la Hongrie, il évoque l'Europe. Il y a ce constat où il dit que l'Europe s'est construite d'abord sur le principe religieux. Et là, il fait la différence entre le catholicisme et l'orthodoxie. Tout ce qui est orthodoxe, pour lui, est quand même un peu éloigné de l'Europe. Là, il parle de la Bulgarie, mais pas de l'Ukraine, il y a juste une référence. Mais pour lui, d'abord c'était le ciment catholique et ensuite la culture. Pour Kundera, la culture disparaît à l'époque où il écrit ce texte. Il évoque notamment son ami philosophe qui a perdu l'ensemble de son œuvre dans une perquisition et qui s'est demandé où il devrait écrire pour réclamer la restitution de ces documents. Tous les deux, en se promenant à Prague, se disent qu'ils ne peuvent pas faire appel à un politique, il faudrait faire appel à une conscience morale, un grand écrivain. Et ils se disent qu'ils constatent amèrement qu'il n'y a plus, aujourd'hui en Europe, quelqu'un qui pourrait être ce tribun, cette référence reconnue, absolue, et dont la parole pourrait porter. Finalement, ils font appel à Sartre. Sartre fait le nécessaire, et un an plus tard — ça a mis quand même plusieurs mois —, ce philosophe peut récupérer ses manuscrits. Néanmoins, Kundera est sur sa lancée sur le fait que la culture disparaît. C'est pour cela que la disparition de l'Europe centrale, pas en Europe centrale, mais en Occident, a été vécue comme un non-événement. Finalement, ça n'a pas été une grande tragédie. Ma première question aurait été de vous demander : vous pensez que Kundera s'est trompé ? Qu'est-ce que le ciment européen aujourd'hui ? Est-ce que c'est quand même la culture, un système de valeurs ou est-ce que nous n'avons finalement plus grand-chose qui nous définit comme européens ? Je poursuivrai mon parallèle sur l'Ukraine, parce qu'en parlant de ces pays qui, pour lui, ont le droit d'être des pays européens, quand bien même étant géographiquement au centre, il donne comme trait particulier, bien sûr, (la qualification) culturelle, mais surtout les révoltes populaires. Il cite (l'échappée) de la Hongrie 56, la Tchécoslovaquie, les différentes révoltes polonaises, etc. Les traits caractéristiques, c'est que ce n'est pas une révolte par le haut, mais une révolte par le bas, qui touche l'ensemble du peuple, qui s'organise sans que quelqu'un lui dise quoi que ce soit. Là, on retrouve ce qui s'est passé en Ukraine, aussi bien avec la révolution orange en 2003 qu’avec la révolution de Maïdan en 2013. Pensez-vous que si Kundera devait écrire ce texte aujourd'hui ou faire un commentaire, inclurait-il l'Ukraine, qui est en Europe orientale, et géographiquement, réclame cette appartenance à l'Europe ? Devrait-elle être reconnue dans cette autre Europe qui a été enlevée et captive ? Si on se réfère aussi bien à Kundera qu'à Miłosz, avec l'autre Europe et la pensée captive ?
Merci beaucoup. Il est 7 h 15, on va avoir 15 minutes pour répondre aux questions que vous avez posées, et après on a une demi-heure de conversation avec le public. Peut-être ajouter à la question que tu viens de poser sur cette Europe dont Kundera faisait allusion à la culture et aux valeurs. Dans notre expérience portugaise d'exilés en France, on a été vus aussi comme une autre Europe : l'Europe de l'intégrisme catholique ; l'Europe des dictatures. Qu'est-ce qui nous faisait rêver de l'Europe ? Ce n'était pas la culture européenne au sens que nous savions très bien que la culture européenne était pleine de démons. Salazar et Franco faisaient aussi partie d'une certaine Europe. On ne se faisait pas d'illusions qu'il y avait une Europe qui était un paradis. Non. On savait que l'Europe était démocratie et dictature. C'était Staline, Hitler, Franco et Salazar. Et aussi les libertés, l'illuminisme et tout ça. Les valeurs qui nous poussaient vers l'Europe, c'était la démocratie et les droits de l'homme. On ne se posait pas la question d'une culture européenne à laquelle on voulait appartenir parce qu'on savait que c'était beaucoup plus complexe que ça.
Les petits pays ont des douleurs que les grands ignorent, donc le Portugal ne se posait pas la question de son existence.
Ne se posait pas la question de son existence. Au Portugal, on a vécu en dictature pendant 40 ans. Ce n'était pas une petite chose. C'était la démocratie, les droits de l'homme, quand on regardait l'Union européenne, c'était de ça qu'on rêvait. C'était s'intégrer dans un espace démocratique et pas dans un espace culturel. Quand même, on sentait qu'on faisait partie de la culture de l'Europe. (Inaudible.)
Oui.
Ses démons et ses défis.
Mais vous n'aviez pas la question : est-ce que le Portugal va survivre ? C'est un ancien empire. Un pays qui a l'histoire du Portugal, même si c'est une histoire qui se rétrécit dans la phase moderne ou postcoloniale, mais il y a ça. Il ne viendrait pas à un Portugais de douter de l'existence de son pays. D'ailleurs, c'est quelque chose que Havel, une fois, a cité parce que son principal rival, quand Havel était président dans les années 90, c'était Vaclav Klaus qui est devenu président après lui. Lui, c'était un nationaliste étroit. Il a fait le divorce tchécoslovaque. Très conservateur, très nationaliste, très épris de l'économie de marché. Klaus avait cette formule : "Est-ce qu'on va laisser dissoudre notre souveraineté et notre identité dans l'Europe comme un morceau de sucre dans une tasse de café ?" Havel avait répondu : "Je ne comprends pas cette phrase. C'est absurde. Je suis Praguois, je suis Tchèque, je suis Européen. Les trois éléments s'emboîtent parfaitement." Est-ce que ça viendrait à l'idée d'un Portugais de se demander : est-ce que mon identité va se dissoudre dans l'Union européenne ?
Oui, il y avait beaucoup de Portugais qui pensaient ça.
Ah, bon ?
Ils étaient contre l'intégration européenne à cause de ça.
Ils n'aimaient pas le projet politique, mais ils ne pensaient pas que l'identité portugaise allait disparaître. En tout cas, Havel imaginait que c'était une question typiquement "est-européenne", cette angoisse identitaire. C'est là où il y a vraiment le lien — vous avez parfaitement raison — entre le propos de Kundera et la situation de l'Ukraine. Dans l'essai de Kundera, c'est ça, la question : les nations qui ne vont pas de soi, dont l'existence ne va pas de soi et n'a jamais été assurée. Elle ne va pas de soi, d'abord parce qu'elles étaient incluses dans de grands empires multinationaux. Ensuite, parce qu'elles ont créé des États, mais qui ont été fragiles. 1918, vous créez, vous disparaissez 20 ans après. La Pologne disparaît à la fin du 18e siècle, réapparaît 1918, redisparaît en 39 avec le pacte Hitler-Staline, etc. "Ça se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part", Alfred Jarry. C'est un grand pays, la Pologne, comme l'Ukraine. Donc, ce n'est pas la taille, ce n'est pas numérique. C'est la même angoisse chez les Slovènes qui ont deux millions d'habitants. Donc, c'est la même chose, c'est l'idée que l'on peut disparaître et qu'il y a les deux grandes forces : la Russie d'un côté, qui, comme je l'ai dit, s'européanise par la conquête impériale, donc vous avez déjà un problème ; et de l'autre côté, l'Allemagne, la Prusse. Dans tout le 19e siècle, c'est entre le panslavisme et le pangermanisme. Voilà, vous avez ces deux. Ensuite, qui devient, au 20e siècle, l'affrontement des deux totalitarismes et, parfois, la complicité des deux totalitarismes, allemand et russo-soviétique. Vu d'Europe centrale, vous êtes une Europe (langue étrangère), vous êtes entre les deux. Les frontières varient selon les périodes. 1918, c'est une période faste, provisoirement, parce que la Russie est reléguée à cause de la révolution, temporairement. L'Allemagne a été défaite. Il y a un espace pour l'Europe centrale. Ça dure 20 ans. Donc, cette idée de la disparition possible, le lien entre la nation, la langue et la culture, c'est quelque chose de très important. Kundera fait un discours au Congrès des écrivains, en 67, où il reprend la question d'un écrivain-essayiste du 19e siècle, de la dernière partie du 19e — (Schauwer) — qui posait la question : "Est-ce que ça valait vraiment la peine de faire tout cet effort pour créer une culture, une autre culture en tchèque ?" Puisque la situation était telle… Au début du 19e, la haute culture était de langue allemande, donc le tchèque était une langue… Donc, il y a ce que vous avez dit.
Ce texte est dans ce recueil.
C'est dans ce recueil. Donc il y a cet effort qui a été fait. (Schauwer) demande : "Est-ce que ça valait vraiment la peine, tout cet effort ?" Un peu, comme ça, ton ironique. Kundera reprend la question et dit : "Ça valait la peine seulement et seulement si par cette langue et cette culture particulière, vous contribuez quelque chose d'original à la culture européenne ou à la culture universelle." L'universel par le particulier. C'est la seule justification. Ce n'est pas du tout cultiver le particularisme. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans ce texte-là, il parle de l'Europe centrale. Il dit : "Maximum de diversité dans un minimum d'espace." Vous avez le Jigsaw puzzle des ethnies, des nationalités et des langues. Ça, c'est, pour lui, la métaphore de l'Europe. Ce qu'il craindrait de l'Europe, ce serait un peu l'uniformisation. S'il y a quelque chose qu'il craindrait — je ne sais pas s'il y a des Portugais qui craignaient ça — en tout cas, ce serait ça qu'il craindrait. Mais il dit ça dès les années 60. Il craint les tendances uniformisatrices qui règnent dans le monde. Donc, à l'ère de la mondialisation, bien sûr, ça devient, là aussi, d'actualité.
(Inaudible)
Est-ce qu'il aurait… ? Oui. Justement son idée, c'est : "On ne fixe pas les frontières par les tanks." Donc, ça ne peut être une question de rapport de force. Il y a ce primat de la culture avec sa dimension religieuse, mais qui ne se limite pas à cette dimension-là. Puis, ce qu'il y a dans l'héritage de la Russie orthodoxe, c'est la religion au service de l'État, c'est l'idéologie d'État, qui est imposée, si nécessaire, par la force. Donc, c'est une espèce de messianisme, à la fois national et impérial, qui sert. Dans le cas ukrainien, il n'y aurait rien de ça. Donc, je ne peux pas parler à la place de Kundera. Il n'habite pas très loin, mais il n'est plus tout à fait en état de venir participer à nos débats. Je pense que ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine lui ferait peut-être ajouter d'autres dimensions à sa définition. Tout ne repose pas sur cette définition de la civilisation par le clivage religieux. Il y a les valeurs. Il parle de ça. L'attachement à certaines valeurs, à leur ancrage européen. Dans la mesure où l'Ukraine s'est approprié ou s'approprie ces valeurs européennes, en quelque sorte, comme je l'ai dit à la fin, l'Europe centrale, par ce fait, s'élargit, on ne sait pas jusqu'où. Je ne vais pas tracer de nouvelles frontières, ce n'est pas ça mon propos.
L'Europe est définie par la démocratie et les droits de l'homme, c'est plus facile, l'intégration de l'Ukraine (inaudible).
Tu commences par la démocratie et les droits de l'homme, absolument, mais tu dois aussi savoir que l'attachement à ces principes repose, dans ces sociétés, sur des notions plus profondes. Si tu dis "c'est la démocratie", c'est-à-dire la possibilité de faire des élections, oui, bien sûr, il y a ça, et l'état de droit. Mais si c'est seulement l'idée qu'il y a un tribunal à La Haye, à Strasbourg ou au Luxembourg, qui est le garant ultime, non. Il faut justement que cette idée des droits soit quelque chose d'intériorisé. C'est une idée qui n'a pas de sens dans l'histoire russe, le droit. Très peu de place. Il y a de brèves périodes. Il y a de brèves périodes. Alors, là, on peut discuter. Entre la fin du 19e et la Première Guerre mondiale, il y a une fenêtre d'opportunité. Richard Pipes avait écrit un livre sur Struve, un des intellectuels russes qui avait commencé comme menchevik et qui a fini comme libéral (à droite), en exil, d'ailleurs. Le premier volume, Liberal on the Left. Deuxième volume, Liberal on the Right. Il y avait cette période, avant la Première Guerre mondiale, où beaucoup en Russie, mais surtout chez les mencheviks, pensaient : il faut d'abord développer une société capitaliste bourgeoise qui établira ces notions de droit. Ensuite, nous passerons à la phase socialiste. L'idée qu'on passe du féodalisme au socialisme, c'était une mauvaise idée. D'autant que la Russie n'a pas eu vraiment de féodalisme. C'est ça, son vrai problème. Le féodalisme, en Occident, c'est un rapport entre le seigneur et son vassal. C'est codifié. Il y a des tribunaux pour arbitrer, éventuellement. La Russie n'a pas eu ça. Ils ont eu l'opritchnina, Ivan le Terrible. Tu élimines la noblesse en place et tu les remplaces par une noblesse de service, des fonctionnaires du pouvoir central. C'est ça, l'opritchnina. Donc ils n'ont pas eu le féodalisme, ils n'ont pas la société civile et ils ont une fusion entre la religion et le pouvoir. Donc ça, effectivement, c'est ce que Kundera dit : "C'est une autre civilisation." Il ne dit pas : "La nôtre est tellement supérieure." L'Ukraine est différente. L'Ukraine a été, pendant longtemps, dans le Commonwealth polono-lituanien, jusqu'à la fin du 18e. Les deux tiers de l'Ukraine, de ce qu'est l'Ukraine aujourd'hui, faisaient partie de cet ensemble-là. Donc, ils ont eu une autre tradition. Il y a aussi la société en Ukraine. Je ne suis pas du tout un expert. Mais il y a l'idée que l'État contrôle la société. Ce n'est pas l'État qui façonne la société, c'est la société qui façonne l'État.
En fait, il faut évoquer d'abord le droit de Magdebourg qui était en Ukraine. Les trois quarts du territoire ukrainien avaient le droit de Magdebourg. Ce qui veut dire que les cités géraient, s'autogéraient. Il y avait les tribunaux, il y avait la propriété privée. Ensuite, effectivement, l'Ukraine, en étant un pays dominé, où le pouvoir était toujours soit étranger, soit hostile, a développé cette solidarité horizontale. C'est ce lien horizontal, démocratique qui a permis à l'Ukraine de s'organiser aussi rapidement aujourd'hui et de ne pas attendre, aussi bien dans l'armée que dans la société, que l'ordre vienne d'en haut. Il n'y a pas de verticalité du pouvoir en Ukraine. Il y a, au contraire, cette horizontalité en raison de cette histoire où les élites ont toujours été soit étrangères, soit hostiles au peuple. Peut-être que je réconcilierais le Portugal et Kundera, l'aspiration "est-européenne", c'est la notion de la liberté. La liberté, c'est ce dont parle Kundera justement dans ce discours au Congrès des écrivains, en disant que maintenant ce dont nous avons besoin pour créer, c'est la liberté, donc il faut avoir cette liberté pour créer. C'est aussi ce à quoi aspiraient les Portugais.
Oui, évidemment.
Mais pour mettre un point final, je citerai aussi Cioran, que Kundera cite dans ce discours. Il dit qu'on ne pense l'Europe qu'en Europe engloutie. C'est justement là où on pense qu'il n'y a plus d'Europe ou que cette Europe est dominée par d'autres forces qu'on aspire à cette Europe, qu'on la rêve, qu'on la veut et qu'on espère un jour la construire. Donc, les deux textes sont dans ce recueil publié chez Gallimard, il y a deux ans.
Merci beaucoup d’avoir réconcilié le Portugal et l'Europe centrale. Mais c'est vraiment l'idée de la liberté et l'Europe comme espace de liberté. Beaucoup plus comme espace qui se définit de façon culturelle, qui peut exclure une partie de l'Europe. On ouvre un débat. Qu'est-ce qui va définir culturellement l'Europe ? Je me rappelle la discussion avec ceux de l'Europe nordique qui disent que l'Europe du Sud n'est pas assez Europe parce qu'elle est trop catholique, parce qu'elle n'a pas fait la révolution que les protestants ont faite, elle n'a pas fait la réforme. On n'en finit pas. Il y aura dix définitions culturelles de l'Europe, opposées. Les démocrates chrétiens allemands peuvent dire : "C'est l'Europe chrétienne." "Catholique", diront quelques-uns. D'autres diront : "Les protestants en font partie. Les orthodoxes n'en font pas partie." (On n'en finit.) La liberté nous unit. La liberté, la démocratie, l'état de droit. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui et qu'on se bat en Ukraine. Je soutiens évidemment la lutte de l'Ukraine pour être une démocratie entourée par les démocraties européennes. C'est ça que la Russie ne veut pas. C'est la démocratie à ses portes. Mais ça, c'est tout un autre débat. Aujourd'hui, on est là pour parler d'exilés. Maintenant, je donne la parole à la salle.
Dans la même collection
-
L'exil : comme libération et réinvention de l'identité
VasconcelosÁlvaro deZhangLunFrenkielEmilieL’un des thèmes culturels et politiques les plus importants de notre temps est le questionnement identitaire, sur l’identité personnelle et aussi l’identité collective.
-
CELSO FURTADO : UN EXIL ACADÉMIQUE
VasconcelosÁlvaro deAguiarRosa Freire d'GarciaAfrânioSezerinoGlauberCelso Furtado arrive à Paris en 1965, quelques mois après le coup d'État militaire au Brésil. Privé de ses droits politiques et civiques, contraint à abandonner ses fonctions officielles de ministre
-
Intellectuels français en exil : les implications de l’hospitalité
RomanJoëlChristopoulouVassiliki-PiyiVasconcelosÁlvaro deDurant la guerre de 1939-1945, plusieurs intellectuels Français payèrent de leur vie leur engagement dans la Résistance active (Jean Cavaillès, Marc Bloch, Victor Basch, Maurice Halbwachs, Jean
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
L'exil : comme libération et réinvention de l'identité
VasconcelosÁlvaro deZhangLunFrenkielEmilieL’un des thèmes culturels et politiques les plus importants de notre temps est le questionnement identitaire, sur l’identité personnelle et aussi l’identité collective.
-
CELSO FURTADO : UN EXIL ACADÉMIQUE
VasconcelosÁlvaro deAguiarRosa Freire d'GarciaAfrânioSezerinoGlauberCelso Furtado arrive à Paris en 1965, quelques mois après le coup d'État militaire au Brésil. Privé de ses droits politiques et civiques, contraint à abandonner ses fonctions officielles de ministre
-
Intellectuels français en exil : les implications de l’hospitalité
RomanJoëlChristopoulouVassiliki-PiyiVasconcelosÁlvaro deDurant la guerre de 1939-1945, plusieurs intellectuels Français payèrent de leur vie leur engagement dans la Résistance active (Jean Cavaillès, Marc Bloch, Victor Basch, Maurice Halbwachs, Jean
-
Ent'revues : Voix ukrainiennes
GaillardRéginaldDmytrychynIrynaMouchardClaudeParaJean-BaptistePour son ultime livraison, Nunc n° 50-51 (mai 2021) consacrait un important dossier à « Ukraine, Pivot de l’Europe ».
Sur le même thème
-
Pio Turoni. Un anarchiste italien en exil en France
Fontanelli MorelFrançoisePio Turroni, anarchiste italien, a été contraint de quitter son pays par suite de l’installation du régime mussolinien. Réfugié en France, il va s’engager dans les mouvements anarchistes et
-
En transit : les Syriens en migration
RegnardCélineDans les mouvements migratoires, entre deux déplacements, il existe un moment particulier, le transit, moment quelques fois fugace et passager, quelques fois plus durable et en tout cas toujours
-
Dix ans de MERE 29 et Hommage aux républicains espagnols
López CabelloIvánSala-PalaJeanIII Colloque international " Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Dix ans de
-
Présentation de l’exposition du projet Leçons pour le présent : Rotspanier, travailleurs forcés esp…
López CabelloIvánIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. -
-
Chronotopes pestiférés ; entre barbelés et exils
López CabelloIvánNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence : José María Naharro
-
La caravana de la Memoria et les premiers réseaux associatifs en Bretagne. Une lutte mémorielle com…
López CabelloIvánCerveraAlfonsIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ». Brest, 17-19 mars 2022. - Conférence
-
Mémoire de l’exil des républicain.es espagnol.es dans le littoral atlantique français pendant la…
López CabelloIvánVigourouxHuguesGarciaGabrielleCarrionArmelleLuisGarrido OrozcoFernandezCarlosRuizJoséIII Colloque international "Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après », Brest, 17-19 mars 2022.- Séance :
-
Projets éditoriaux - Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale
López CabelloIvánMartinez-MalerOdetteAdámez CastroGuadalupeNaharro-CalderónJosé MaríaIII Colloque international " Républicain•e•s espagnol•e•s exilé•e•s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances ". Brest, 17-19 mars 2022 - Projets éditoriaux (Brest, 18 mars
-
Les républicains espagnols exilés en France pendant la Seconde Guerre mondiale : entre travail forc…
López CabelloIvánDreyfus-ArmandGenevièveMartinez-MalerOdetteIII Colloque international « Républicain.e.s espagnol.e.s exilé.e.s pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après » (Brest, 17-19 mars 2022). -
-
Rotspanier, 80 ans après (partie 1)
López CabelloIvánVigourouxHuguesAllende Santa CruzClaudineIII Colloque international " Républicain•es espagnol•es exilé•es pendant la Seconde Guerre mondiale : travail forcé et résistances. Rotspanier, 80 ans après ". Brest, 17-19 mars 2022. - Séance :
-
Table ronde sur Au-Béraud l'éphémère
LefrançoisFrédéricDésertGéraldRosierJean-MarcArsayeJean-PierreTable ronde sur Au-Béraud l'éphémère, ouvrage de Jean-Pierre Arsaye, lors de l'opération en faveur de Présence Kréyol.
-
"La politique migratoire de la France dans un contexte européen et mondial : le regard des SHS", Fr…
HéranFrançoisSéminaire général du MESOPOLHIS, vendredi 10 février 2023 - François Hérant présente "La politique migratoire de la France dans un contexte européen et mondial : le regard des SHS".