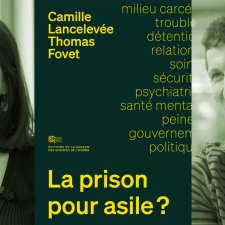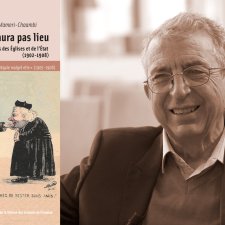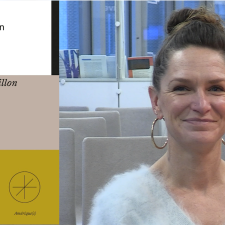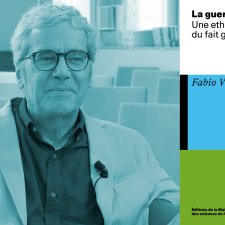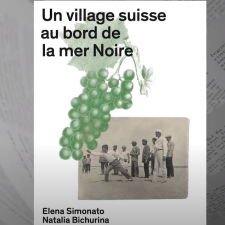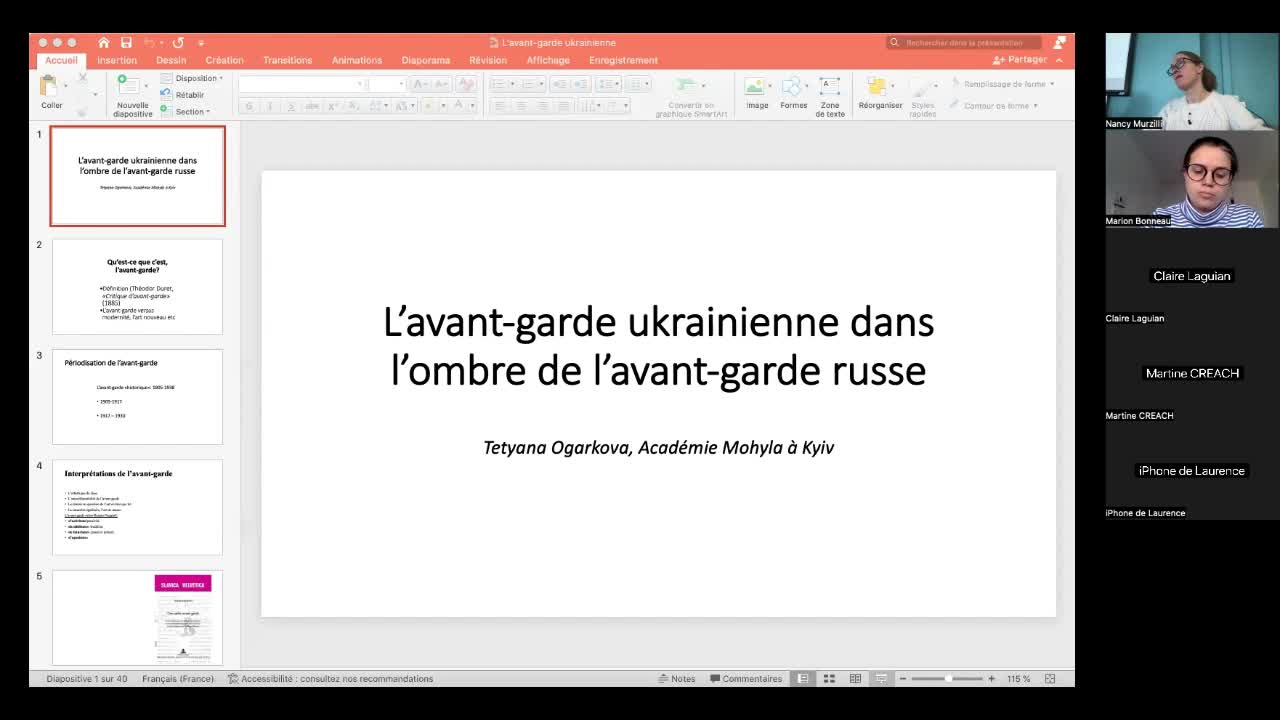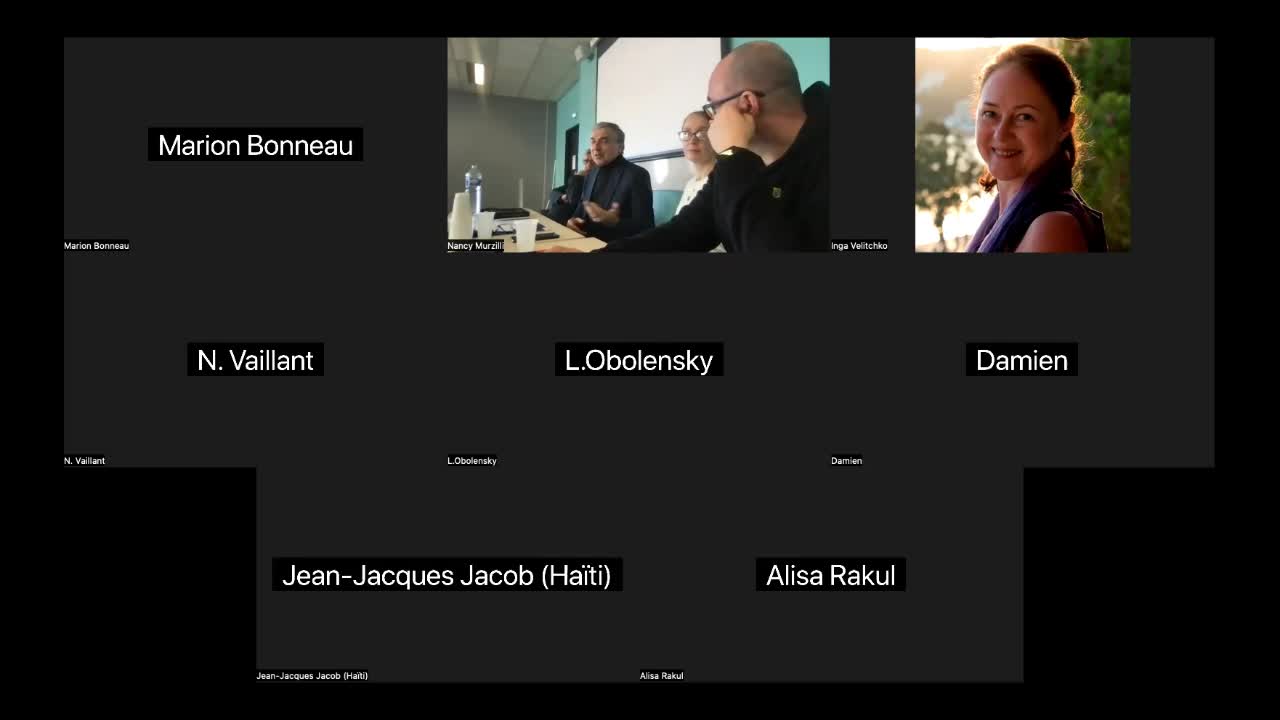Chapitres
Notice
Retranscription
En France, malheureusement, on ne s’intéresse pas vraiment aux relations bilatérales entre la France et l’Ukraine. Mais pour les diplomates, c’était un grand défi de construire de bonnes relations, parce que malheureusement, les relations entre la France et l’Ukraine étaient parasitées, dans une certaine mesure, par les relations entre la France et la Russie. Ça leur donnait une certaine méconnaissance de l’Ukraine. Les diplomates qui étaient en poste, les diplomates français qui étaient en poste en Ukraine ont remarqué ce problème. J’espère que mon ouvrage va éclairer ce sujet qui est assez inconnu et qui est devenu vraiment très important parce qu’on sait très bien que maintenant, il y a la guerre qui s’est déclenchée, la guerre conventionnelle en Europe. Petit à petit, la France est devenue un allié très important ou un partenaire, donc avoir de bonnes relations bilatérales avec la France, c’est important. Bien sûr, je comprends qu’il y a le cadre européen, le cadre otanien, mais si on se comprend mieux au niveau des deux pays, je pense que ce dialogue va faciliter aussi l'aide très concrète. J’ai interrogé les anciens ambassadeurs de France en Ukraine. Dans mon livre, vous pouvez trouver les entretiens avec d’anciens ambassadeurs, comme Philippe de Suremain, Jacques Faure, Jean-Paul Véziant, Pascal Fieschi, Éric Fournier, avec les députés de l’Assemblée nationale, et ce qui est le plus peut-être fascinant, avec les militaires français et les militaires ukrainiens. Je suis, par formation, historienne et politologue. Quand il s’agit de recherches strictement historiques, malheureusement, il y a ce sentiment d’impuissance. On ne peut pas changer, on peut travailler uniquement avec des archives ou des sources qui sont écrites. En revanche, quand il s’agit de la science politique ou les relations contemporaines, il y a des sources qui sont vivantes et on peut obtenir l’information très facilement. J’ai essayé de donner des approches très différentes des personnes qui étaient en activité, qui étaient acteurs de ces relations bilatérales. Les archives diplomatiques, j’ai étudié uniquement les questions qui concernaient le début des années 90 du 20e siècle. C’est déjà très intéressant, mais après il y a une impasse. C’est protégé, on ne peut pas y avoir accès. J’ai trouvé la solution, je me suis tournée vers les militaires et les diplomates et j’ai obtenu l’information très facilement. Traditionnellement, on dit que le domaine de la défense est strictement protégé, interdite d’accès et que les militaires ne souhaitent pas communiquer. Mon expérience était différente. J’ai découvert, avec les militaires, la possibilité d’étudier les relations contemporaines. Quand il y a des relations bilatérales, beaucoup de choses ne sont pas secrètes. Mon travail, il me semble qu’il est indispensable quand il s’agit des relations contemporaines entre les deux pays. C’est une méthode pour donner des conseils aux dirigeants des pays. Par exemple, en Ukraine, on écrit des notes analytiques qui sont envoyées au Parlement d’Ukraine, aux ministères différents. Il y a cette liberté de chercheur. Je peux parler ouvertement des problèmes qui étaient par exemple dans les relations bilatérales, mais je peux aussi souligner les atouts. Par exemple, je peux écrire que le prob…
Lire l'intégralitéOksana Mitrofanova - France-Ukraine
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Interview de Oksana Mitrofanova, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : France-Ukraine. Une histoire des relations diplomatiques et militaires. 1991-2023, publié le 15 février 2024 aux Editions de la MSH.
Plus d'informations sur l'ouvrage en cliquant ici.
La transcription est disponible dans l'onglet Documentation.
Thème
Documentation
Transcription
En France, malheureusement, on ne s’intéresse pas vraiment aux relations bilatérales entre la France et l’Ukraine.
Mais pour les diplomates, c’était un grand défi de construire de bonnes relations, parce que malheureusement, les relations entre la France et l’Ukraine étaient parasitées, dans une certaine mesure, par les relations entre la France et la Russie.
Ça leur donnait une certaine méconnaissance de l’Ukraine.
Les diplomates qui étaient en poste, les diplomates français qui étaient en poste en Ukraine ont remarqué ce problème.
J’espère que mon ouvrage va éclairer ce sujet qui est assez inconnu et qui est devenu vraiment très important parce qu’on sait très bien que maintenant, il y a la guerre qui s’est déclenchée, la guerre conventionnelle en Europe.
Petit à petit, la France est devenue un allié très important ou un partenaire, donc avoir de bonnes relations bilatérales avec la France, c’est important.
Bien sûr, je comprends qu’il y a le cadre européen, le cadre otanien, mais si on se comprend mieux au niveau des deux pays, je pense que ce dialogue va faciliter aussi l'aide très concrète.
J’ai interrogé les anciens ambassadeurs de France en Ukraine.
Dans mon livre, vous pouvez trouver les entretiens avec d’anciens ambassadeurs, comme Philippe de Suremain, Jacques Faure, Jean-Paul Véziant, Pascal Fieschi, Éric Fournier, avec les députés de l’Assemblée nationale, et ce qui est le plus peut-être fascinant, avec les militaires français et les militaires ukrainiens.
Je suis, par formation, historienne et politologue.
Quand il s’agit de recherches strictement historiques, malheureusement, il y a ce sentiment d’impuissance.
On ne peut pas changer, on peut travailler uniquement avec des archives ou des sources qui sont écrites.
En revanche, quand il s’agit de la science politique ou les relations contemporaines, il y a des sources qui sont vivantes et on peut obtenir l’information très facilement.
J’ai essayé de donner des approches très différentes des personnes qui étaient en activité, qui étaient acteurs de ces relations bilatérales.
Les archives diplomatiques, j’ai étudié uniquement les questions qui concernaient le début des années 90 du 20e siècle.
C’est déjà très intéressant, mais après il y a une impasse.
C’est protégé, on ne peut pas y avoir accès.
J’ai trouvé la solution, je me suis tournée vers les militaires et les diplomates et j’ai obtenu l’information très facilement.
Traditionnellement, on dit que le domaine de la défense est strictement protégé, interdite d’accès et que les militaires ne souhaitent pas communiquer.
Mon expérience était différente.
J’ai découvert, avec les militaires, la possibilité d’étudier les relations contemporaines.
Quand il y a des relations bilatérales, beaucoup de choses ne sont pas secrètes.
Mon travail, il me semble qu’il est indispensable quand il s’agit des relations contemporaines entre les deux pays.
C’est une méthode pour donner des conseils aux dirigeants des pays.
Par exemple, en Ukraine, on écrit des notes analytiques qui sont envoyées au Parlement d’Ukraine, aux ministères différents.
Il y a cette liberté de chercheur.
Je peux parler ouvertement des problèmes qui étaient par exemple dans les relations bilatérales, mais je peux aussi souligner les atouts.
Par exemple, je peux écrire que le problème d’absence de nombre suffisant de militaires ukrainiens qui maîtrisent le français pose le problème pour choisir un candidat pour un stage en France.
On peut essayer, dans certains ministères, de régler ce problème.
Par exemple, s’il y a des champs de coopérations très intéressants, il faut les développer.
On peut dire qu’avant la guerre, l’Ukraine possédait des champs d’entraînement de l’époque de l’Union soviétique qui étaient très intéressants pour les militaires français, qui ont envoyé les chars Leclerc.
À l’avenir, on peut envisager de continuer cette coopération, comme la location de champs d’entraînement.
C’est très concret.
D’abord, pourquoi j’ai choisi cette date ?
Tout simplement, avant l’indépendance de l’Ukraine, il est très difficile d’analyser les relations bilatérales entre la France et l’Ukraine parce qu’à l’époque, la France était un sujet de droit international, donc c’était un État.
En revanche, l’Ukraine, était la République de l’Union soviétique.
Du coup, la coopération se passait plutôt avec Moscou, entre Paris et Moscou.
Dès le début de l’indépendance, la situation change radicalement parce que l’Ukraine devient un État indépendant.
Du coup, il y a un défi, comprendre ce pays qui est apparu soudainement dans l’espace stratégique européen.
Comme l’a remarqué l’ancien ambassadeur de France en Ukraine, Philippe de Suremain, certains cercles en France ont pensé que c’est un accident de l’histoire.
L’apparition de l’Ukraine, c’est un accident de l’histoire.
Le problème, c’est aussi le manque de connaissances de l’Ukraine, la connaissance de son histoire, de sa spécificité.
Ensuite, on a développé le projet Printemps français.
Le Printemps français, c’est un projet culturel qui se passe plutôt en mars.
C’est la représentation de pièces de théâtre, de tableaux d’artistes.
C’est intéressant.
C’est un dialogue culturel.
Il ne faut pas nier ce domaine de coopération.
L’étape suivante, je pense qu’il faut parler de la visite officielle du président de la République Jacques Chirac, les 2, 3 et 4 septembre 1998, en visite officielle.
Je trouve que cette visite est une bonne illustration d’un proverbe qui dit que c’est mieux de voir une fois qu’attendre cent fois.
Jacques Chirac est arrivé en Ukraine, il a eu suffisamment de temps, pas uniquement pour parler avec ses homologues ukrainiens, mais aussi pour avoir une intervention devant les étudiants.
Cette visite était importante parce qu’il s’agissait de déblocages d’aide du fonds monétaire international.
Petit à petit, cette négociation a débouché vers la construction du sarcophage de Tchernobyl.
C’est un problème connu partout dans le monde.
C’est vrai que les Français ont remarqué beaucoup d’intrigues autour de cette construction.
Finalement, résultat, quand on a réglé tous les problèmes, c’est le consortium Novarka qui a construit ce sarcophage.
Les visites de présidents sont importantes parce qu’ils peuvent activer le dialogue et le dialogue entre les scientifiques.
Dans l’équipe du président, peuvent venir des chercheurs, des scientifiques, signer des accords de coopération et activer les échanges.
Ensuite, parmi les étapes, je peux parler du format de Normandie en 2014, quand la France avec l’Allemagne a essayé de régler le conflit militaire de basse intensité dans le Donbass.
Malheureusement, ça a mené vers l’échec.
Au moins, il faut reconnaître qu’on est passé par cette tentative.
Les relations changent radicalement avec le début de la guerre conventionnelle parce que l’aide de la France à l’Ukraine devient importante.
Ce n’est pas uniquement de l’aide, mais aussi un changement de conception.
Si dans le passé, l’Ukraine était vue sous le prisme de la Russie, maintenant, le monde politique français découvre l’efficacité de l’armée ukrainienne.
Ce qui est important, c’est Emmanuel Macron qui a soutenu le statut de candidat de l’Ukraine pour l’adhésion à l’Union européenne.
On dit que c’est lui qui a réussi à convaincre le sceptique qu’était chancelier Olaf Scholz.
Ce n’est pas du tout négligeable.
Ce qui est assez radical pour la politique française, c’est qu’en été 2023, le président de la République s’est prononcé favorablement à l’adhésion dans l’avenir de l’Ukraine dans l’OTAN.
On ne sait pas quand, mais pour la politique française, je vous confirme, c’est très radical parce qu’on se souvient qu’en 2008, pendant le sommet de l’OTAN, c’est la France et l’Allemagne qui ont bloqué cette procédure de donner à l’Ukraine le membership plan, le plan de préparation d’adhésion à l’OTAN.
Si au début de la guerre, le président de la République a mené un discours qui a été mal perçu en Ukraine, il a dit que ce qui se passait en Ukraine n’est pas un génocide, il a parlé de fraternité entre le peuple russe et ukrainien, ça reste un discours politique.
Les Ukrainiens n’étaient pas contents du tout.
Il faut voir ce qui s’est passé dans le domaine pratique.
Dans le domaine pratique au même moment, la France a envoyé les canons César, l’artillerie lourde en Ukraine.
Cette aide pratique militaire pendant la guerre est vraiment très importante.
La France a aussi envoyé l’aide de défense antiaérienne qui n’est pas du tout négligeable.
Il s’agit de Crotale et du système Mamba, le système Mamba franco-italien qui est contemporain, qui arrive à battre des missiles balistiques.
Après l’indépendance de l’Ukraine, les diplomates ukrainiens ont dit qu’il était très difficile de travailler en France à cause de l’influence de la diplomatie russe.
Le dialogue était difficile.
On ne connaissait pas l’existence de la langue ukrainienne.
Il faut comprendre que l’ukrainien et le russe, c’est la même chose que le français et l’espagnol.
Le processus de découverte de l’Ukraine était assez difficile, peut-être parce que beaucoup de spécialistes français, d’anciens soviétologues, maîtrisaient le russe.
Après la chute de l’Union soviétique, ils se sont reconvertis en spécialistes de la Russie et l’Ukraine, c’était quelque chose à côté.
Ces spécialistes qui ne maîtrisaient pas l’ukrainien, ont étudié l’Ukraine, mais dans les sources écrites en Russie et en russe.
Du coup, les conseils qui étaient donnés aux dirigeants français étaient problématiques.
C’était vraiment une période très difficile.
Mais petit à petit, il y a des changements.
Par exemple, les doctorants et les jeunes chercheurs français réalisent très bien le défi.
Ils maîtrisent l’ukrainien.
On peut voir maintenant des ouvrages importants dans le domaine de la recherche, consacrés à l’Ukraine avec l’utilisation de sources ukrainiennes.
D’un autre côté, oui, il y a une spécificité aussi.
J’ai l’impression que la situation en Ukraine était mieux vue ou plus lisible par les diplomates français qui étaient sur place, c’est-à-dire qui étaient à Kiev.
Plusieurs diplomates français m’ont fait remarquer que l’approche était très différente de l’ambassade de France à Kiev que du quai d’Orsay et les relations avec l’Élysée.
Le dernier exemple, je peux citer le livre de l’ambassadeur Étienne de Poncins.
Au début de la guerre, il était à Kiev.
Il a écrit un livre assez intéressant.
Au printemps 2022, il a dit qu’il souhaitait revenir à l’ambassade parce qu’il avait sur place le développement de la situation militaire.
En revanche, ses collègues à Paris ont considéré que c’était très dangereux.
Dans ce livre, il parle ouvertement de ce problème, que c’est mieux vu quand les diplomates sont sur place.
Ils sont arrivés à comprendre cette spécificité ukrainienne.
Comme exemple, on peut donner l’échec de toutes les prévisions de cette guerre conventionnelle.
Beaucoup d’analystes français ont dit que la guerre n’était pas possible du tout.
Les meilleures analystes des meilleurs centres, comme l’IFRI, l’IRIS ou la FRS, ont fait les publications, non ne va pas avoir la guerre.
Il y a aussi l’information que même le renseignement militaire français s’est trompé.
Ce sont les renseignements militaires américain et britannique qui ont averti le gouvernement qu’on aurait une guerre conventionnelle.
En France, il se forme un cercle de politologues, politistes spécialisés en relations internationales qui maîtrisent l’ukrainien, qui peuvent donner de bons conseils.
Ensuite, il y a le facteur d’État.
Il y a des jeunes diplomates maintenant qui arrivent en poste.
L’existence de l’Ukraine pour ces jeunes personnes était évidente.
Toute leur vie, ils ont connu l’Ukraine comme un État, pas comme une République de l’Union soviétique.
Je pense que ça aussi, ça change la perception.
Dans la même collection
-
Nehru, les débats qui ont fait l'Inde
SinghTripurdamanHussainAdeelInterview de Tripurdaman Singh et Adeel Hussain, dans le cadre de la sortie de leur ouvrage Nehru. Les débats qui ont fait l'Inde
-
La prison pour asile ?
LancelevéeCamilleFovetThomasInterview de Camille Lancelevée et Thomas Fovet, dans le cadre de la sortie de leur ouvrage "La prison pour asile ?"
-
La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1…
BaubérotJeanInterview de Jean Baubérot, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1908). Tome III
-
Harlem, une histoire de gentrification
RecoquillonCharlotteInterview de Charlotte Recoquillon, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : Harlem, Une histoire de la gentrification.
-
L'Impressionnisme à ses frontières
ClaassVictorInterview de Victor Claass, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : L' Impressionnisme à ses frontières
-
Fabio Viti - La guerre au Baoulé. Une ethnographie historique du fait guerrier.
VitiFabioInterview de Fabio Viti, dans le cadre de la sortie de son ouvrage La guerre au Baoulé. Une ethnographie historique du fait guerrier.
-
Les expulsés, sujets politiques
LecadetClaraInterview de Clara Lecadet, dans le cadre de la sortie de son ouvrage Les expulsés, sujets politiques.
-
L'esprit politique des savoirs
CommailleJacquesInterview de Jacques Commaille, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : L'esprit politique des savoirs », publié le 12 octobre 2023
-
Alessandro Gallicchio - Nationalismes, antisémitismes et débats autour de l'art juif
GallicchioAlessandroInterview d'Alessandro Gallicchio, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Nationalismes, antisémitismes et débats autour de l'art juif".
-
Dépouiller en toute légalité. L'aryanisation économique des biens juifs en Algérie sous le régime d…
LaloumJeanInterview de Jean Laloum, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : Dépouiller « en toute légalité », publié en septembre 2023.
-
Rémy Péru-Dumesnil - Les États-Unis en Guyane durant la Seconde Guerre Mondiale
Péru-DumesnilRémyInterview de Rémy Péru-Dumesnil, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Les États-Unis en Guyane durant la Seconde Guerre Mondiale".
-
Interview de Séverine Autesserre pour son ouvrage "Sur les fronts de la paix"
AutesserreSéverineDans Sur les fronts de la paix, Séverine Autesserre, chercheuse primée et activiste, examine l’industrie de la paix, si bien intentionnée et pourtant si défectueuse. En s’appuyant sur des cas du monde
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
Oksana Mitrofanova - Diplomatic links between Ukraine and France
MitrofanovaOksanaOksana Mitrofanova, chercheuse ukrainienne, spécialiste de l'histoire et des relations politiques internationales, en particulier entre l'Ukraine et la France, nous éclaire sur les liens diplomatiques
-
Table ronde : Contraints à l’exil - parcours de chercheurs affectés par la guerre en Ukraine
GubertFloreLieppeGwenaëlleLohéacLauraKandakouDzianisБеловаОлгаMitrofanovaOksanaDans le cadre de la campagne de levée de fonds au profit des chercheuses et chercheurs affectés par la guerre en Ukraine, la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) a organisé, le jeudi 17
Sur le même thème
-
La frontière chiites/sunnites au Moyen-Orient
BrombergerChristianChiites, sunnites, comment sont nées ces deux branches de l’Islam ? Qu’elles sont aujourd’hui leurs particularités et leurs relations dans les domaines très divers, activités religieuses, croyances,
-
Gelinada Grinchenko
GrinchenkoGelinadaGelinada Grinchenko is a Professor of History at V. N. Karazin National University, Kharkiv, Ukraine.
-
Un village suisse au bord de la mer Noire
BichurinaNataliaEn 1822, sept familles viticoles suisses quittent les bords du lac Léman pour s'installer au Liman de Dniestr, non loin d'Odessa, au bord de la mer Noire.
-
La Russie, vue par Valérie Pozner
PoznerValérieLa Fondation Maison des sciences de l'homme soutient les milieux intellectuels évoluant dans des pays marqués par divers obstacles à la liberté académique. Pour ce faire, elle accompagne des
-
La redécouverte du milieu urbain dans la culture militaire occidentale depuis les années 2000
BoulangerPhilippePhilippe Boulanger aborde la ville sous l'angle des enjeux militaires : un espace longtemps incertain dans la pensée militaire occidentale, un espace difficile à maîtriser, les nouveaux défis dans la
-
Interview de Séverine Autesserre pour son ouvrage "Sur les fronts de la paix"
AutesserreSéverineDans Sur les fronts de la paix, Séverine Autesserre, chercheuse primée et activiste, examine l’industrie de la paix, si bien intentionnée et pourtant si défectueuse. En s’appuyant sur des cas du monde
-
Les représentations littéraires des bombardements du Havre
AntonSoniaL’expression littéraire a précocement pris les ruines pour objet de description, notamment les ruines urbaines.
-
Fuir la guerre. Les réfugiés syriens dans les villes libanaises.
El KhouriDimaPour des raisons évidentes de proximité, les Syriens ont toujours fait partie du paysage des villes libanaises, recrutés pour des emplois saisonniers ou en visite du fait de leurs attaches familiales.
-
Conférence de Tetyana Ogarkova : « L’avant-garde ukrainienne dans l’ombre de l’avant-garde russe »
OgarkovaTetyanaL’équipe FabLitt a eu le plaisir de recevoir, le 4 avril 2023, Tetyana Ogarkova (professeure à l’Académie Mohyla, professeure invitée du Département de Littérature française, francophone et comparée
-
Table ronde : "Qu'est-ce qu'être universitaire, journaliste, intellectuel.le en temps de guerre ?"
OgarkovaTetyanaСиговКонстантинYermolenkoVolodymyrL’équipe FabLitt a eu le plaisir de recevoir, le 4 avril 2023, Tetyana Ogarkova (professeure à l’Académie Mohyla, professeure invitée du Département de Littérature française, francophone et comparée
-
Being a historian, running a history research center in times of war in Ukraine. Interview with Sof…
DyakSofiaEntretien avec Sofia Dyak, historian, specialist of post-WWII urban recovery and transformation, director of the Lviv Center for Urban History.
-
Minorities experiment in interwar Ukraine: A Soviet answer to the national problem
PalkoOlenaEntretien avec Olena Palko, historienne, professeure à l’université de Bâle (SNF PRIMA Grantee), spécialiste de l’histoire culturelle et de la politique soviétique des minorités en Ukraine dans l