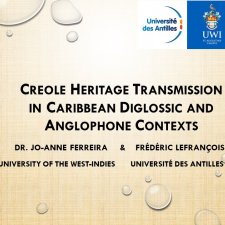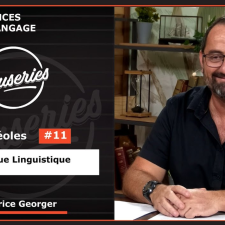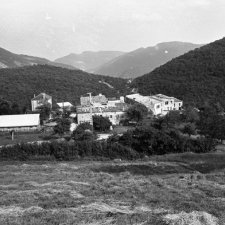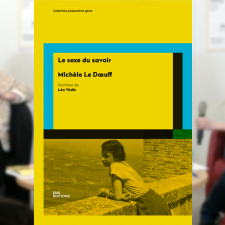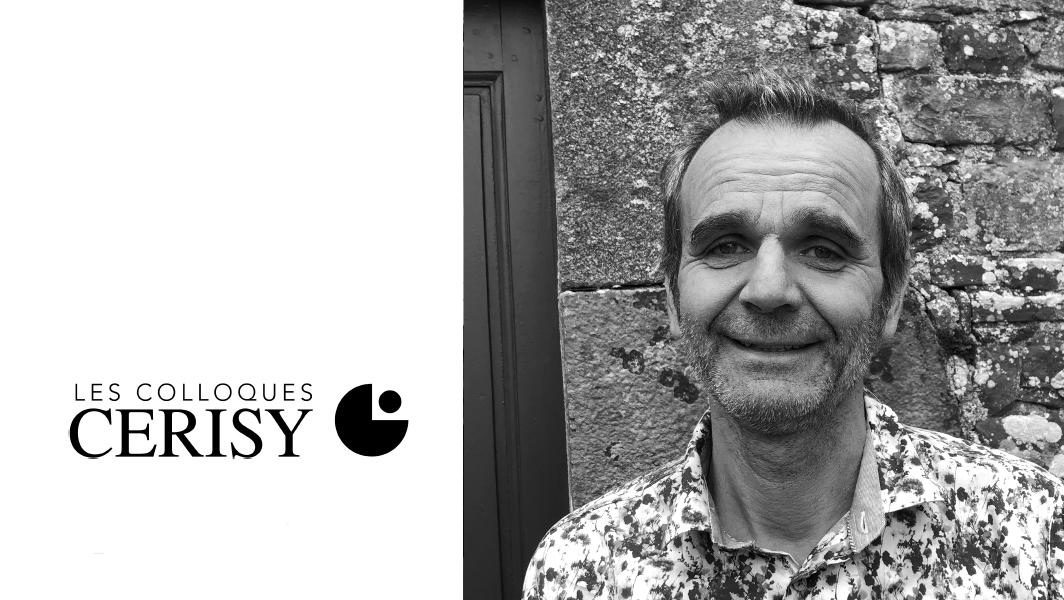Notice
MRSH Caen
Le discours savant sur les poissons de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a été prononcée dans le cadre du séminaire annuel du pôle maritime de la MRSH, dont les thématiques 2010-2011 concernent les ressources marines.
Catherine Jacquemard, professeur de latin à l'UCBN, a axé ses recherches sur la littérature scientifique médiévale. Brigitte Gauvin, maître de conférences en latin à l'UCBN, travaille sur l'édition de textes scientifiques du XVIe siècle. Marie-Agnès Lucas-Avenel, maître de conférences en latin à l'UCBN, co-directrice de l'Office universitaire de Basse-Normandie (OUEN), travaille sur l'historiographie normande médiévale. Toutes trois sont membres du Centre Michel de Boüard (CRAHAM - UMR 6273) et sont engagées dans un travail collectif sur les traités latins d'ichtyologie contenus dans les encyclopédies médiévales ; à ce titre, elles collaborent au programme Sourcencyme piloté par l'Atelier Vincent de Beauvais (Nancy II).
Résumé
Les poissons et l'ensemble des créatures aquatiques ont longtemps été des animaux mal connus, soit parce qu'ils ne sont pas immédiatement visibles, soit parce que leurs mœurs sont difficiles à analyser et parce que l'homme a du mal à les distinguer. À la source du discours savant sur les poissons se trouve pourtant une œuvre stupéfiante de précision et d'exactitude puisqu'Aristote, dès le IVe siècle avant J-C, avait, dans son Histoire des animaux, consacré aux poissons de nombreux chapitres portant sur tous les aspects de leur morphologie et de leur comportement.
Au premier siècle après J-C, c'est Pline, écrivain latin, qui devient à son tour l'incarnation du savant universel. Reprenant, dans son Histoire naturelle, de nombreux éléments à Aristote, il donne au discours savant sur l'animal, et donc sur les poissons, une double orientation, à la fois zoologique, dans la lignée d'Aristote, et médicale, en réunissant tous les remèdes et recettes magiques qu'on peut tirer des poissons. Au siècle suivant, en Orient, un ouvrage chrétien, le Physiologos, dresse un tableau de la nature comme manifestation de la parole divine. C'est la source du troisième type de discours : le discours allégorique.
À partir du début de notre ère, les poissons vont donc être le sujet de ce triple discours. Alors qu'on perd l'accès direct au texte d'Aristote, c'est Pline qui va inspirer de nombreux continuateurs : les encyclopédistes du XIIe et du XIIIe siècles puisent abondamment à cette source avant de retrouver l'accès à Aristote par l'intermédiaire de la science arabe, et ils assurent ainsi la continuité du discours zoologique ; les médecins de l'Antiquité tardive comme Marcellus ou Paul d'Égine enrichissent quant à eux le discours médical, qui connaîtra un nouvel essor avec la découverte, au Xe siècle, des textes des médecins arabes ; enfin la tradition allégorique est exploitée par les pères de l'Église comme Ambroise de Milan ou Basile de Césarée pendant l'Antiquité, puis par Isidore de Séville et enfin par les encyclopédistes médiévaux, depuis Alexandre Nequam jusqu'à Vincent de Beauvais, qui dans de gigantesques efforts de synthèse, tentent de réunir la totalité des informations sur les poissons comme sur le reste de la création.
Le discours savant sur les poissons cependant ne se construit pas de manière linéaire : certes, si l'on compare les textes d'Aristote et de Pline à ce qu'il en reste à la fin du Moyen Âge, on est forcé de constater que le souci constant de ne rien perdre de la science des Anciens à propos de toutes les créatures n'a pas empêché le discours de se corrompre : les aléas de la transmission écrite - erreurs de copie, erreurs d'interprétation ou de lecture, problèmes liés à la traduction du grec vers l'arabe, puis de l'arabe vers le latin, etc. - font que certains poissons disparaissent, que d'autres naissent et que certains changent de nom. Toutefois, le Moyen Âge amorce une évolution qui se concrétisera pleinement à la Renaissance : les savants introduisent de nouveaux poissons qui ne sont pas dans les livres mais qu'ils connaissent, et commencent dès lors timidement à se détacher du discours livresque pour apporter de nouveaux savoirs résultant de l'observation personnelle et de l'expérience des pêcheurs.
Thème
Sur le même thème
-
Gestèmes et expertise sensorielle en taille de pierre
MartinClémenceLaboratoire d'Anthropologie et de Sociologie Mémoire Identité et Cognition Sociale , Séminaire 2009-2010 , Anthropologie du Geste.
-
Creole Heritage Transmission in Caribbean Diglossic and Anglophone Contexts
LefrançoisFrédéricFerreiraJo-Anne S.BélaiseMaxCommunication presentée lors de la journée d'étude “Problématiques d’éducation en sociétés crécoles. Perspectives de recherche”, Université des Antilles, Campus de Schoelcher, le 27 mars 2024.
-
Langue et culture créoles : Politique linguistique
ChadyShimeen-KhanGeorgerFabriceSciences du langage - Langue et culture créoles #11 - Politique linguistique
-
Mémoire renversée. Parcours biographique de l'oeuvre de Séra
SéraCet entretien mené par Véronique Donnat explore les questions biographiques qui ont déterminé l’œuvre de Séra, peintre, plasticien, sculpteur et auteur de bandes dessinées.
-
Les nouvelles voies de l'énonciation - Dans l'intimité de la recherche
Colas-BlaiseMarionDonderoMaria GiuliaBasso FossaliPierluigiVallespirMathildeSoirée "Les nouvelles voies de l'énonciation", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 7 juin 2023 au Forum de la FMSH
-
Rencontre avec Sjoerd Wartena, Vachères-en-Quint (Drôme)
Avec la participation de Sjoerd Wartena, fondateur de la coopérative des plantes aromatiques du Diois et co-fondateur de l’association Terre de liens. Interview réalisée par Pierre-Antoine Landel.
-
-
Soirée de présentation de l'ouvrage "Le sexe du savoir"
Le DœuffMichèleBertinMarjoriePrésentation de l'ouvrage "Le sexe du savoir", de Michèle Le Dœuff, présenté par Marjorie Bertin.
-
Présence de la préhistoire : autour du fac-similé de la Grotte Cosquer
EfratiBenjaminLabrusseRémyFritzCaroleVanrellLucCohenClaudinePigeaudRomainLa préhistoire s’inscrit-elle à contretemps de notre présent ? En est-elle un ailleurs absolu ou en fait-elle partie de manière indissociable ?
-
Comment un territoire absorbe un grand parc éolien en mer ?
La mer constitue le dernier espace de la conquête énergétique. L'État planifie d'immenses parcs éoliens au large des côtes : il décide de leur taille et de leur localisation avant d'en confier la
-
La propagande dans le contexte politique italien
Cette conférence, donnée dans le cadre du programme PandheMic (Propagande : héritages et mutations contemporaines) , a été l'occasion d'attirer l’attention sur la transformation des stratégies de
-
La propagande d'extrême-droite dans l'Allemagne contemporaine
Cette intervention à deux voix se propose de dresser un bref état des lieux des évolutions contemporaines de la propagande d’extrême-droite en Allemagne. Sont évoqués la situation juridique et