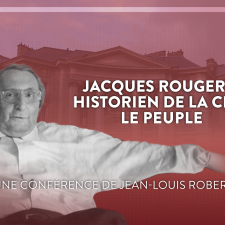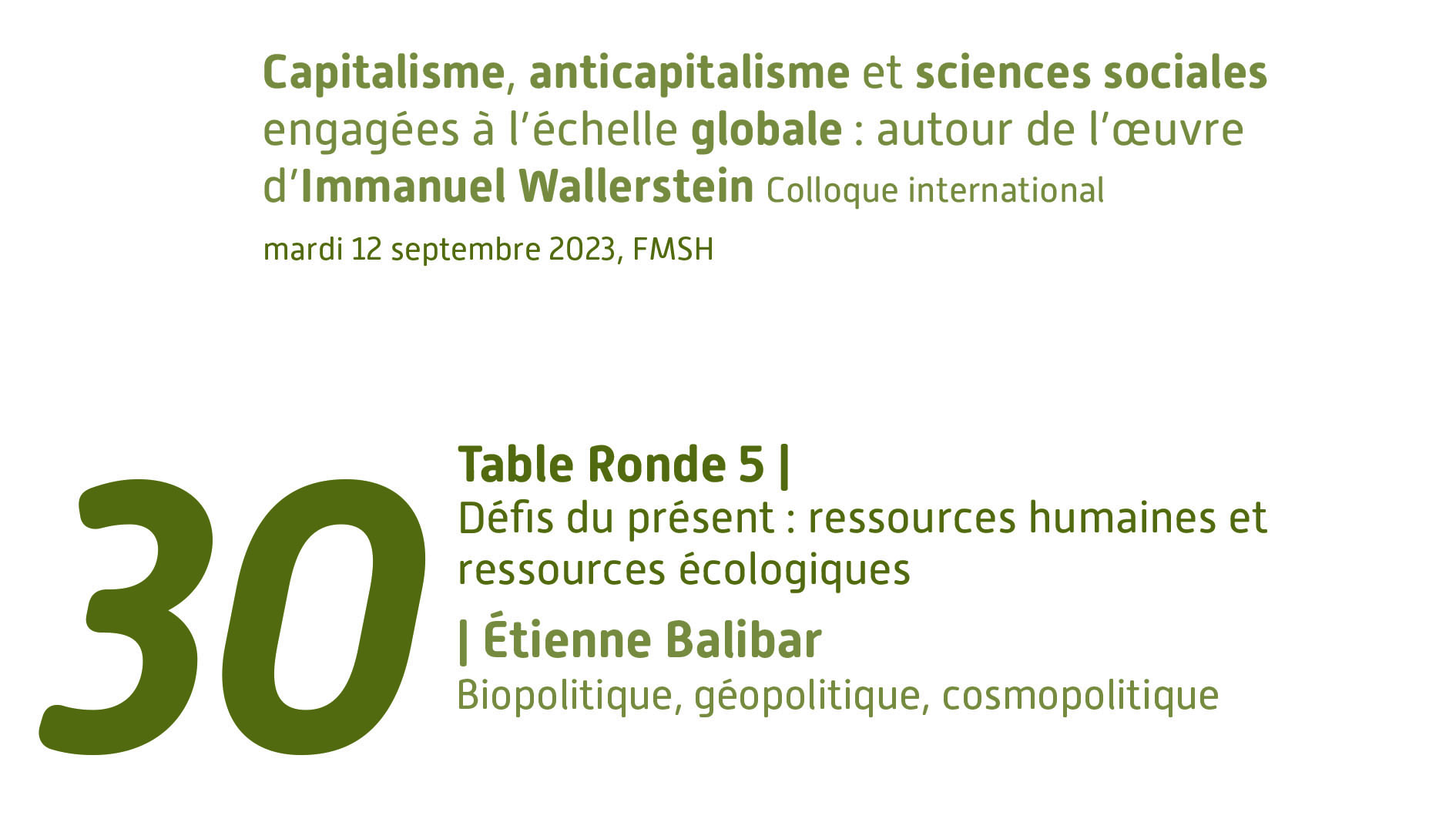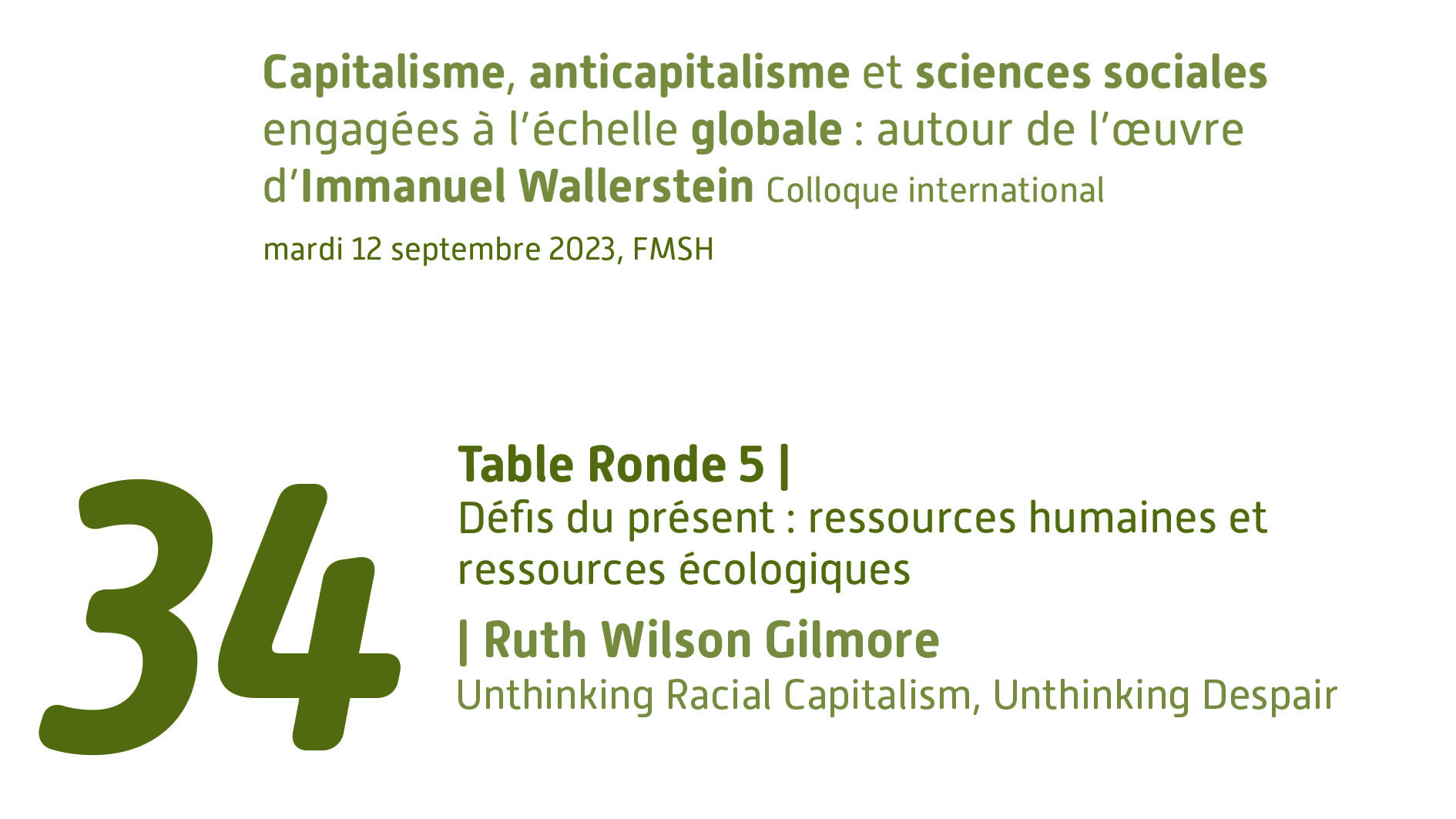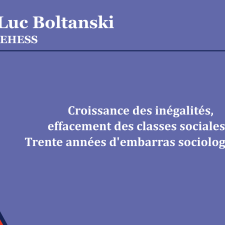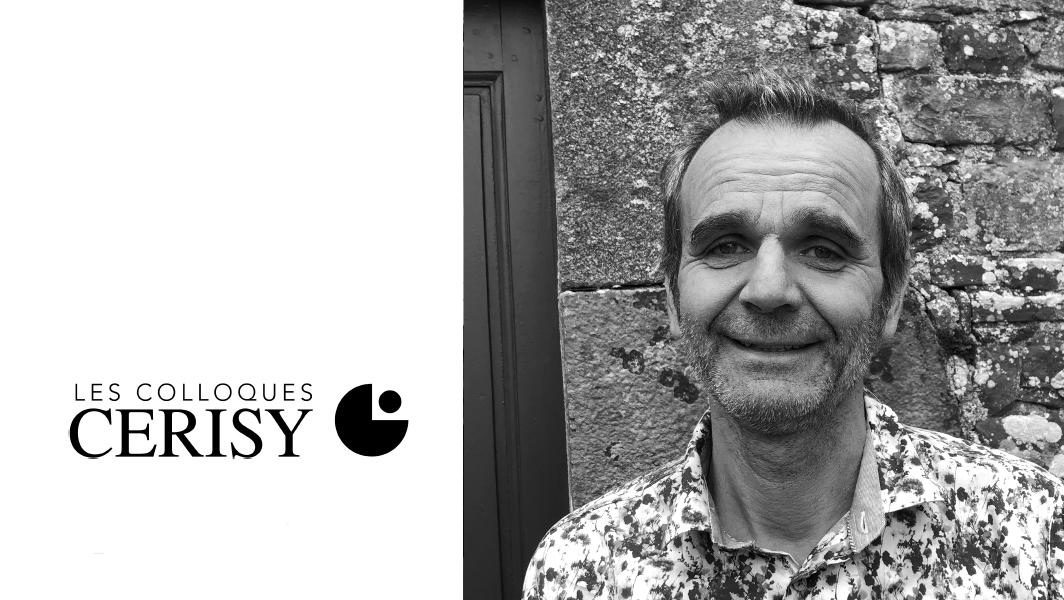Notice
MRSH Caen
Les marins des paroisses littorales et rurales : des terriens comme les autres ? Le cas des côtes nord de la Bretagne au XVIIIe siècle
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a été enregistrée dans le cadre du séminaire annuel du pôle Sociétés et espaces ruraux de la MRSH de l'année 2016-2017.
Emmanuelle Charpentier est maître de conférences en histoire moderne à l'université de Toulouse et membre de l'équipe de recherche France, Amériques, Espagne. Sociétés, Pouvoirs, Acteurs (Framespa).
Résumé de la communication
Le nombre des pescheurs de Plérin que nous avons vérifié [...] se monte à 40 personnes, dont plusieurs d'entre eux sont classés, et quelques-uns navigateurs terreneuviers, ceux qui ne sont point dans ce cas sont tendeurs à la basse-eau et pescheurs de pied dans la baye [de Saint-Brieuc], ces derniers sont aussi comme ceux de Pordick [Pordic] petits laboureurs et occupés à la culture de leurs terres, quelques-uns aussi s'employent à la pesche pendant toute l'année et n'ont point d'autre profession ». C'est dans ces termes que François Le Masson du Parc, « Inspecteur général des pêches du poisson de mer » pour les provinces de Normandie, Flandres, Picardie et Bretagne, évoque en 1731 les pêcheurs de Plérin, près de Saint-Brieuc. Dans l'exercice de sa mission, il se heurte à une difficulté concrète : recenser les pêcheurs de chaque paroisse dont les activités s'entremêlent en illustrant toutes les possibilités qu'offre la situation d'interface du littoral à ses habitants. Ces opportunités, entre terre et mer, brouillent les identités, notamment dans les vastes portions de littoral occupées par les paroisses rurales. La possibilité de choisir et de naviguer entre horizon terrestre et horizon maritime incite à s'interroger sur la place des gens de mer au sein des sociétés littorales et rurales, sur les côtes nord de la Bretagne au XVIIIe siècle. Contre toute attente, pour une province réputée maritime, les gens de mer apparaissent peu dans les villages littoraux où ils sont minoritaires et divisés par d'importants écarts sociaux et de revenus, l'opulence étant rarement atteinte. Aussi se pose la question des choix sous-tendant le basculement dans une carrière maritime : répondent-ils à une réelle vocation ou bien à la saisie d'opportunités par les individus ? Une fois ce choix établi mais jamais définitif, les ménages de gens de mer doivent faire face à l'absence et à l'irrégularité des revenus, contraintes inhérentes aux métiers maritimes : cela donne lieu à des stratégies de (sur)vie dans lesquelles les épouses de marins prennent toute leur place et gagnent davantage d'autonomie dans une société qui considère encore les femmes comme des mineures juridiques.
Sur le même thème
-
3. Jacques Rougerie et le peuple
RobertJean-LouisLa troisième conférence de la journée d’étude sur l’historien Jacques Rougerie est menée par le professeur Jean-Louis Robert et consacrée aux liens entre Jacques Rougerie et le peuple. Jean
-
Table ronde 5/ Biopolitique, géopolitique, cosmopolitique
BalibarÉtienneDans le cadre de ses 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l'homme organise le colloque international "Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale : autour de
-
Table ronde 5/ Ruth Wilson Gilmore, Unthinking Racial Capitalism, Unthinking Despair
GilmoreRuth WilsonDans le cadre de ses 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l'homme organise le colloque international "Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale : autour de
-
Croissance des inégalités, effacement des classes sociales ? Trente années d'embarras sociologiques
BoltanskiLucConférence donnée dans le cadre du colloque « Inégalités et Justice sociale » organisé à l’Université Bordeaux Segalen le 30 mai 2013
-
Faire œuvre économique contre l'économie politique
Bien qu'on qualifie proverbialement Balzac de romancier de l'argent, les relations de l'auteur de La Comédie humaine avec l'économie politique n'ont jamais été véritablement étudiées. Ce silence est d
-
Comment un territoire absorbe un grand parc éolien en mer ?
La mer constitue le dernier espace de la conquête énergétique. L'État planifie d'immenses parcs éoliens au large des côtes : il décide de leur taille et de leur localisation avant d'en confier la
-
Le pain, révélateur de la condition sociale pendant l’empire romain ?
Si les céréales font partie intégrante de l’alimentation humaine depuis le Néolithique, la forme sous laquelle elles sont consommées constitue un marqueur culturel majeur d’identité. Comprendre la
-
Se distinguer sans trahir ? La construction des goûts alimentaires et des frontières de race et de …
Cette communication interroge la spécificité des pratiques alimentaires d’une famille louisianaise de la black middle class, chez qui l’auteur a loué une chambre pendant près de cinq mois au début de
-
Repenser le fracassant vacarme de l'oubli
Cette conférence a pour point de départ l’amnésie collective qui a longtemps caractérisé l’histoire de l’esclavage et retrace les étapes de la mise en visibilité des acteurs de l’histoire de l
-
Le travail à la Belle Époque : un tableau divers, quelques lignes de forces
À partir des centaines de reportages de Léon et Maurice Bonneff dans le quotidien L'Humanité, que Jean Jaurès venait à peine de fonder, s'esquisse un panorama de la condition ouvrière en France à la
-
Dis-moi comment tu manges, je te dirai si tu es sage. Postures et paroles du philosophe aux banquet…
Dans le Banquet de Platon plusieurs éléments de mise en scène vont pour ainsi dire isoler Socrate et l’opposer au reste de l’assemblée. Dans le livre II de la République, lors de la mise en place
-
Jouets futiles et sérieux de la Renaissance
Si les jeux à la Renaissance ont fait l’objet d’un beau colloque du Centre de la Renaissance en 1982, sous la direction de Philippe Ariès et André Stegman, et si les jeux de hasard, massivement