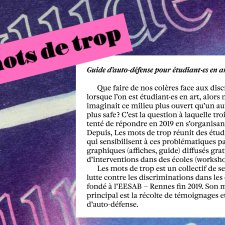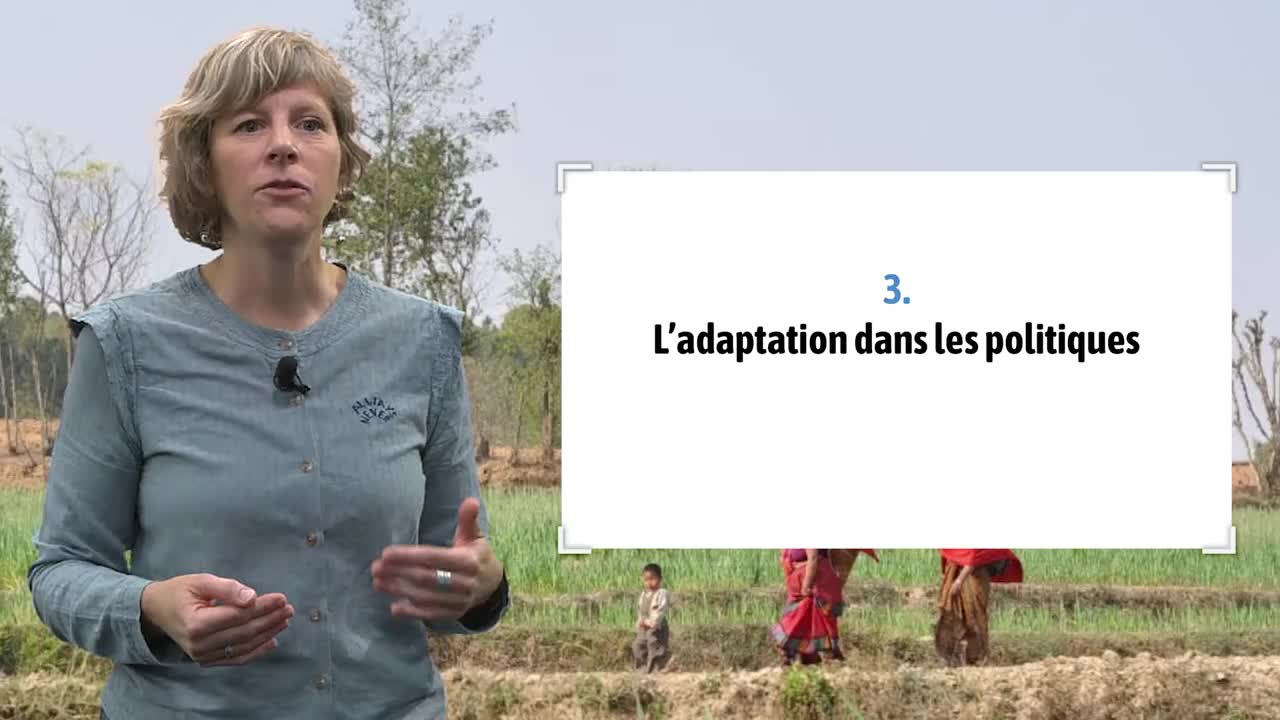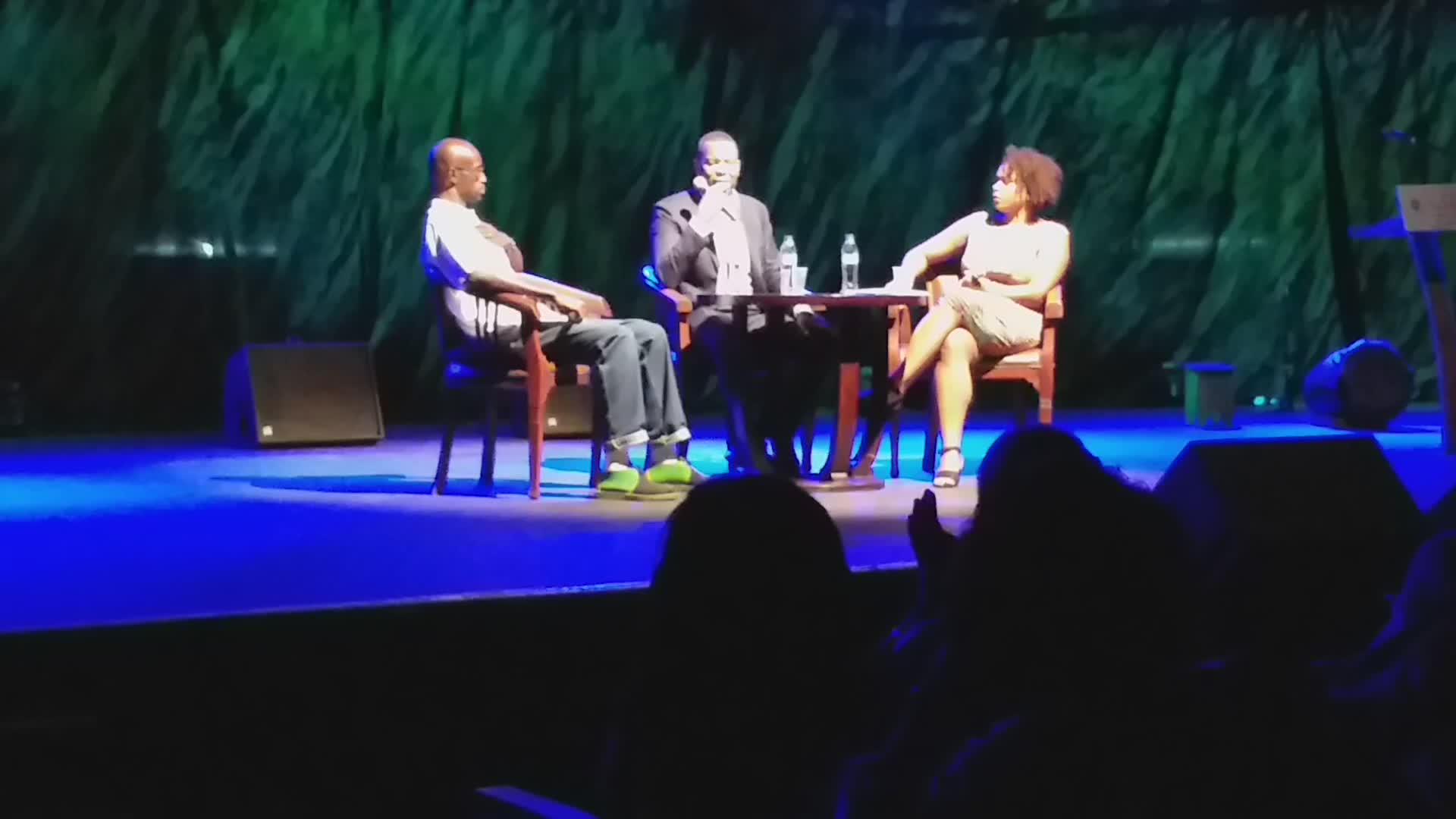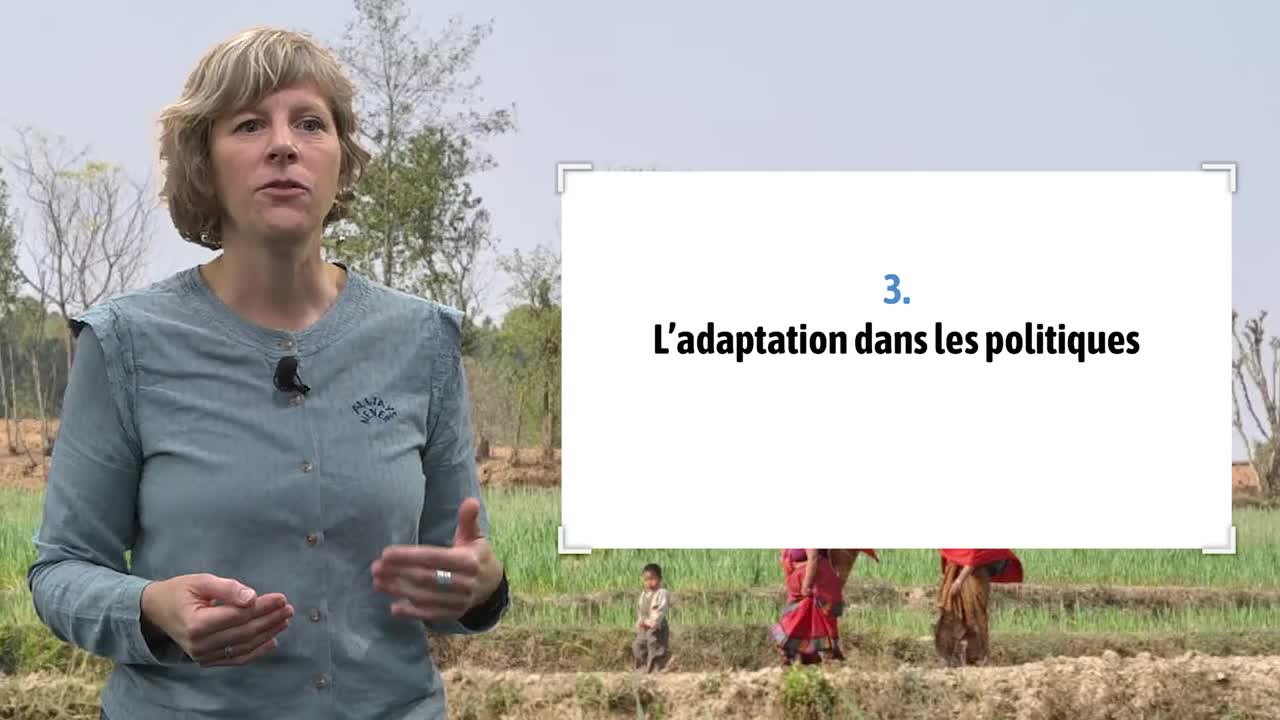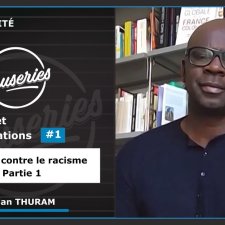Notice
FMSH
Le Brésil, vu par Rebecca Lemos Igreja
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Peu avant les élections présidentielles de 2022 au Brésil avons reçu Rebecca Lemos Igreja, anthropologue et professeure à l’Université de Brasilia. Elle nous a parlé de la situation des universités dans son pays.
Sans négliger aucune dimension de la crise qu’elles ont traversée, Rebecca Lemos Igreja remonte aux réformes de l’enseignement supérieur menées par Lula et, au-delà, aux sources historiques d’une situation politique marquée par la confrontation.
De fait, nous explique-t-elle, les universités n’ont pas seulement vu leurs moyens réduits à peau de chagrin, mais se sont trouvées au cœur d’une véritable bataille idéologique.
Cette bataille ayant pour but de les expurger de l’influence d’un supposé « marxisme culturel », et d’instaurer un nouvel enseignement fondé sur des valeurs conservatrices, au bénéfice d’une élite restreinte.
Outre ces pressions financière et administrative, les instruments de cette tentative de révolution conservatrice ont été le soutien massif à l’enseignement évangéliste, la surveillance des professeurs, le dénigrement et l’incitation à la violence sur les réseaux sociaux, avec pour résultat l’autocensure, le renoncement à certaines recherches, la peur de parler librement devant les étudiants.
Thème
Documentation
Transcription du podcast de Rebecca Lemos dans la collection Zones contraintes
La Fondation Maison des sciences de l'homme soutient les milieux intellectuels évoluant dans des pays marqués par divers obstacles à la liberté académique. Pour ce faire, elle accompagne des chercheurs et chercheuses qui ne peuvent plus exercer leurs activités avec la sérénité, voire avec la sécurité nécessaire. Des situations de stress, de surveillance, des blocages administratifs, le racisme ou encore les discriminations de genre, parfois les guerres les ont conduits à se déplacer, à se protéger, à s'isoler, voire à se cacher. Cette diversité d'obstacles appelle en retour autant de stratégies de protection et de contournements de la part des chercheurs et chercheuses. Cette collection Zones contraintes vous en livre les récits. Aujourd'hui, nous entendrons Rebecca Lemos Igreja. Elle est venue du Brésil, lauréate du programme Thémis de la FMSH. Ces soutiens que délivre la Fondation permettent de réunir, pour quelque temps au moins, les conditions d'une recherche paisible, d'obtenir un visa, de se loger ou encore de disposer d'un espace de travail et de tisser des liens avec de nouveaux collègues.
Peu avant les élections présidentielles de 2022 au Brésil, nous avons reçu l'anthropologue Rebecca Rebecca Lemos Igreja, professeur à l'université de Brasilia, pour qu'elle nous parle de la situation des universités dans son pays. Sans négliger aucune dimension de la crise qu'elles ont traversée, Rebecca Lemos Igreja remonte aux réformes de l'enseignement supérieur menées par Lula et, au-delà, aux sources historiques d'une situation politique marquée par la confrontation. De fait, nous explique-t-elle, les universités n'ont pas seulement vu leurs moyens réduits à peau de chagrin, mais se sont trouvées au cœur d'une véritable bataille idéologique. Cette bataille avait pour but de les expurger de l'influence d'un supposé marxisme culturel et d'instaurer un nouvel enseignement fondé sur des valeurs conservatrices au bénéfice d'une élite restreinte. Outre ces pressions financières et administratives, les instruments de cette tentative de révolution conservatrice ont été le soutien massif à l'enseignement évangéliste, la surveillance des professeurs, le dénigrement et l'incitation à la violence sur les réseaux sociaux, avec pour résultats l'autocensure, le renoncement à certaines recherches, la peur de parler librement devant les étudiants.
"Je m'appelle avec Rebecca Lemos Igreja. Je suis Brésilienne, anthropologue et professeure de l'université de Brasilia qui est le District fédéral, la capitale du pays. Je suis professeure de sciences sociales et de la faculté de droit. Je travaille entre les deux disciplines. Je suis aussi associée à la FLACSO, c'est la Faculté Latino-Américaine de Sciences Sociales qui est un organisme latino-américain créé il y a longtemps dans les années 50 par l'UNESCO et qui s'occupe d'établir des programmes de masters et doctorats dans tous les pays d'Amérique latine. Là-bas, je coordonne un programme qui est un collège d'études globales où on discute de plusieurs thématiques en relation aux questions actuelles qui sont plus prégnantes, importantes aujourd'hui. En ce moment, je suis ici aussi à Paris invitée des programmes de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Comme je l'ai dit, j'ai deux volets dans la faculté de droit et sciences sociales, mais ici, ils sont très connectés parce que mon intérêt est surtout de discuter du rôle des pouvoirs judiciaires dans la démocratie. C'est hyper important pour savoir quel est le rôle, comment les pouvoirs judiciaires peuvent agir pour la protection de la démocratie. Surtout qu'en Amérique latine, on a vu le pouvoir judiciaire prendre beaucoup l'espace de la politique. La politique aujourd'hui, elle se joue pas mal à partir du pouvoir judiciaire. Je fais beaucoup de recherches à propos du pouvoir judiciaire en essayant de tracer les profils des juges et la propre structure du pouvoir judiciaire au Brésil. On fait beaucoup de recherches avec l'association des magistrats au Brésil. Et aussi, je fais des recherches sur l'inclusion des technologies dans les processus judiciaires. C’est-à-dire aujourd'hui, avec l'excuse des technicismes, en le disant comme ça, on applique toujours plus des technologies, des intelligences artificielles pour juger tous les procès et même toute l'automatisation du système de justice. Je fais des recherches à propos de ces sujets parce que ça m'intéresse comment toute cette modification du pouvoir judiciaire protège ou ne protège pas les droits humains, les droits des citoyens. Je suis anthropologue juridique, il faut en parler aussi. C'est pour ça que je m'intéresse à ces sujets. J'ai été formée en anthropologie légale. À part ça, je travaille beaucoup sur le racisme, les discriminations, des recherches sur le multiculturalisme des peuples indiens d'Amérique surtout au Mexique où j'ai vécu longtemps. Et les populations noires au Brésil où cela fait plus de 25 ans que je travaille sur les sujets de politiques publiques de discrimination positive spécialement et tous les changements constitutionnels en Amérique latine qui ont été faits pour la protection des Indiens et des Noirs, surtout. Mais ces derniers temps, j'ai commencé à travailler sur l'extrême droite. L'extrême droite au Brésil, elle apparaît avec une redéfinition, je trouve comme un peu partout dans le monde, une redéfinition identitaire très forte, en promettant une réforme culturelle et des valeurs dans le pays et dans la société brésilienne en discutant la propre définition de ceux qui sont brésiliens et ceux qui ne sont pas brésiliens. Ce gouvernement, il met en discussion la définition propre, et c'est très intéressant, des Indiens, des Noirs. Qui est un Indien ? Comment on définit un Indien ? Comment on définit un Noir ? Toute cette expérience de travail sur l'ethnicité, on l'a transférée pour travailler sur l'identification même de cette extrême droite, en essayant aussi de tracer le profil et de regarder comment elle s'identifie, comment elle se présente, quelles sont les valeurs qu'elle défend. On essaie, d'une façon très anthropologique quand même, de comprendre l'extrême droite par ses activités, sa quotidienneté, les ministères, les autorités, en essayant de tracer le fonctionnement même du gouvernement Bolsonaro. Pas pour critiquer, mais pour échapper parfois à des places très communes de discussions de populisme, d'autoritarisme, pour essayer d'aller un peu au-delà et d'approfondir dans la structure même du gouvernement. Ils travaillent finalement. Le projet du gouvernement, le budget, les choix des autorités, même l'organigramme, même les sites Internet des institutions. On cherche pas mal à partir de ces catégories des autorités pour construire ces profils de l'extrême droite brésilienne. Parce qu'on est étonnés, surpris et on ne s'attendait pas du tout à ça.
Il faut comprendre le scénario au Brésil. Les universités sont vraiment, on peut dire le plan du gouvernement parce qu'on dit beaucoup à propos de Bolsonaro : "Il est un peu idiot, fou", mais il faut bien comprendre qu'il est bien organisé. Il y a tout un plan. Il arrive avec la promesse de faire vraiment une révolution culturelle. Les universités — comme il le dit souvent et même les ministres — sont les représentantes de ce qu'il appelle le marxisme culturel. Il faut enlever la gauche de l'université, comme il le dit. Il faut remplacer l'université avec d'autres savoirs. Et là, joue aussi cette idée qu'il prône la religion. Bolsonaro, il prône les discours religieux. Et là, on va rentrer dans le terrain du négationnisme, du design intelligent comme il l'appelle, du créationnisme. Et ça joue beaucoup dans les discussions avec l'université, que l'université doit s'ouvrir à d'autres traditions de savoirs. Il utilise même ce nom en s'appropriant même le concept anthropologique. Il veut détruire les universités, comme on le dit souvent. Les structures d'universités au Brésil sont surtout des universités fédérales, plus de 60, qui sont maintenues directement par le ministère de l'Éducation brésilien. Nous sommes tous des profs embauchés directement à l'université, mais employés par le ministère de l'Éducation. On a une carrière nationale. Elles sont les meilleures universités du pays. Ce sont des universités publiques et fédérales. Mais il y a les universités qui sont d'État, comme l'État de São Paulo, l'État de Rio, qui sont maintenues directement par les gouvernements d'État. Les universités les plus connues du Brésil, sont celles de São Paulo et elles sont de l'État de São Paulo. Ce sont les plus fortes universités étatiques et à Rio aussi. Il y a encore un autre type d'université publique, c'est l'université municipale.
Plus de la majorité des productions académiques et des recherches au Brésil viennent des universités publiques. Il y a les universités privées et même confessionnelles comme la catholique. Il y en a deux ou trois qui sont vraiment de bonnes universités. Il y en a quelques-unes qui sont aussi protestantes, qui sont connues et qui sont des universités confessionnelles. Et après ça, il y a 10 000 universités qui sont des facultés privées très spécialisées un peu partout dans le Brésil. Ça, ce sont les structures qui sont contrôlées par le ministère de l'Éducation qui a deux agences, ça c'est très important, une agence publique nationale pour le financement de la recherche. Une autre qui finance aussi la recherche, mais qui contrôle tous les masters et les programmes des masters et doctorats dans le pays. C’est-à-dire la décision d'ouvrir, de fermer un master ou un doctorat, tout le financement des bourses, la production des professeurs, tout ça est contrôlé par la CAPS. La décision de maintenir ouvert ou fermé un programme, la décision d'approuver des créations de programmes est centralisée, même s'ils font partie d'universités privées. L'université au Brésil, elle est devenue quand même un centre d'attention parce que c'est là qu'on a vu un des grands changements que le gouvernement Lula a faits parce qu'il a doublé la quantité d'universités du pays. Il a plus que doublé la quantité d'élèves et de profs. Il a créé deux programmes gigantesques. Et plus que ça, il a créé un système de bourses aussi pour des élèves étudiant dans des universités privées. Avec ça, il a presque doublé la quantité d'étudiants universitaires dans le pays. C'est du jamais vu. Et en plus, on a établi dans le pays le système des quotas. C'est un système qui fait que 50 % des places des universités publiques doivent être pour les étudiants qui viennent de l'école publique. Parce qu'au Brésil, les écoles publiques, c'est le contraire des universités publiques. Ce ne sont pas de bonnes écoles. Normalement, les universités publiques sont occupées par des élèves qui viennent de l'école privée. Et ça, c'est une façon d'obliger les élèves de l'école publique à entrer à l'université. Parmi les 50 % des élèves de l'école publique, la moitié est réservée à des élèves noirs et indiens. Et tout ça, par rapport au pourcentage de la région d'où ils viennent. Il y a tout un calcul, mais ça a changé beaucoup l'image de l'université, la représentation des élèves dans l'université. Ça a augmenté la quantité d'élèves des couches sociales beaucoup plus pauvres et il y a plus de Noirs et d'Indiens dans les universités. Vraiment, ça a beaucoup élargi l'ambiance parce que c'était jusqu’à la licence. Aujourd'hui, on a des quotas même pour les masters et les doctorats. Ça a complètement changé l'univers de l'éducation. Et en plus, il y a aussi les quotas qui existent, ce sont des lois fédérales qui existent pour les concours publics. Tous les concours pour l'administration publique, ils doivent avoir 20 % de quotas pour les Noirs. Là, ça ne prend pas en compte le niveau social, c'est directement pour les Noirs. C’est-à-dire que les concours des professeurs des universités aussi doivent respecter les pourcentages pour les Noirs. Ça oblige aussi à changer la configuration des universités. Lorsque Bolsonaro est arrivé, sa première chose a été de se battre pour en finir avec les quotas. On touche à un moment très compliqué parce que les quotas étaient prévus de façon temporaire, 10 ans. C'est exactement cette année. Et puis, le ministre de l'Éducation de Bolsonaro a dit : "L'université, elle n'est pas pour les pauvres." Il dit ce genre des choses. Elle est faite pour l'élite. Ce qu'on voit dans les systèmes exprime une coupure sociale énorme, une dispute sociale, de maintenir une situation d'élite. On parle d'un pays qui a été toujours géré par des grandes oligarchies, surtout des grands propriétaires terriens, un pays avec un historique d'esclavage gigantesque. Ça, c'est super important. Et un pays qui n'est même pas comme d'autres pays d'Amérique latine. Même si le Brésil s'est beaucoup développé, d'autres pays d'Amérique latine comme le Mexique par exemple ont eu des révolutions. Ils ont eu des changements de pouvoir d'État. Nous, on a une élite qui est depuis la colonisation la même. Les grands changements sont venus ces derniers temps. On est un pays qui, plus qu'on ne l'imagine, est très conservateur par rapport aux valeurs, à la religion et en plus, avec la montée des évangéliques. Les évangéliques, ils ont aussi une structure éducationnelle qui grandit beaucoup. C'est un peu effrayant parce qu’ils ont beaucoup d'écoles. Il faut faire attention parce que les universités et les écoles publiques aussi, elles sont vraiment persécutées. Il y a tout un projet qui s'appelle l'école sans parti du gouvernement dont l'objet est de punir tous les profs d'écoles publiques ou d'universités qui pouvaient faire de l'idéologie ; ils voulaient interdire l'idéologie dans l'espace public. En plus, il y a toute une démarche pour faire approuver au Congrès national l'éducation domiciliaire qui est une demande des Églises et des écoles privées, parce qu'il y a ce côté réformateur, mais il y a un côté ultra néo-libéral. Donc le gouvernement a beaucoup de soutien des facultés privées au Brésil. C'est vraiment défendre cette idée de la religion, du droit qu'on étudie à partir de son univers religieux et nettoyer les universités de toute discussion gauchiste, comme ils disent.
On a vécu depuis quatre ans une baisse de 95 % de financement des universités publiques. C'est gigantesque. On est à bout de souffle. Il a essayé d'une façon plutôt violente de contrôler l'université, mais quand même, il y a une structure ancienne des associations et des hiérarchies des organisations des universités publiques au Brésil. Ce qu'il a essayé les dernières années, c'est vraiment d'enlever tout l'argent pour empêcher qu'elles fonctionnent. Il peut couper les budgets parce que par exemple, tout l'argent de l'université publique sort des comptes du gouvernement. Et tout le budget est centralisé et sort directement du ministère. Chaque année, il envoie au congrès national les budgets pour l'année suivante. Et là, il décide combien vont être dédiés à l'éducation. Bolsonaro a beaucoup de soutien au Congrès national. Le Congrès national aussi a été pris par les conservateurs. Il a géré tout ce qu'il appelle les budgets secrets au Brésil, qui sont de l'argent qui part directement aux députés et sénateurs. Et comme ça, on est bloqués. On n’a pas beaucoup de représentativité pour défendre les universités. Si on parle à propos de l'idéologie, du marxisme culturel, Bolsonaro, il a fait toute la propagande, la publicité lorsqu'il était en campagne lors des dernières élections en combattant l'idéologie du genre. Pour eux, tout ce qui arrive au Brésil avec les femmes, les homosexuel•le•s et toute cette ouverture. Ça, c'était fondamental pour son élection. Incroyable, mais toutes les fake news étaient gérées à cause de ça. Et en plus que l'université était un espace de diffusion de cette idéologie, mais aussi de la drogue et du communisme. C'est étonnant qu'on en soit venu à tout un débat sur "le communisme, le communisme, le communisme" alors que là, on est au milieu des élections au Brésil et c'est toujours ce qu'on doit répondre. Et que, nous, les profs, on ne sait absolument rien. Nous sommes des vagabonds. Nous sommes vraiment des drogués. Mais c'est très raffiné, la façon dont il le fait parce qu'il construit toujours cette idée de liberté, de démocratie dans sa tête. Et pour lui, c'est ça. La liberté, c'est pouvoir défendre le conservatisme. La liberté, c'est vraiment pouvoir décider de faire une éducation à partir de la religion contre la laïcité. Toutes ces attaques à l'université n'étaient pas seulement contre les sciences humaines, mais aussi aux sciences exactes. Parce que là, on est en train de gérer des situations et même des élèves à l'université qui croient vraiment au créationnisme. Ça nous a beaucoup épatés. Vraiment, ils font beaucoup de comparaisons avec ce qu'ils entendent à l'église et ce qu'on dit dans les cours. Moi-même, j'ai eu des élèves en sciences sociales qui disaient qu'ils avaient étudié à l'église à propos de la création. Soudain, on a vu la science se faire attaquer, un peu comme aux États-Unis. La pandémie nous a menés aussi à la discussion du négationnisme. Donc il y a toute une partie des sciences exactes et de la nature. Le Brésil a toute une tradition de production de vaccins, des institutions très fortes. Le négationnisme nous a beaucoup touchés à l'université dans tout ce qu'on fait. Même les structures de recherches du gouvernement des données sociales, même le recensement démographique. Il a voulu changer le recensement, enlever des questions, interférer dans le recensement. Il a même voulu se mêler des choix des questions pour les examens du bac brésilien. Il a essayé d'obliger que toutes les épreuves passent par la présidence de la République. Là, on a eu des soutiens du pouvoir judiciaire pour arrêter ça, parce qu'ils ont essayé de contrôler tous les examens des universités. Et bien sûr, en ce qui concerne les sciences humaines, des carrières comme la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, aucun financement. Surveillance des cours, de ce qu'on dit, des manifestations publiques. Il y a eu un prof qui a fait un cours sur l'impeachment, il a été surveillé.
Mais il a plusieurs manières de le faire. On peut être jugés par des procès administratifs en tant que fonctionnaires publics. Ils ont essayé plusieurs fois. Ils ont ouvert des procès contre des professeurs pour idéologisation dans des cours. Ils ont motivé des élèves pour enregistrer des cours et de dénoncer les profs qui étaient en train de faire ça. Ceux-là, ce sont de longs procès. Il y a eu des scandales énormes au Brésil à propos de ça. Même des persécutions qui étaient un peu continues dans les universités. Il y a une association qui a été créée même par des profs qui sont proches de l'extrême droite. Ils se sont appelés : les professeurs pour la liberté. C'est le nom de l'association. Ils sont très conservateurs. Ils défendent aussi le néolibéralisme, la privatisation de l'université.
Il y a une chose plus sophistiquée qui nous atteint beaucoup, qui nous fait peur, c'est que ce gouvernement travaille avec les réseaux sociaux. Il a le "cabinet de la haine" qui est très connu, qui est animé par les enfants de Bolsonaro. Ce cabinet s'occupe beaucoup des réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram. Et lorsqu'il y a une prof qui est très connue, qui travaille sur l'avortement, il commence par la détruire par les réseaux sociaux et ça dérape dans des menaces de mort très présentes. C'est aussi ce qui justifie un peu le silence en ce moment des profs parce que soudain tu peux être dans une discussion publique dans des journaux et il y a un niveau d'agression incroyable. Il motive le fait que la société nous attaque. C'est ça qu'il dit : "Il faut surveiller." Et c'est là qu'il dit aux gens même avec toute la politique d'armes : "Vous pouvez marcher armés. Vous pouvez aller voter armés." Il a incité la population à aller voter avec des armes. C'est la Cour suprême qui a interdit aux gens de porter des armes les jours d'élections. Et c'est pour ça qu'on est effrayés parce que finalement, on risque toujours de tomber dans ces mécanismes fous d'attaques sur les réseaux sociaux qui sont promus par la présidence de la République. On est surveillés par d'autres profs, par des élèves. Je trouve que c'est même différent de l'époque de la dictature, parce que les réseaux sociaux, c'est un outil énorme. Juste pour compléter. Moi qui fais de la recherche sur l'extrême droite, on a vraiment une ambiance toxique, il faut cacher pas mal de choses, on n'a pas de financement pour ça, impossible. Mais on essaie quand même… Bon, ça va être public, le podcast. Mais j'en profite pour rassembler les élèves et de façon cachée, je fais mes recherches à propos de l'extrême droite. Bien sûr qu'on ne peut pas interviewer les gens parce qu'on se cache. On ne veut pas être remarqués, diffusés. Il y a un contrôle et celui-ci, je l'ai même subi. Lorsqu'on participe à des organisations internationales, moi à FLACSO par exemple, ou des commissions, des comités de scientifiques, il y a une surveillance directe. Moi-même, j'ai été déjà investiguée par la présidence de la République, mon nom est connu, je le sais parce qu'ils ont appelé des gens que je connais pour avoir des renseignements sur moi. Ils surveillent en contrôlant toute cette participation qu'on peut avoir dans des commissions scientifiques, dans des institutions, dans des organismes. Il faut toujours jouer un peu la protection. On a un site Internet sur nos projets de recherche. Si vous regardez, c'est toujours un peu caché. Et surtout les élèves, ils y font beaucoup attention parce qu'ils cherchent du travail. On a eu pas mal d'élèves qui ont été appelés par la police de temps en temps. Des gens qui travaillent avec la population indienne, c'est impossible. Vous ne pouvez plus entrer dans une communauté indienne, travailler sur les Indiens contrôlés par les comités d'éthique sans avoir l'autorisation de la présidence. C’est-à-dire qu'on ne va pas demander parce qu'on sait qu'on n'aura pas l'autorisation. C'est de cette façon qu'on est vraiment surveillés et qu'on vit cette peur quotidienne. Même moi, je rentre dans mes cours, je fais un peu attention pour voir quel niveau de discours je peux avoir. On essaie quand même d'être en cachette et d'éviter l’exposition publique. C'est ça qu'il nous fait. C'est incroyable. Une exposition publique incroyable. Ils peuvent détruire un académicien, des professeurs publiquement. Comme on dit, ils vont déléguer la violence aux partisans qui se sentent légitimés de nous attaquer publiquement.
Au début, on a eu quand même des disputes violentes, même physiquement, des élèves qui se sont confrontés à d'autres élèves. Il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de soutien du mouvement "Brésil libre". Ce sont des jeunes d'extrême droite qui sont aussi des étudiants, donc on a peur. Il a aussi amené l'université à éviter des rassemblements des étudiants dans l'université dans des congrès, des séminaires. On a vécu ça dans notre université. Des élèves qui envahissent au milieu des séminaires ou des congrès pour créer toute la dispute, la confusion, la provocation, l'attaque physique. La pandémie nous a aidés lorsqu'on est partis en virtuel, donc on a pu. Mais en même temps, les risques étaient autres parce que là, ça devient public sur Internet. Physiquement, ça a diminué. L'université a demandé de faire attention, de ne pas enregistrer les cours. Mais on sait que les élèves peuvent enregistrer. On a eu des cas vraiment graves qui ont provoqué des démissions de professeurs. On a eu même un recteur d'une université qui a été persécuté par la justice et accusé faussement de corruption. Il ne l'a pas supporté, il s'est suicidé. Ce qui peut arriver à l'université, vendredi dernier, comme je l'ai dit, tout l'argent de l'université reste dans le même compte public. Bolsonaro a confisqué cet agent pour passer au Congrès. Tous les élèves sont sortis dans la rue parce que là, c'est fini, on ferme les universités privées. On est arrivé à ce point-là. On est dans un moment qui, sans exagération, si ce gouvernement continue, on ne sait pas quoi faire. D'abord, on est vraiment étonnés avec le fondamentalisme religieux qui a pris des proportions incroyables. On n'a plus de voix et d'espaces, et dans cette campagne, c'est toujours la même accusation envers les universités, envers les professeurs. On est vraiment inquiets parce qu'on ne sait pas. On a la légitimation vraiment d'une surveillance et d'un contrôle de la connaissance incroyable. On remplit tous les ans des fichiers gigantesques avec les programmes de chaque cours. On peut cacher une année, mais on ne le pourra plus. On a des ministres qui sont pasteurs, donc ils contrôlent l'éducation. Déjà, ça va être très difficile si Lula revient parce qu’il y aura un congrès national sur tout le Sénat très occupé par l'extrême droite.
La dernière chose que je peux dire, c'est que jusque-là, on a eu beaucoup de soutiens de la Cour suprême. Bolsonaro attaque la Cour suprême tous les jours. Mais c'est la Cour suprême qui a protégé même des professeurs qui étaient accusés, menacés parce que c'est constitutionnel, l'autonomie de l'université. C'est la Cour suprême qui a quand même rendu possible qu'on continue à travailler. C'est hyper important. Mais là, les vice-présidents et Bolsonaro ont confirmé et ils ont promis d'élargir les numéros des magistrats à la Cour suprême pour qu'ils puissent mettre des gens qui pensent comme eux. Et ça, c'est même une promesse de la campagne de Bolsonaro de changer la Cour suprême. C'est vraiment la dernière protection que l'on a. Il faut en finir avec la Cour suprême parce que la Cour suprême, elle défend la laïcité de l'État, les droits, les universités publiques, l'autonomie des universités. Même toute la vaccination au Brésil, la lutte contre la pandémie a été soutenue par la Cour suprême qui a libéré les vaccins. Vraiment, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, l'étude du pouvoir judiciaire au Brésil parce que c'est vrai que c'est un peu le gardien de la démocratie en ce moment. Il a déjà choisi deux ministres. Un ministre qui est assez évangéliste, très conservateur. Lorsqu'il a choisi le dernier ministre de la Cour suprême, il a dit qu'il voulait un ministre terriblement évangélique. Je n'aurais jamais pu l'imaginer à ce niveau, mais on peut dire que c'est vraiment une installation au pouvoir de l'Église."
Depuis cet enregistrement, Lula a été réélu président du Brésil. Il a succédé à Bolsonaro le 1ᵉʳ janvier 2023.
Depuis 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l'homme soutient et diffuse des connaissances en sciences humaines et sociales. Avec les voix de (Vlad Berindei) et (Emmanuelle Corne), ce podcast a été enregistré en octobre 2022 et publié en janvier 2023 dans la collection Zones contraintes.
Dans la même collection
-
La Russie, vue par Valérie Pozner
PoznerValérieLa Fondation Maison des sciences de l'homme soutient les milieux intellectuels évoluant dans des pays marqués par divers obstacles à la liberté académique. Pour ce faire, elle accompagne des
-
L'Éthiopie, vue par Abrham Meareg
Meareg AmareAbrhamLa Fondation Maison des sciences de l'homme soutient les milieux intellectuels évoluant dans des pays marqués par divers obstacles à la liberté académique.
Sur le même thème
-
Les Causeries de l'Égalité - L'égalité et le genre #7 - Femmes et discriminations
DucretMarie PatriciaDechepy-TellierJohanLes Causeries de l'Égalité - L'égalité et le genre #7 - Femmes et discriminations
-
Les mots de trop – Guide d’auto-défense pour étudiant·es en art
AlvèsAnaïsBaierlEstelleVelaSophieQue faire de nos colères face aux discriminations subies lorsque l’on est étudiant·es en art, alors même que l’on imaginait ce milieu plus ouvert qu’un autre, peut-être plus safe ?
-
Handicaps et travail : discriminations en raison du handicap dans l'emploi
DucretMarie PatriciaLefevreDidierDidier Lefevre - Causeries Handicaps - Handicaps et travail #2 - Discriminations en raison du handicap dans l'emploi
-
1. Jacques Rougerie et Paris
GribaudiMaurizioDemartiniAnne-EmmanuelleFureixEmmanuelAnne-Emmanuelle Demartini introduit la journée d'étude du 18 mars 2023 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, consacré au parcours de l'historien Jacques Rougerie. La première conférence de la
-
Adaptation to climate change: an introduction
SchipperE. Lisa F.Lisa Schipper, a professor at the University of Bonn (Germany), looks at adaptation to climate change in this video.
-
An Interview with Ta-Nehisi Coates, S. Gadet and A. Celestine
GadetSteveCoatesTa-NehisiCélestineAudreyAn Interview with Ta-Nehisi Coates, S. Gadet & A. Celestine
-
Feeling British: An Interview with Zita Holbourne
LefrançoisFrédéricHolbourneZitaFeeling British: An Interview with Zita Holbourne
-
Table ronde 2/ Le post-capitalisme sera féministe, antiraciste et écologique
VergèsFrançoiseDans le cadre de ses 60 ans, la Fondation Maison des sciences de l'homme organise le colloque international "Capitalisme, anticapitalisme et sciences sociales engagées à l'échelle globale : autour de
-
L’adaptation au changement climatique : une introduction
SchipperE. Lisa F.Lisa Schipper, professeure à l’université de Bonn (Allemagne), s’intéresse dans cette vidéo à l’adaptation au changement climatique.
-
Alice walker : my life, my work, my struggles
LamraniSalimWalkerAliceLes causeries de l'égalité - Alice Walker
-
Eduquer contre le racisme partie 2
ThuramLilianLamraniSalimCauseries de l'égalité, racisme et discrimination 1 partie 2
-
Causeries égalité, racisme et discrimination 1 partie 1
ThuramLilianLamraniSalimCauseries de l'égalité, racisme et discrimination 1