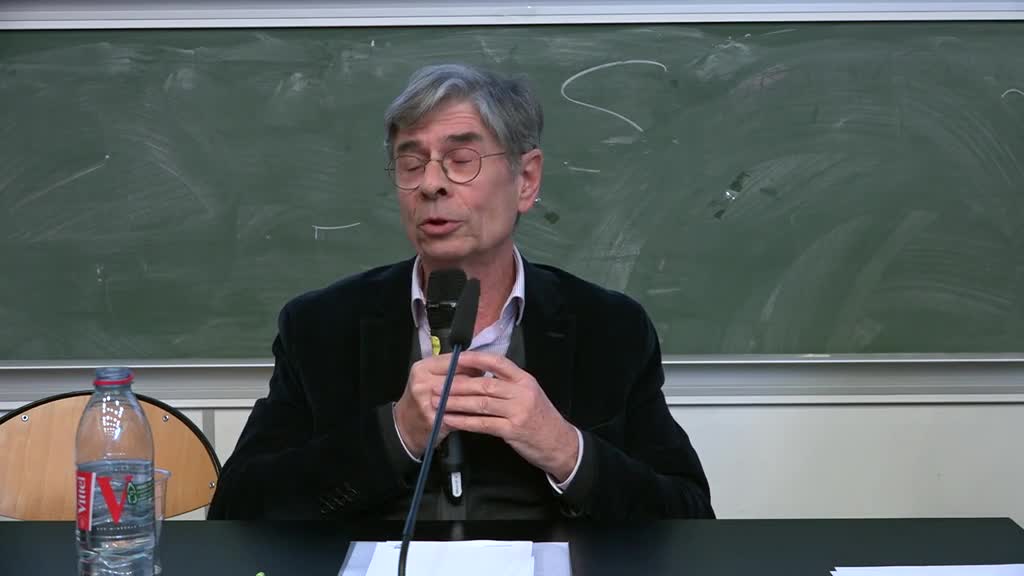Notice
La texture du présent : où en sommes-nous avec le présentisme ?
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
François Hartog
Directeur d'études EHESS
Le présent estnotre lieu et notre milieu. Il faut s’en distancier pour enappréhender la texture ; c’est la démarche même dessciences sociales, comprendre plus pour agir mieux. Nous en savonsbeaucoup sur les différents présents, et en savons de plus en plusavec le développement des big data. Cela risque d’accentuerl’éclatement. Nous appréhendons les détails, pas toujours lacomposition du tableau. L’historien propose des allers-retours avecle passé, par la comparaison. Présentisme, c’est une prise dedistance maximale par la comparaison de présents du passé avec lenôtre. Une nouvelle configuration où le présent a remplacé lefutur dans le premier rôle. Le futur éclairait le présent et lepassé, obligeant à accélérer vers un futur prometteur.Aujourd’ui, il est devenu impossible de croire que les progrèstechnologiques et humaines marchent du même pas, d’où une crisedu futur depuis les années 70. Le présent prend une placecroissante. Le présent devient à la mode et une injonction :travailler et vivre au présent, flexible, innovant. Les technologiesde l’information ont démultiplié l’exploitation du « tempsréel ». Le présent est devenu omniprésent, fabriquant encontinu le passé et le futur dont il avait besoin. Le futur commence« maintenant ». Ces décennies ont été aussi les années« mémoire ». La mémoire et le patrimoine deviennentdeux figures du discours politique et médiatique. Descommémorations, des politiques mémorielles se mettent en place,débouchant sur des lois mémorielles. La mémoire est une extensiondu présent au passé, le plus souvent douloureux, caché ou oublié.Les musées de la mémoire proclament : ne pas oublier pour nepas recommencer. L’Histoire en revanche, ouvrait vers le futur,téléologique, ce faisant du côté des vainqueurs, la mémoiredevenant l’arme des oubliés et des victimes. Diagnostiquer leprésent : il y a des présentismes, celui qui est choisi, deceux qui sont connectés, agiles, et celui qui est subi, de ceux quine peuvent se projeter, dans la précarité. Le plus démuni est lemigrant, enfermé dans le présent sans fin de la migration. Destemporalités trop désaccordées entre groupes sociaux sontporteuses de danger. La discordance des temps alimente puissamment leconflit social, nourrit des mouvements de refus, de colère, derepli.
Dans les appels àsortir du présentisme ou du court-thermisme, à rouvrir l’histoireet l’avenir, s’opère une prise de conscience que cette bulle, enphase avec l’économie globalisée du capitalisme financier, estporteuse de dangers. En régime présentiste, le temps historiqueporté par le futur, patine. Ce temps là n’a plus cours, dans lemonde du début du XXIe siècle. Une nouvelle conception del’histoire rétablissant la circulation entre les trois catégoriesdu passé, du présent et du futur, est nécessaire pour faire faceau présent et récupérer une capacité d’action. A l’accélérationet à l’urgence, on oppose le ralentissement, des modes de vie plussobres – des petites sécessions silencieuses, plutôtindividuelles, dont le nombre augmente, qui ne sont pas agies par lanostalgie du passé, mais par le souci du futur. Mais pour certains,le chemin le plus direct vers l’avenir est celui d’un passémythifié. Ces critiques du présentisme ont été renforcées par lesurgissement de la menace de l’anthropocène. Comme si un nouveauChronos venait faire éclater le présentisme. L’anthropocènemobilise la catastrophe, comme le présentisme, la catastrophe enmarche ou la catastrophe finale, la 6e extinction,l’effondrement, l’apocalypse. Le présentisme se trouve face àun « sombre abime du temps » (Buffon), mais est toujoursactif, la révolution numérique poursuivant sa progression. Un tempslong se dresse devant les individus vivant dans l’instantané.Certains essaient de donner un visage humain à la conditionnumérique. La nouvelle condition numérique est déchirée entredeux temporalités incommensurables. Est-il possible d’en faire unnouveau temps historique ? Double mouvement de mise à distance,observer le présent et s’efforcer de regarder la terre comme si onn’en était pas.
Thème
Dans la même collection
-
La Méditerranée est-elle, à nouveau, au cœur des enjeux du Monde ?
GrataloupChristianChristian Grataloup, Géohistorien, ancien professeur à l'Université Paris Diderot
-
L’interdisciplinarité au regard de deux passeurs de frontières disciplinaires : François Hartog et …
GrataloupChristianHartogFrançoisPratiqué l’interdisciplinarité sans même le savoir.
-
Introduction et présentation de l'Institut SoMuM « Sociétés en Mutation en Méditerranée »
RenaudetIsabelleMercierDelphineCrivelloMarylineMazzellaSylviePrésentation du nouvel Institut Somum par Maryline Crivello, vice-présidente du Conseil d'administration d'Aix-Marseille Université, historienne (TELEMME) Sylvie Mazzella, directrice de l
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
L’interdisciplinarité au regard de deux passeurs de frontières disciplinaires : François Hartog et …
GrataloupChristianHartogFrançoisPratiqué l’interdisciplinarité sans même le savoir.