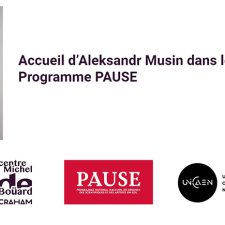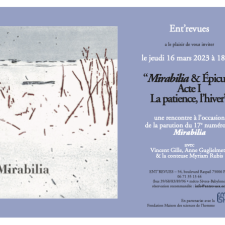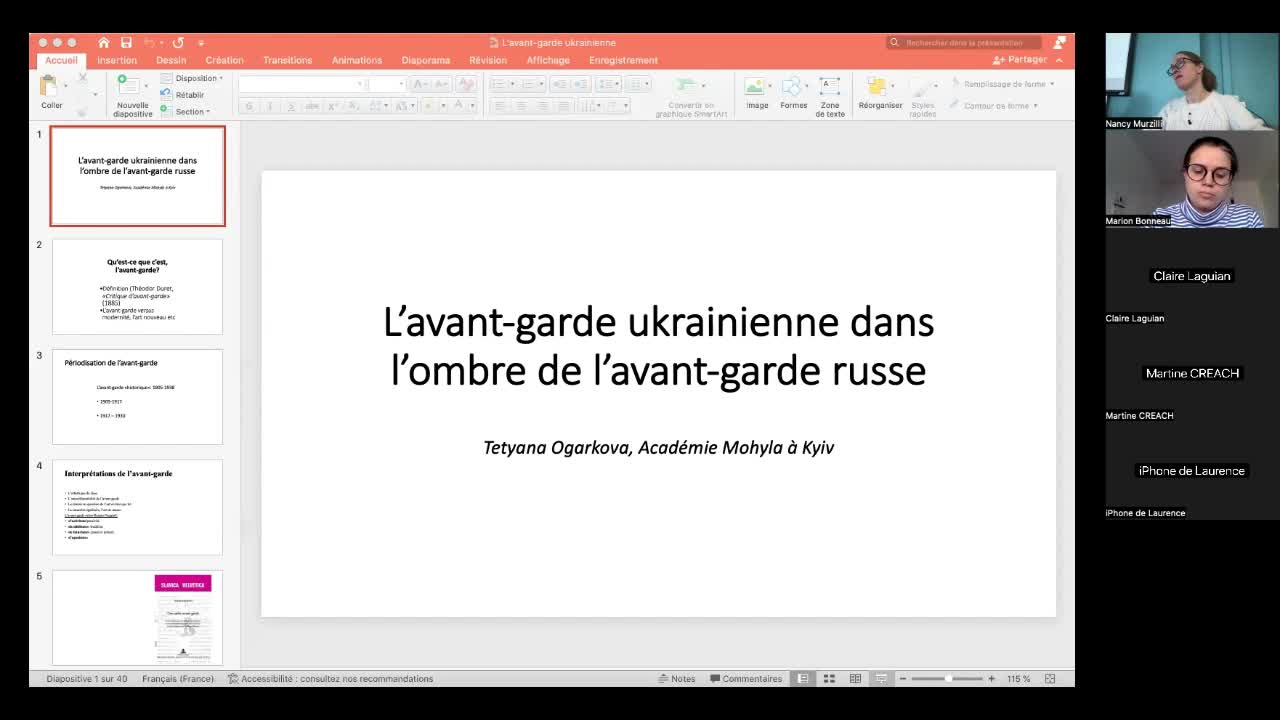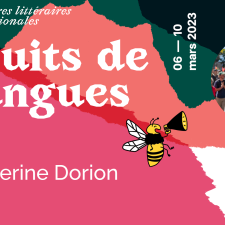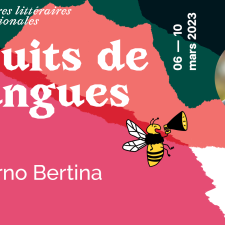Chapitres
- Lucia Carle05'26"
- Marco Revelli33'59"
Notice
FMSH
Présentation de la journée et intervention de Marco Revelli - Journée d'étude Nuto Revelli 1re partie
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Dans le cadre du programme de manifestations à Paris organisé par la Fondation Nuto Revelli à l'occasion du centenaire de Nuto Revelli, la FMSH accueille une journée d'étude autour de Nuto Revelli, écrivain italien du XXe siècle et l'une des figures majeures de la Résistance italienne pendant la Seconde Guerre mondiale.
1re partie :
Présentation de la journée par Lucia Carle
Marco Revelli : Nuto Revelli, l’Université et les professionnels de la recherche
Gérard Béaur : L'histoire de la famille depuis un demi-siècle. Une vue cavalière (en document joint)
Thème
Documentation
Communication de Gérard Béaur
Comme on me l’a conseillé ou concédé, je vais faire un pas de côté et me focaliser sur l’histoire de la famille telle qu’elle s’est développée dans l’historiographie française depuis un demi-siècle alors même que Neto Revelli poursuivait sa quête pour connaitre et comprendre les campagnes italiennes en phase d’exode rural accéléré, et pour en garder la mémoire à coups d’études et d’enquêtes orales.
A ce moment, en France, en parallèle, une foule d’historiens et plus largement de spécialistes des sciences sociales s’orientèrent vers les mêmes questions pour des raisons analogues : saisir la spécificité, je dirais l’étrangeté des sociétés rurales. Cette démarche s’inscrivait dans un courant de recherches anthropologiques et ethnographiques déclenchées au même moment dans les années 1960, qui s’appuyaient à fond sur l’enquête orale pour comprendre de l’intérieur le mode de fonctionnement de sociétés rurales en train de mourir et en recueillir les fonctions traditionnelles. Plozevet en Bretagne, L’Aubrac, Minot dans le Châtillonnais constituèrent autant de balises de cette intrusion fructueuse. La dernière de ces entreprises mérite de nous retenir davantage car dans son cheminement, elle mettait au premier plan les modes d’alliances et la parenté. C’est dans cette veine que se situa une autre enquête de ce genre entreprise un peu plus tard, dans un esprit quelque peu différent. Conduite par I. Chiva et J. Goy dans les Baronnies des Pyrénées, elle devait déboucher sur deux publications phares au début des années 1980 avant d’alimenter une intense coopération franco-québécoise. On peut dire qu’alors les historiens sortirent de l’histoire démographique si féconde jusque-là mais dans laquelle ils s’étaient enfermés pour se ruer sur la question centrale de la reproduction sociale et familiale et au-delà, plus largement, sur l’histoire de la famille en milieu rural.
Cet axe de recherches ne venait cependant pas de nulle part.
L’histoire de la famille a en effet un long passé mais elle ne devient un « objet » historique ou plutôt elle ne resurgit comme « lieu privilégié » d’observation et de compréhension des processus économiques et sociaux qu’à ce moment-là.
Avant ce virage, elle restait semble-t-il à l’arrière-plan de mutations historiques qui la dépassaient, étouffée par les succès du capitalisme et par le développement de l’Etat. Pour retrouver l’esprit de ce qu’était cette « nouvelle » histoire de la famille, il faut pourtant revenir aux travaux fondateurs de Le Play et des leplaysiens qui se focalisaient au 19e siècle sur le mode d’organisation familiale couplée avec les logiques résidentielles qui le rendaient possible, à l’abri d’un système de valeurs qui s’imposaient aux acteurs. On connaît l’opposition classique ainsi exaltée entre la famille souche qui conjugue tradition et stabilité, la famille patriarcale qui inspire des principes communautaires et autoritaires et pour finir la famille instable accablée de tous les maux qui instaure un individualisme destructeur.
Dans les années 60, Peter Laslett et le groupe de Cambridge érigèrent la composition des ménages à un moment donné en marqueur décisif pour comprendre les systèmes familiaux qui s’imposent dans les campagnes. C’est au même moment que parut un ouvrage modeste au succès surprenant qui permettait de glisser de l’observation des structures familiales aux principes qui régissaient la transmission des propriétés et les modes d’héritage des exploitations. L’ouvrage de Jean Yver publié en 1966 spatialisait de manière fine les coutumes qui fragmentaient le territoire français sous l’Ancien Régime et déclinaient à l’infini les règles qui présidaient aux successions dans les différentes régions. Il serait peut-être resté confidentiel comme un modèle d’érudition étourdissant si Emmanuel Le Roy Ladurie ne l’avait pas brandi comme étendard d’une opposition entre une France égalitaire et une France qui assumait une inégalité successorale intrinsèque validant ainsi d’une certaine façon les leçons de Le Play.
Pour notre propos, je me contenterais d’insister sur l’observation in situ d’un système à maisons impliquant un mode de transmission intégrale de la propriété tel que l’avait analysé Le Play un bon siècle plus tôt. L’impact de cette recherche fut à coup sûr considérable et suscita de nombreuses vocations.
Les nombreuses études de cas qui émergèrent alors eurent des répercussions prévisibles. Si l’assise juridique et le primat des valeurs intériorisées par les familles suffisaient à justifier et les modes de transmission du patrimoine et les principes résidentiels qui commandaient l’ordinaire des familles, il était fatal que l’on sorte de cette aporie et que l’on s’intéresse non plus à des normes abstraites mais à des pratiques concrètes, non plus à des recettes en surplomb mais à de véritables stratégies familiales.
De là la recherche encore inaboutie d’une géographie beaucoup plus complexe que l’on feignait de le croire jusqu’alors, comme l’a montré Anne Zink pour le sud-ouest. Une géographie bigarrée que l’on peut encore rêver de définir à partir de l’enquête que je mène à une époque un soupçon tardive, en 1810. De là aussi certaines révisions déchirantes.
L’opposition entre les zones de coutumes plus ou moins égalitaires et les zones de droit romain fondamentalement inégalitaires ne résista pas à l’analyse. Il existait des coutumes dans les zones méridionales, plus ou moins empreintes de droit romain et elles étaient généralement tout aussi inégalitaires. Le droit romain n’expliquait donc pas tout. D’un autre côté, il n’était pas aussi simple de décréter que le droit romain exigeait l’inégalité. En vérité, les parents ou le père arbitraient comme ils le voulaient et étaient parfaitement en mesure d’instaurer une égalité entre les héritiers, ne serait-ce qu’en ne faisant rien puisqu’en l’absence de désignation d’héritier par contrat de mariage ou par testament, l’égalité prévalait.
D’un autre côté, on s’apercevait qu’un peu partout, les familles faisaient des choix hétérodoxes. En un même lieu, certaines familles partageaient et d’autres pas, même si une tendance majoritaire s’affirmait généralement. Le travail de Tiphaine Barthelemy révélait que certaines familles perpétuaient une tradition d’égalité alors que d’autres s’acharnaient de génération en génération à privilégier un héritier. C’est donc que c’est au sein des familles que s’incarnaient les choix successoraux selon les priorités qu’elles adoptaient. Il fut donc opportun de rappeler que ces priorités étaient au nombre de 3 et qu’il fallait les concilier au mieux, à savoir : préserver la viabilité de l’exploitation, accorder une chance équivalente aux enfants, assurer les vieux jours des parents et notamment de la future veuve. A ce jeu, les familles devaient faire des concessions.
Il n’y avait donc jamais d’unanimité dans les stratégies successorales. Bien au contraire. On trouvait toujours des francs-tireurs qui s’affranchissaient avec désinvolture de la pratique coutumière majoritaire de leur région. Il n’en reste pas moins que des priorités et des normes imposaient leur marque sur le système de reproduction familial et dessinaient grossièrement cette géographie revendiquée par les historiens.
Il est apparu que dans les zones dites inégalitaires, c’est la conservation d’une unité d’exploitation viable et le maintien d’une structure foncière stable ainsi que le maintien de l’autorité parentale qui primaient sur le sort des enfants et particulièrement des non héritiers. A l’inverse, dans les zones égalitaires, l’égalité importait avant toute autre considération, quitte à laisser le patrimoine s’émietter et à priver les parents de toute initiative, leur laissant des conditions de survie aléatoires. Ce sont donc des stratégies différentes qui imposaient les règles du jeu.
Dans ces conditions, dans la continuité des positions leplaysiennes, les familles férues d’égalité témoignaient d’un manque de rationalité déconcertant. Etait-il bien raisonnable de fragmenter les propriétés à l’infini, en conduisant ainsi les générations successives vers une prolétarisation sans limites, tandis que les familles rétives au partage maintenaient le bien être des générations futures ?
Ce contraste était d’autant mieux préservé que les études de qualité pullulaient dans les zones inégalitaires, souvent de montagnes au demeurant, tandis que les zones égalitaires étaient très largement délaissées, au point qu’on finissait par penser qu’elles n’étaient que des zones marginales et que la France tout entière était acquise au modèle pyrénéen. Il est exact que le morcellement incessant des propriétés finissait par défier l’imagination et obligeait à des gymnastiques compliquées puisque les propriétés n’étaient jamais les mêmes alors que la conservation des structures foncières dans les sociétés méridionales avaient quelque chose de rassurant et de reposant.
La remise en cause a été lente. Il a fallu du temps pour admettre que les partages n’étaient pas l’aboutissement d’un processus successoral mais une étape obligée dans un parcours complexe. Ils étaient fréquemment précédés d’une avance d’hoirie au moment du mariage des enfants qui n’avaient pas besoin d’attendre un passage de témoin plus ou moins tardif pour prendre leur envol. Ils étaient surtout suivis d’une sorte de mouvement brownien par lequel les héritiers échangeaient, vendaient et achetaient des parcelles, pas seulement entre eux mais en s’adressant aux autres familles. La frénésie du marché foncier était la résultante de cet engouement. Chacun nourrissait ainsi l’espoir de reconstituer au mieux une nouvelle exploitation plus conforme aux besoins de la famille que celle dont il avait été le bénéficiaire. Il le pouvait d’autant plus que le système égalitaire n’était pas aussi impitoyable aux filles que le système de transmission intégrale à un héritier, à coup sûr un fils, sauf en pays basque comme l’a montré Marie-Pierre Arrizabalaga ou sauf en l’absence d’héritier mâle. Elles apportaient aussi une portion d’héritage en terre ou le plus souvent en argent qui se cumulait ainsi avec celle du mari.
Cette nouvelle exploitation n’était dans les faits ni tout à fait une autre ni tout à fait la même que celle de la génération précédente. L’un d’eux, voire plusieurs d’entre eux, parvenaient ainsi par touches successives à arrondir le patrimoine, les autres étaient en effet plus ou moins prolétarisés. Se réalisait ainsi une fluidité du système de production accentuée par la pratique du fermage. Car, en effet, les biens-fonds hérités ne représentaient pas, loin de là, l’essentiel de l’exploitation. Les familles, ici, prenaient assez systématiquement des terres en fermage et celles-ci finissaient par représenter pour les grands fermiers une part écrasante des terres qu’ils mettaient en cultures. Cette combinaison explique la plasticité des exploitations en zone égalitaire opposée à la pseudo rigidité de celles qui dominaient le système agraire dans les zones inégalitaires.
Cette différence fondamentale explique que le rapport à la terre tel que le concevait Bernard Derouet était tout sauf identique et à son tour il permet de mieux comprendre les comportements successoraux divergents des sociétés paysannes. Dans les zones de partage inégalitaire dominait le faire-valoir direct, dans les zones de partage égalitaire le fermage jouait un rôle essentiel. A la limite, dans les premières il n’y avait pas ou peu de marge de manœuvre pour compléter ce qu’on possédait, dans les secondes une autre partie était en cours à travers le marché de la location. Ainsi, paradoxalement, le modèle chayanovien, si prégnant dans les études sur les familles et exploitations paysannes, ne s’appliquait guère où l’on l’attendait. Si l’étendue de l’exploitation s’ajustait en permanence à la composition du noyau familial et à la disponibilité en force de travail que ce dernier octroyait, c’est bien dans les régions de partage égalitaire avec l’appoint du fermage, scandé par les modulations du cycle de vie.
Pourtant cette opposition binaire est-elle pleinement opératoire ? Est-il bien certain que les exploitations subsistaient intangibles au fil des générations là où le patrimoine se transmettait intact de père en fils ? Faut-il penser qu’il n’était jamais dispersé et même écorné d’une génération à l’autre et jamais agrandi par les processus d’accumulation de terres inhérents aux systèmes égalitaires ? En principe, un héritier n’épousait jamais une héritière pour le cas où il parviendrait à en détecter une qui serait passé à travers les mailles de l’impitoyable filtre successoral. Dans ces conditions, il n’y aurait ni concentration foncière, ni marché foncier et les exploitations devraient subsister intacte au fil des siècles. C’est bien là l’esprit du modèle et l’idéal poursuivi par les familles. Pourtant Marc Conesa a établi récemment que ce système dit à maison n’était pas aussi efficace qu’on le pense communément. Il ne parvient à retrouver les mêmes familles sur les mêmes exploitations sur une durée suffisamment longue.
C’est donc qu’il y a une part de mythe et de « ratés » dans ce mode de dévolution des patrimoines paysans. Il n’est pas juste de dire que l’héritier élu emportait tout et les autres rien. Pour les évacuer de la succession, les exclus recevaient en principe une dot, une légitime, très loin de leur part d’héritage, plus ou moins arbitrairement défini par les parents mais qu’ils ne pouvaient réduire à une portion ridicule. Elle était forcément en argent et pas en terres, donc elle n’aurait su générer le démembrement du foncier mais elle nécessitait des liquidités dont les parents étaient censés disposer. Bien souvent, ce n’était pas le cas et les dots n’étaient pas versées ou ne l’étaient pas intégralement et elles entraînaient un endettement plus ou moins long, à la charge des parents ou de l’héritier qui n’en pouvait mais. A défaut, il fallait souscrire un emprunt auprès d’un créancier extérieur.
De toute façon, les dots pesaient sur l’exploitation. Il n’était pas rare qu’elles ne soient jamais acquittées ou mal acquittées. Mais il était encore moins rare que pour s’en défaire ou y parer, les familles consentent une cession de biens en paiement de droits ou de légitimes. Les cadets et cadettes ne se privaient pas de réclamer leur dû, en particulier les héritiers d’une autre maison qui avaient épousé une cadette comme il était de règle. Ces cessions pullulent dans les minutiers notariaux. Ce n’était pas la seule occasion de s’endetter, les aléas de l’existence, les charges de familles excessives engendraient mille occasions d’être contraints de se défaire de parcelles voire de l’ensemble de l’exploitation. La stabilité revendiquée n’était donc pas une règle intangible et le crédit aussi bien que le marché foncier auxquels on n’a pendant longtemps prêté qu’une attention discrète à la différence de ce qui est courant dans les sociétés septentrionales, servaient ici aussi d’amortisseur pour les processus de transmission.
On comprend que le sort des exclus fut crucial pour les familles. L’idéal, c’était qu’une cadette épouse un héritier ou à l’extrême rigueur qu’un cadet épouse une héritière. Bien mieux qu’un mariage croisé ou un réenchaînement d’alliances permettent d’envisager un clearing et une compensation qui annule la dette. Restaient à régler le sort des exclus auxquels on s’est peu attaché pendant longtemps. En pratique une cadette ne devait pas épouser un cadet, donc le meilleur sort qui pouvait être réservé à l’un et à l’autre était de rester célibataires et conservés comme domestiques sur l’exploitation de leur frère. S’ils s’affranchissaient de cette obligation, ils risquaient bien de mener une existence difficile, pourvus de leur maigre dot, si tant est qu’elle leur fût versée. A défaut, partir. L’exclusion alimentait ainsi l’émigration ou à tout le moins la sortie de l’agriculture pour se reconvertir dans l’artisanat, le commerce ou autre chose.
Cette émigration parfois proche vers la ville ou plus lointaine a été à l’origine de parcours atypiques et inattendus, professionnels et géographiques. Ils se conjuguaient avec les migrations temporaires des cadets mais surtout des héritiers vers la région parisienne ou vers l’Espagne telles qu’elles sont relatées par Rose Duroux, destinées à accumuler un pécule pour trouver des ressources supplémentaires et souvent pour arrondir le patrimoine, à rebours de l’idéal de stabilité revendiqué.
Ce modèle aurait volé en éclat avec la révolution et le Code civil. C’est bien ainsi que Le Play et beaucoup d’autres avec lui voyaient les choses et cette conception perdure encore durablement dans les jugements péremptoires qui résistent encore à une dure réalité. Le code civil ne changea pas grand-chose. D’une part, il s’agissait d’un « compromis génial » comme disait Joseph Goy.
Dans les régions de coutumes égalitaires, par définition on partageait déjà mais dans les régions d’inégalité, le Code concédait des possibilités d’avantager l’un ou l’autre des héritiers en jouant sur la quotité disponible, cette part dont les parents conservaient la libre disposition en dehors de ce qui revenait de droit aux autres héritiers réservataires. Naturellement il se trouva des cadets opiniâtres pour revendiquer leur part comme l’a montré Antoinette Fauve-Chamoux mais Marie-Pierre Arrizabalaga ou Christine Lacanette-Pommel ont permis d’observer les parades imaginées par les familles pour échapper aux affres de l’égalité : sous-estimation des biens, ventes fictives etc… Tant et si bien que le système antérieur a perduré malgré le Code civil ou grâce à lui, au point que l’enquête auprès des notaires réalisée par Pierre Lamaison en 1988 a révélé que si lesdits notaires affirmaient heureusement qu’ils appliquaient le Code, la cartographie des pratiques d’héritage censées avantager ou non un héritier répliquaient assez exactement ce que l’on savait des modes de dévolution d’Ancien Régime.
Cette permanence transparaît à peu près partout avec quelques rares exceptions, au premier chef la Normandie. Fabrice Boudjaaba a montré que dans une région où la coutume réservait jusque-là l’héritage aux seuls garçons, selon un principe lignager, quasiment instantanément, les Normands basculèrent dans un système résolument égalitaire entre garçons et filles. Si les Normands continuèrent à signer des contrats de mariage, ce n’était pas pour doter les filles mais pour protéger au maximum les femmes mariées en cas de veuvage par toutes sortes de clauses appropriées : préciput etc… , destinées à remplacer le douaire dont elles bénéficiaient auparavant. En cela ils ne faisaient que prolonger les habitudes prises sous l’Ancien Régime qui impliquaient déjà au moins au 18e siècle qu’un arsenal de donations mutuelles en cas de mort n’assure la protection des veuves. L’égalité était déjà dans les esprits si ce n’est dans la lettre. Le Code ne faisait que formaliser ce qui était en gestation.
Si la question de la reproduction familiale a occupé tant de place dans les priorités des historiens, il s’en faut de beaucoup qu’elle ait détenu et surtout qu’elle détienne encore un quelconque monopole. On a vu qu’elle touchait à bien d’autres aspects puisqu’elle en active également bien d’autres : le crédit, le marché de la terre, les modes d’exploitation, les cycles de vie, la démographie ou les migrations. Je voudrais terminer par un versant qu’on néglige souvent, c’est que les familles travaillent, épargnent, accumulent pas seulement pour assurer leur conservation mais pour transmettre. A cet égard, la révolution de la consommation qui serait intervenue au 18e siècle qui se manifeste par une prolifération des objets et une amélioration des conditions de confort dans les intérieurs paysans atteste d’une forte progression du niveau de vie et joue un rôle clé dans ce processus de transmission qui implique aussi bien des meubles que des immeubles.
A quoi faut-il attribuer cette consumer revolution qui perdure jusqu’à aujourd’hui dans notre société de consommation ? A une révolution industrieuse, autrement dit à une intensification du travail qui se traduit par une augmentation de l’effort productif mais aussi par la mobilisation inopinée des femmes et des enfants nées précisément du désir de consommer? J’ai exprimé des doutes sur ce point pour plusieurs raisons dont l’une est qu’il est surprenant que cette soif de consommation soit apparue si soudainement, précisément au moment où la situation économique s’améliore. Pour une autre raison, également. C’est que nous n’avons aucun argument pour plaider que les femmes ne faisaient rien avant le 18e siècle. Bien au contraire, je plaide qu’elles sont pleinement intégrées dans le cycle productif depuis toujours et donc dans le processus de transmission.
C’est donc bien davantage la répartition des tâches et du travail à l’intérieur du couple qui doit retenir notre attention et encore le travail des ouvrières migrantes investies dans des activités agricoles sur des grandes exploitations. Au-delà, il faut sans doute relativiser l’image pas totalement fausse mais sans doute exagérée de la position subordonnée de la femme dans la famille. Les paysans normands ne mobilisent-ils pas tout l’arsenal des dispositions notariales pour protéger leur future veuve au moment du mariage ? Les femmes des maçons creusois n’assumaient-elles pas la direction de l’exploitation et la gestion des deniers du ménage en l’absence de leurs époux migrants ?
Dans la même collection
-
Intervention d'Eric Vial et Antonio Bechelloni - Journée d'étude Nuto Revelli 6e partie
VialÉricBechelloniAntonioDans le cadre du programme de manifestations à Paris organisé par la Fondation Nuto Revelli à l'occasion du centenaire de Nuto Revelli, la FMSH accueille une journée d'étude autour de Nuto Revelli,
-
Intervention de Alessandro Martini et Maurice Aymard - Journée d'étude Nuto Revelli 5e partie
MartiniAlessandroAymardMauriceDans le cadre du programme de manifestations à Paris organisé par la Fondation Nuto Revelli à l'occasion du centenaire de Nuto Revelli, la FMSH accueille une journée d'étude autour de Nuto Revelli,
-
Intervention de Marco Revelli - Journée d'étude Nuto Revelli 4e partie
RevelliMarcoDans le cadre du programme de manifestations à Paris organisé par la Fondation Nuto Revelli à l'occasion du centenaire de Nuto Revelli, la FMSH accueille une journée d'étude autour de Nuto Revelli,
-
Intervention de Hessam Khorasani - Journée d'étude Nuto Revelli matin 3e partie
Khorasani ZadehHessamDans le cadre du programme de manifestations à Paris organisé par la Fondation Nuto Revelli à l'occasion du centenaire de Nuto Revelli, la FMSH accueille une journée d'étude autour de Nuto Revelli,
-
Intervention de Lucia Carle - Journée d'étude Nuto Revelli matin 2e partie
CarleLuciaDans le cadre du programme de manifestations à Paris organisé par la Fondation Nuto Revelli à l'occasion du centenaire de Nuto Revelli, la FMSH accueille une journée d'étude autour de Nuto Revelli,
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
Intervention de Marco Revelli - Journée d'étude Nuto Revelli 4e partie
RevelliMarcoDans le cadre du programme de manifestations à Paris organisé par la Fondation Nuto Revelli à l'occasion du centenaire de Nuto Revelli, la FMSH accueille une journée d'étude autour de Nuto Revelli,
-
Intervention de Lucia Carle - Journée d'étude Nuto Revelli matin 2e partie
CarleLuciaDans le cadre du programme de manifestations à Paris organisé par la Fondation Nuto Revelli à l'occasion du centenaire de Nuto Revelli, la FMSH accueille une journée d'étude autour de Nuto Revelli,
-
Conclusion
RevelliMarcoIncontro ricordo in occasione dell'ottantesimo anniversario della morte di Piero Gobetti, in ricordo del suo impegno antifascista e dell'esilio parigino. Organizzato dal Centro studi Piero Gobetti, la
Sur le même thème
-
Pio Turoni. Un anarchiste italien en exil en France
Fontanelli MorelFrançoisePio Turroni, anarchiste italien, a été contraint de quitter son pays par suite de l’installation du régime mussolinien. Réfugié en France, il va s’engager dans les mouvements anarchistes et
-
France-Italie : Je t'aime moi non plus. Réflexions historiques et politologiques
LazarMarcCette conférence analyse la complexité des relations franco-italiennes en se concentrant sur la période qui court de 1945 à nos jours
-
Histoire de vie à l’âge du cuivre en Italie. Questionner le rôle des enfants dans la vie quotidien…
BernardiniSara« Dedans / Dehors » « GlobalMed – La Méditerranée et le monde de la Préhistoire à nos jours. Approches interdisciplinaires et internationales » 2e rencontre du réseau GlobalMed Maison
-
Les fusillés du Pays d’Aix
MencheriniRobertL’historien Robert Mencherini d’Aix-Marseille Université s’est attaché à un travail de mémoire concernant ceux qui ont laissé leur vie à l’occasion de la répression et des combats qui se sont déroulés
-
Les potiers de Pompéi
CavassaLaëtitiaComme une véritable enquête policière, Laetitia Cavassa, ingénieure de recherche au CNRS, explique la campagne de fouille qu’elle a menée dans un atelier de 2012 à 2018 à Pompéi pour éclairer les
-
Immigration italienne en France (XIXe-XXe siècles)
MourlaneStéphaneLes Italiens occupent une place particulière dans les mouvements migratoires en France. La frontière commune, la pression démographique et les difficultés économiques en font le contingent le plus
-
Dans la guerre, la liberté ? Guerre et pensée politique en Italie à la fin du Moyen Âge
BaggioniLaurentLaurent Baggioni explore la manière dont la réflexion politique assimile l'expérience de la guerre dans l'Italie entre le milieu du XIVe et le début du XVIe siècle.
-
Interview d'Aleksandr Musin dans le cadre du Programme PAUSE
MusinAleksandr EvgenʹevičLe CRAHAM accueille depuis le début du mois de mars 2023 Aleksandr Musin, dans le cadre d'un programme d’accueil de chercheurs en exil piloté par le Collège de France. A. Musin présentera ses
-
Ent'revues : Soirée "Mirabilia"
GilleVincentGuglielmettiAnneRubisMyriamRencontre avec Vincent Gille, Anne Guglielmetti et la conteuse Myriam Rubis à l'occasion de la parution du 17e numéro de "Mirabilia".
-
Conférence de Tetyana Ogarkova : « L’avant-garde ukrainienne dans l’ombre de l’avant-garde russe »
OgarkovaTetyanaL’équipe FabLitt a eu le plaisir de recevoir, le 4 avril 2023, Tetyana Ogarkova (professeure à l’Académie Mohyla, professeure invitée du Département de Littérature française, francophone et comparée
-
Rencontre avec Catherine Dorion
Rencontre avec l'autrice, comédienne et militante politique du Quebec, Catherine Dorion
-
Rencontre avec Arno Bertina
BertinaArnoConsidérant que sa « langue natale, c’est le roman », Arno Bertina se construit autour d’un langage et d’une littérature variée, l’amenant à co-fonder le collectif d’écrivains autour de la revue et de