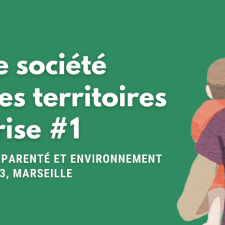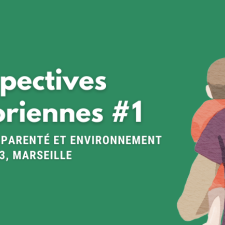Notice
Famille et travail dans les missions jésuites du Paraguay (XVIIe-XVIIIe siècles) et dans la communauté guarani mbya de Kokuere Guazú (XXIe siècle) : perspectives croisées
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Trois siècles séparent les missions jésuites du Paraguay des communautés indigènes guaranis qui occupent aujourd’hui le même espace. Longtemps pensées comme une utopie concrète par certains de leurs contemporains, mais aussi par des auteurs du XXe siècle, les missions participent d’un grand projet évangélisateur qui bouleverse les manières de vivre des populations locales. La sédentarisation implique le développement d’une agriculture pérenne, ainsi que l’exploitation du bétail, alors que les Guaranis pratiquaient jusqu’ici la chasse, la pêche, la cueillette et l’agriculture sur brûlis. Le projet missionnaire porte ainsi une réforme de l’espace, du temps, des techniques et de la production, mais aussi du modèle familial indigène. La famille élargie caractéristique de la chefferie, fondée sur la réciprocité et le partage, est remplacée par la famille nucléaire chrétienne qui découle des sacrements du mariage, et détermine l’organisation du travail. Cependant, les sources en espagnol, mais surtout en guarani, indiquent qu’au quotidien, les Indiens ne se conforment pas toujours au projet jésuite. Une série de malentendus traverse la communication entre les deux parties, animées par des modèles de rationalité différents, et qui s’actualisent dans toutes les institutions, notamment la famille et le travail. Or, notre expérience de terrain dans une communauté guarani contemporaine met en évidence la persistance de certains malentendus, entre l’État et les populations indigènes d’une part, entre ces dernières et l’anthropologue d’autre part. En croisant les documents d’archives, dont un manuscrit monolingue guarani, inédit et les données ethnographiques relatives à la famille et au travail, nous montrerons comment ces deux sociétés s’adaptent aux transformations environnementales et sociales. Nous montrerons également que l’étude du passé fournit des clés interprétatives pour comprendre ces transformations dans le présent, et inversement, puis mettrons en évidence des mécanismes de résistance et de collaboration communs aux deux époques afin de questionner les représentations parfois idéalisées de ces deux sociétés.
Thème
Dans la même collection
-
Devenir agriculteur biologique, à distance de sa famille
SamakMadlyneLe rôle déterminant de la distance sociale à la famille dans les parcours d’adhésion à l’agriculture biologique, à partir de données d'une enquête menée dans les Alpes-Maritimes.
-
Reconfiguration de la famille face à la crise environnementale où comment refuser la parentalité au…
Infécondité volontaire, modes de vie écologiques et autres manières de « faire famille » face à la crise environnementale. Une intervention de Mélanie Bania (GRESCO Limoges).
-
Désirer – ou non – un enfant comme forme d’égoïsme : un enjeu particulier dans le cadre des bouleve…
VialleManonCe que le désir et le non-désir d’enfant disent des normes et représentations de la famille et de la reproduction dans les sociétés européennes, dans le cadre particulier des enjeux environnementaux.
-
« Les petits sauvageons d’ici » : enfance et modes de vie ruraux alternatifs
AutardJeanAlors que les communautés néorurales post-1968 souhaitaient rompre avec la « famille bourgeoise », le mode de vie des alternatifs ruraux actuels s’organise largement autour d’unités familiales ou de
-
Des crises environnementales aux effets sur les maisonnées : stratégies de survie économique auprès…
GoudetJean-MarcA propos des stratégies familiales mises en oeuvre pour surmonter les effets des transformations environnementales au Bangladesh.
-
Familles monoparentales face à la précarité énergétique
CheveignéSuzanne deLa situation des familles monoparentales face à la précarité énergétique en France à partir d'une enquête de terrain menée auprès d’acteurs associatifs, associée à une analyse des données disponibles.
-
Faire familles dans des domiciles aux pieds d’argiles : continuités et changements face à l’adaptat…
NemozSophieUne enquête sur les logements fissurés par le retrait-gonflement terrains argileux en France interroge l'adaptation des familles aux changements climatiques.
-
Famille, genre et changements environnementaux au Burkina Faso
AttanéAnneQuand la régénération du couvert végétal influence les échanges intra-familiaux.
-
Rural families facing environmental degradation in Central Asia’s cotton oases: Soviet legacies and…
TrevisaniTommasoThe importance of past agricultural practices, kinship and family at a time of growing social disparities and environmental vulnerability in Central Asia’s irrigated cotton oases.
-
Les familles rurales de Jendouba face au Code forestier : un Léviathan
BouhdibaSofianeLes conséquences du Code forestier tunisien de 2017 sur la vie des familles forestières de Jendouba : un accès difficile aux ressources naturelles entraînant un exode rural et un désintéressement aux
-
La mangrove et la liberté : faire famille à Bahia (Nord-Est du Brésil)
CabralJoão de PinaPropriété de l’État brésilien, les vastes mangroves de Bahia sont occupées par les populations à bas revenus. Ces dernières années, on assiste à un appauvrissement systémique de ces populations et à
-
Développement économique, famille et environnement dans l’Occident latin au Moyen Age (IXe-XIIIe)
FellerLaurentLa transformation de l'environnement dans l'Occident médiéval, rendue possible par la mobilité de la population et l'évolution de la famille paysanne.