
Les Dominicains : prêcher en ville
Un ordre créé en France et qui a essaimé dans le monde entier
Le Frère Jacques Courcier réside au couvent Saint-Jacques à Paris 13e (ancien couvent des Jacobins, premier nom des Dominicains) depuis 1971, soit plus de 50 ans. Il nous propose un parcours varié, mêlant l'histoire des Dominicains (ordre créé à la fin du 12e siècle à Toulouse), son long parcours et sa propre place dans l'Ordre, et la place de celui-ci dans la société et la culture contemporaines.
L'Ordre aujourd'hui, ce sont plus de 6000 Frères (et 3000 moniales) dans le monde, dont un peu moins de 500 en France (300 de la Province de Paris, 170 de la Province de Toulouse — l'Ordre est organisé en Provinces).
(vidéo Jacques Courcier, durée 59 mn)
Origines de l'Ordre
L'Ordre dominicain est fondé à Toulouse par l'Espagnol Dominique de Guzman (v. 1170-1221) sous le nom d'Ordre des Frères Prêcheurs — à Toulouse, en terre où se développe le catharisme, car justement Dominique veut ramener ces cathares à la foi chrétienne traditionnelle.
Par ailleurs, et de manière plus essentielle, il voit sa mission en complément, sinon en opposition, à l'approche monacale des grands monastères qui régnai(en)t jusqu'alors : il s'agissait de prêcher en priorité dans les villes, avec des Frères instruits, éduqués eux-mêmes dans les universités naissantes des grandes villes européennes : Toulouse, Bologne, Paris, Cologne,...
Les Dominicains n'ont pas de terres (à la différence des grands ordres monastiques); ils font vœu de pauvreté, de mendicité.
Ci-contre, quelques dominicains 'historiques' cités : 1) Dominique de Guzman, le fondateur — tableau de Fra Angelico (v. 1390-1455), lui même dominicain ; 2) Giordano Bruno (1548-1600) ; 3) Henri Lacordaire (1802-1861), prédicateur du renouveau de l'Ordre (portrait par Théodore Chassériau, 1840 ; musée du Louvre). Puis 4) Un dominicain anonyme contemporain, en 2012 (WikiCommons auteur Bob100).




Les Dominicains et l'Inquisition
Dans l'imaginaire collectif, les Dominicains sont souvent associés à l'Inquisition, née en même temps. Sans évidemment défendre celle-ci, le frère Courcier rappelle que : 1) la notion d'inquisition était fondée sur une recherche de preuves, ce qui au départ était un progrès ; 2) si des Franciscains et Dominicains ont en effet présidé des tribunaux inquisitoriaux, ce fut bien après la mort de saint Dominique en 1221 ; 3) le dominicain Giordano Bruno (1548-1600) a lui-même été victime de l'Inquisition ; 4) les pages les plus noires de l'Inquisition se situent à la fin du 16e siècle et au début du 17e, période à laquelle les Dominicains s'en étaient éloignés de longue date.
Disparitions et renouveaux
L'Ordre, comme toutes les congrégations et corporations, est supprimé lors de la Révolution. Une anecdote amusante est que les radicaux, les Jacobins, doivent leur nom au fait qu'ils se réunissaient au couvent Saint-Jacques à Paris, qui lui-même avait donné son nom à l'Ordre (avant qu'il prenne le nom de dominicain): les Jacobins.
La Restauration ramène les ordres, et le frère Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861) participe du renouveau des Dominicains, entre traditionalisme et ouverture.
Selon l'intervenant, la Première Guerre mondiale joue le rôle d'un ciment dans la nation, y compris entre les religieux et le reste de la population. Tous sont dans les tranchées — rôle que joueront aussi les camps dans la Seconde Guerre mondiale. Ceci donnera naissance après 1945 au mouvement des prêtres-ouvriers, dans lequel les Dominicains ont un rôle moteur ; ce mouvement sera condamné par le pape Pie XII en 1954.
1) Fr. Marie-Dominique Chenu (1895-1990), un des moteurs du mouvement des prêtres ouvriers (archives Province de France) ; 2) Fr. Joseph Robert (1910-1991), prêtre-ouvrier (archives familiales, page Maitron); 3) revue dominicaine Economie et Humanisme, fondée en 1942 par le Fr. Louis-Joseph Lebret (1897-1966), numéro ancien, puis 3bis) numéro récent.


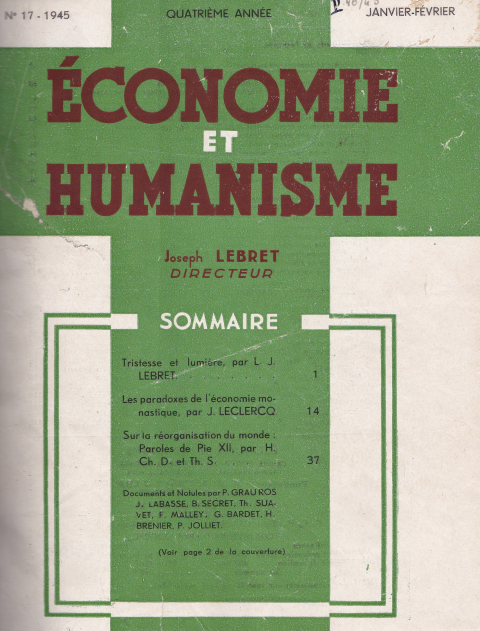
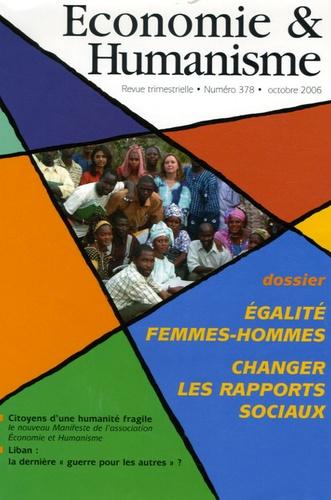
Action culturelle et intellectuelle
Prédication et recherche sont les deux activités des dominicains, qui passent volontiers pour des « intellectuels ».
L'Ordre a créé en 1949 l'émission catholique TV dominicale Le Jour du Seigneur et continue à l'animer ; comme il a créé en 1929 les éditions du Cerf, logées au couvent Saint-Jacques à Paris ; ou la revue L'Art sacré (1935-1969).
La vidéo se termine par des vues du couvent de Sainte-Marie de La Tourette à L'Arbresle (près de Lyon), construit à la fin des années 1950 par l'architecte Le Corbusier pour l'Ordre ; il est utilisé à présent comme lieu d'exposition d'artistes d'art sacré (Anish Kapoor, Geneviève Asse, Anselm Kiefer...) [ci-contre image WikiCommons Alexandre Norman]. Et par des vues de la chapelle dominicaine du Saint-Rosaire, ou chapelle Matisse à Vence (Alpes-Maritimes), bâtie par l'architecte Auguste Perret et décorée par le peintre Matisse, consacrée en 1951 [ci-contre image WikiCommons Axel Boldt].




Remerciements
Canal-U/cultureGnum remercie Michel Bourdeau, CNRS/IHPST, d'avoir eu l'idée de cette intervention et de l'avoir menée.
(texte et images ci-dessus en transcription sommaire par A. Moatti de la vidéo de J. Courcier)

