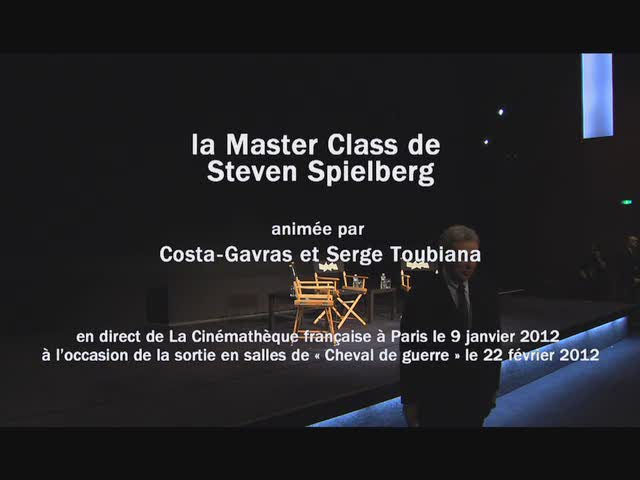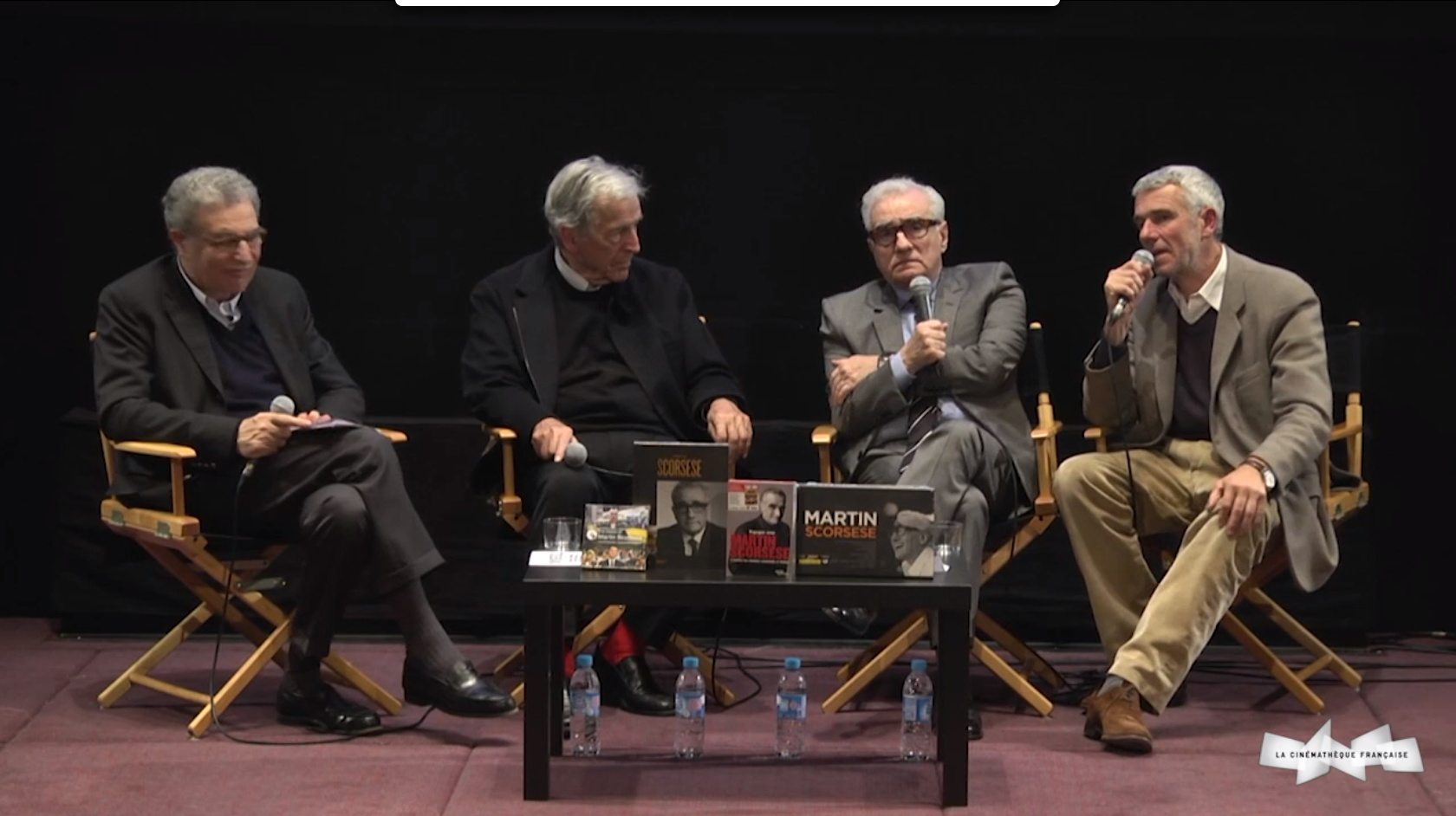Le 7ème art
Moteur, ça tourne
Ce film, s'appuyant sur les archives de la cinémathèque Gaumont, reconstitue l'évolution du cinématographe. En 1894, Louis Lumière imagine le principe de base du cinématographe qui sert tout à la fois d'enregistreur, de développeur et de diffuseur. Mais il envisage une machine qui, non seulement transcrit le mouvement de la vie mais aussi en communique les sons, les couleurs, le relief. Le Coq de Charles Pathé, la Marguerite de Léon Gaumont : voilà les deux symboles qui vont conduire le cinématographe du gadget à la grande industrie. Dès lors, les studios s'édifient et le cinématographe fait place à la copie standard, image et son optique, ainsi qu'à la flexibilité technologique d'un matériel allégé.
Pour la conquête du monde : anthropologie et cinema
"La conquête politique et scientifique du monde"
Naissance et développement du cinéma et de l'anthropologie à partir de la fin du XIXème siècle. Postures scientifiques d'exploration du monde (collecte, identification, appropriation) et d'instrumentalisation à l'origine de l'émergence d'un langage du cinéma. Une conception évolutionniste du monde.
Dès son départ, le cinéma tente de saisir ce qui est l’objet même de l’ethnologie : les pratiques de l’être humain dans les relations qu’il établit et qu’il énonce avec ses semblables et avec l’environnement qui le situe et dont il dispose. Cependant la prise organisée d’images vise également à percevoir sinon marquer les frontières qui distinguent l’humanité de la nature à laquelle cependant l’être humain appartient tout en ne sachant pas toujours la place qu’il y occupe. Identification et distinction, telles sont les opérations constamment à l’oeuvre et dont on peut espérer qu’aucune jamais ne prendra le pas sur l’autre, leur balancement garantissant une vraie dynamique d’existence, de découverte, d’invention, de réalisation, un espace d’exercice de ce qui serait la liberté.
La couleur au cinéma
Nous savons tous qu’il existe deux façons principales de définir la couleur :
- l’une, objective, qui la définit comme un phénomène produit physiquement ;
- l’autre, subjective, qui la définit comme un phénomène perçu par notre cerveau à partir des informations transmises par l’oeil.
Dans le premier cas, il s’agit d’analyser et de comprendre un ensemble mesurable de phénomènes physiques objectifs. Dans le second, il s’agit plutôt de décrire l’expérience psychosensorielle du spectateur qui perçoit et interprète les informations de couleurs qui l’environnent.
Le cinema de Kubrick, entre raison et passion
Un fil rouge relie les films de Kubrick qui sont autant d’avertissements en forme de fables : le rapport au coeur de chaque homme et dans la société entre une volonté de contrôle, l’affirmation de la raison et l’irruption de la passion, de la violence et du refoulé.
Historien et critique de cinéma, Michel Ciment est maître de conférences en civilisation américaine à l’université de Paris 7 et membre du comité de rédaction de Positif, collaborateur régulier du Masque et la Plume à France Inter et producteur de Projection privée à France Culture. Il est l’auteur, entre autres, de Kazan par Kazan (1973), Le Livre de Losey (1979) et de Kubrick (1980), premier ouvrage français sur le cinéaste.
L'histoire en chanté du cinema français
Dès qu'on lui a donné la parole (autour de 1929), le cinéma français s'est mis à chanter : adaptation d'opérettes, films-véhicules pour stars du music-hall, élaboration d'un étrange modèle de films chantants par René Clair. Jamais pourtant, la comédie musicale ne se constitue en genre. Seul Jacques Demy va en proposer sa très singulière formulation. Mais au même moment, de Varda à Godard, c'est toute la Nouvelle Vague qui place le format chanson au cœur même de son esthétique. Depuis, d'Eustache à Bozon, tout ce que le cinéma français comporte de plus créatif a aimé suspendre ses récits en chansons. Tendons l'oreille à ce que nous chante le cinéma français.
Master class
Master class de Steven Spielberg
La master class de Steven Spielberg, animée par Serge Toubiana, a eu lieu à la Cinémathèque française le 9 janvier 2012.
Scorsese par Scorsese : une leçon de cinéma
Leçon de cinéma de Martin Scorsese à la Cinémathèque française à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée. Rencontre animée par Serge Toubiana et Costa-Gavras.