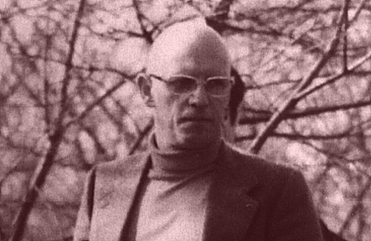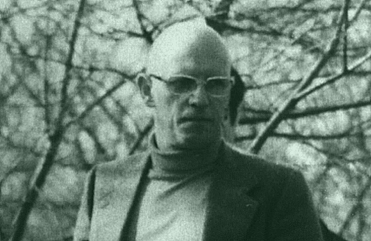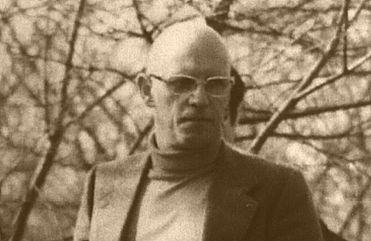Foucault, Michel (1926-1984)
Michel Foucault
A propos de Michel Foucault
Il y a eu plusieurs Michel Foucault : le critique de la littérature, l'archéologue des savoirs, le critique des pouvoirs, l'historien des plaisirs. De même le Foucault français n'a que peu à voir avec le Foucault américain et le professeur au Collège de France est bien loin du journaliste pétitionnaire qui s'est investi dans les actions du GIP au début des années 70.
Michel Foucault est revenu à de plusieurs reprises sur son autobiographie et en particulier sur la question de sa classification. Il signale par exemple qu'on l'a «
localisé tour à tour et parfois simultanément sur la plupart des cases de l'échiquier politique : on a fait de [lui]
un anarchiste, un gauchiste, un marxiste tapageur ou occulte, un nihiliste, un antimarxiste explicite ou secret, un technocrate au service du gaullisme, un néolibéral (1). »
La publication en 1994 des
Dits et Écrits, rassemblant 394 textes publiés par Michel Foucault sur près de trente ans, propose une nouvelle lecture de son oeuvre, même s'il a toujours été très critique envers ce terme. Ces quatre tomes des
Dits Écrits offre aux lecteurs l'image d'une oeuvre non pas figée mais au contraire toujours en train de se faire, par retours ou détours. Aujourd'hui la publication de ses cours au Collège de France, si elle accroît la masse documentaire disponible, montre aussi à quel point il se place encore et peut-être plus que jamais dans notre modernité: La norme, la mesure ou encore le processus de médicalisation qu'il a été l'un des premiers à problématiser sont des thèmes qui continuent à nous questionner aujourd'hui.
En ce qui concerne les sources biographiques sur Foucault, on peut dégager deux orientations générales. La première est explicitement biographique. Il s'agit des travaux biographiques (2) de David Macey et de James Miller, ses biographes américains, mais aussi des deux ouvrages que lui a consacrés Didier Eribon en France. Dans la même orientation biographique, mais à un autre niveau, la vie de Michel Foucault est présentée dans ce que l'on peut appeler des « semi-biographies » qui sont constituées par de très nombreux témoignages, comme ceux de Claude Mauriac (3) ou de Paul Veyne, pour citer les plus importants. Il est même possible d'obtenir des informations qui le concernent dans la littérature les « bio-fictions » d'Hervé Guibert (4) ou Femmes de Sollers, même si cette source littéraire reste sujette à caution.
La seconde orientation tente de fabriquer sur le travail de Foucault des périodisations, chronologique ou thématique. Le travail exemplaire de Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, intitulé
Michel Foucault un parcours philosophique, qui n'a pas d'équivalent en France, offre une périodisation de l'oeuvre de Foucault en quatre étapes : une étape heideggerienne, une étape archéologique ou quasi-structuraliste, une étape généalogique, une étape éthique. Le principal avantage est d'avoir compris que ces quatre étapes s'entremêlent, ce qui est par ailleurs très bien manifesté par la volonté sous-jacente d'élaborer le «
parcours » de Michel Foucault. Cependant l'inconvénient de ce genre de découpage est que cette partition ne fait pas la part de l'activité militante du philosophe ni de son adhésion au parti communiste. Le livre de Gilles Deleuze quant à lui, opère à partir d'une toute autre approche du travail de Foucault. Il s'agit pour Deleuze de déconstruire son travail pour tenter d'en faire comprendre la cohérence, en se coulant dans la démarche même de Foucault. Gilles Deleuze recompose le système autour de trois volets principaux ; «
le savoir », «
le pouvoir » et «
le soi ». Le seul véritable « défaut » de ce livre est qu'il présuppose une connaissance déjà poussée de ces thèmes de prédilection.
Notes
(1) Michel Foucault, « Polémique, politique et problématisation », in Dits et écrits, Tome IV, Numéro 342, pp. 591-598.
(2) David Macey, Michel Foucault, traduit de l'anglais par Pierre Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 1994. Didier Eribon, Michel Foucault 1926-1984, Paris, Flammarion, 1989. James Miller, La passion Michel Foucault, Paris, Plon, 1993.
(3) Claude Mauriac, Mauriac et fils, Tome IX du Temps immobile, Grasset, Paris, 1986.
(4) Hervé Guibert, A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Gallimard, Paris, 1990.
Biographie chronoligique
Pour faciliter l'approche, je ne proposerai pas en guise de biographie une reconstitution précise de son parcours, mais un découpage (avec ce que cela suppose d'arbitraire et implique comme manques), en six phases. Une bio-chronologie plus affinée est néanmoins disponible dans le tome I des
Dits et Écrits.
1.
Foucault est né à Poitiers en
1926 dans une famille de médecins. Après la guerre, il rentre en khâgne au lycée Henri IV et a comme enseignant de philosophie Jean Hyppolite. En
1946 il entre à l'École Normale Supérieure et devient l'élève de Louis Althusser. Il passe successivement en
1948, une licence de philosophie, en
1949 une licence de psychologie, en
1951 l'agrégation de philosophie et, en
1952, un diplôme de psycho-pathologie à l'Institut de Psychologie de Paris.
2.
De 1954 à 1963, Foucault développe des intérêts, pour la psychologie et son histoire. En
1954, il publie Maladie mentale et personnalité (PUF) ; en
1955, il devient lecteur de Français à l'Université d'Uppsala en Suède où il commence ses recherches pour une histoire de la folie. En
1960, il est élu maître de conférences de Psychologie à la Faculté des Lettres de Clermont Ferrand. C'est en
1961 qu'il publie sa thèse de doctorat ès lettres intitulée :
Histoire de la folie à l'âge classique ; enfin, en
1963, il publie simultanément
Naissance de la clinique : une archéologie du regard médical (PUF) et
Raymond Roussel (Gallimard).
3.
De 1963 à 1969, Foucault s'occupe plus particulièrement de littérature, en particulier dans des articles sur George Bataille (« Préface à la transgression » en
1963, in
Dits et Écrits, Tome I), Magritte (« Ceci n'est pas une pipe »,
1968, in
Dits et Écrits, tome I), Blanchot. Cependant, il inscrit de plus en plus ses recherches en épistémologie et en histoire de la philosophie avec, entre autres, en
1966, un ouvrage comme
Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, ouvrage qui le fera définitivement connaître du grand public. Mais il rédige aussi, en
1967, une
« Introduction aux uvres philosophiques complètes de F. Nietzsche », ou encore, en
1968,
« Sur l'archéologie des sciences. Réponse au Cercle d'épistémologie ». Il participe aussi, après les événements de mai, à la création du Centre universitaire expérimental de Vincennes en tant que responsable du département de philosophie. Et, en
1969, il publie
L'archéologie du savoir (Gallimard) qui le fera élire au Collège de France, à la chaire d'Histoire des systèmes de pensée.
4.
A partir de 1970 et jusqu'en 1976, son parcours prendra une orientation plus politique et militante. En
1970 parait la Leçon inaugurale au Collège de France publiée sous le titre :
L'Ordre du discours (Gallimard). Un an plus tard, en
1971, Foucault participe à la création du Groupe d'information sur les prisons (GIP) avec Jean-Marie Domenach et Pierre Vidal Naquet. Cette date marque le début de son engagement dans de nombreux combats comme la contre enquête sur « l'affaire Jaubert » ou encore sa prise de position à la création du « Comité Djellali » après l'assassinat d'un jeune Algérien dans le quartier de la Goutte d'or à Paris. En
1973, il publie un dossier collectif intitulé
Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère : un cas de parricide au XIXe siècle. Et, en
1975,
Surveiller et punir : naissance de la prison (Gallimard). A la même époque, il se rend en Espagne avec Yves Montand et d'autres personnalités pour protester contre l'exécution de onze militants de l'ETA et du FRAP. Ce qui lui vaudra, ainsi qu'aux autres, une expulsion, très médiatisée, hors d'Espagne.
5.
De 1976 à 1980, contrairement à l'idée reçue d'un passage à vide, puisque Foucault n'a fait paraître qu'un seul ouvrage en
1976,
La volonté de savoir, premier tome de son Histoire de la Sexualité qui, à l'origine, devait être composée de 6 volumes. Foucault a abandonné son programme et profité de ses voyages à l'étranger pour mettre à l'épreuve de nouveaux concepts opératoires, comme celui de biopolitique ou encore de gouvernementalité. En
1978, il édite
Herculine Barbin : Alexina B. Souvenirs d'une hermaphrodite au XIXe siècle (Gallimard) et couvre les événements politiques qui secouent l'Iran (départ du Shah) pour le quotidien italien
Corriere della Sera.
6.
De 1980 à sa mort le 25 juin 1984, Foucault alterne son travail de recherche à et des interventions humanitaires. En
1982, par exemple, avec Médecins du monde, il convoie des médicaments en Pologne et publie, avec l'historienne Arlette Farge, le
Désordre des familles qui analyse les lettres de cachets des archives de la Bastille (Gallimard). En
1984, il publie, quelques jours avant sa mort, les tomes II et III de son Histoire de la Sexualité, intitulés
L'usage des plaisirs et
Le souci de soi qui analysent la sexualité dans l'histoire gréco-romaine.
Vidéos
Michel Foucault et la sociologie (3) Entre résistance et actualité
L'oeuvre de Michel Foucault, autant scientifique que politique, a suscité et suscite encore aujourd'hui de nombreuses interprétations et critiques, mais aussi fascination et séduction. Foucault a
Michel Foucault et la sociologie (1) Lectures et usages de Michel Foucault
Le premier volet du programme "Foucault et la sociologie : un usage spécifique" consacré aux relations entre Michel Foucault et la sociologie revient sur la réception de ses ouvrages, en particulier
Michel Foucault et la sociologie (2) Problématiques sociologiques ?
Si la réception des ouvrages de Michel Foucault donne une première idée des relations que la sociologie a pu entretenir avec Foucault, il s'agit de montrer - dans ce second volet du programme