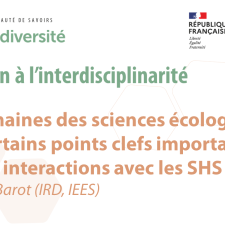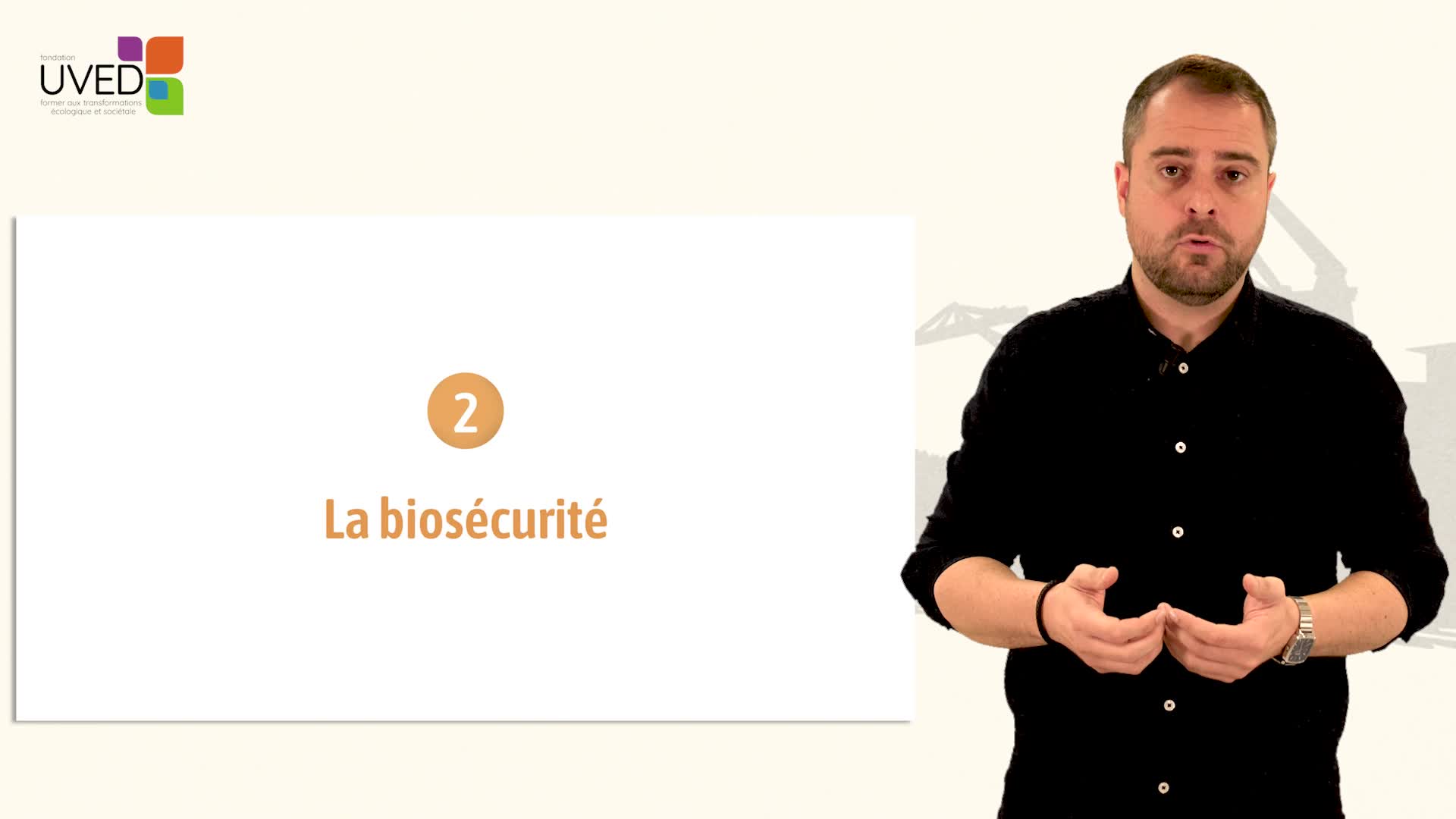Notice
Le barcoding et les mollusques
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Nicolas Puillandre, chercheur au Muséum national d'Histoire naturelle, explique le barcoding en lien avec son travail.
Thème
Documentation
Transcription
« Je suis Nicolas Puillandre, je suis maître de conférence au Muséum national d’Histoire naturelle et je travaille essentiellement sur des mollusques marins : phylogénie, taxonomie, évolution, des choses comme ça. Et un nouvel outil qu’on a depuis quelques années, c’est le barcoding.
Alors, qu’est-ce que c’est le barcoding? Le barcoding, c’est simplement l’idée d’aller regarder la variabilité d’une molécule qui s’appelle la molécule d’ADN, qui est donc un ensemble de gènes et plein d’autres choses qui code, qui contient ce qu’on appelle l’information génétique, et qui code, et bien, pour faire un organisme, pour tout ce qui fait un organisme. Et donc cette molécule d’ADN, on va pouvoir la lire avec des techniques assez pointues, et on va comparer ce qu’on appelle cette séquence d’ADN entre individus de même espèce ou d’espèces différentes.
Et en fait, selon le barcoding, ce qu’on s’attend à trouver, c’est que des spécimens d’une même espèce vont avoir des séquences d’ADN très proches, ou plus proches en tout cas. Et des spécimens d’espèces différentes vont avoir des séquences ADN plus différentes. Et donc, comme ça on va pouvoir distinguer les espèces, c’est pas toujours évident, mais dans beaucoup de cas ça marche bien.
Donc ça s’appelle barcoding tout simplement par analogie avec les barres-codes alimentaires, où quand vous lisez un barres-code alimentaire vous accès à tout un tas d’informations, vous savez ce que c’est comme produit. Ben là c’est un peu ça l’idée, c’est qu’en séquençant un petit morceau d’ADN, en obtenant une séquence d’ADN pour plein d’individus, on va pouvoir savoir à quelle espèce appartient cet individu et aussi on va pouvoir délimiter nos espèces. »
Liens
Lors des expéditions de «La Planète Revisitée»
Dossier pédagogique - La mise en collection des spécimensles chercheurs ne s’intéressent pas aux groupes d’êtres vivants déjà bien documentés tels que les mammifères ou les oiseaux mais aux taxons encore mal connus ou inconnus des chercheurs : on parle de biodiversité négligée. Ce dossier va donc rappeler ce qu’est la biodiversité
Sur le même thème
-
Sol et biodiversité : quelles agricultures, quelles solutions ?
SelosseMarc-AndréLe sol a longtemps été géré sans conscience des blessures induites : urbanisation, agriculture intensive, érosion, etc. Pourtant, certaines agricultures ont déjà mis en place des solutions.
-
Présentation des domaines des sciences écologiques et de certains points clefs importants pour les …
BarotSébastienDans cette séance, Sébastien Barot propose une introduction aux grands domaines des sciences écologiques et à leurs fondements épistémologiques et méthodologiques.
-
Évolution des forêts tropicales humides : des processus globaux à la conservation locale transdisci…
CouvreurThomas L.P.Thomas Couvreur présente des travaux de recherche sur les forêts tropicales humides, leur biodiversité au niveau global et les projets de conversation en Equateur
-
Tresser les filets fantômes. Une anthropologie des déchets marins : entre visible et invisible
Le RouxGéraldineBourgeois CostaHenriVidardMathieuSixième rencontre du cycle Océans : héritage commun, défis partagés, qui s'est tenue le 14 octobre 2025, avec Géraldine Le Roux, Henri Bourgeois Costa et Mathieu Vidard au Forum de la FMSH
-
Présentation du GBIF - Global Biodiversity Information Facility - Système Mondial d’Information sur…
ArchambeauAnne-SophieAnne-Sophie Archambeau, Node manager GBIF France, présente le Système Mondial d’Information sur la Biodiversité, programme intergouvernemental et infrastructure de données, créé en 2001, pour
-
Le sauvage dans les aires marines protégées
BricaultPaulineBoemareCatherineLachowskyCarolineQuatrième rencontre du cycle Océans : héritage commun, défis partagés, qui s'est tenue le 17 juin 2025, avec Pauline Bricault, Catherine Boemare et Caroline Lachowsky, au Forum de la FMSH
-
Secret de paysages
CarrièreStéphanieGeninDidierLaquesAnne-ÉlisabethCette vidéo présente une analyse des paysages malgaches. Elle a été réalisée dans le cadre du projet Varuna Science de la Durabilité par des scientifiques malgaches et français, tous membres du
-
Les valeurs de la biodiversité
BlancoJulienPaquetSarahIssu du projet Varuna Science de la Durabilité (Financement AFD et maitrise d'ouvrage Expertise France) développé par l'UMR SENS et ses partenaires malgaches, cette vidéo a été réalisée par Julien
-
Évaluations socio-économiques et environnementales : justifient-elles les grands projets d’aménagem…
LevrelHaroldLa valorisation monétaire attribuable à la biodiversité et la pertinence ou non des outils socio-économiques et environnementaux peuvent mener à des situations de contentieux, comme le cas de l'A69.
-
Les plantes exotiques envahissantes en forêt
DecocqGuillaumeGuillaume Decocq, professeur à l'université de Picardie Jules Verne, discute dans cette vidéo des invasions biologiques en milieu forestier.
-
Prédateurs introduits dans les îles : quels impacts ?
BonnaudElsaElsa Bonnaud, maître de conférences à l'Université Paris Saclay, discute dans cette vidéo des invasions biologiques en milieu insulaire.
-
Prévenir les invasions biologiques
AlbertArnaudArnaud Albert, chargé de mission Espèces Exotiques Envahissantes à l'Office Français de la Biodiversité, discute dans cette vidéo, de la prévention des invasions biologiques.