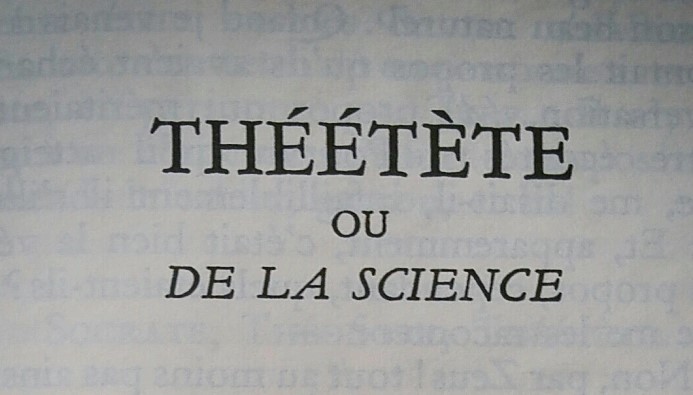- Présentation
- Rubriques
- Colloque international : Projet Recherche Transformation [ Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg ] 20 et 21 novembre 2025
- Colloque Sécularisation : perspectives judéo-islamiques - novembre 2024
- Entretiens
- Podcasts
- Séminaire platonicien et néoplatonicien (2016-2020)
- Séminaire platonicien et néoplatonicien (2020-2021)
- Séminaire platonicien et néoplatonicien (2021-2022)
- Séminaire platonicien et néoplatonicien (2022-2023)
- Séminaire platonicien et néoplatonicien (2023 - 2024)
- Séminaire platonicien et néoplatonicien (2024 - 2025)
- Séminaire platonicien et néoplatonicien (2025-2026)
- Partenaires
- Contact
2023-2024 - 1er semestre - Savoir et connaissance [ Lectures du Théétète ]
Description
Le Théétète met en scène un Socrate qui s’intéresse non plus aux questions éthiques et politiques comme dans les dialogues
de jeunesse et de la maturité, mais à une question épistémologique, la définition de la science (épistèmè), comme
le Sophiste qu’il annonce. On notera que la discussion a pour préambule la construction par Théodore de longueurs
«irrationnelles ». Dans un premier temps, Socrate explique comment il conçoit la pédagogie non comme la transmission
d’un savoir, mais comme l’accouchement d’une vérité que chacun possède en lui-même. Puis on passe à la définition de
la science. La science ne peut résider dans la sensation comme le prétend Protagoras. On serait amené par là un relativisme
plus ou moins absolu. La science ne peut non plus résider dans l’opinion vraie, pas même accompagnée de définition : mais
est-il possible que des éléments qui ne peuvent être définis puissent contribuer à la définition d’un tout, compte tenu de
surcroît que le terme « définition » présente plusieurs sens ?
Collection
Lectures du Théétète
BRISSON Luc
OFMAN Salomon
NARCY Michel
DELCOMMINETTE Sylvain
BALANSARD Anne
MERKER Anne
DONATO Marco
FERRARI Franco
BéNATOUïL Thomas
MACé Arnaud
Le Théétète met en scène un Socrate qui s’intéresse non plus aux questions éthiques et politiques comme dans les dialogues de jeunesse et de la maturité, mais à une question épistémologique, la définition de la science (épistèmè), comme le Sophiste qu’il annonce. On notera que la discussion a pour préambule la construction par Théodore de longueurs « irrationnelles ». Dans un premier temps, Socrate explique comment il conçoit la pédagogie non comme la transmission d’un savoir, mais comme l’accouchement d’une vérité que chacun possède en lui-même. Puis on passe à la définition de la science. La science ne peut résider dans la sensation comme le prétend Protagoras. On serait amené par là un relativisme plus ou moins absolu. La science ne peut non plus résider dans l’opinion vraie, pas même accompagnée de définition : mais est-il possible que des éléments qui ne peuvent être définis puissent contribuer à la définition d’un tout, compte tenu de surcroît que le terme « définition » présente plusieurs sens ?
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
- document 1 document 2 document 3
Intervenants
Helléniste, philologue et historien des idées. Auteur d'une thèse en Etudes grecques à Paris Sciences et Lettres (en 2018). - Enseignant-chercheur en Philosophie antique et Langue et littérature grecques à l'université de Bourgogne (en 2023)
Philosophe. Professeur de philosophie ancienne, Faculté de philosophie et sciences sociales, Université libre de Bruxelles (2024)
Doctorat en Philosophie. Métaphysique, épistémologie, esthétique (Lille 3, 2014)
Historien de la philosophie. - Directeur de recherche émérite au CNRS, Membre du centre Jean-Pépin (UMR 8320) (en 2023)
Traduit du grec ancien en français