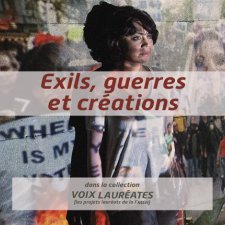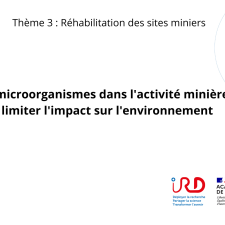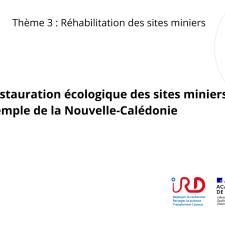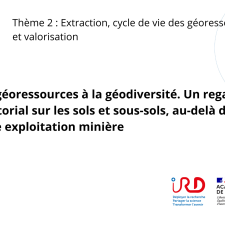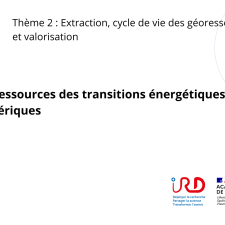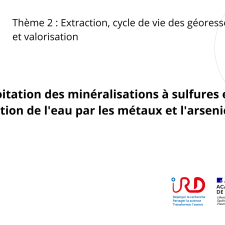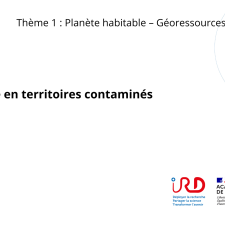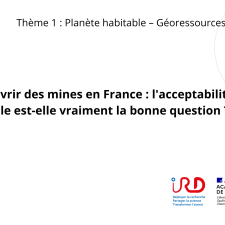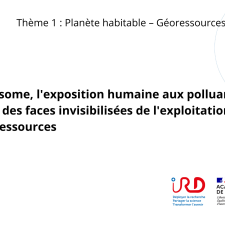Notice
Retranscription
Le réseau EcoHisMa est né de la volonté de chercheurs en sciences humaines et sociales et de chercheurs en sciences de la mer de travailler ensemble.Chacun d’entre nous sait qu’il est impossible de comprendre la complexité des écosystèmes marins et des défis environnementaux actuels sans mettre en commun nos compétences, nos savoirs, nos moyens.Ainsi nous nous sommes fixés trois objectifs :Rappeler d’abord à tout à chacun que les rapports que nous entretenons avec les environnements marins ont une histoire, et donc encourager la recherche à prendre en considération le passé de ces milieux naturels, de ceux qui y vivent et de ceux qui en vivent, en prenant en compte les acteurs humains et non-humains. . D’où le titre « Eco-Histoire ».Mutualiser ensuite les connaissances et les pratiques de recherche sur les manières d’étudier, de préserver et de conserver les ressources marines. Les données et les méthodes d’enquête que nous utilisons au quotidien dans notre travail sont très différentes selon que l’on est historien, anthropologue, biologiste ou encore écologue.Enfin, former les jeunes chercheurs des deux rives de la Méditerranée à la pratique de l’interdisciplinarité en organisant des écoles d’été, des sorties sur le terrain, des rencontres avec les professionnels de la pêche et les gestionnaires. On oublie souvent que les ressources marines, à l’instar des épices et des esclaves, ont été des supports de la première mondialisation. C’est le cas de la Morue, de la baleine mais aussi du corail rouge exploité pendant des siècles par les Européens en Algérie et en Tunisie.Les ressources des mers et des océans ont ainsi joué un rôle moteur dans les conquêtes coloniales et la construction des empires européens.Dans les pays du Maghreb, la colonisation a laissé des traces durables sur la manière d’exploiter la mer, de compter les poissons et les coraux, d’organiser les activités de pêche et de pisciculture. Les Européens ont importé avec eux un ensemble de techniques, de normes juridiques et scientifiques, mais aussi de représentations de la nature. Elles étaient souvent inadaptées aux réalités et aux écosystèmes locaux.Les archives, comme les collections des Musées d’histoire naturelle témoignent de cet héritage colonial. Elles permettent aussi de tracer les généalogies des déséquilibres actuels entre Nord et Sud dans l’accès aux territoires et aux ressources de la mer. Beaucoup de ces traces de ce passé commun doivent pour partie encore être localisées et explicitées, et c’est aussi ça l’un des enjeux du réseau EcoHisMa. Au moment des indépendances, les nouveaux États ont dû faire face à de nombreux bouleversements. Ils se sont organisés tant bien que mal pour affronter les grands défis de la seconde moitié du 20e siècle que sont le changement climatique, l’anthropisation des littoraux, la dégradation des environnements marins, l’industrialisation des pêches…Les États du Maghreb s’affranchissent des tutelles internationales en finançant leurs propres programmes, en formant leurs propres experts et en réaffirmant leur souveraineté sur leurs espaces et leurs ressources maritimes.Tout cela permet aujourd’hui d’envisager des rapports à parts égales qui sont garants d’échanges scientifiques de qualité, et ce malgré les contentieux entre nos gouvernements.
ECOHISMA Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb : discours, pratiques et savoirs, XIXe-XXIe siècle
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Projet lauréat 2024 de l'appel "Réseaux internationaux en SHS - Climat et Environnement" : Le réseau ECOHISMA « Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb » a pour objectif de développer une réflexion commune et interdisciplinaire sur les discours, les pratiques et les savoirs autour desquels ont été élaborées les dispositifs de gestion des ressources de la mer au Maghreb depuis le milieu du XIXe siècle à aujourd’hui. Ce projet de réseau s’appuie sur une équipe de chercheurs européens et nord-africains, dont les travaux se situent à l’intersection de champs disciplinaires relevant des SHS et des sciences de la mer. Planifiées sur deux années (2025-2026), les activités du réseau ECOHISMA visent à la mutualisation de données de recherche et de méthodologies d’enquête, à la diffusion des travaux de ses membres auprès des communautés de chercheurs et du grand public, et à la formation de jeunes chercheurs des rives Nord et Sud de la Méditerranée.
Hugo Vermeren est chargé de recherche au CNRS (UMR 7303 TELEMMe), spécialiste du Maghreb contemporain et de l’histoire environnementale de la colonisation. Il a notamment publié le livre Les Italiens à Bône (1865-1940). Migrations méditerranéennes et colonisation de peuplement en Algérie (2017). Coordinateur du programme « Gouverner les îles » hébergé par l’Ecole Française de Rome et membre du programme Back3M consacré à l’histoire des colonies de phoques moines dans l’espace Pelagos, il s’intéresse en particulier au rôle des activités de pêche dans les processus de territorialisation des espaces lagunaires et insulaires, aux politiques coloniales de gestion halieutique, ainsi qu’à la production historique des normes et des savoirs sur la mer.
Tarik Ghodbani est professeur de géographie environnementale à l’Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed. Docteur de l’Université de Paris 8, il a soutenu en 2013 une thèse intitulée Environnement et littoralisation de l’Ouest algérien. Il a depuis participé à plusieurs programmes internationaux (Fulbright, DAAD, Chevening) et dirigé le laboratoire de recherche Espace Géographique Et Aménagement du Territoire (EGEAT) de 2016 à 2023. Auteur de nombreux travaux sur les politiques écologiques territoriales, il mène actuellement ses recherches sur les zones humides à l’échelle de l’Algérie et du Maghreb, en portant une attention particulière dans le domaine de la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la santé des citoyens.
Dans la même collection
-
Art et résilience
BriandCatherineArt et résilience L'Art au service de l'accompagnement des personnes atteintes du VIH au Bénin. Une approche holistique et humaniste
-
Exil.s, guerre.s et création.s
LobodenkoKaterynaSannelliDaniloLe projet « Exil·s, guerre·s et création·s : images de résistance au service de l’histoire » sera mené par le groupe de recherche Arts, Médias, Exils (AME), affilié à l’Institut de recherche sur le
Sur le même thème
-
Les enjeux d'un numérique soutenable
NinassiBenjaminBenjamin Ninassi, adjoint au directeur du programme Numérique et environnement de l’INRIA, propose dans cette vidéo un cadrage sur les grands enjeux du numérique.
-
COP30 Climat au Brésil : Que faut-il en retenir et quelles conséquences pour la recherche française…
DouniasEdmondBarbierNicolasDerroireGéraldineDurieuxLaurentLa récente COP Climat au Brésil était aussi une « COP des forêts ». Quatre participants à la caravane Iaraçu et à la COP témoigneront du déroulé et des retombées.
-
2 - Les Vendanges du Savoir - Changement climatique : que nous dit la vigne ?
Garcia de Cortazar AtauriIñakiChangement climatique : que nous dit la vigne ? Comprendre pour adapter l’agriculture de demain
-
Adapter les villes à un climat qui se réchauffe
MigliariMatteoComment adapter les villes face à un climat qui se réchauffe pour garantir leur vivabilité ? C'est la question centrale que s'est posée Matteo Migliari durant ses années de thèse, réalisée entre le
-
Des microorganismes dans l’activité minière pour limiter l’impact sur l’environnement
BruneelOdileLa conférence présente un état des lieux de l'importance des micro-organismes pour tenter de limiter l'impact de l'activité minière sur l'environnement, avec les avantages et les inconvénients de ces
-
La restauration écologique des sites miniers. L'exemple de la Nouvelle-Calédonie.
PillonYohanLa présentation démarre par une introduction aux grands concepts dans le restauration écologique et ses enjeux dans un contexte minier. Les procédés mis en œuvre sont présentés sur un exemple : la
-
Des géoressources à la géodiversité. Un regard territorial sur les sols et sous-sols, au-delà de la…
ScammaccaOttoneLe concept de « géodiversité », pendant non-vivant de la biodiversité, vise à renouveler le regard porté sur la nature. Cette présentation met l’accent sur ce nouveau paradigme – en montrant un
-
Les ressources des transitions énergétiques et numériques.
Van LichterveldeMariekeLa transition énergétique nous promet une sortie des énergies fossiles grâce à l’électrification massive. Mais l’extraction galopante des métaux nécessaires à cette transition pose de nombreux
-
Exploitation des minéralisations à sulfures et pollution de l'eau par les métaux et l'arsenic.
CasiotCorinneLa conférence a pour thème l’exploitation des minéralisations à sulfures qui engendre des pollutions de l’environnement et de l’eau en particulier. Les phénomènes chimiques à l’œuvre sont explicités.
-
Vivre en territoires contaminés.
BecerraSylviaLa présentation propose un "toxic-tour" de sites contaminés dans des pays du sud, entre territoires miniers, pétroliers et de pollutions urbaines. Elle se centre sur les impacts sociaux
-
Rouvrir des mines en France : l’acceptabilité sociale est-elle vraiment la bonne question ?
CerceauJulietteDans le cadre de la transition énergétique, des projets de réouverture de mines en France hexagonale voient le jour et interrogent les populations. La conférence revisite la question de l
-
Exposome, l'exposition humaine aux polluants : l’une des faces invisibilisées de l'exploitation des…
MauriceLaurenceL’exposome correspond à l’ensemble des expositions environnementales auxquelles vous êtes soumis tout au long de votre vie, via votre alimentation, l’air que vous respirez, les rayonnements qui vous