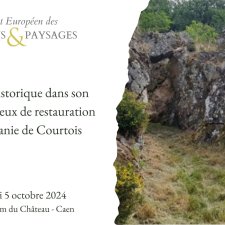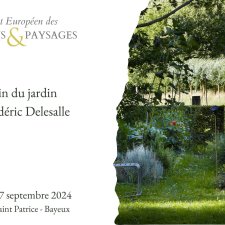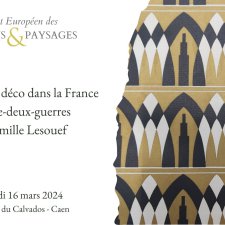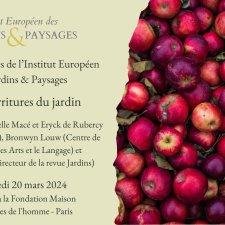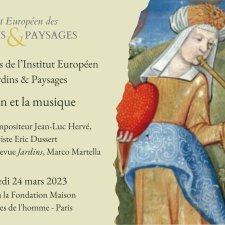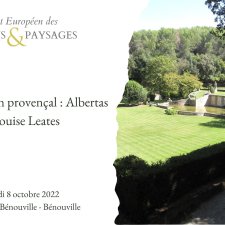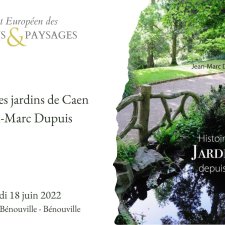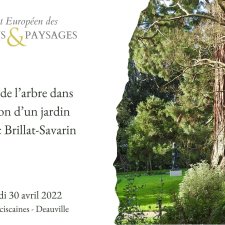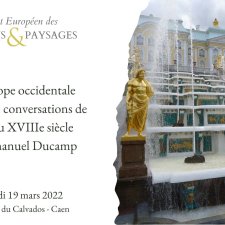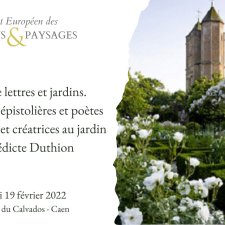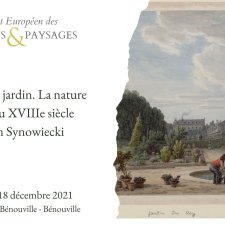Notice
L’art des jardins au Maroc : entre tradition et modernité
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
« On dit avec raison : les italiens construisent leurs jardins, les Anglais les plantent, les Français les dessinent. On peut ajouter : les Marocains y vivent » Irène Menjily-de Corny, « Jardins du Maroc », le temps apprivoisé, Paris, 1991
Au Maroc, depuis les premières installations humaines, le jardin et plus largement la nature ont toujours été étroitement liés à la vie de la cité traditionnelle. Véritables ville-jardins, les medinas se sont développées autour d’une multitude d’espaces plantés hiérarchisées autour de l’eau, allant du riad privatif à l’intérieur des demeures aux grands vergers extra-muros (jnan) en passant par les agdal, vergers clos irriguées et les arsa situés à l’intérieur des remparts des medinas. Chacun de ses terme en arabe qui désignent le mot « jardin » renvoie à une typologie avec une forme, une taille et une fonction spécifiques.
Aujourd’hui, de très beaux témoignages de la tradition paysagère marocaine sont encore visibles, des jardins ancestraux qui figurent de modèles et qui continuent d’attirer des touristes du monde entier. Réplique agrandie du généralife à Grenade, le jardin Dar el-Batha à Fès est un bel exemple de Riad marocain traditionnel du XIXe siècle. A l’échelle de la ville, citons les jardins de l’Agdal à Marrakech créés sous la dynastie almohade au XIIème siècle. Vaste verger nourricier et d’agrément protégé de murailles, les jardins de l’Agdal, d’une superficie d’environ 500 hectares, pratiquement la superficie de la medina, marquent le style du jardin « almohade », une réalisation paysagère à l’échelle de la ville et du territoire magnifiée grâce aux vues exceptionnelles sur l’horizon des montagnes de l’Atlas au sud.
Avec l’arrivée du protectorat français en 1912, et l’aménagement de villes nouvelles européennes à l’extérieur des medinas, un nouveau modèle de jardin va apparaître : le « jardin public urbain». A travers le paysagiste J.C.N. Forestier et ses disciples français paysagistes et architectes, un nouvel art des jardins est expérimenté au Maroc : tantôt inspiré de la tradition mauresque, tantôt reproduction du jardin à la française expression du pouvoir colonial, tantôt « jardin métisse », savant mélange de tradition française et de savoir-faire andalous. Cette période coloniale sera totalement occultée de l’histoire de l’art des jardins au Maroc, d’où la publication de mon livre « Villes-paysages du Maroc », aux éditions de La Découverte en 2017.
Dès la fin du protectorat français en 1956, la création jardiniste décline, aucun nouveau jardin public n’est réalisé en dehors de quelques parcs conçus par des paysagistes étrangers.
Aujourd’hui, seule une poignée de paysagistes formés pour la majorité à l’Institut Agronomique et Vétérinaire de Rabat (IAV) et issus d’écoles de paysages étrangères exercent au Maroc, sans cadre juridique. L’IAV est la seule école marocaine à former des paysagistes mais l’enseignement de l’art des jardins et du projet de paysage y est insuffisant. En ce début de XXIe siècle, les nouveaux besoins et les nouvelles contraintes qui se posent (densification des villes, changement climatique, épuisement des ressources en eau, perte de la biodiversité, nouveaux usages, etc.) changent notre regard sur le jardin et la manière de le concevoir.
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Sur le même thème
-
Propos introductifs au colloque Jardin et littérature
HarrisonRobertNaugretteFlorencePropos introductifs au colloque Jardin et littérature
-
Le jardin historique dans son territoire, enjeux de restauration
CourtoisStéphanie deConférence du 5 octobre 2025
-
-
Jardins et Art déco dans la France de l’entre-deux-guerres
LesouefCamilleConférence du 16 mars 2024
-
Les Rencontres de l'Institut Européen des Jardins et Paysages
MartellaMarcoMacéMarielleLouwBronwynRubercyEryck deRencontres du 20 mars 2024
-
Les Rencontres de l'Institut Européen des Jardins et Paysages
MartellaMarcoHervéJean-LucDussertÉricRencontres du 24 mars 2023
-
-
-
-
De l’Europe occidentale à la Russie : conversations de jardins au XVIIIe siècle
DucampEmmanuelConférence du 19 mars 2022
-
Femmes de lettres et jardins. Romancières, épistolières et poètes comme guides et créatrices au jar…
DuthionBénédicteConférence du 19 février 2022
-
Paris est un jardin. La nature en ville au XVIIIe siècle
SynowieckiJanConférence du 18 décembre 2021