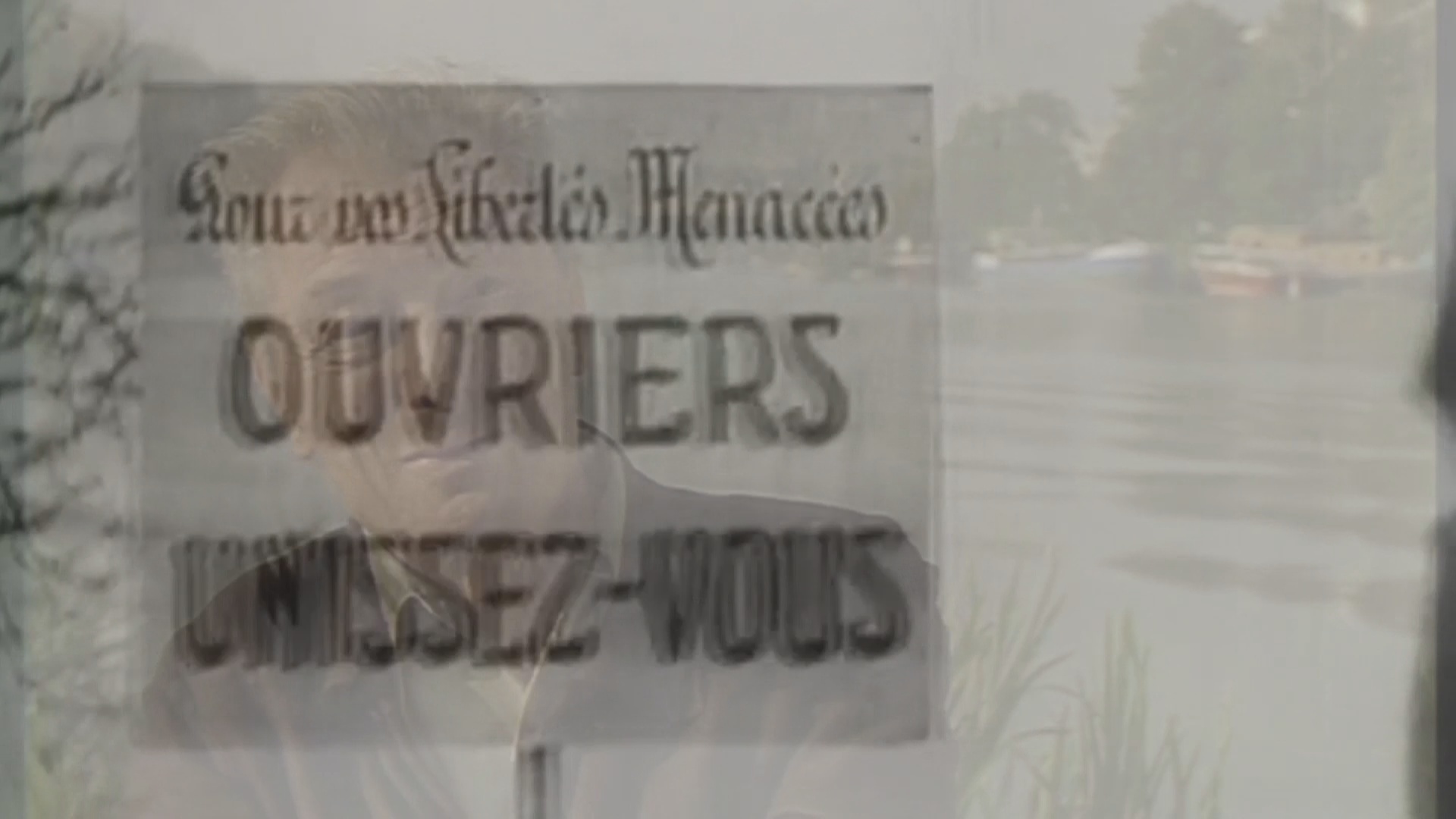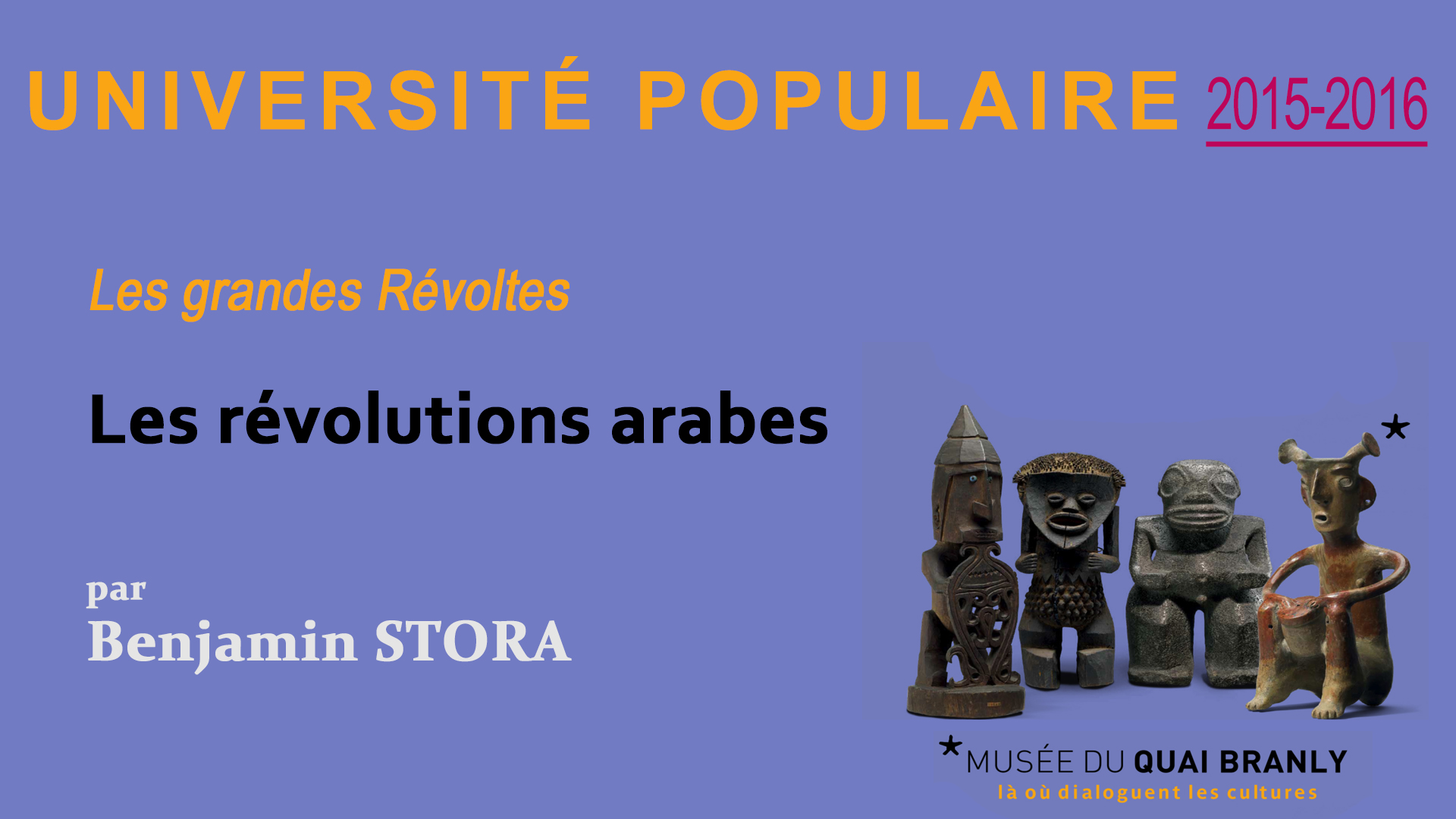Les mouvements sociaux : de la grève aux émeutes
Vertige de l'émeute : comprendre le basculment des manifestations en France
La manifestation est souvent décrite comme l’espace où s’exprime un sentiment d’impuissance quotidienne. Elle rompt avec l’ordinaire et ouvre une scène collective où se mêlent revendications politiques, libération pulsionnelle et effet cathartique. Mais que se joue-t-il lorsqu’une manifestation bascule dans l’émeute ?
Le moment du basculement
La frontière entre protestation pacifique et désordre radical est ténue. Comprendre ce basculement est essentiel : il éclaire la dynamique interne des mouvements sociaux et interroge la réponse de l’État. La répression est-elle proportionnée ? Ou bien traduit-elle l’incapacité des institutions à entendre une crise sociale profonde ?
La narration des violences
La désignation d’un événement comme « émeute » n’est jamais neutre. Les pouvoirs publics et les médias isolent certains actes de violence, les mettent en récit et les catégorisent pour justifier des mesures coercitives. Cette narration oriente les perceptions de l’opinion publique, alimente les débats politiques et influence le champ juridique.

Le rôle du sentiment d’injustice
L’émeute ne se réduit pas à la violence brute. Elle s’enracine dans le ressenti d’un blocage : conditions de vie dégradées, absence de canaux d’expression, fermeture de l’écoute institutionnelle. C’est cette expérience d’injustice qui nourrit la colère et donne à la protestation sa dimension explosive.
Liberté ou sécurité ?
Face à ces tensions, l’État est pris dans un dilemme : garantir le droit de manifester tout en « sécurisant » l’espace public. Or cette volonté d’encadrement conduit parfois à repousser les limites du cadre légal, au risque de fragiliser l’un des droits fondamentaux de la démocratie.
Une perspective ethnologique
L’intérêt d’une approche ethnologique est de pénétrer au cœur du phénomène, dans l’« ici et maintenant » de la rue. Plus qu’un projet de transformation radicale, l’émeute objective les évolutions sociales en cours. Elle révèle la fragilité des équilibres démocratiques et l’importance du vécu collectif dans l’écriture de l’histoire sociale.
Le travail des chercheurs
Dans cette vidéo, l’équipe de Chercheurs en ville accueille Romain Huët, auteur de l’ouvrage Vertige de l’émeute, et propose une plongée ethnologique au cœur des manifestations. Ensemble, ils explorent l’émeute non pas comme une rupture radicale mais comme une mise en lumière des tensions sociales déjà présentes. En interrogeant le moment où la protestation bascule, il met en évidence le rôle du sentiment d’injustice, la construction médiatique du terme « émeute », questionne la violence qui en découle et interroge la finalité de ces manifestations. Une réflexion qui éclaire, par l’intérieur, les enjeux contemporains des mobilisations collectives.
Pour aller plus loin : pourquoi faire grève ?
Ces vidéos forment une traversée des mouvements sociaux du XXème et XXIème siècle. Des grèves ouvrières de Mai 68 à celles de décembre 1995, en passant par les mobilisations minières étudiées par Ariane Mak et les luttes autour des retraites dans les années 2000, elles illustrent la permanence d’un même besoin collectif : rendre visible une parole que les institutions n’entendent plus. Ces mobilisations révèlent l’évolution des rapports entre citoyens, État et travail, mais aussi la tension croissante entre légitimité démocratique et logique de contrôle. Ensemble, elles dessinent le fil conducteur d’une société où la contestation n’est pas une rupture de l’ordre social, mais une condition de sa vitalité.
Entretien avec Ariane Mak autour de son ouvrage En guerre et en grève. Enquêtes dans les cités mini…
De 1939 à 1945, le Royaume-Uni a connu plus de 7 000 grèves, en grande partie dans l’industrie charbonnière.
04 - Entre l’ancien et le nouveau : les grèves ouvrières de mai-juin 68
Session Effets sociaux et politiques de mai 68. Pratiques, acteurs, représentations Colloque MAI 68 en quarantaine On peut aujourd’hui dépasser l’opposition convenue entre un mouvement étudiant
décembre 1995 : histoire d'un mouvement social
"Décembre 95" fut le dernier grand mouvement social du XXème siècle en France. Ce documentaire vise à revenir sur l'histoire de cette grève et ses enjeux, la retraite, la sécurité sociale, les
- Syndicalisme
- Histoire des groupes sociaux (conditions sociales, histoire sociale)
- Grèves (grèves de solidarité, grèves générales, grèves sur le tas, piquets de grève...)
- Syndicats (associations de travailleurs, Internationale ouvrière, mouvements ouvriers, ouvrages généraux sur les syndicats, ouvrages interdisciplinaires sur les relations de travail, rôle des syndicats dans la démocratie industrielle, syndicalisme, syndic
- Mouvement social
Une histoire des retraites - Les années 2000
Figure spectrale et spectaculaire brandie lors du mouvement social de décembre 2019-janvier 2020 contre la réforme des retraites, la société financière Blackrock ne symbolise qu’une petite part de
Construction de la menace et pénalisation du militantisme écologiste : le cas de Bure (Meuse)
À mesure que s’amplifient les transformations globales, les mouvements écologistes appelant une action décisive des autorités publiques pour freiner les changements climatiques et préserver les
Comprendre l'émeute
Les analyses sociologiques et politiques de la violence émeutières suivent en principe deux perspectives différentes. La première cherche à dégager les facteurs issus du contexte social, susceptibles d’expliquer l’apparition de la violence émeutière (inégalités sociales, exclusion, discriminations, expériences de l’injustice, etc.). La seconde perspective, quant à elle, vise à comprendre les processus et la dynamique des violences en s’appuyant sur un profilage sociologique des émeutiers. La plupart des études s’accordent pour établir un diagnostic sociologique selon lequel la généralisation de la frustration sociale favoriserait l’expérience émeutière. En bref, il y a une base institutionnelle (sociale, politique et culturelle) qui constitue un ensemble de conditions importantes pour l’expression des formes de violence.
Pour le formuler autrement, il existe des configurations sociales spécifiques qui créent des conditions favorables aux expressions émeutières. L’objectif de cette communication est de se plonger plus au cœur de l’émeute pour en déceler sa réalité sensible et son vécu subjectif. Autrement dit, il s’agira de décrire l’expérience subjective de l’émeute, la façon dont les émeutiers mettent en sens leurs actes, les thématisent et en donnent une explication. Romain Huët tâchera alors de réaliser une « phénoménologie » de l’émeute au sens où elle sera comprise comme une « expérience sensible » produisant une série d’affects, de rapports sociaux, et de pratiques symboliques qui maintiennent ou encouragent les activités à la stratégie émeutière. Il tentera d’appréhender l’émeute dans une perspective de « corps assemblés en des lieux » afin d’examiner les effets de verticalisation corporelle qui l’orientent ; c’est ainsi éprouver l’unité phénoménologique depuis laquelle cet acte se donne simultanément comme action et affection. C’est reconnaître, donc, l’acte de l’émeutier pour ce qu’il est et éviter de re-présenter autre chose que lui : une colère, une perte de repères, une haine, etc.
Une approche historique, un regard au-delà des frontières
Quatre exemples à travers le temps et l'espace pour élargir le champ de réflexion
Paris des émeutes, Paris des révoltes
L’historien Jean-Claude Caron explore la ville de Paris comme un « laboratoire » des révoltes populaires, depuis les journées insurrectionnelles du XIXᵉ siècle jusqu’à des formes contemporaines de tensions urbaines. Il choisit Paris pour sa fréquence exceptionnelle de « journées » de soulèvement (insurrection, guerre sociale, émeute) et pour la figure du « citoyen-combattant » qui surgit à l’occasion de ces épisodes. Il montre aussi comment la rue devient un espace politique où le peuple affirme sa présence lorsque les institutions ne l’écoutent plus. L’émeute y apparaît non comme un simple débordement de violence, mais comme une forme de participation populaire, inscrite dans une mémoire collective de résistance. Cette perspective éclaire les tensions contemporaines entre le droit de manifester et la répression : chaque émeute révèle la fragilité du dialogue entre l’État et les citoyens, et la nécessité de repenser la place du conflit dans la démocratie.
Au tournant du 6 février 1934
Ce 2ème "épisode" du parcours de Jean-René Chauvin porte sur l'année 1934. Le coup de force fasciste du 6 février 1934, et la contre manifestation des organisations ouvrières du 12 février 1934, racontée par Jean-René Chauvin. La division entre le Parti Socialiste et le parti Communiste au début de l'année 1934 est encore de vigueur, et le cheminement qui finit par aboutir, le 27 juillet 1934, au Pacte d'Unité d'action entre communistes et socialistes, sera le prélude au Front Populaire... Le rôle de la gauche socialiste, menée par Marceau Pivert et Jean Zyromski est souligné. De même que l'analyse trotskiste du fascisme.
Les révolutions arabes
Ce cycle décrypte des mouvements historiques de révoltes et de combats, pacifiques ou non, qui ont été à l’origine de bouleversements politiques et sociaux, et qui restent, encore aujourd’hui, gravés dans nos cultures et nos imaginaires.
Cette conférence analyse les soulèvements dans le monde arabe, notamment pendant et après 2010-2011, comme des formes contemporaines de révoltes sociales et politiques inscrites dans une continuité historique. Elle invite à considérer ces mouvements non seulement comme des “révolutions” abouties, mais comme des processus inachevés mêlant espoirs de modernisation, contestation des régimes autoritaires et réaffirmation de l’espace public.
Une histoire de la vie chère au Burkina Faso
Au Burkina Faso, la « vie chère » occupe aujourd’hui une place centrale dans les difficultés matérielles et les sentiments d’injustice ressentis par les classes populaires. L’augmentation des cours de biens de consommation courante a ainsi suscité des mobilisations parfois violentes dans ce pays depuis le début des années 2000, et alimente également un mécontentement plus diffus à l’encontre des autorités jugées responsables des prix.
À partir d’une enquête menée dans les quartiers populaires de villes burkinabè, l’auteur traite d’un phénomène peu étudié : la place grandissante des prix dans l’expression de la colère au sein de sociétés contemporaines. Cette colère est interrogée sous l’angle de la vie quotidienne et des représentations populaires de l’économie, sous celui de l’histoire de la politique des prix et des traces qu’elle a laissées dans les mémoires, et enfin sous celui de différentes formes de mobilisations (manifestations, émeutes, pillages). Au-delà du cas du Burkina Faso, cet ouvrage propose une réflexion plus générale sur l’évolution des modes de gouvernement et de leurs contestations à l’ère néolibérale.
paris des émeutes, paris des révoltes
Entre les Trois Glorieuses et la résistance au coup d’État du 2 décembre 1851, Paris constitue un cas unique en Europe en termes de fréquence de révoltes populaires. La période est en effet
Au tournant du 6 février 1934
Ce 2ème "épisode" du parcours de Jean-René Chauvin porte sur l'année 1934. Le coup de force fasciste du 6 février 1934, et la contre manifestation des organisations ouvrières du 12 février 1934,
Les révolutions arabes
Conférence de l’Université populaire du quai Branly (UPQB), donnée le 17 février 2016 Ce cycle décrypte des mouvements historiques de révoltes et de combats, pacifiques ou non, qui ont été à l
Les prix de la colère Une histoire de la vie chère au Burkina Faso
Vincent Bonnecase Étudier comment la colère de citoyens ordinaires s’exprime le plus souvent à bas bruit, mais parfois aussi en mouvements de rue informels et quasi insurrectionnels, et en quoi