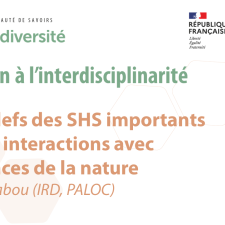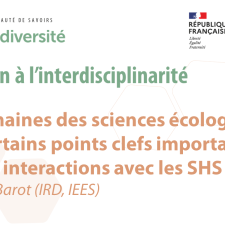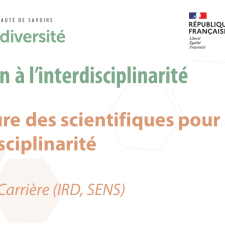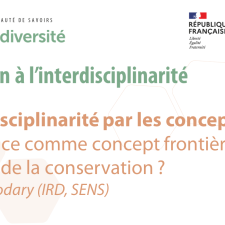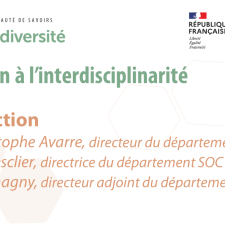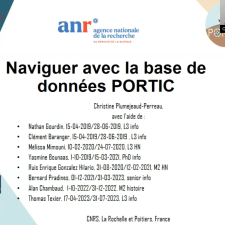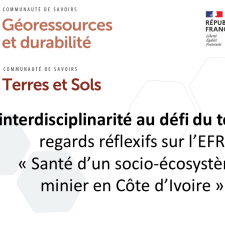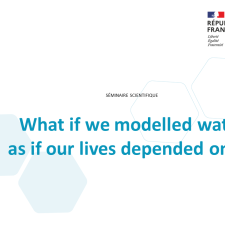Notice
MSH Paris Nord
Frédéric Le Blay - À propos du projet Atlantys - MSH Ange-Guépin
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
- Dossier
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
TRANSCRIPTION Podcast Frederic Le Blay RNMSH
Le 10 octobre 2022 a eu lieu une journée de réflexion portant sur les recherches interdisciplinaires, sur les transitions écologiques et sur le changement climatique. Cet événement questionnait la place des Maisons des sciences de l’homme, MSH, et celles du réseau national des MSH dans les mises en réseau interdisciplinaire sur ces thématiques. Nous y avons interviewé des porteurs et porteuses de projets identifiés dans le cadre de ces mises en réseau ou des personnalités bénéficiant d’un financement de ce dernier. Dans cet épisode, Frédéric Le Blay nous parle du projet « Atlantys ». Il est maître de conférences à l’Université de Nantes, chercheur en philosophie des sciences et directeur de la MSH Ange Guépin, Nantes Angers Le Mans. Sa démarche s’inscrit dans la perspective de l’anthropologie environnementale. Il s’intéresse aux savoirs relatifs au cosmos et à la nature, comme la cosmologie, la météorologie, les relations homme animal, ou encore les savoirs sur le vivant, mais aussi à la philosophie médicale orientée autour des enjeux de santé et d’environnement, comme les théories du climat, l’hygiénisme, le naturisme et, en lien avec la médecine, les approches holistiques du soin.
« Le projet que j’ai porté, parce que c’est un projet qui est arrivé à sa fin dans le cadre du contrat qui était le sien, s’intéressait à la relation des sociétés humaines, aux aléas naturels et aux menaces environnementales. Je l’ai coordonné entre 2015 et 2019. C’était un projet financé et labellisé par la Région des Pays de la Loire au titre d’un appel à projets que la région avait lancé, qui s’appelait Paris scientifiques. Plus précisément, le projet portait sur l’imaginaire de la fin du monde et sur l’expérience de la catastrophe. Avec un intitulé pareil, imaginaire de la fin du monde, on comprend assez bien qu’il s’agissait d’une démarche très exploratoire et très spéculative. J’ai d’ailleurs toujours dit qu’il valait mieux que la fin du monde reste de l’ordre de la spéculation et pas de l’expérimentation. C’était une démarche qui cherchait à relier deux registres constitutifs des cultures humaines. Le premier registre était celui de l’expérience et de la mémoire des faits passés, des faits passés qui ont pu être vécus comme des catastrophes, des catastrophes qui pouvaient remettre en cause l’existence de certaines communautés ou de certaines sociétés. Pour le rattacher à une discipline, on pourrait dire que ça relève de l’histoire, l’histoire comme étant la collecte de l’ensemble des expériences vécues par l’humanité. C’est l’histoire aussi dans une perspective très anthropologique. Le second registre, c’était un registre de l’imaginaire mêlant les différentes formes de la pensée, la création artistique, la création littéraire, la spéculation philosophique, mais aussi la croyance, les croyances et les théories scientifiques. Il s’agissait de parvenir à dégager des figures paradigmatiques ou des structures récurrentes relatives à l’idée de catastrophe ou à l’idée de fin des temps. Là encore, on retrouve assez nettement la dimension anthropologique à travers cette interrogation. Le but était de parvenir à proposer une analyse critique dans le cadre, et au service de, même si la science n’est pas toujours au service de la société, mais elle peut l’être aussi, des débats contemporains sur le changement climatique, l’avenir du vivant, la fin de l’humanité, etc.
Les membres de l’équipe, qui était une équipe vraiment interdisciplinaire, représentaient un prisme assez large des sciences humaines et des sciences sociales : l’anthropologie, la philosophie, l’histoire, l’histoire des religions, l’histoire des sciences, la géographie, la sociologie, la psychologie, la littérature, l’histoire de l’art et l’archéologie. C’était pour les SHS. Sur un sujet comme celui-là, il fallait aussi avoir quand même quelques collaborations en dehors des SHS. Nous avions un collègue qui était un peu l’artéfact au sein de l’équipe, un collègue issu des sciences de la terre et des sciences environnementales, qui a apporté son point de vue et sa contribution par rapport à ce champ. Il faut aussi mentionner des collaborations institutionnelles à l’étranger, pas seulement limitées à la participation d’un chercheur ou d’une chercheuse, mais vraiment des institutions en tant que telles qui se sont engagées à nos côtés. C’était essentiellement l’aire pacifique. Un sujet comme l’expérience des catastrophes et l’imaginaire de la fin du monde, l’aire Pacifique a des résonances assez fortes, aussi bien sur le plan historique que sur le plan d’une actualité très contemporaine. Nous avions comme partenaire le Big History Institute installé à Sydney, en Australie, l’université Ajou en Corée du Sud et l’université de Niigata au Japon. Tout ce petit monde était hébergé à la MSH Ange Guépin à Nantes. Le projet reposait sur une approche interdisciplinaire. Il faut quand même reconnaître que la place des SHS était centrale puisqu’il s’agissait d’inscrire les problématiques environnementales dans le champ de la culture. Compte tenu de la complexité de l’objet d’étude, l’approche interdisciplinaire conditionnait cependant la possibilité même du projet. Parce que la culture peut être aisément réduite à l’histoire, éventuellement à la sociologie, à la littérature. Comme je l’ai indiqué, nous avions des psychologues qui travaillaient avec nous, qui ne sont pas forcément ancrés sur le champ de la culture en tant que tel, du point de vue de leur registre épistémique. Il n’était pas facile de maintenir la pleine interdisciplinarité à tous les niveaux du projet. Nous l’avions articulé en quatre axes qui privilégiaient certains champs disciplinaires, même si à chaque fois, nous avons favorisé les croisements disciplinaires qui n’allaient pas nécessairement de soi. Le premier axe portait sur l’imaginaire de la fin du monde en tant que tel. Il interrogeait les croyances et les peurs millénaristes. Son animation était confiée à un anthropologue spécialiste des religions et à un psychologue travaillant lui-même sur les croyances. Les croyances, c’est un enjeu de la psychologie collective. Il intégrait aussi la philosophie des sciences en confrontant les modèles scientifiques aux différents scénarios apocalyptiques, puisque la science est capable de modéliser des scénarios, de fin de la planète, de fin du système solaire et de fin de l’univers. Ce sont des scénarios qu’il est intéressant de croiser avec d’autres formes de représentations ou d’imaginer. Le second axe était beaucoup plus centré sur la philosophie et sur l’histoire des sciences puisqu’il étudiait les différentes théories relatives à la fin du monde en précisant les différentes acceptions de l’objet lui-même, puisqu’il fallait déjà s’entendre sur ce qu’est-ce que le monde, quand on parle de fin du monde. Du point de vue de la science par exemple, le monde, ça ne veut pas dire grand-chose, donc il faut pouvoir définir les objets. C’est moi-même qui assurais l’animation de cet axe avec un collègue Canadien spécialiste de littérature, travaillant sur la littérature scientifique moderne, des 17e et 18e siècle. Le troisième axe, confronter l’imaginaire à travers la littérature, le cinéma et les arts. Il confrontait cet imaginaire tel qu’il peut s’exprimer sous différentes formes à l’expérience vécue. Il était animé par un géographe, c’était le volet expérimental de la catastrophe, et par un spécialiste de littérature comparée. Dans ce cadre, il s’agissait d’étudier comment la réalité pouvait alimenter les œuvres de l’imaginaire ou, à l’inverse, comment celle-ci pouvait modifier notre regard sur la réalité. De ce point de vue-là, l’étude du genre du film catastrophe qui nous a pas mal occupés est assez intéressante, parce que non seulement elle est alimentée par une réalité, mais elle tend fortement aussi à modifier notre perception de notre réalité et des risques qui menacent notre existence. Le quatrième axe portait sur l’histoire des catastrophes. Il était confié à une historienne de l’Antiquité et un géographe spécialiste du littoral. Il n’y avait pas d’activités de terrain à proprement parler dans ce cadre. Il n’y a pas d’activités de terrain sur la fin du monde ou sur la catastrophe, mais le terrain des géographes ou des archéologues, qui préexiste aux problématiques, de même que le terrain de la psychologie ou de l’anthropologie, ont été fortement sollicités comme arrière-plan méthodologique.
La question de l’apport des SHS sur les questions environnementales ou climatiques me paraît absolument essentiel. Parce que les SHS, selon moi, apportent des réponses face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, grands défis qui ne trouveront pas, j’en suis persuadé, leur solution dans la technique et dans l’ingénierie seule, même si la technique et l’ingénierie sont indispensables. Si nous n’interrogeons pas ce qui conditionne profondément notre relation à la nature, notre relation à l’environnement ou au monde, nous ne pourrions arriver qu’à poser des pansements là où il faut remonter à la cause du problème et soigner, soigner le monde, soigner notre relation au monde et notre relation à l’environnement. Ça n’est pas de la technique, ça n’est pas de l’ingénierie. Cette relation à l’environnement s’intègre dans des schèmes historiques, mais aussi des schèmes culturels, qui s’alimentent des expériences vécues par les communautés humaines. Il n’existe aucune définition universelle et objective de ce qu’est l’environnement. Il en va un peu différemment du climat, qui obéit à des lois et des modèles que la science peut établir, même si les effets du climat ne sont pas perçus à l’identique partout sur le globe. L’histoire et la culture interviennent aussi. Dans la notion de biodiversité, par exemple, qui paraît a priori ne pas devoir poser de problème de définition : du point de vue de la science, c’est une notion qui paraît assez bien circonscrite, doit aussi être interrogée, de mon point de vue. À de nombreux égards, elle est fondée sur un imaginaire, un imaginaire de la profusion et de l’abondance de vie, qui ne correspond pas à ce que toutes les sociétés humaines perçoivent de leur environnement. Les SHS ont la capacité à questionner le fond des choses et le fond même des mots, des notions et des concepts qui sont les nôtres lorsque nous parlons de monde, d’environnement, de biodiversité, de climat, de nature, etc., d’où leur rôle essentiel.
Les freins pour le montage d’un tel projet sont liés à l’ancrage fortement disciplinaire de notre culture académique. Tous les chercheurs qui pratiquent l’interdisciplinarité disent cela et ils ont raison, parce que c’est vrai. Notre culture académique elle-même pose des freins, puisque c’est une culture qui préfère que l’on puisse inscrire tout projet dans un champ déjà bien balisé, en général, sur la base d’un état de l’art parfaitement maîtrisé. Or, plus le projet complexe et interdisciplinaire, moins la maîtrise de l’art est assurée. C’est dès l’étape d’expertise du projet que parfois, les freins apparaissent. Ça va dépendre beaucoup des experts qui sont capables de comprendre, en dehors de tout champ disciplinaire bien défini, ce dont il s’agit exactement dans le projet. L’autre difficulté, c’est une difficulté d’expérience, est celle du bon format en termes de consortium de partenaires. Sur de tels sujets, on pourrait a priori réunir une multiplicité d’experts et de disciplines, mais au-delà d’une certaine taille, le consortium n’est plus viable, parce que les moyens sont limités. Cependant, sur de tels sujets, il faut s’assurer de ne pas passer à côté d’une expertise essentielle à la réussite du projet. Il y a un équilibre à trouver en termes de partenaires. Dans mon expérience, cet équilibre s’attache surtout chemin faisant et non pas dans la phase de montage. Quant aux leviers et l’existence de cadres encourageant ce type de démarche, bien sûr les MSH. J’ai aussi eu la chance de bénéficier d’un cadre particulièrement propice, celui d’un appel à projet régional qui par son nom même, Paris scientifiques, reposait sur le principe de la prise de risques. Ce n’est pas évident a priori qu’une collectivité territoriale comme une région aille financer un projet sur la fin du monde. Il existe parfois des cadres, des fenêtres qui s’ouvrent, des portes qui s’ouvrent, qu’il faut savoir saisir.
Concernant la plus-value d’une MSH, et à travers une MSH, de l’ensemble du réseau des MSH, je garde une certaine réserve quant à la réponse par mon statut de directeur de MSH, donc je ne peux plus me limiter au seul point de vue du chercheur. Aujourd’hui, ma vision a forcément changé, en bien, évidemment. Ce que je peux dire cependant, c’est que les MSH sont le lieu par excellence où l’on considère que les frontières et les usages disciplinaires doivent être interrogés. Par rapport au réseau national, ce que le réseau apporte, on le voit très bien à travers l’organisation d’un colloque comme celui d’aujourd’hui, c’est une capacité à mobiliser en réseau des acteurs qui parfois se connaissent, mais qui souvent ne se connaissent pas vraiment. Le réseau apporte cela. Et le réseau apporte aussi au quotidien, et je parle en tant que directeur d’une MSH un ensemble d’informations qui peuvent être des informations très concrètes, comme des informations stratégiques, sur l’évolution du paysage des SHS, l’évolution du paysage de la recherche. C’est très précieux pour se situer et se positionner par rapport à ce que l’on fait dans un cadre plus global. Il me semble qu’une MSH, comme le réseau national des MSH, peut en permanence offrir cet arrière-plan.
Le projet est officiellement clos puisque le contrat régional qui le finançait a couru jusqu’en 2019. Il a véritablement eu un effet structurant, c’est-à-dire qu’un certain nombre de relations ont pu être établies pendant ces trois années et ces relations continuent de produire leurs effets à travers des collaborations plus ponctuelles. Il y a eu un certain nombre d’activités de valorisation, des colloques et des séminaires, qui ont donné lieu à des publications d’actes sous des formes diverses, des livres, des numéros spéciaux dans des revues. Comme nous voulions absolument mettre l’accent sur la dimension création dans ce programme, ce qui a été l’événement de clôture du programme, c’était une grande exposition au Lieu unique de Nantes. Nous avions fait venir un très grand photographe japonais actuel, Naoya Hatakeyama, qui a documenté les événements de 2011 au Japon puisqu’il est originaire d’une des régions les plus touchées par le grand tremblement de terre et le grand tsunami, la région de Rikuzentakata, sa ville de naissance, qui a été entièrement dévastée par le tsunami, il n’en reste plus rien. Depuis 2011, Naoya Hatakeyama documente l’après-2011, l’après-catastrophe dans cette région fortement dévastée. Nous l’avions invité à présenter une série de photographies qui n’avaient pas encore été présentées en France, qui avaient déjà été présentées au Japon, aux États-Unis, au Mexique et différents lieux. C’est une exposition qui a duré deux mois et autour de laquelle nous avions organisé quelques événements, une coproduction avec une grande scène culturelle. C’était quelque chose de nouveau pour moi et pour la plupart des partenaires du programme. On n’avait jamais été dans cette démarche de coproduire quelque chose avec une scène nationale. Le public a été au rendez-vous, puisque sur deux mois, nous avons accueilli 8 000 visiteurs autour de cette exposition, avec un relais médiatique assez important, y compris au niveau national. Pour nous, c’était vraiment une belle réussite. Il y a eu un projet de dépôt de candidature à l’ANR pour poursuivre certains aspects du programme. La candidature a bien été déposée, mais nous n’étions pas prêts, et nous le savions. Pour être honnête, ce dont j’aurai besoin maintenant, c’est surtout de temps pour poursuivre. Si je suis venu assister à cette journée, pour être parfaitement honnête, c’est parce qu’on m’a invité pour vous parler de mon programme Atlantys. J’avais l’intention de participer à cette journée parce qu’elle rejoint des choses qui m’intéressent. Je m’étais inscrit pour la suivre en distance, comme beaucoup de participants aujourd’hui. Normalement, je devais la suivre depuis Nantes. J’avoue que c’est une démarche à laquelle je me soumets volontiers de plus en plus, parce qu’il faut aussi faire ce que l’on dit quand on travaille sur les questions qui m’intéressent d’environnement. Ne pas toujours se déplacer lorsque la technologie permet de participer à quelque chose de collectif, c’est bien aussi. Il y avait aujourd’hui l’enregistrement de cet entretien, donc je me suis déplacé, et évidemment, je ne le regrette pas. »
Ce podcast a été co-réalisé par la MSH Val-de-Loire et la Fondation Maison des sciences de l’homme, toutes deux membres du Réseau des plateformes Audio-Visio du Réseau national des MSH.
Sur le même thème
-
Retour d’expérience sur la 3e conférence de l’UNOC : contributions de la science, résultats et leço…
HerrmannMarineBarotSébastienCuninElisabethDuvailStéphanieBertrandSophiePringaultOlivierLa troisième conférence de l’UNOC s’est tenue en Juin à Nice. La conférence a été un succès en termes de nombre de participants en provenance de pays très divers. Mais quels ont été les résultats
-
Durabilité du "système chasse" au Sud Bénin
VodouheFifanouGaubertPhilippePrésentation de l'approche transdisciplinaire au sein du laboratoire mixte international (LMI) SHUNT sur la durabilité du "système chasse" au Sud Bénin
-
Présentation de points clefs des SHS importants pour les interactions avec les sciences de la nature
BenabouSarahDans cette séance, Sarah Benabou présente plusieurs notions clés des sciences humaines et sociales utiles pour dialoguer avec les sciences de la nature dans les projets interdisciplinaires sur l
-
Présentation des domaines des sciences écologiques et de certains points clefs importants pour les …
BarotSébastienDans cette séance, Sébastien Barot propose une introduction aux grands domaines des sciences écologiques et à leurs fondements épistémologiques et méthodologiques.
-
La posture des scientifiques pour l’interdisciplinarité
CarrièreStéphanieStéphanie Carrière (ethnoécologue, IRD) explore la question de la posture du chercheur ou de la chercheuse dans les démarches interdisciplinaires.
-
L’interdisciplinarité par les concepts ? La distance comme concept frontière en sciences de la cons…
RodaryEstienneL'interdisciplinarité invite a redéfinir les champs disciplinaires selon une approche dynamique., et à partager des concepts frontières, comme celui de distance
-
Formation à l’interdisciplinarité - Introduction
AvarreJean ChristopheMesclierÉvelyneRomagnyBrunoL'approche interdisciplinaire ou transdisciplinaire est au cœur des sciences de la durabilité, promues par l'IRD.
-
ANR PORTIC - Partie I : « Naviguer avec la base de données PORTIC » (coordinatrice : Christine Plum…
PlumejeaudChristineSofiaPierre NiccolòJournée de restitution du projet ANR PORTIC
-
ANR PROTIC - Introduction
MarzagalliSilviaJournée de restitution du programme ANR PORTIC - Introduction
-
ANR PORTIC - Partie II : « Projet PORTIC : négocier l’écriture d’une enquête » (coordinateur : Robi…
MouratRobin deCharlesLoïcMarzagalliSilviaGirardPaulMazoyerBéatriceJournée de restitution du programme ANR PORTIC
-
L’interdisciplinarité au défi du terrain : regards réflexifs sur l’EFR « Santé d’un socio-écosystèm…
L’École de formation à la recherche (EFR) « Santé d’un socio-écosystème minier » organisée par les Communautés de savoirs Géoressources et durabilité » et « Terres et sols » et l’université Félix
-
What if we modelled water as if our lives depended on it? - CoSavez-vous ? Eau bien commun
KruegerTobiasIn this seminar, Tobias Krueger will delve into practices of hydrological modelling to show what worlds they create...