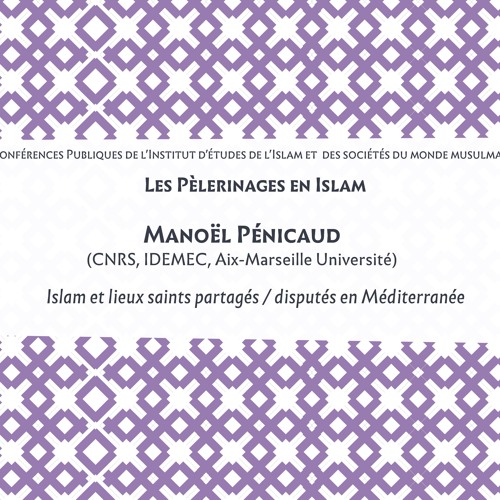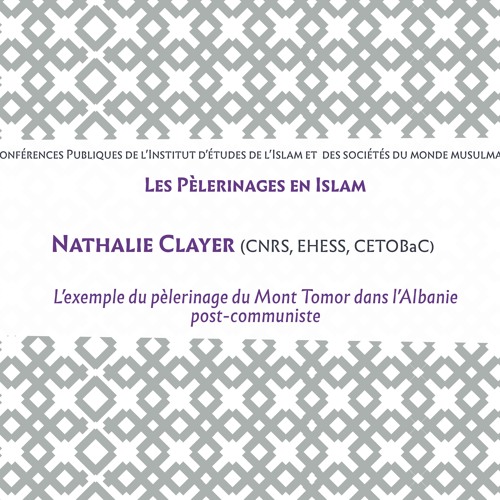Chapitres
- Présentation de Isil KaraKas00'49"
- Introduction06'14"
- Le droit à la vie12'00"
- Interdiction de la torture08'32"
- La liberté d'expression20'14"
- Principe de laïcité11'45"
- Conclusion01'51"
- Questions14'36"
Notice
Turquie et Droits de l'Homme - Isil KaraKas
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Une conférence du cycle La Turquie, aujourd'hui demain
Turquie et Droits de l'Homme par Isil KaraKas
Thème
Documentation
Documents pédagogiques
Texte de la 722e conférence de l’Université de tous les savoirs
donnée le 17 octobre 2009
Turquie et Droits de l’Homme par Işıl KARAKAŞ
Professeur de droit international public
Juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme, Strasbourg
Chers invités, Mesdames et Messieurs,
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour cette invitation. Je suis très heureuse d’être parmi des conférenciers de l’université de Tous les Savoirs et de trouver une possibilité de faire une petite contribution dans le cadre de la « Saison de la Turquie » en France.
La Turquie et la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
La Turquie, qui est membre du Conseil de l’Europe depuis 1949 se situe dans l’espace juridique européen formé par des États partageant les mêmes valeurs fondamentales, les mêmes principes juridiques et au sein duquel existe un réseau dense de règles positives communes et souvent exigeantes comme celles qui se sont développées dans le cadre du Conseil de l’Europe, notamment la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Turquie a ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme en 1954 mais elle n’a reconnu le recours individuel qu’en 1987 et elle a accepté la juridiction obligatoire de la Cour en 1990. Au moment de la reconnaissance, elle a déposé une déclaration représentant les caractéristiques d’une réserve qui a été déclaré ultérieurement invalide par la Commission européenne des Droits de l’Homme.
C’était la période du gouvernement d’Özal et son but était, après le coup d’état militaire du 12 septembre 1980, de s’ouvrir vers l’Europe en vue d’obtenir la candidature à l’Union européenne. A cette date, la Turquie a également ratifié la Convention contre la torture, elle fut l’un des premiers pays à la ratifier : la motivation venait du fait que l’on disait à l’époque (mais c’est toujours le cas aujourd’hui) : « le chemin de Bruxelles passe par Strasbourg. »
La Turquie, qui est déjà liée par la Convention et, notamment après la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour et donc sous l’influence du droit européen des droits de l’homme, s’est engagée à harmoniser son système juridique avec les normes européennes (modification de la Constitution en 2001 et en 2004 ainsi que 9 paquets de réformes pendant ces dernières années). Aujourd’hui, aucun juriste turc, praticien ou théoricien ne peut ignorer l’influence grandissante de la Convention et de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur le droit turc. Mais c’est justement sur ce point que les difficultés apparaissent : face aux textes réformés, l’interprétation restrictive des juridictions se poursuit dans le domaine des droits de l’homme.
La Turquie fait l’objet auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme de multiples recours qui aboutissent à de nombreuses condamnations. Le nombre total d’arrêts constatant au moins une violation de la Convention est de 1676 (au 1.1.2009), et à ce jour, 12 029 requêtes sont encore pendantes.
A travers plusieurs exemples, nous pouvons constater que les violations sont d’une nature souvent grave: elles concernent le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains, l’Habeas Corpus mais également la liberté d’expression ; ceci reflète bien la fragilité vis-à-vis du respect de la Convention en Turquie.
J’essayerai de faire un panorama des problèmes des droits de l’homme de la Turquie suivant la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et des réformes effectuées en vue d’harmonisation de son ordre juridique avec les normes européennes.
I. Cas no : 1 : « Les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques » : Droit à la vie et interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants.
A. Droit à la vie :
Le respect du droit à la vie est la condition nécessaire à l’exercice de tous les autres droits, et doit être protégé par la loi. L’obligation de l’État à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations.
Comme le montre le texte de l’article 2 lui-même, le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, l’article 2 ne donne pas carte blanche. Le non-encadrement par des règles et l’abandon à l’arbitraire de l’action des agents de l’État sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l’homme. Cela signifie que les opérations de police, en plus d’être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment délimitées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force (Makaratzis c. Grèce [GC] § 58, CEDH 2004XI).
A cet égard, il convient de rappeler que, pris dans son ensemble, le texte de cette disposition montre que le paragraphe 2 ne définit pas avant tout les situations dans lesquelles il est permis d’infliger la mort intentionnellement, mais décrit celles où l’on peut avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. L’emploi des termes « absolument nécessaire » donne à entendre qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement utilisé pour déterminer si l’intervention de l’État est « nécessaire dans une société démocratique » en vertu du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En particulier, le recours à la force doit être strictement proportionné à la réalisation des buts énumérés aux alinéas 2 a), b) et c) de l’article 2. Reconnaissant l’importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se former une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsque l’on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, Perk et al c. Turquie, 28 mars 2006).
L’État a donc non seulement une responsabilité négative mais aussi une obligation positive. L’obligation positive de protéger la vie implique une protection procédurale du droit à la vie et l’obligation pour les autorités nationales de mener une enquête efficace et indépendante sur tout recours à la force « absolument nécessaire » qui peut conduire à donner la mort permettant de conduire à l’identification et à la punition de responsables (McCann, Kaya c. Turquie, 19 février 1998).
Le premier exemple de cette obligation positive de mener une enquête efficace est l’arrêt Kaya. Le Gouvernement soutenait que la mort de Kaya était survenue au cours d’un affrontement avec les forces de sécurité et que celles-ci se trouvaient en état de légitime défense. Le problème est qu’il n’y a eu en fait aucune enquête officielle sur le décès de Kaya. Le procureur n’a fait aucune investigation sur les lieux. La Cour a été frappée par le fait que le procureur semblait avoir admis sans se poser de question que le défunt était un terroriste mort au cours d’un affrontement avec les forces de sécurité. Il n’a interrogé aucun soldat et n’a pris aucune mesure pour vérifier s’il restait des cartouches vides ou d’autres preuves dans la zone (§ 89). Le corps du défunt n’a pas été transféré dans un lieu plus sûr afin de procéder à des analyses plus approfondies du cadavre. D’après § 91 de l’arrêt : « La Cour constate que les incidents mortels sont chose tragique et courante dans le Sud-est de la Turquie en raison du manque de sécurité qui y règne. Cependant, ni la fréquence de violents conflits armés ni le grand nombre de victimes n'a d'incidence sur l'obligation, découlant de l'article 2, d'effectuer une enquête efficace et indépendante sur les décès survenus lors d'affrontements avec les forces de sécurité, et ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les circonstances manquent à bien des égards de netteté. ». Et elle conclut que les autorités n’ont pas pratiqué d’enquête effective sur les circonstances. Il y a donc eu violation de l’Article 2.
Cette obligation vaut également dans les cas où il n’a pas été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat (Tanrikulu, 8 juillet 1999). Dans l’arrêt Çakici (8 juillet 1999) la Cour a jugé que la Turquie a manqué à son obligation de protéger la vie dès lors qu’une personne arrêtée et détenue par la police a ensuite disparue (de même dans l’affaire Ertak, 9 mai 2000).
La Cour retient une présomption de causalité en l’absence d’explication de la part des autorités à la disparition et elle considère comme établie que la victime est décédée à la suite de sa garde à vue. De même, pour un individu placé en garde à vue, décédé au cours de celle-ci (arrêt Salman, 27 juin 2000). Il faut également empêcher le suicide des détenus (arrêt Tanribilir, 16 novembre 2000). L’exigence de mener une enquête officielle adéquate et effective est le point commun de tous ces arrêts.
Dans le cadre de l’article 2 comme la force employée doit être strictement proportionnée à la réalisation du but autorisé la Cour contrôle à la fois les actes d’exécution et l’organisation de l’opération en question. Cela concerne surtout une formation efficace et des instructions claires sur l’utilisation des armes à feu. (Isaak c. Turquie, 24 juin 2008, Beyazgul, 15 septembre 2009)
Les forces de sécurité, avant de se servir d’armes à feu, doivent être employées des moyens neutralisants tels que projectiles à gaz lacrymogène, balles plastiques ou grenades paralysantes, en vue de limiter le recours aux moyens susceptibles de causer la mort. Mais selon les circonstances de l’affaire la Cour trouve « souhaitable que de tels moyens soient répandus si l’on veut limiter progressivement le recours aux méthodes susceptibles d’entraîner la mort. Cependant, établir une telle obligation de principe sans tenir compte des circonstances d’une affaire donnée imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui, eu égard notamment au caractère imprévisible de la nature humaine. » (Perk et al § 72)
Bien évidemment les forces de l’ordre prendront toutes les mesures qu’ils estimaient raisonnablement nécessaires pour éliminer tout risque pour leur propre vie et celles de tiers. Mais ces mesures doivent être strictement proportionné au but poursuivi comme démontre le cas de la condamnation de la Turquie pour l’usage d’une mitrailleuse pour disperser les manifestants (Gulec 27 juillet 1998).
Le droit à la vie, une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, n’a pas toujours sa place primordiale dans les décisions des tribunaux internes. L’exemple le plus récent est la décision de l’Assemblée générale criminelle de la Cour de cassation (31 mars 2009) qui approuve l’usage d’armes à feu sur les manifestants jetant des pierres aux forces de l’ordre, ce qui a causé la mort d’une personne qui n’était même pas parmi les manifestants.
La motivation de cette décision réside dans la prise en compte des spécificités propres à la région (Sud-est) ayant provoqué agitation, crainte et affolement excusables chez les forces de l’ordre suite de leur psychologie « au feu du moment » et la limite n’a pas été dépassée. La différence avec la jurisprudence de la CourEDH surgit clairement sur ce point. Dans toutes les affaires des recours aux armes à feu, il y avait agression armée de l’autre partie et le but des forces de l’ordre était de tout faire pour éliminer tout risque pour leur propre vie et celles de tiers, cette condition de proportionnalité fait défaut dans la décision de la Cour de cassation en utilisant une critère de région, étrangère aussi à la CourEDH.
La Cour a constaté une violation de l’article 2 dans 186 arrêts (substantielle ou procédurale) pour la période de 1959-2009.
B : Interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants
L’article 3, l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements « consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques ». L’intégrité physique de la personne bénéficie d’une garantie absolue même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. La Cour considère (Selmouni c. France, 28 juillet 1999) que c’est tout usage de la force physique sur une personne en situation d’infériorité (privée de liberté) qui est prohibée et tombe sous le coup de l’article 3.
L’obligation pour l’État est d’abord négative - de ne pas faire - mais également une obligation positive de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté et de fournir des soins médicaux. Par exemple, dans l’arrêt Ilhan (27 juin 2000), la qualification de torture a été établie suite à l’absence de soins médicaux pendant 36 heures.
La qualification de torture est de nombre de 22 affaires pour la Turquie : la première qualification concerne l’arrêt Aksoy (18 décembre 1996), à propos du traitement de la pendaison palestinienne infligée par la police durant la garde à vue, de la falaka (Turkmen 19 décembre 2006), à propos du viol de la requérante par des policiers durant sa garde à vue (Aydin 25 septembre 1997).
L’obligation procédurale issue de l’article 3 est de faire une enquête officielle approfondie et effective en vue de l’identification des responsables (Dikme, 11 juillet 2000). Cela concerne le recours effectif dans le sens de l’article 13 de la Convention.
D’après l’arrêt Bati et autres, 3 septembre 2004 (§ 133-137) :
La notion de « recours effectif », lorsqu'un individu formule une allégation défendable de sévices graves subis alors qu'il se trouve dans les mains d'agents de l'Etat, requiert, outre le versement d'une indemnité là où il convient et sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, une enquête approfondie et effective. Quant au type d'enquête, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir dès qu'une plainte officielle est déposée. Même lorsqu'une plainte proprement dite n'est pas formulée, il y a lieu d'ouvrir une enquête s'il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu'on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement (voir, entre plusieurs autres, Özbey (déc.), no 31883/96, 8 mars 2001). Les autorités doivent avoir égard à la situation particulièrement vulnérable des victimes de torture et au fait que si un individu a subi des sévices sérieux, sa capacité ou sa volonté de se plaindre se trouvent souvent affaiblies (Aksoy, § 97 et 98).
L'enquête menée doit être « effective » en pratique comme en droit et ne pas être entravée de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'État défendeur (Aksoy, § 95 ; Aydin, § 103). Cette enquête doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (Aksoy, § 98).
S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'État de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000IV).
Certes, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. La Cour prend note du fait que les allégations de tortures subies pendant une garde à vue sont extrêmement difficiles à étayer pour la victime si elle a été isolée du monde extérieur et privée de la possibilité de voir médecins, avocats, parents ou amis, susceptibles de lui fournir un soutien et d'établir les preuves nécessaires (Aksoy, § 97). Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, la déclaration détaillée de la victime présumée au sujet de ces allégations, les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations médicales, notamment de la cause des blessures. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause des blessures ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme.
Pour qu'une enquête menée au sujet de torture ou de mauvais traitements commis par des agents de l'État puisse passer pour effective, l'on peut considérer, d'une manière générale, qu'il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements.
Cela suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique. Dans tous les cas, toutefois, un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête est indispensable (Aksoy, § 98).
En effet dans sa jurisprudence récente, la Cour a souligné l’impunité accordée aux agents des forces de l’ordre accusées de torture. (Bati et autres, Abdulsamet Yaman 2 novembre 2004, Teren Aksakal 11 septembre 2007).
En ce qui concerne la disparition d’une personne sous réserve de conditions particulières (proximité de la parenté, silence des autorités), il s’agit de traitement inhumain et dégradant ( Kurt, 25 mai 1998, §§ 133-134 ; Timurtaş, 13 juin 2000 ; Chypre contre la Turquie, 10 mai 2001, § 157) et également dans l’incendie volontaire des maisons dans les villages du sud-est par les forces de l’ordre turques, il s’agit là encore de traitement inhumain ( Selçuk et Asker, 24 avril 1998, Bilgin, 16 novembre 2000).
D’après les réformes des 2004-2005, il existe aujourd’hui un cadre législatif complet et comme dit le gouvernement la lutte contre la torture continue avec une politique de « tolérance zéro ».
II. Cas n° 2 : Liberté d’expression :
La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique dans laquelle existent « le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture » et elle « vaut non seulement pour les informations et idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population » (Handyside, 1976).
Cette liberté est particulièrement étendue mais elle est soumise à certaines limites, prévues à l’article 10/2. Les États disposent donc d’une certaine marge d’appréciation mais avec une interprétation étroite (Sunday Times, 1979) sous contrôle européen.
La Cour a conclu dans 170 (1959-2009) affaires à la violation de la liberté d’expression, notamment en raison de la condamnation par des cours de sûreté de l’État à la suite de la publication d’articles, de livres ou de déclarations ou concernant de la saisie de publications. Les violations de l’article 10 constatées dans ces affaires découlent surtout de l’absence de proportionnalité dans l’interprétation et l’application des dispositions législatives en ce qui concerne les limites de la critique portant sur les thèmes d’intérêt général en l’absence de toute incitation à la violence.
Il s’agissait surtout des débats de la « question kurde » qui demeure une question d’actualité sociopolitique et aussi de la « question arménienne » qui constitue l’un des débats les plus importants toujours en cours aux niveaux national et international. Souvent l’analyse des requérants n’est pas dans la lignée de celle des autorités nationales sur le sujet et dont l’opinion ou le discours contient des formulations qui peuvent heurter, choquer ou même inquiéter certains pour qui la Cour a affirmé que de telles idées bénéficiaient de la liberté d’expression. La Cour a toujours mis l’accent sur le droit du public de s’informer d’une autre manière sur la situation dans le Sud-est de la Turquie et de mener un débat démocratique sur la politique et l’histoire du pays. (Surek, no. 4, GC, 8 juillet 1999 § 58).
Concernant le cadre général des réformes dans le domaine de la liberté d’expression, un changement significatif a été réalisé par l’abrogation de la disposition constitutionnelle interdisant l’emploi des « langues prohibées par la loi » (art. 26).
Cela constitue une garantie de la liberté d’expression en permettant l’emploi des langues autres que le turc. La liberté de presse a bénéficié d’une mesure identique, qui abroge la règle posée par l’article 28 de la Constitution : « les publications ne peuvent pas être faites dans d’autres langues que le turc ». Mais, il est évident que la protection effective de la liberté d’expression, et particulièrement de la liberté de la presse sera assurée par les lois d’application et la pratique.
A cet égard, il faut noter l’abrogation de l’article 8 de la loi anti-terrorisme relatif à la propagande contre l’unité indivisible de l’État, et la modification de l’article 7 de la même loi qui précise que seul « l’appel à la violence » peut constituer une limite à la liberté d’expression, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ces modifications, avec celles du code pénal (ancien) (ainsi les articles 159 - réduction des peines relatives à l’offense à l’égard de l’État, et 312 - la propagande ne sera punie que si elle constitue un danger pour l’ordre public), ont considérablement contribué à diminuer les condamnations concernant la liberté d’expression. Mais l’expression non violente des opinions peut toujours faire l’objet de poursuites par le parquet en utilisant certaines dispositions maintenues dans le nouveau code pénal de 2005. Le nouveau code pénal dans son article 216 pose le critère du « danger évident et proche » pour la condamnation des personnes qui incitent à l’hostilité et à la haine; le terme « danger proche » a été délibérément préféré à celui de « danger immédiat » ou “présent” (ou manifeste) utilisé par la Cour Suprême américaine, sans doute parce qu’il confère une marge d’appréciation plus large aux procureurs concernant la proximité du danger.
L’article 301 du nouveau code pénal qui sanctionne toute insulte proférée à l’encontre de la nation turque (auparavant il y figurait la notion de « turquicité ») même dans sa version modifiée, continue d’être une source ambigüe en ce qui concerne l’interprétation des juridictions loin de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme relative à l’article 10 de la Convention.
La décision de l’Assemblé Civile de la Cour de cassation illustre bien l’exemple de l’usage de l’article 301 par les juridictions. Cette décision donne la possibilité aux personnes qui se sentent insultées par les déclarations d’Orhan Pamuk de prétendre à un dommage moral. (8 octobre 2009)
Ces articles ont continué à être utilisés pour poursuivre les journalistes, éditeurs ou académiques pour l’expression d’opinions non-violentes. Cette situation explique, malgré les réformes constitutionnelles et législatives, le grand nombre de requêtes pendantes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Mais l’autorité du droit international des droits de l’homme est renforcée dans l’ordre juridique turc car la réforme de l’article 90 de la Constitution prévoit la suprématie de la norme internationale sur la règle interne en cas de conflit. Cette provision revêt une grande importance dans l’ouverture de l’ordre juridique turc vers le droit européen des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il reste l’application de cette provision par les juridictions turques.
Dans le domaine de l’audiovisuel enfin, les émissions de radio et de télévision dans les « langues utilisées traditionnellement par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne », sont désormais autorisées.
La TRT (chaîne officielle) a commencé à diffuser des émissions en bosniaque, en arabe, en circassien et en deux dialectes kurdes. Finalement, en 2008, une nouvelle chaîne de TRT (TRT chesh) a débuté ses émissions uniquement en langue kurde. Avec une nouvelle réglementation de janvier 2004, les chaînes nationales privées peuvent également diffuser des émissions dans des langues autres que le turc, avec toutefois des restrictions de durée (4h par semaine pour la télévision et 5h pour la radio). Dans la même ligne, un règlement sur « l’enseignement dans différentes langues traditionnellement utilisées par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne » est entré en vigueur. En 2004, des cours privés ont commencé à enseigner le kurde (les élèves de ces cours doivent être âgés de plus de 15 ans) dans des villes de l’Est et du Sud-est de la Turquie. Mais la plupart de ces cours ont été fermés suite au manque d’étudiants.
La Cour a déjà eu l’occasion de conclure à la violation de l’article 10 pour l’interdiction d’interpréter une pièce de théâtre en kurde dans les salles d’une municipalité (Ulusoy et autres, 3 mai 2007). Malgré divers amendements en la matière, les obstacles continuent quant à l’expression en kurde en pratique.
D’après l’article 6/5 de la loi anti-terrorisme (adoptée en 2006), la publication de tout périodique contenant la propagande d’une organisation terroriste ou l’incitation à commettre une infraction dans le cadre des activités d’une organisation terroriste ou faisant apologie d’un crime commis ou de ses auteurs peut être temporairement suspendue par décision judiciaire pour une période de 15 à 30 jours. Cette suspension aurait un effet préventif concernant la parution des articles sur des sujets identiques. Il peut y avoir d’autres méthodes moins restrictives restant dans les limites du critère de « nécessaire dans une société démocratique ».
Ces exemples démontrent la position de la Turquie face à la jurisprudence de la CourEDH ; le grand nombre d’arrêt (170) constatant la violation de la liberté d’expression prouve le chemin à parcourir dans les décisions de juridictions internes en vue de se conformer aux normes européennes.
III. Cas n° 3 : Dissolution des partis politiques :
Le pouvoir de la Cour constitutionnelle turque concernant la dissolution d’un parti politique est soumis à un contrôle européen. Les États ne disposent que d’une certaine marge d’appréciation. Jusqu’à aujourd’hui, la Cour constitutionnelle turque a décidé la dissolution de 27 partis politiques avec la liquidation et le transfert de leurs biens au Trésor Public.
La Cour européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée sur les 9 affaires : Parti communiste unifié de Turquie (30 janvier 1998), Parti socialiste (25 mai 1998), Özdep (Parti de la liberté et de la démocratie) (8 décembre 1999), DEP (Dicle pour le Parti de la démocratie (10 décembre 2002), HEP (Parti du travail du peuple) (2002) Refah Partisi (13 février 2003), Parti de la démocratie et de l’Evolution et autres, 26 Avril 2005, Emek Partisi et Şenol, 31 Mai 2005, Demokratik Kitle Partisi et Elçi v. Turkey, 3 Mai 2007.
Les motifs des décisions de la Cour constitutionnelle sont : l’intégrité territoriale, l’indivisibilité de l’État, l’unité nationale (c’est-à-dire qu’il n’existe pas de minorité, ni de minorité nationale, hormis celles qui sont mentionnées dans le Traité de Lausanne) et être « un centre d’activités contraires au principe de laïcité ».
La Cour européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt du Parti communiste, considère que « même si le programme du parti parle du peuple, de la nation ou des citoyens kurdes, il ne les qualifie pas pour autant de minorité et ne revendique pas le bénéfice d’un traitement ou de droits particuliers, voire celui de se séparer du reste de la population de la Turquie » (§ 56).
La Cour considère que la caractéristique de la démocratie est la résolution des problèmes par le dialogue et sans recours à la violence. Mais elle admet également que le programme politique d’un parti peut cacher des objectifs et des intentions différents de ceux qu’il affiche publiquement. Il faut donc comparer le contenu du programme avec les actes et prises de position de ses responsables. Concernant le Parti socialiste qui vise un projet pour l’établissement d’un système fédéral (ce qui est incompatible avec les principes et structures actuels de l’État turc) ne le rendait pas contraire aux règles démocratiques. D’après la Cour : « il était de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettaient en cause le mode d’organisation actuel d’un État » dans la mesure où ils ne visaient pas à porter atteinte à la démocratie elle-même.
Suivant la jurisprudence de la Cour un parti politique peut mener campagne en faveur d’un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l’État mais à deux conditions :
- les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points de vue légaux et démocratiques ;
- le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux.
Donc, un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas les règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci, ainsi que la méconnaissance des droits et libertés ne peut se prévaloir de la protection de la Cour. Mais la Cour considère que la dissolution définitive d’un parti politique est une mesure radicale.
Dans l’arrêt Dicle (DEP) du 10 décembre 2002, la Cour, jugeant toujours la sévérité de la mesure (la dissolution), estime que la prise d’une mesure à l’encontre des propos de l’ex-président qui avait fait des déclarations aboutissant à la dissolution du parti, pouvait répondre à un besoin social impérieux (et une instruction pénale avait été déclenchée contre lui). Un seul discours ne pouvait constituer une raison suffisante justifiant une sanction aussi générale que la responsabilité individuelle déjà engagée au plan pénal.
L’arrêt Refah Partisi (GC, 13 février 2003) souligne l’incompatibilité de la loi islamique avec la Convention (§ 71) et précise donc les limites dans lesquelles les partis politiques peuvent mener des activités bénéficiant de la protection de la Convention : Utiliser les moyens légaux démocratiques, respecter les règles de la démocratie et ne pas viser la destruction de la démocratie.
La Cour estime qu’un État peut imposer aux partis politiques « le devoir de respecter et de sauvegarder les droits et libertés garantis par la Convention ainsi que l’obligation de ne pas proposer un programme politique en contradiction avec les principes fondamentaux de la démocratie » (§ 103).
Eu égard à l'absence de projet politique de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays et/ou à l'absence d'une invitation ou d'une justification de recours à la force à des fins politiques, la dissolution ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux » et ainsi comme étant « nécessaire dans une société démocratique ». (Demokratik Kitle Partisi et Elçi v. Turkey, 3 Mai 2007 § 33)
Avec des modifications apportées à la constitution en 2001 (article 69) la Cour constitutionnelle pourrait prévoir des sanctions autres que la dissolution (privation de l’aide de l’État). Aussi une majorité des trois cinquièmes est nécessaire pour l’interdiction d’un parti. Elle avait appliqué cette méthode concernant le procès d’AKP en 2008 et avait décidé réduire le montant alloué non pas à la dissolution parce que la majorité qualifiée n’était pas requise. Dès lors, la dissolution des partis politiques en Turquie est devenue plus difficile.
La dernière décision de dissolution date de 2003 pour le parti HADEP qui est toujours devant la CourEDH et dont le recours pour la dissolution du parti DTP est toujours pendant devant la Cour constitutionnelle.
IV. Cas no. 4 : Principe de laïcité
En Turquie, pays majoritairement musulman, le principe de laïcité est considéré comme un principe fondateur de la République. Le problème majeur concernait le port du foulard dans les établissements scolaires.
Une des premières affaires turques concernait une étudiante licenciée en pharmacie qui n’a pas pu obtenir son diplôme au motif qu’elle n’avait pas produit une photographie d’identité sur laquelle elle apparaissait sans foulard. Dans sa décision Karaduman du 3 mai 1993, la Commission européenne des Droits de l’Homme considérait que le port du foulard islamique était assimilé à « une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas la religion musulmane ou qui adhèrent à une autre religion, susceptible de mettre en cause aussi bien l’ordre public que le respect dû aux opinions d’autrui ».
Dans l’arrêt Leyla Şahin du 10 novembre 2005 (GC), l’interdiction du foulard dans les universités était considérée comme nécessaire dans une société démocratique avec les références aux arrêts de la Cour constitutionnelle turque ; la laïcité est un principe de valeur constitutionnelle en raison de l’expérience historique du pays et des particularités de la religion musulmane, et qu’elle constitue l’une des conditions indispensables de la démocratie, le garant de la liberté de religion et du principe d’égalité.
La Cour a considéré le foulard comme signe extérieur fort et ayant un effet prosélytique. Selon la Cour, l’article 9 ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction religieuse et il ne confère pas aux individus agissant de la sorte le droit de se soustraire à ses règles. Elle tient compte de la large marge d’appréciation de l’État en la matière.
La Cour a relevé que la République s’était construite autour de la laïcité, principe ayant acquis valeur constitutionnelle ; que le système constitutionnel attachait une importance primordiale à la protection des droits des femmes ; que la majorité de la population de ce pays adhérait à la religion musulmane et que pour les partisans de la laïcité le voile islamique était devenu le symbole d’un islam politique exerçant une influence grandissante.
La Cour a ainsi estimé que la laïcité était assurément l’un des principes fondateurs de l’État qui cadrent avec la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme et de la démocratie. Elle a ainsi pris acte de ce que la laïcité en Turquie constituait le garant des valeurs démocratiques et des principes d’inviolabilité de la liberté de religion et d’égalité, qu’il visait également à prémunir l’individu non seulement contre des ingérences arbitraires de l’État mais aussi contre des pressions extérieures émanant des mouvements extrémistes et que la liberté de manifester sa religion pouvait être restreinte afin de préserver ces valeurs.
Elle en a conclu qu’une telle conception de la laïcité lui paraissait être respectueuse des valeurs sous-jacentes à la Convention dont la sauvegarde peut être considérée comme nécessaire à la protection du système démocratique en Turquie (Leyla Sahin, § 114).
Dans l’affaire Köse et autres contre la Turquie (Décision du 24 janvier 2006, requête n° 26625/02), la Cour a également estimé clairs et parfaitement légitimes les principes de laïcité et de neutralité de l’école ainsi que du respect du principe du pluralisme, pour justifier le refus d’accès en cours d’élèves voilées à la suite du refus de ces dernières de ne pas porter le foulard islamique dans l’établissement scolaire, nonobstant la réglementation en la matière (Kervanci contre la France, 4 décembre 2008). La Cour rappelle avoir jugé qu’il incombait aux autorités nationales, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elles jouissent, de veiller avec une grande vigilance au respect du pluralisme et à la liberté d’autrui.
La Cour réitère qu’une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion, et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure l’article 9 de la Convention (Refah Partisi § 93).
Dans le cadre de l’enseignement religieux dans les écoles (Hasan et Eylem Zengin, 9 octobre 2007), Melle Zengin doit suivre le cours de « culture religieuse et connaissance morale ».
Mais selon le programme du cours de « culture religieuse et connaissance morale », l'enseignement en la matière est dispensé dans le respect du principe de laïcité et de la liberté de pensée, de religion et de conscience, et vise à « développer une culture de paix et un contexte de tolérance ». Il tend également à transmettre des connaissances concernant l'ensemble des grandes religions. L'un des buts suivis dans ce programme consiste à éduquer des hommes « ayant des connaissances sur le développement historique du judaïsme, du christianisme, de l'hindouisme et du bouddhisme, sur leurs spécificités principales et le contenu de leur doctrine, et pouvant apprécier selon des critères objectifs la place de l'islam face au judaïsme et au christianisme ».
Pour la Cour, les intentions décrites ci-dessus sont à l'évidence conforme aux principes de pluralisme et d’objectivité consacrés par l’article 2 du Protocole N° 1, droit à l’instruction.
A cet égard, elle constate que le principe de laïcité, tel que garanti par la Constitution turque, interdit à l'État de témoigner une préférence pour une religion ou croyance précise, guidant ainsi l'État dans son rôle d'arbitre impartial, et implique nécessairement la liberté de religion et de conscience (Leyla Şahin § 113).
Quant aux manuels utilisés dans le cadre de ce cours, leur examen montre qu'ils ne se contentent pas de transmettre des informations sur la connaissance des religions en général ; ils contiennent également des textes qui tendent à inculquer aux élèves les grands principes de la religion musulmane et donner un aperçu général de ses rites cultuels, tels que la profession de foi, les cinq prières quotidiennes, le ramadan, le pèlerinage, les notions d'anges et de créatures invisibles, la croyance en l'autre monde, etc.
De même, les élèves doivent apprendre par cœur plusieurs sourates du Coran, étudier, illustrations à l'appui, les prières quotidiennes et passer des épreuves écrites à des fins d'évaluation.
A cet égard, la Cour estime que, dans une société démocratique, seul un pluralisme éducatif peut permettre aux élèves de développer un sens critique à l'égard du fait religieux dans le cadre de la liberté de pensée, de conscience et de religion.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que l'enseignement dispensé dans la matière intitulée « culture religieuse et connaissance morale » ne peut être considéré comme répondant aux critères d'objectivité et de pluralisme et, plus particulièrement dans le cas concret des requérants, comme respectant les convictions religieuses et philosophiques du père de Mlle Zengin, qui adhère à la confession des alévis et au sujet de laquelle le contenu du cours demeure manifestement insuffisant.
Le système offre une possibilité de dispense uniquement à deux catégories d'élèves de nationalité turque, à savoir ceux ayant des parents adhérant à la religion chrétienne ou juive. La Cour estime que cette situation est critiquable, dans la mesure où « s'il s'agit bien d'un cours sur les différentes cultures religieuses, le fait de limiter le caractère obligatoire du cours aux enfants musulmans n'aurait pas lieu d'être. Par contre, si le cours vise essentiellement à enseigner la religion musulmane, en tant que cours sur une religion spécifique, il ne devrait pas avoir de caractère obligatoire pour préserver la liberté religieuse des enfants et de leurs parents ». Cela est d'autant plus vrai qu'aucune possibilité de choix appropriée n'a été envisagée pour les enfants des parents ayant une conviction religieuse ou philosophique autre que l'islam sunnite, et que le mécanisme de dispense est susceptible de soumettre ceux-ci à une lourde charge et à la nécessité de dévoiler leur convictions religieuses ou philosophiques afin que leurs enfants soient dispensés de suivre les cours de religion.
Le suivi de l’exécution de cet arrêt est toujours devant le Comité des Ministres. La Turquie doit procéder aux modifications nécessaires dans le contenu des livres de classe.
Conclusion
Les réformes de ces dernières années sont considérables. Mais il reste à poursuivre ces réformes afin de renforcer la démocratie libérale par la garantie efficace des droits de l’homme, tout particulièrement dans les domaines de la liberté d’expression et de la liberté d’association et de continuer la lutte contre les mauvais traitements.
La jurisprudence de la Cour joue et jouera toujours un rôle très important, comme l’accélérateur principal, dans le rapprochement du droit turc vers le droit européen des droits de l’homme.
Les juridictions turques, qui étaient largement liées aux principes constitutionnels restrictifs, devraient s’orienter vers l’autorité du droit de la Convention qui avait déjà sa base juridique dans la Constitution (Article 90 modifié).
Par l’interprétation conforme à la Convention, même les dispositions peu favorables à une protection efficace des droits de l’homme dans une société démocratique peuvent être appliquées dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Mais, bien évidemment, pour cela il faudrait une autre logique en vue d’établir les valeurs fondamentales de la démocratie en Turquie.
Je vous remercie pour votre attention.
Dans la même collection
-
La Turquie, membre de l'Union Européenne : un fardeau ou un atout ?- Seyfettin Gursel
Une conférence du cycle La Turquie, aujourd'hui demain La Turquie, membre de l'Union Européenne : un fardeau ou un atout ? par Seyfettin Gursel
-
L'Islam et le pluralisme en Turquie - Kenan Gürsoy
GürsoyKenanUne conférence du cycle La Turquie, aujourd'hui demain L'Islam et le pluralisme en Turquie par Kenan Gürsoy Ambassadeur plénipotentiaire de Turquie près le Saint Siège
-
Sexualité et modernité - Nilüfer Gole
GöleNilüferSexualité et modernité par Nilüfer Gole Une conférence du cycle La Turquie, aujourd'hui demain
-
La politique culturelle en jeu : le renouveau culturel en Turquie - Serhan Ada
Une conférence du cycle La Turquie, aujourd'hui demainLa politique culturelle en jeu : le renouveau culturel en Turquiepar M. Serhan Ada, Professeur Université de Bilgi à Istanbul
-
L'Islam et Politique : Turquie - Ali Bayramoglu
BayramogluAliUne conférence du cycle La Turquie, aujourd'hui demain L'Islam et Politique : Turquie par Ali Bayramoglu
-
Les entrepreneurs en Turquie - Murat Yalçintas
YalçintasMuratUne conférence du cycle La Turquie, aujourd'hui demain Les entrepreneurs en Turquie par Murat Yalçintas
-
La question chypriote - I.Turkmen, G.Vassiliou
ΒασιλείουΓιώργοςLa question chypriote par M. Ilter Turkmen, Ancien Ministre des Affaires étrangères et M. Georges Vassiliou, Ancien Président de la République Chypriote Une conférence du cycle La Turquie : aujourd
-
La politique étrangère de la Turquie - Beryl Dedeoglu
La politique étrangère de la Turquie par Mme Beryl Dedeoglu, Directrice du département des relations internationales à l'Université Galatasaray Une conférence du cycle La Turquie : aujourd'hui,
-
La Turquie et L'Union européenne - Cengiz Aktar
AktarO. CengizLa Turquie et L'Union européenne Par M. Cengiz Aktar, Professeur Université Bahçesehir
Sur le même thème
-
Interview avec Rachida Chih
ChihRachidaL'entretien est mené à propos des ouvrages The Presence of the Prophet in Early Modern and Contemporary Islam, volumes 1, 2 et 3.
-
Mer de Chine du Sud : revendications d'espaces maritimes contradictoires et lectures divergentes du…
LasserreFrédéricAdoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994, la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) compte aujourd’hui 169 Parties, dont l’Union
-
-
Prière
Marongiu-PerriaOmeroComme toute religion, l’islam est défini par des caractéristiques cultuelles.
-
Chrétiens
HeybergerBernardLoryPierrePisaniEmmanuelD’après la tradition musulmane, l’islam est présenté comme l’héritier du christianisme, face auquel il s’est construit dans un jeu de miroir mais aussi d’opposition.
-
Hajj
SeuratLeïlaBoualiHassanChiffoleauSylviaLe pèlerinage vers les Lieux saints est une des prescriptions canoniques de l’islam.
-
L’Islam a-t-il (ré)inventé la carte du monde ?
ValletÉricConférence d'Éric Vallet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « L’Islam a-t-il (ré)inventé la carte du monde ? ».
-
Islam et lieux saints partagés/disputés en Méditerranée
PénicaudManoëlManoël Pénicaud est anthropologue, chargé de recherche au CNRS et membre de l’Institut d’ethnologie méditerranéenne européenne et comparative (CNRS, Aix-Marseille Université).
-
Les États et l’islam radical face au culte des saints au XXe et XXIe siècle : tolérer, réguler ou é…
ZarconeThierryHistorien et Anthropologue, Thierry Zarcone est Directeur de recherches au CNRS, rattaché au GSRL (Groupe Sociétés Religions Laïcité) et chargé de cours à l’Institut d’études politiques d’Aix en
-
L'exemple du pèlerinage du Mont Tomor dans l'Albanie post-communiste
КлејерНаталиHistorienne, Nathalie Clayer est directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS rattachée au Centre d'Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (Cétobac) qu’elle a
-
Pèlerinages d’empire : l’Europe coloniale et le hajj
ChantreLucHistorien, Luc Chantre est chercheur associé au Centre français d’archéologie et de sciences sociales (CEFAS).
-
De la caravane à l’avion : l’expérience du monde dans le voyage à La Mecque
ChiffoleauSylviaChargée de recherche au CNRS et rattachée au Laboratoire de Recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) à Lyon, Sylvia Chiffoleau est historienne.