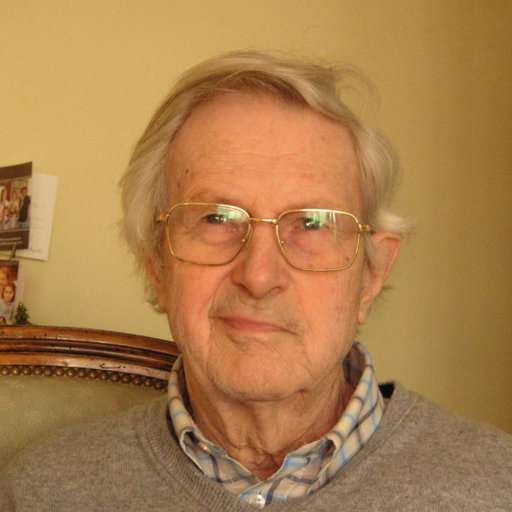Notice
CLAUDE MASSET (PARIS, 2022)
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
CLAUDE MASSET : le professeur d'histoire devenu responsable d'une équipe CNRS
Ma carrière de préhistorien a commencé modestement en 1961, quand je me décidai à suivre des cours de Préhistoire à la Sorbonne. Le sujet m’intéressait, mais je n’y étais nullement formé : j’avais alors 36 ans, et enseignais l’histoire au lycée Michelet à Vanves.
En 1963 j’ai participé comme stagiaire à la fouille d’Arcy-sur-Cure sous la direction d’André Leroi-Gourhan, lequel était assisté par Michel Brézillon et par le père Hours. L’année suivante, je fus de la première équipe de Pincevent. En 1965, André Leroi-Gourhan, le « patron », me confia la responsabilité du sauvetage d’une première sépulture collective (à Neuvy-en-Dunois, Eure-et-Loir), puis d’une seconde en 1966 (à Marolles-sur-Seine, Seine-et-Marne). Ce sont ces hasards qui m’ont spécialisé dans cette partie de la préhistoire. Fort de la caution de Leroi-Gourhan, je fis des offres de service à plusieurs directeurs de circonscriptions ; ce fut Roger Agache qui me proposa l’allée mégalithique de la Chaussée-Tirancourt, dans la Somme. Je l’ai fouillée avec Jean Leclerc de 1968 à 1975, à l’aide d’une petite équipe dont plusieurs membres m’ont accompagné sur d’autres sites – plusieurs ont fait carrière en préhistoire.
La fouille d’Essômes-sur-Marne (Aisne) s’est intercalée entre 1971 et 1973. Puis vint l’allée couverte de Méréaucourt (Somme), elle aussi proposée par Roger Agache : 1981-1991 ; et finalement celle du très petit site de Fromelennes dans les Ardennes (1995).
La thèse prévue à l’origine sur les sépultures collectives n’a jamais vu le jour. Dans l’intervalle, en effet, je m’étais intéressé à l’anthropologie des populations dont je fouillais les restes. Je trouvais incroyables les répartitions d’âges proposées par les anthropologues, et me mis en tête de détecter où se nichait l’erreur. Il y avait en fait plusieurs sources de déviations systématiques, que je commençais à publier à partir de 1971. S’en est suivi une thèse « de troisième cycle » en 1975 (« Problèmes de démographie préhistorique », puis en thèse « d’état » en 1982 (« Estimation de l’âge au décès par les sutures crâniennes »). En 1984 me fut confié un « Groupement de Recherches » du CNRS (devenu par la suite une « Recherche Coopérative sur programme). Cela qui faisait de moi un cas à peu près unique : un professeur de collège responsable d’une équipe CNRS. Ce dernier n’avait jamais voulu de moi, en dépit de plusieurs candidatures. J’obtins quand même en 1988 un très modeste « poste d’accueil », pour un an renouvelable (cela à l’occasion d’une grève des commissions de recrutement !). Ce poste, deux fois renouvelé, me conduisit jusqu’à ma retraite en 1991. Cette dernière n’interrompit pas mes travaux. Je ne raconterai pas mes bagarres avec l’anthropologie internationale pour faire admettre mes conclusions. Un tournant décisif fut atteint en 1989 lorsque parut, dans un manuel américain, mon « Age Estimation on the Basis of the Cranial Sutures ». Mais la bataille n’a vraiment été gagnée (et encore…) qu’au début des années 2000. Dans les années 90 j’avais surtout travaillé à la taphonomie des tous-petits, et sur des traces d’organisation sociale au Néolithique… et aussi, bien sûr, sur les publications de mes fouilles.
Au cours de toute cette période j’ai assez peu contribué aux activités de notre Equipe d’Ethnologie Préhistorique ; en revanche, j’y trouvais un élargissement de mes horizons, un intérêt non feint pour mes travaux, et la chaleur de l’amitié. Pendant assez longtemps, Jean Leclerc et moi étions seuls à nous spécialiser dans l’étude des nécropoles. Depuis sont arrivés Philippe Chambon (un ancien de
Méréaucourt), et son groupe « FUN » (FUNéraire). Il va sans dire que je fais partie avec plaisir de ce récent dispositif. Hélas, l’âge venant, je n’y participe pas beaucoup.
Retardées par les lenteurs et les difficultés de l’étude anthropologique des inhumés, la publication des grandes sépultures collectives évoquées plus haut n’est intervenue que longtemps après leur fouille :
1) en 2006 : (coll. avec J. Leclerc) L’évolution de la pratique funéraire dans la sépulture collective néolithique de la Chaussée-Tirancourt (Somme). Bulletin de la Société Préhistorique Française, 103/1 (janvier-mars 2006), p. 87-116.
2) en 2013 : (coauteurs A. Blin, M. Girard, D. Jagu, F. Mahzoud, J. Pelegrin, H. Plisson) L’allée couverte du Bois d’Archemont à Méréaucourt (Somme). Gallia Préhistoire 55, p. 73-179.
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Dans la même collection
-
SOUVENIRS SUR TABLE EN N/B (PARIS, 2022)
KarlinClaudineLavalléeDanièleJulienMichèleLe GueutErwan« Dans ce désert morose, telle photo, tout d’un coup, m’arrive ; elle m’anime et je l’anime » Roland Barthes (1980 : 19).
-
FRANCOISE DOUAU-GUILLON (NANTERRE, 2022)
DouauFrançoiseDes fouilles archéologique à la restauration de mobilier archéologique au musée d'Archéologie Nationale
-
MARIE-BARBARA LE GONIDEC (RENNES, 2022)
Le GonidecMarie-BarbaraLa découverte de l'ethnomusicologie et de la culture matérielle
-
-
JEAN-MICHEL BONJEAN (LONS-LE-SAUNIER, 2022)
BonjeanJean-MichelLa modernité des techniques de fouille
-
-
JACQUES MEISSONNIER (DIJON, 2021)
MeissonnierJacquesDe l'enseignement en histoire au service régional d'archéologie
-
-
CLAUDINE KARLIN (LE PRE-SAINT-GERVAIS, 2022)
KarlinClaudineUne carrière au service des chasseurs-cueilleurs magdaléniens
-
JEAN-PIERRE OLIVIER DE SARDAN (PARIS, 2022)
Olivier de SardanJean-PierreDu stage au Centre de Formation aux Recherches Ethnologiques à la thèse en ethnologie
-
-
GAËLLE DUMARCAY (MONTEREAU-FAULT-YONNE, 2022)
DumarçayGaëlleSe spécialiser dans l'étude des structures de combustion
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
Claude Masset (Paris, 2016)
MassetClaude"Les méthodes de Leroi-Gourhan sont pensées pour les sols d'habitat. Dans une sépulture collective, il n'y a pas de sol, mais il faut essayer d'y voir clair."