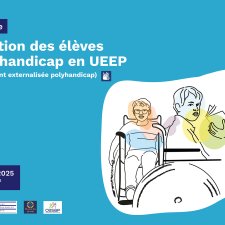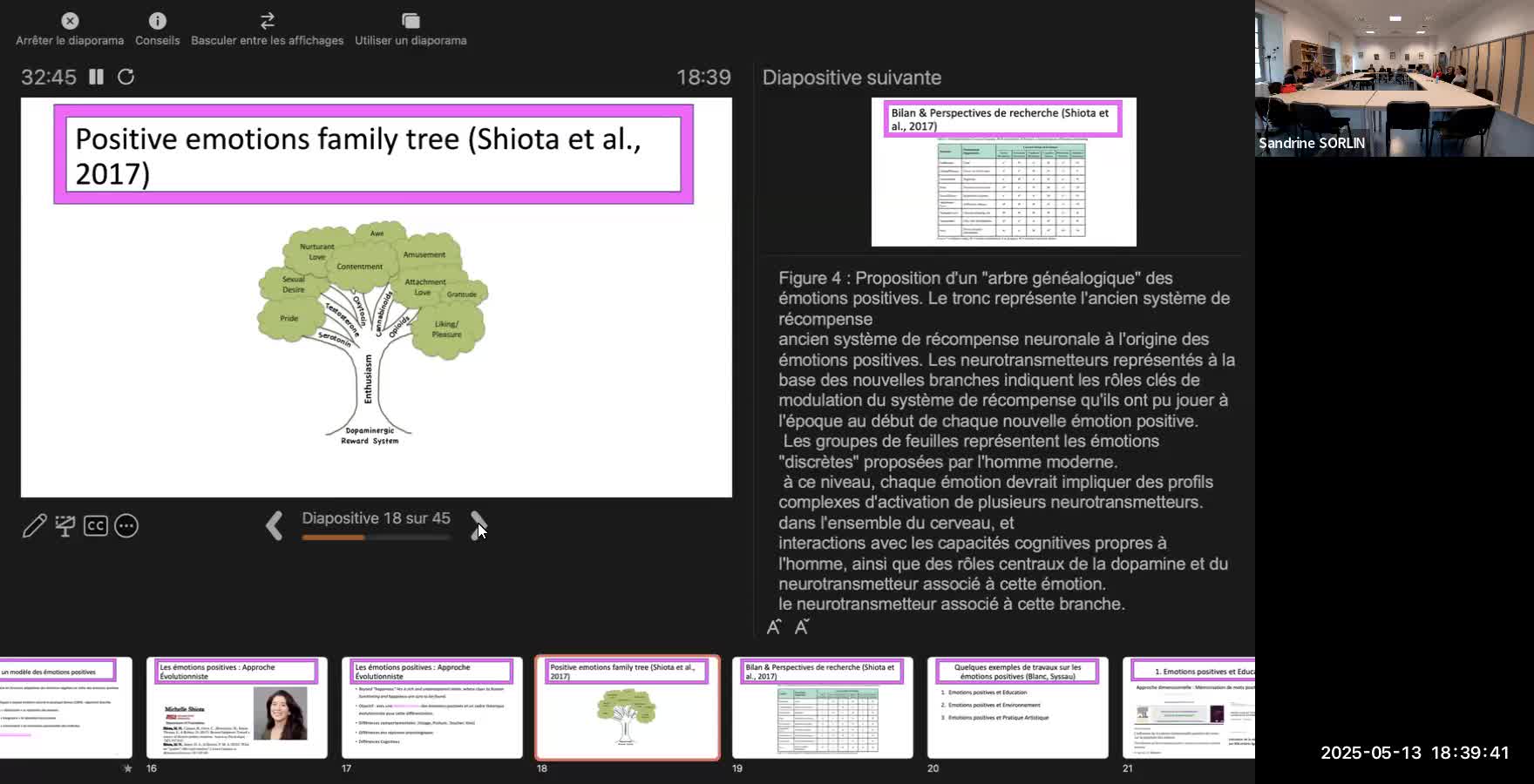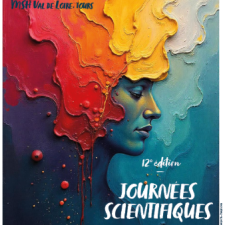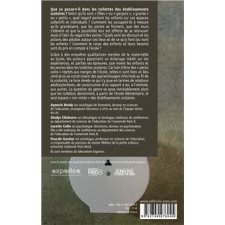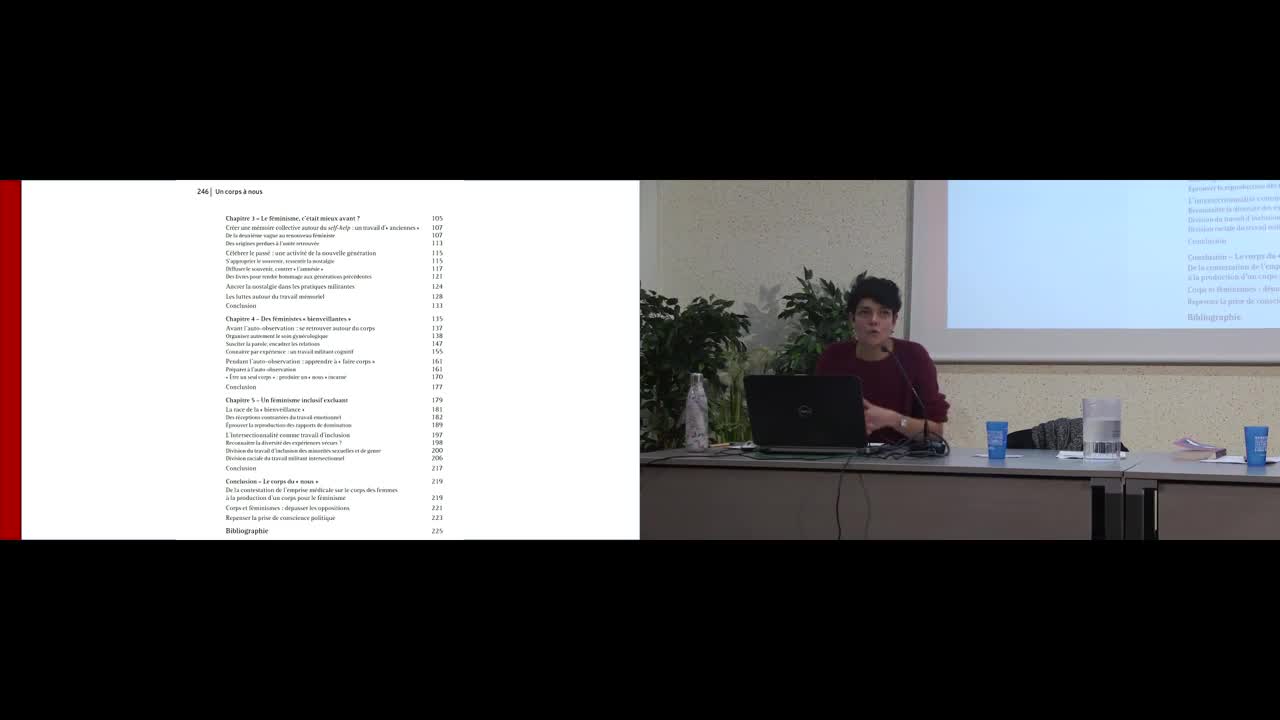Notice
"L’avènement du « corps » aujourd’hui entre sens commun et sens savant", semi-plénière avec la participation de Jean-Claude Schmitt, Alain Corbin, Georges Vigarello et Irène Thèry
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
L’avènement du « corps » aujourd’hui entre sens commun et sens savant
Coordination : CE de l’AFS, Axe « Corps, Santé, Société » à la MSH-Paris Nord. Séance animée par Dominique Memmi
Intervenants :
- Jean-Claude Schmitt
- Alain Corbin
- Georges Vigarello
- Irène Thèry
Dans le champ savant, comme dans les pratiques sociales, le « corps » est devenu un incontournable. De nombreuses pratiques et micro-mobilisations sociales tendent aujourd’hui à le présenter comme indispensable pour penser correctement des questions aussi diverses que la « perte » (il faudrait retrouver du corps pour « faire son deuil »), l’ « origine » (pour les enfants adoptés ou ceux nés de procréation artificielle), l’identité « vraie » (grâce aux opérations sur transexuels), le rapport à l’enfant (amélioré par l’allaitement, ou les premiers soins masculins au bébé) mais aussi sa différence (les « minorités visibles »). Le corps serait devenu « bon à penser » (mais aussi à regarder, à toucher, à retrouver) pour l’équilibrepsychique, la fortification du lien social, la fortification des identités individuelles et collectives... Inscription d’un thème « corps » au programme de l’agrégation de sciences sociales ; publication deplusieurs manuels de Sociologie du corps, de deux Dictionnaire du corps ; référence-révérence sur le plan épistémologique à l’objet et au mot « corps » dans les contenus et les titres des ouvrages d’histoire (Histoire du corps), d’anthropologie (Corps et affects dirigé par Françoise Héritier) ; ou de sociologie;élection d’un texte très longtemps inaperçu de Marcel Mauss - Les Techniques du corps, comme texte séminal, singulière insistance de Pierre Bourdieu à la fin de sa vie sur la connaissance « par corps » : au coeur des sciences sociales aussi, l’intérêt pour le "corps", à la fois comme objet et comme instrument de lecture du monde social, qui avait émergé dans les années 70, s'est fortement intensifié, tout en s'infléchissant idéologiquement, depuis les années 90. Enfin, rapprochement à la fois inévitable et hasardeux : avec le développement des sciences cognitives, des neuro-sciences, l’apparition d’une neuropsychologie voire récemment d’une neuro-économie, ou l’omniprésence des médecins et biologistes dans l’espace public comme auteurs d’essais sur le monde social, bien d’autres indices tendent à montrer que le donné physique, sous l’espèce également du « biologique », est devenu un prêt à penser. Sont ici en oeuvre des logiques internes, propres aux différents champs scientifiques. Mais elles ne suffisent pas à expliquer l’infléchissement simultané de multiples pratiques sociales. Bachelard fait de « l’expérience première » et sensorielle une expression privilégiée du sens commun et le premier obstacle à la progression de l’esprit scientifique. Aurait-t-on affaire ici à une sourde et générale activation d’un "physicalisme ordinaire" ? Y-a-t-il porosité à cet égard entre univers savant et pratiques ordinaires ? Et si oui, comment l'expliquer ? Tout se passe comme si cette histoire, toujours en tension, s’était déroulée en deux temps : une reformulation - "matérialiste", "physicaliste" ? – de la définition de l'individu et du lien social, dans lesannées 60 sous l’effet, notamment, du féminisme ; une plus récente tentation au naturalisme, depuissurtout les années 90, avec ses significations idéologiques, incitant à penser le monde social à l’aide du corps, voire du biologique. Sous la concrétion de ces deux moments se profile-t-il une matrice commune, une interprétation sociétale latente, une nouvelle « lecture partagée» de la société sur elle-même (Veyne,2008) ? Le problème de l’interprétation et des mots pour le dire se pose tout particulièrement pour le second de ces moments. Entreprise de « naturalisation », de « biologisation » du social et du psychisme ? « Retour » dénié du physicalisme ? Ou simple manifestation parmi d‘autres de l’appétence sociétale retrouvée pour les pensées « concrètes », la force de « l’expérience » vécue, le crédit du « témoin » ayant assisté à« l’événement » ?
Pour réfléchir à cette question seront invités des auteurs ayant été, mais de l’intérieur des sciences sociales - et non des sciences de la vie - parties prenantes de cette histoire savante et/ou aptesaujourd’hui à en objectiver les étapes et les effets : Jean-Claude Schmitt, un des représentants historiques – par La raison des gestes dans l'Occident médiéval notamment – de cette tendance à avoir fait du corps un instrument de lecture privilégié du social ; Alain Corbin et Georges Vigarello, codirecteurs d’une Histoire du corps en trois volumes ; enfin Irène Thèry, sociologue et plus récemment engagée dans cette voie à partir de sa Distinction de sexe. Aucune intervention en forme ne sera demandée aux intervenants mais leur participation à une réflexion collective, dûment préparée et encadrée, afin d’objectiver :
- les logiques proprement scientifiques qui furent au principe de l’intérêt pour la dimension corporelle dans leurs travaux,
- la réception de leurs travaux de ce point de vue (mésinterprétations éventuelles, usages dévoyés),
- les logiques sociales éventuellement communes qui pourraient soutenir cette production scientifique, sa bonne réception, en même temps que la réflexivité sociale. Une ligne interprétative leur sera à cet égard proposée pour se voir débattue.
Intervention / Responsable scientifique
Avec les mêmes intervenants et intervenantes
-
"Vers une dénaturalisation du genre, de la sexualité et de la famille ?", semi-plénière avec la par…
FassinÉricThéryIrèneVers une dénaturalisation du genre, de la sexualité et de la famille ? Coordination : Salima Amari (RT24, université Paris 8, CRESPPA-GTM) et Gilda Charrier (RT33, Université de Bretagne Occidentale,
Sur le même thème
-
L'autonomie au coeur du travail éducatif au quotidien
WinanceMyriamRéflexions à partir de la recherche Polyordinaire sur l'ordinaire des familles dont un des membres est polyhandicapé
-
"Les émotions positives", Arielle Syssau et Nathalie Blanc, UMPV
BlancNathalieSyssauArielleLes émotions sont au cœur du séminaire qui sera l’occasion de balayer l’apport de la psychologie à la compréhension de leurs interactions avec la cognition.
-
L’éducation démocratique : recherches ethnographiques sur l’autonomie scolaire et politique en Fran…
BaudeMatiasLa thèse porte sur une ethnographie comparée d’écoles démocratiques en France et au Québec. Ces établissements scolaires, privés et hors contrat, se caractérisent par la tenue de conseils d’école, qui
-
Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 5
LaugierSandraProtestaAmarFerrandAnnieJaoulMélanieGrannisTanguyVázquezLydiaFalquetJulesHatemGhadaCinquième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH
-
Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 4
FalquetJulesJaoulMélanieGrannisTanguyQuatrième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH
-
Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 3
IbeasJuan ManuelVázquezLydiaTroisième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH
-
Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 1
FraisseGenevièvePollet RouyerFrédériquePena LópezClaudiaPremière session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH
-
Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 2
LeguilClotildeSantelliEmmanuelleDeuxième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH.
-
Les tout-petits ? Pas touche ! Partie 3
ColinLucetteChicharroGladysLe DûMaïMemmiDominiqueLeroyGhislainCe séminaire vise à rendre raison depuis 18 ans de la floraison saisissante depuis le milieu des années 90 en histoire, sociologie, anthropologie, droit, sciences politiques, d’ouvrages consacrés aux
-
Programmes de recherche qui mobilisent des collectifs pluridisciplinaires autour de l’étude des con…
Hidri NeysOumayaProfilletLucasLes activités physiques sont devenues une thématique importante dans de nombreuses productions culturelles à destination des jeunes générations, que ce soit au sein des images fixes des albums qu’ils
-
Un corps à nous - Luttes féministes pour la réappropriation du corps
QuéréLucileConférence en lien avec : La semaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
-
Contrôle du corps des femmes dans le droit romain (IIe-Ier siècles av. J.-C.)
DuboulozJulienMare Nostrum (Entretien radiophonique)