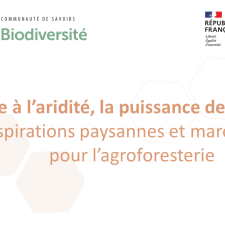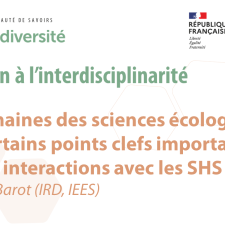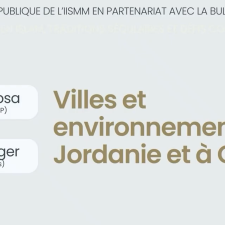Notice
L’agriculture dans la réserve : entre difficultés et attachement au territoire
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Jusqu’aux années 1950, l’activité et l’occupation agricole sur le site de la future réserve se limitent à quelques haciendas comme celle de la Flor. En 1950 s’amorce une colonisation de la région sous l’impulsion de l’état qui finance l’installation de nouveaux ejidos formés de paysans sans terre déplacés et l’aménagement de barrages pour assurer la ressource en eau nécessaire à l’élevage bovin, animaux destinés à l’exportation vers les Etats Unis. L’activité se développe essentiellement au sein d’ejidos comme celui du NCPE Tlahualilo (créé en 1960, comptant 124 ejidatarios et 144 370 ha) regroupant les sites de Las Tortugas, Barbacoa et El Quemado. Les conditions de vie sont particulièrement difficiles en particulier lors des épisodes de sècheresses, sécheresses qui semblent prendre plus d’importance ces dernières années et renvoient vers une image « très noire du futur ». Certains ont trouvé une solution dans une migration provisoire aux Etats Unis mais l’attachement à la terre et au désert les a conduits à revenir, ce qui n’est pas le cas des plus jeunes.
Dans ce tableau, l’ejido de la Flor fait figure d’exception : l’ouverture vers l’écotourisme et le tourisme à la ferme a permis de développer une activité qui permet des conditions de vie correctes, les enfants partis à la ville pour étudier reviennent et s’engagent dans le prolongement de l’activité.
Plusieurs actions sont en cours en collaboration avec la CONANP telles que la restauration des sols et la mise en place de pâturage constituées de plantes natives, ou encore la valorisation des productions via par exemple la labélisation d’une viande organique… mais la vulnérabilité des agriculteurs reste forte : les plus anciens s’adaptent et les jeunes partent mettant en péril le maintien de l’activité dans la réserve.
Dans la même collection
-
Principes et modalités de gestion des aires naturelles protégées et réserves de biosphère au Mexique
Au Mexique, les réserves de biosphère sont reconnues par la législation nationale et intégrées aux ANP, aires naturelles protégées identifiées et gérées par le SEMARNAT, Secrétariat de l
-
L’éducation à l’environnement autour de la réserve de biosphère
Eduquer à l’environnement est un des principaux objectifs des réserves de biosphère, dans la continuité de leurs objectifs de recherche scientifique et de préservation et développement associé.
-
L’agriculture sur les marges de la réserve : pratiques intensives fondées sur la ressource en eau
Au cours des dernières décennies, la région a vu se développer une agriculture intensive basée sur l’usage de la ressource en eau souterraine, de denses réseaux d’irrigation et une haute
-
L’exploitation du sel par les femmes : un tremplin pour l’amélioration des conditions de vie et la …
Aujourd’hui l’exploitation du sel constitue avec l’élevage une des deux principales activités au sein de la réserve. Les premières salines connues localement s’implantent vers la fin du XIXème
-
La participation dans la réserve : modalités et facteur de réussite des actions de restauration et …
L’intégration des communautés aux prises de décision et aux actions est un point emblématique des réserves de biosphère. La participation dans le cas de Mapimí s’initie par la présence de la
-
L’écotourisme dans la réserve : histoire et dynamisme de l'association de « La Flor »
La fréquentation désordonnée de la zona del silencio, zone du silence, des années 1970 a progressivement laissé place à l’organisation d’un tourisme culturel, rural et environnementale, accompagné et
-
Une réserve à deux temps : une gestion moins tournée vers l’écologie avec le changement de coordina…
L’idée de la zone protégée émerge au début des années 1970 et se matérialise en 1977 d’abord par une « reserva forestal integral » établie par Décret de l’Etat de Durango. Avec l’adhésion au programme
Sur le même thème
-
Sol et biodiversité : quelles agricultures, quelles solutions ?
SelosseMarc-AndréLe sol a longtemps été géré sans conscience des blessures induites : urbanisation, agriculture intensive, érosion, etc. Pourtant, certaines agricultures ont déjà mis en place des solutions.
-
Face à l’aridité, la puissance de l’arbre : Inspirations paysannes et marocaines pour l’agroforeste…
MichonGenevièveRencontre avec Geneviève Michon, autour de son dernier livre qui détaille les pratiques et les savoirs agroforestiers d’agriculteurs et d’agropasteurs du Maroc, mais aussi du Sahel, d’Éthiopie, d
-
Présentation des domaines des sciences écologiques et de certains points clefs importants pour les …
BarotSébastienDans cette séance, Sébastien Barot propose une introduction aux grands domaines des sciences écologiques et à leurs fondements épistémologiques et méthodologiques.
-
Évolution des forêts tropicales humides : des processus globaux à la conservation locale transdisci…
CouvreurThomas L.P.Thomas Couvreur présente des travaux de recherche sur les forêts tropicales humides, leur biodiversité au niveau global et les projets de conversation en Equateur
-
Tresser les filets fantômes. Une anthropologie des déchets marins : entre visible et invisible
Le RouxGéraldineBourgeois CostaHenriVidardMathieuSixième rencontre du cycle Océans : héritage commun, défis partagés, qui s'est tenue le 14 octobre 2025, avec Géraldine Le Roux, Henri Bourgeois Costa et Mathieu Vidard au Forum de la FMSH
-
La place de l'édition scientifique publique dans le panorama de l'écologie du livre
GokselNisanCe webinaire est la première action du groupe de travail "Écologie du livre" piloté par Nina Koulikoff (MSH Mondes) et Cédric Vigneault (Enssib)...
-
Présentation du GBIF - Global Biodiversity Information Facility - Système Mondial d’Information sur…
ArchambeauAnne-SophieAnne-Sophie Archambeau, Node manager GBIF France, présente le Système Mondial d’Information sur la Biodiversité, programme intergouvernemental et infrastructure de données, créé en 2001, pour
-
Villes et environnement en Jordanie et à Oman
AbabsaMyriamKlingerThibautBilardelloSophieConférence publique de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) en partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC).
-
Le sauvage dans les aires marines protégées
BricaultPaulineBoemareCatherineLachowskyCarolineQuatrième rencontre du cycle Océans : héritage commun, défis partagés, qui s'est tenue le 17 juin 2025, avec Pauline Bricault, Catherine Boemare et Caroline Lachowsky, au Forum de la FMSH
-
Secret de paysages
CarrièreStéphanieGeninDidierLaquesAnne-ÉlisabethCette vidéo présente une analyse des paysages malgaches. Elle a été réalisée dans le cadre du projet Varuna Science de la Durabilité par des scientifiques malgaches et français, tous membres du
-
Les valeurs de la biodiversité
BlancoJulienPaquetSarahIssu du projet Varuna Science de la Durabilité (Financement AFD et maitrise d'ouvrage Expertise France) développé par l'UMR SENS et ses partenaires malgaches, cette vidéo a été réalisée par Julien
-
Évaluations socio-économiques et environnementales : justifient-elles les grands projets d’aménagem…
LevrelHaroldLa valorisation monétaire attribuable à la biodiversité et la pertinence ou non des outils socio-économiques et environnementaux peuvent mener à des situations de contentieux, comme le cas de l'A69.