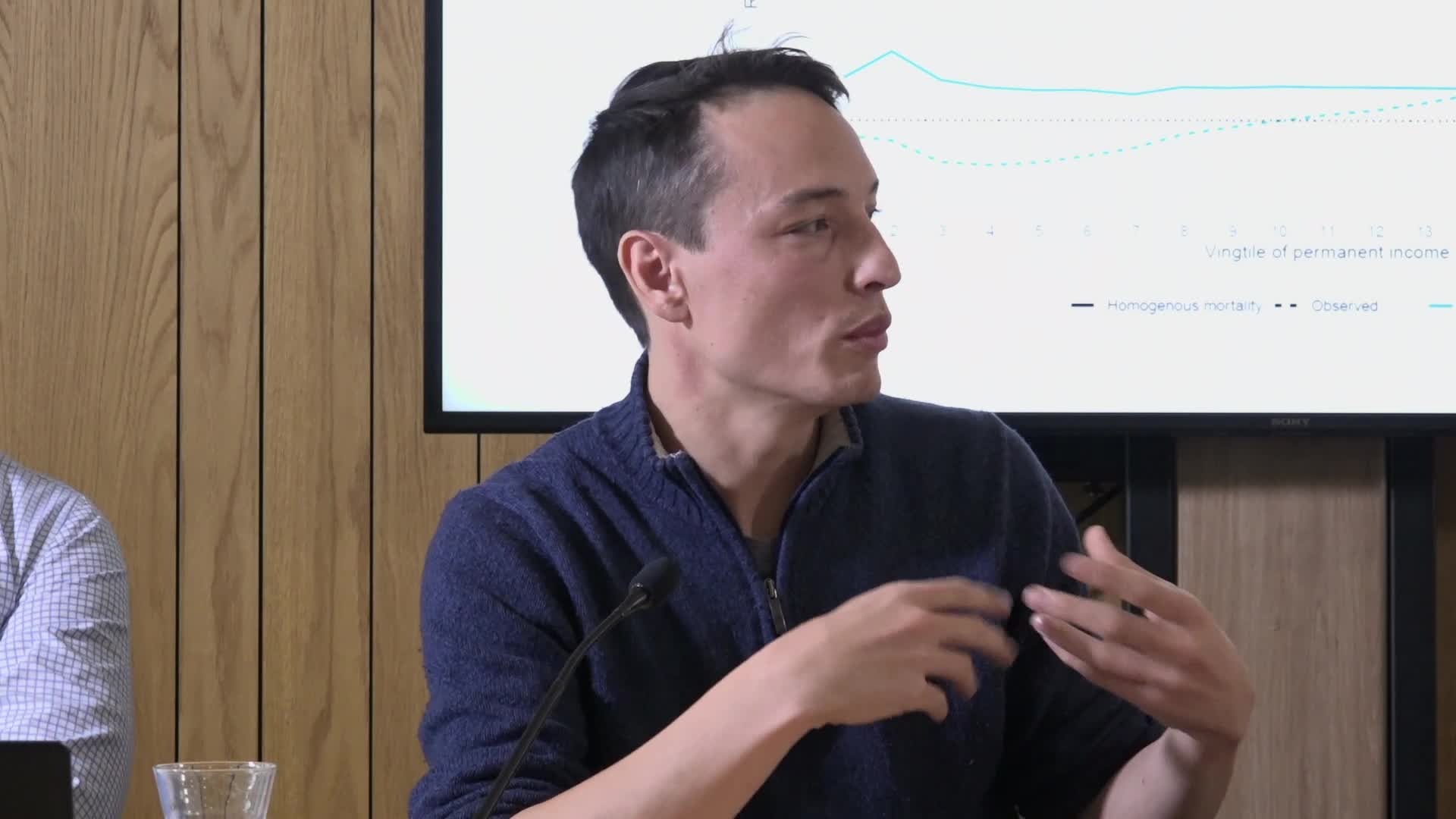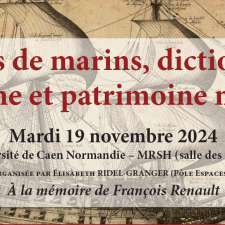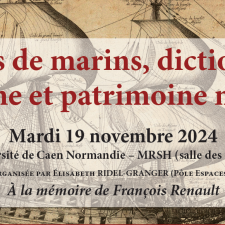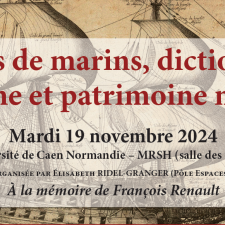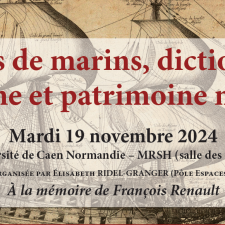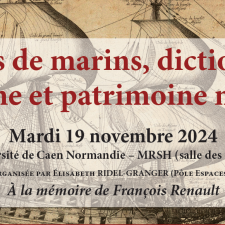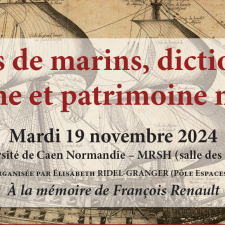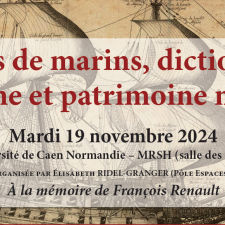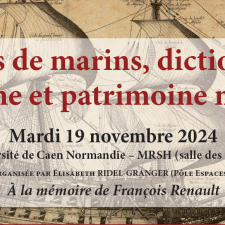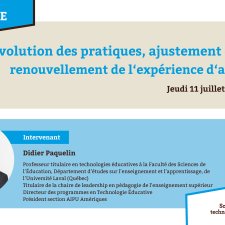Notice
MRSH Caen
La défense du littoral en baie du Mont-Saint-Michel dans l'antiquité tardive
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette communication a été donnée dans le cadre d'une journée d'études organisée par le pôle Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires de la MRSH, journée intitulée Le littoral : contrôle, surveillance et usage des côtes.
Historien et archéologue, Daniel Levalet est président de la Société d'Archéologie d'Avranches, Mortain et Granville.
Résumé de la communication
Les causes de la défense.
A la fin du IVe siècle ap. J.C., des pirates connus sous l'appellation générique de « Saxons » viennent ravager les côtes du nord-ouest de l'empire romain. Ces pirates, francs, jutes, angles, frisons, saxons, viennent des régions situées en bordure de la Mer du nord, ou du Danemark actuel. Ils s'en prennent aux villes côtières, aux ports et aux bateaux de commerce.
La défense.
Elle nous est connue par un document de la fin du IVe ou du début du Ve siècle : la Notitia dignitatum imperii romani. Il donne la liste des dignités civiles et militaires d'un dispositif de défense constitué sur les côtes de la Gaule et de la Bretagne (Angleterre actuelle)
Dans ce dernier pays, le dispositif connu sous le nom de Litus saxonicum comprenait une série de fortifications de pierre, en dehors des villes, dont les traces archéologiques sont encore visibles aujourd'hui (comme Portchester).
En Gaule, le Tractus armoricani et nervani consistait en villes fortifiées et réutilisation de fortifications littorales protohistoriques.
La baie du Mont Saint-Michel.
Coutances : L'auteur romain Ammien Marcellin a beau mentionner des « constantia castra » qu'on localise aujourd'hui près de l'embouchure de la Sienne, on n'a jamais découvert de fortifications romaines autour de cette ville. En revanche, le site dit du camp de César, à Montchaton, sur la rive gauche du fleuve, éperon barré de l'âge du bronze, a livré des monnaies de la fin du IIIe et du IVe siècle.
Alet : A l'ouest de Saint-Malo, sur l'estuaire de la Rance, la presqu'île a été occupée aux époques gauloise et romaine. Un port important (Reginca) commerçait avec l'Angleterre. Les fouilles de Loïc Langouet ont mis au jour le castellum à l'emplacement de la Tour Solidor.
Avranches : Un castellum est possible sur le site du donjon médiéval, à l'intérieur de la ville fortifiée après la fin du IIIe siècle. Plusieurs structures plus proches du littoral devaient compléter la défense, telles le camp du Grand Dick (Vains) qui devait protéger le port d'Ingena. Il est possible qu'une station d'observation ait aussi existé sur le point culminant d'Avranches, au lieudit « Le champ des murailles » (Le Val Saint-Père).
Bibliographie
Daniel Levalet, Un élément du litus saxonicum dans la région d'Avranches ?, Annales de Normandie, Recueil d'études offert en hommage au doyen Michel de Boüard, n° spécial, Caen, 1982, p. 361-375.
Id., Avranches et la cité des abrincates (Ier s. av. J.C. - VIIe s. ap. J.C.), Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, t. XLV, Caen, 2010.
Loïc Langouet, La cité d'Alet, Les dossiers du Centre régional d'archéologie d'Alet, Supplément 1996 - N° S.
Thème
Sur le même thème
-
08 - "« Ouvrir » et « co-construire » : l’aménagement urbain face au numérique"
ZazaOrnellaLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d
-
ANR X EHESS : Penser la cohésion sociale (2-2)
KiesowRainer MariaBrunoAnne-SophieBaudotPierre-YvesRainhornJudithTôMaximeCussetPierre-YvesA l’occasion de la sortie du Cahier de l’ANR consacré au bilan de près de deux décennies de recherche sur les inégalités et les vulnérabilités dans notre société...
-
Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.
Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.
-
Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du …
Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du Dictionnaire de marine de Nicolas Desroches (1687) annoté au XVIIIe siècle par un élève officier.
-
L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.
L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.
-
Les marins, leurs langues et leurs dictionnaires : un tour d’horizons.
Les marins, leurs langues et leurs dictionnaires : un tour d’horizons.
-
DicoMarine. Bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine 17e-19e siècles.
DicoMarine. Bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine 17e-19e siècles.
-
Du matériel à l’immatériel, « la chose et le mot » : archéologie et dictionnaires de marine.
Du matériel à l’immatériel, « la chose et le mot » : archéologie et dictionnaires de marine.
-
Le lexique maritime dans les parlers normands.
Le lexique maritime dans les parlers normands.
-
L’argot de l’École navale : technolecte et sociolecte.
L’argot de l’École navale : technolecte et sociolecte.
-
Témoignage et présentation de la journée d'hommage à B. Morel
Baby-CollinVirginieLe 21 octobre 2022, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et le laboratoire TELEMMe rendaient hommage à notre collègue Bernard Morel, pour la première année de son décès. Cette vidéo
-
Evolution des pratiques, ajustement des espaces : renouvellement de l'expérience d'apprentissage
PaquelinDidierGarciaCécileChampionChristopheConférence organisée par le Collège sciences et technologies de l'Université de Bordeaux - 11 juillet 2024