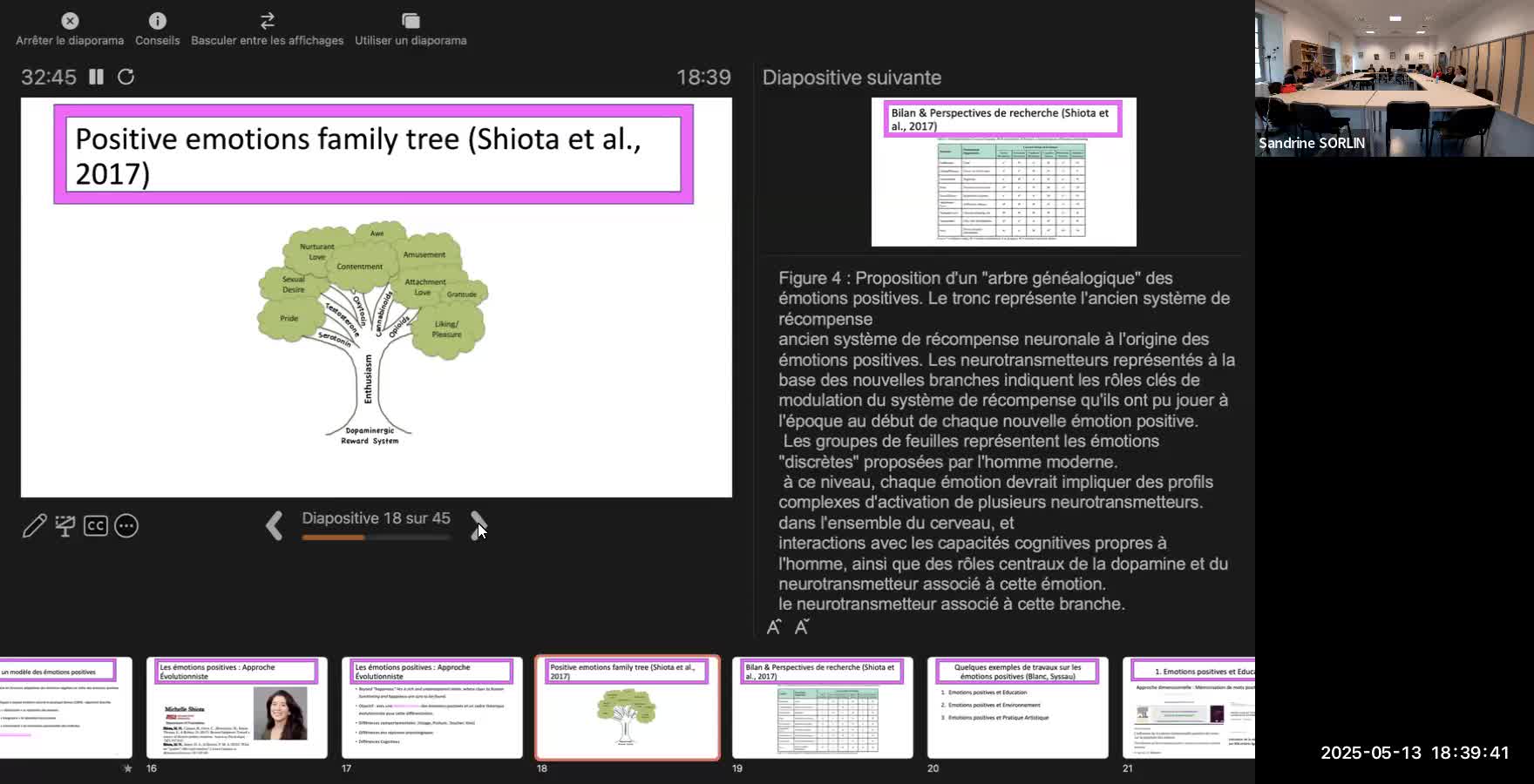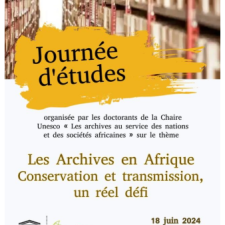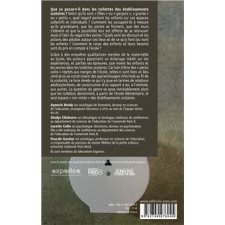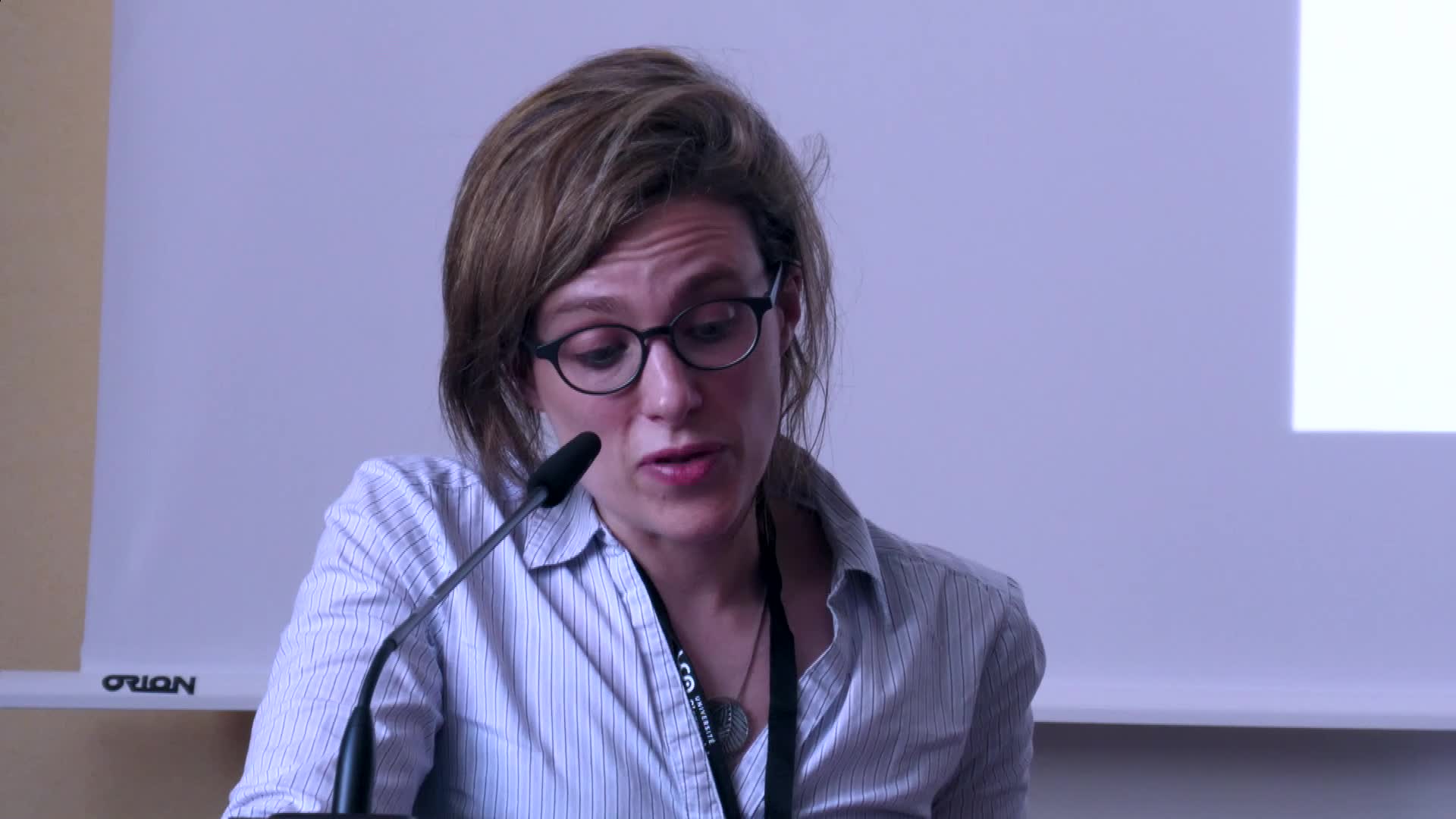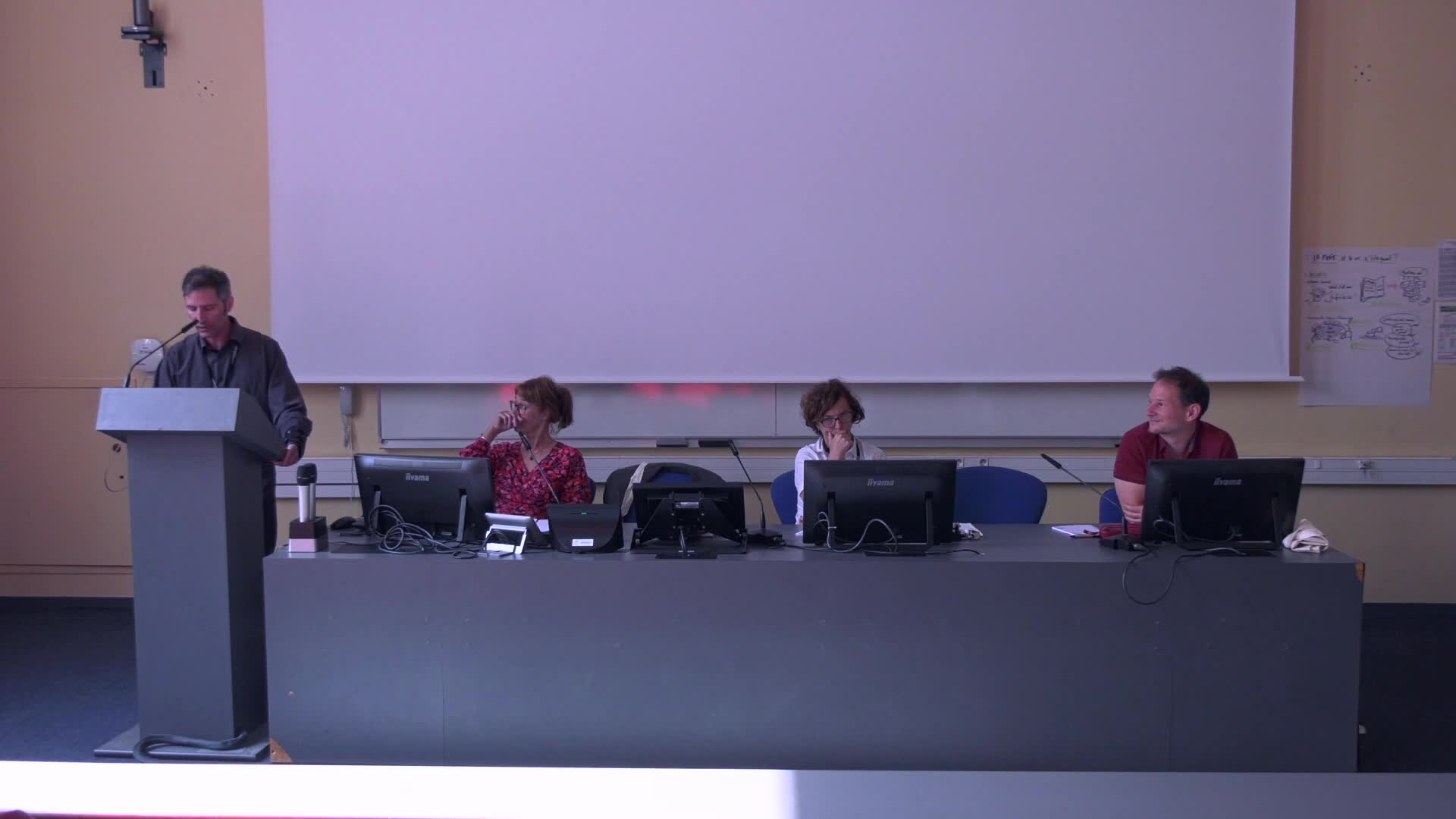Notice
MRSH Caen
La médecine légale au service de l’histoire et vice-versa
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a été enregistrée dans le cadre du séminaire annuel du pôle Sociétés et espaces ruraux de la MRSH de l'année 2016-2017.
Philippe Charlier est maître de conférences des universités et praticien hospitalier dans le service de médecine légale de l'Hôpital universitaire Raymond Poincaré de Garches. Il est également chercheur au Laboratoire d’Éthique Médicale de l'université Paris 5. Il dirige une équipe pluridisciplinaire travaillant dans les domaines de l'anthropologie médico-légale, du diagnostic rétrospectif, de la paléopathologie et de la pathographie. Il s'est spécialisé dans l'étude des restes humains anciens ou de momies, et tient la réputation de faire parler les morts et d'en percer leurs secrets. Pour lui, « chaque découverte amène plein de nouvelles questions et c'est toujours pareil en paléopathologie » ; de même, « un squelette est la partie émergée de l'histoire d'un individu, une momie est la totalité de l'iceberg de la vie de cet individu…, on peut aller beaucoup plus au fond des choses. »
Résumé de la communication
« Ouvrez quelques cadavres : vous verrez aussitôt disparaître l’obscurité que la seule observation n’avait pu dissiper. » Ce conseil, donné par Xavier Bichat en 1801, est-il toujours l‘actualité alors que nos sociétés modernes s’interrogent sur le sens à donner au corps mort ? Exposition de cadavres humains, restitution de restes anatomiques aux peuples premiers, multiplication des études médico-historiques, rénovation complète du musée de l’Homme à Paris, intensification des autopsies judiciaires, chaque fois se pose la même question : quelle place et quel sens faut-il donner à ces « patients atypiques », ces morts utiles aux vivants ? Ce regard change-t-il selon le praticien (anthropologue, médecin, biologiste, etc.) ? Est-il influencé par la société du moment ? S’applique-t-il dans les mêmes termes selon l’aspect et le degré de conservation du corps ? Que peuvent nous apporter des moines bénédictins, des étudiants béninois en médecine, un chef de Papouasie Nouvelle-Guinée, une ancienne Kumari népalaise, etc. ? En quoi l’autopsie sert-elle le bien commun ? Il est aujourd’hui important, en l’absence de norme précise, de questionner les approches généralement admises. En réfléchissant à la place des sciences humaines dans la démarche du praticien vis-à-vis du corps mort, il s’agit de remettre au centre des préoccupations le respect dû au cadavre comme aux familles. Car en rendant le corps mort présentable et/ou accessible au non-initié, que ce corps soit récent ou ancien, le praticien (et a fortiori le médecin légiste) redonne une identité à l’individu.
Extrait de la 4e de couverture : Ouvrez quelques cadavres. Une anthropologie médicale du corps mort, Buchet Chastel, 2015
Sur le même thème
-
"Les émotions positives", Arielle Syssau et Nathalie Blanc, UMPV
BlancNathalieSyssauArielleLes émotions sont au cœur du séminaire qui sera l’occasion de balayer l’apport de la psychologie à la compréhension de leurs interactions avec la cognition.
-
1.3. Conservation des archives et écriture de l'histoire au Sénégal : enjeux et initiatives
Conservation des archives et écriture de l'histoire au Sénégal : enjeux et initiatives | Communication donnée par Maissa FAYE, archiviste à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) au Sénégal et
-
Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 5
LaugierSandraProtestaAmarFerrandAnnieJaoulMélanieGrannisTanguyVázquezLydiaFalquetJulesHatemGhadaCinquième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH
-
Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 4
FalquetJulesJaoulMélanieGrannisTanguyQuatrième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH
-
Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 3
IbeasJuan ManuelVázquezLydiaTroisième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH
-
Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 1
FraisseGenevièvePollet RouyerFrédériquePena LópezClaudiaPremière session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH
-
Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement : Session 2
LeguilClotildeSantelliEmmanuelleDeuxième session de la journée Sexe et démocratie. De l'enjeu du consentement, qui s'est tenue le 30 mai 2024 dans le Hall de la FMSH.
-
Les tout-petits ? Pas touche ! Partie 3
ColinLucetteChicharroGladysLe DûMaïMemmiDominiqueLeroyGhislainCe séminaire vise à rendre raison depuis 18 ans de la floraison saisissante depuis le milieu des années 90 en histoire, sociologie, anthropologie, droit, sciences politiques, d’ouvrages consacrés aux
-
Regards croisés #1 [des mots et des dessins]
VincentCatherineErrardMarie-LysCatherine Vincent, journaliste indépendante, et Marie-Lys Errard, traductrice graphique, livrent leurs impressions et ressentis après une première journée de science dite sur la mort. Libres propos.
-
Regards croisés #2 [des mots et des dessins]
ErrardMarie-LysVincentCatherineMarie-Lys Errard, traductrice-graphiste, et la journaliste Catherine Vincent proposent une rétrospective sensible en mots et en dessins pour conclure le colloque à la fin de la deuxième journée.
-
Frontières de la mort et limites de la médecine
MaglioMilenaMilena Maglio explore les termes essentiels - don d’organes, euthanasie, arrêt des traitements, etc. -qui occupent le débat en éthique clinique pour réfléchir la définition de la mort.
-
Des mots identiques pour des réalités différentes
SchepensFlorentAuteur du livre « Les soignants et la mort », Florent Schepens décrypte les discours des professionnels soignants pour illustrer différents points de vue sur le mourir.