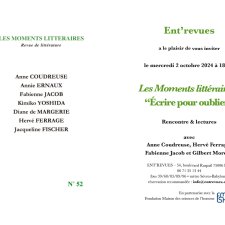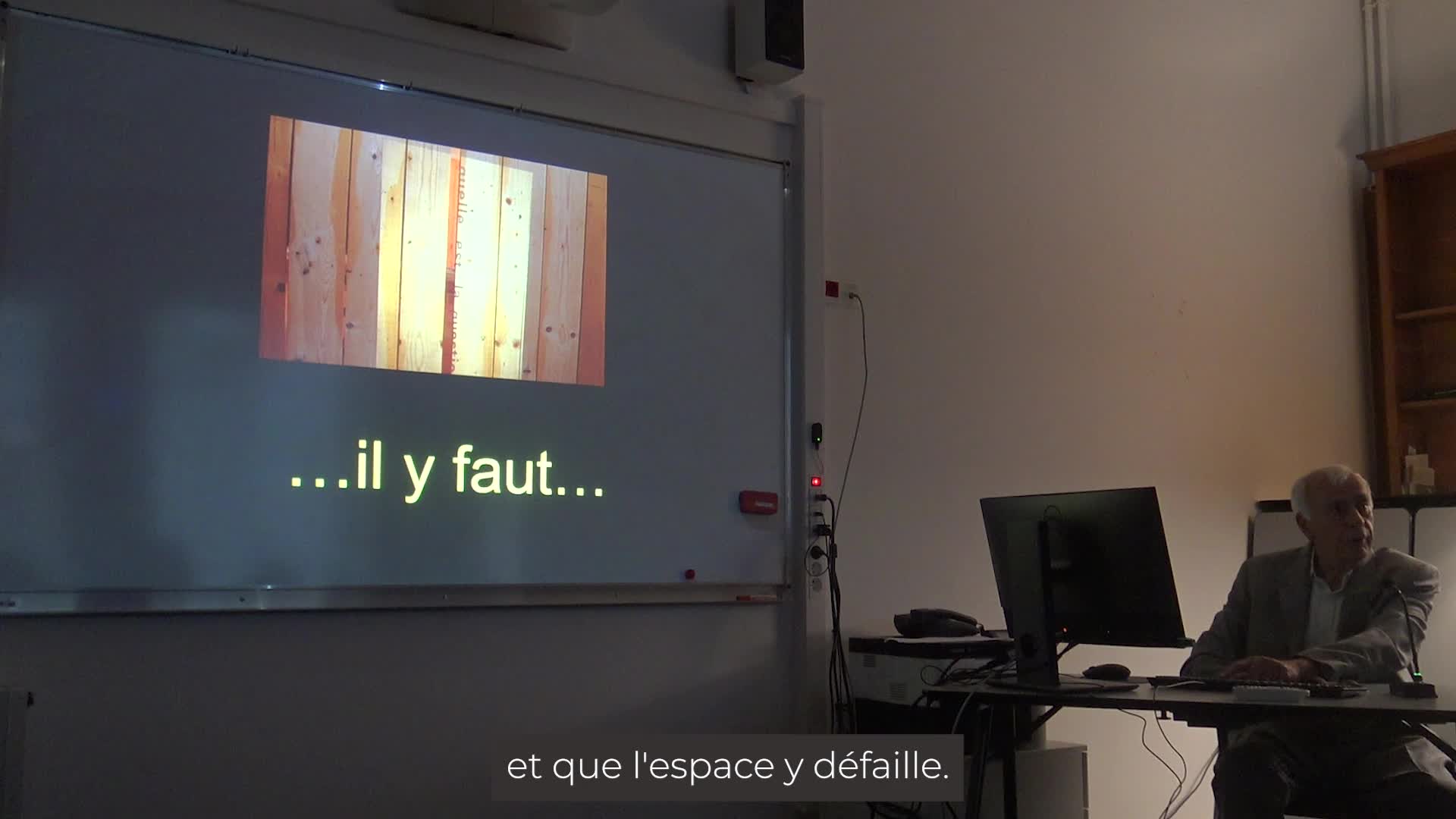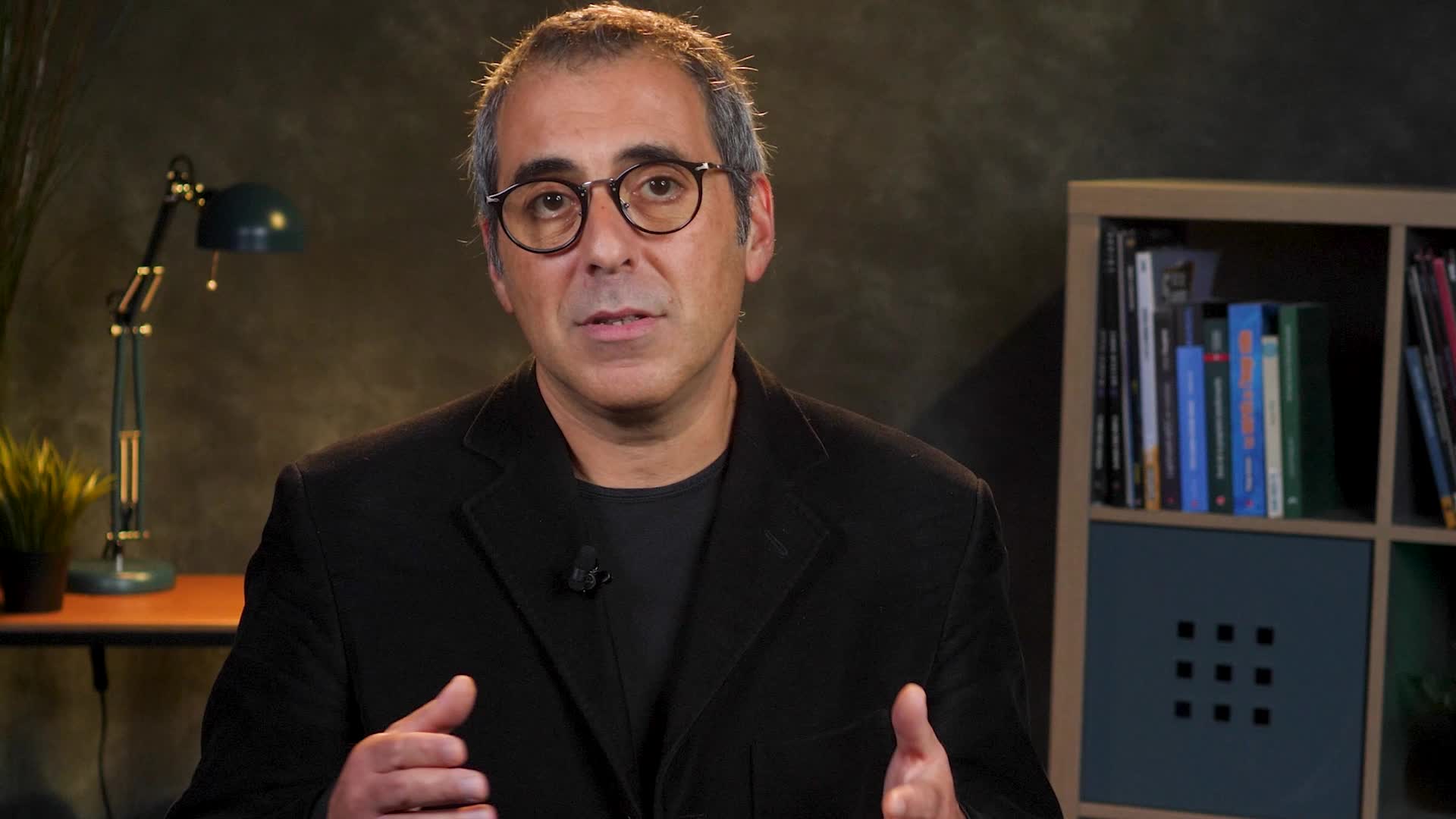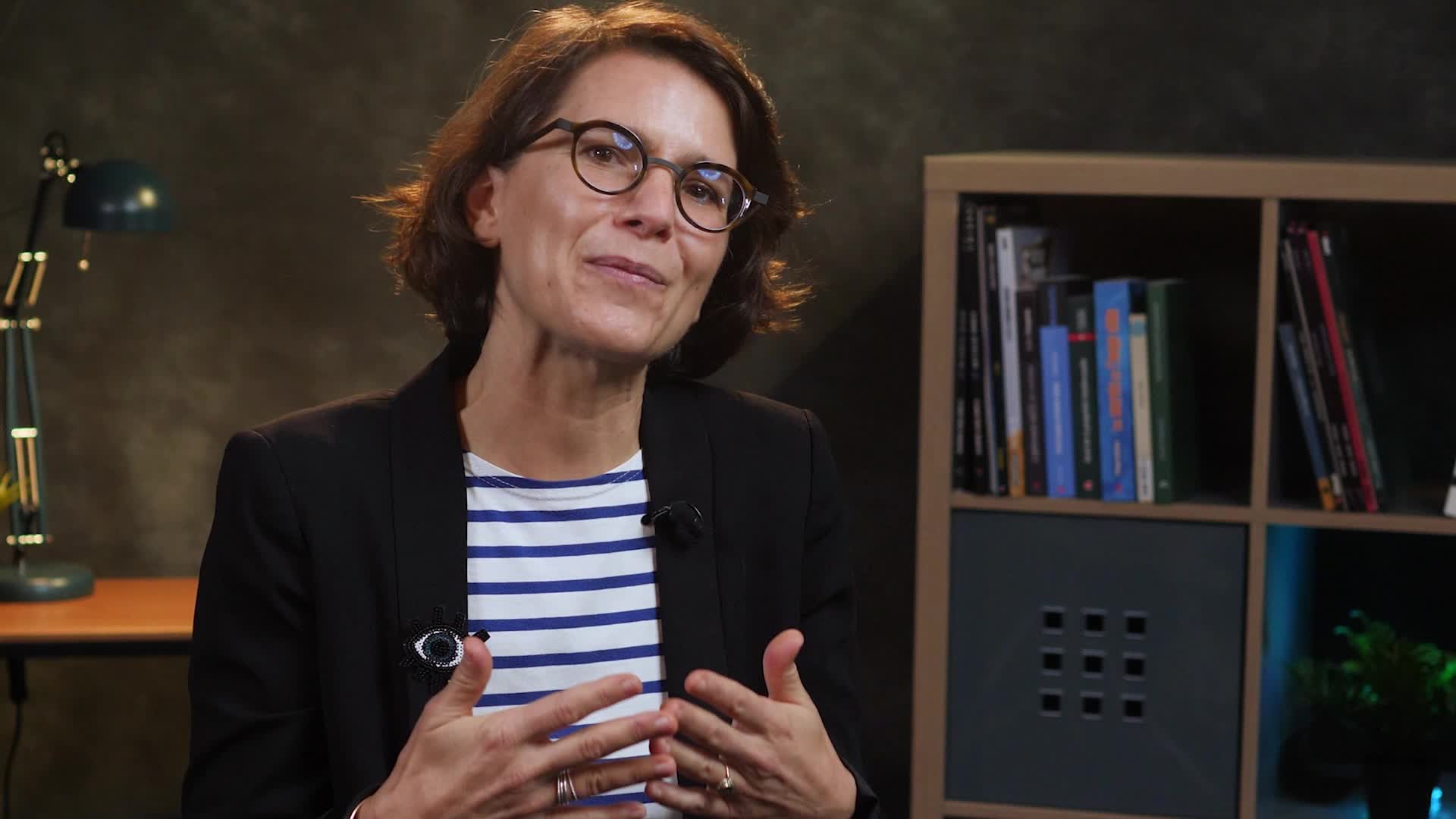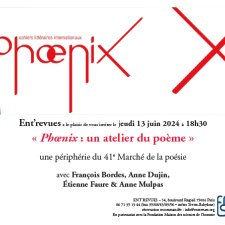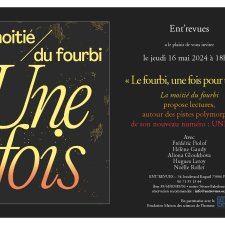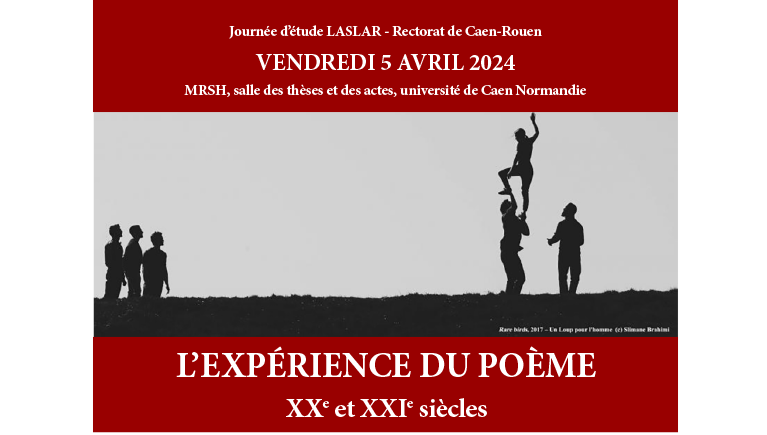Notice
CCIC, Cerisy-la-Salle
Le langage poétique : l'avenir d'une révolution
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque intitulé Julia Kristeva : révolte et reliance qui s’est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 16 au 23 juin 2021, sous la direction de Sarah-Anaïs CREVIER GOULET, Keren MOCK, Nicolas RABAIN et Beatriz SANTOS.
Cette rencontre se proposait comme une traversée dans l'œuvre protéiforme de Julia Kristeva. Toujours en acte, la pensée qu'elle déploie est à l'écoute des bouleversements de l'histoire, des théories et des disciplines, tout comme des enjeux contemporains et des questions éthiques. Conçue dans les mouvements de révolte et de reliance, elle prend ancrage au cœur même de ce qui relie l'intime et le social-historique : là est la force créative d'une œuvre dont le rayonnement dépasse cultures et disciplines...
Martin Rueff (1968) enseigne à l'université de Genève. Poète, traducteur, philosophe, il est l'auteur de nombreux essais et de plusieurs livres de poésie. Il est co-rédacteur en chef de la revue Po&sie (directeur : Michel Deguy). Il a récemment publié Foudroyante pitié et A coups redoublés (Mimesis, 2018, livres distingués par le prix La Bruyère de l'Académie française), s'est chargé de l'édition de Le Corps et ses raisons de Jean Starobinski (octobre 2020, Paris, Le Seuil). Il participe à la retraduction des œuvres d'Italo Calvino chez Gallimard. Dernier livre de poèmes : La Jonction (Caen, Nous, 2019). Prochain livre de poèmes à paraître : Verticale ponte (Modoinfoshop, Bologna, septembre 2021).
Résumé de la communication
Il est temps pour les poètes et les poéticiens de relire le triptyque constitué par Sémiotiké (1969), Le Langage, cet inconnu (1969) et La Révolution du langage poétique (1974). On y découvre une théorie du sens et du langage qui prend le poème comme théâtre des opérations, et une théorie du poème aussi puissante que généreuse. Au sommet de ce triangle siège La Révolution du langage poétique, livre difficile et excitant. On fait l'hypothèse que la sémanalyse permet de répondre au "hiatus" du sémantique et du sémiotique sur lequel n'aura cessé de butter Emile Benveniste. On suggère aussi que les thèses de psychanalyse développées par la suite dans l'œuvre de Julia Kristeva trouvent leur origine dans les théories de la sémanalyse.
Publication : https://cerisy-colloques.fr/juliakristeva-pub2024/
Thème
Documentation
Sur le même thème
-
Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…
CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...
-
Soirée Ent'revues : "Les moments littéraires"
CoudreuseAnneJacobFabienneFerrageHervéMoreauGilbertRencontre avec Anne Coudreuse, Fabienne Jacob, Hervé Ferrage et Gilbert Moreau, dans le cadre de la parution du 52e numéro de la revue "Les Moments littéraires" intitulé "Écrire pour oublier"
-
Le Livre en question 5 : Jean Lancri
LancriJeanLecture de Jean Lancri : une création originale inspirée par Edmond Jabès.
-
1 – Evolution des paradigmes culturels. 1
NobileLuca"Evolution des paradigmes culturels (1)" par Luca Nobile, Université de Bourgogne
-
La littérature de colportage aux 18ème et 19ème siècles
BouyguesÉlodie"La littérature de colportage aux 18ème et 19ème siècles" par Elodie Bouygues (Université de Franche-Comté)
-
Soirée Ent'revues : "Phœnix: un atelier du poème"
MulpasAnneFaureÉtienneDujinAnneRencontre avec Anne Mulpas, Étienne Faure et Anne Dujin, dans le cadre de la sortie du 40e numéro de la revue Phœnix
-
Soirée Ent'revues | Le fourbi, une fois pour toutes !
FiolofFrédéricGaudyHélèneGloukhovaAlionaLeroyHuguesRolletNoëlleRencontre avec Frédéric Fiolof, Hélène Gaudy, Aliona Gloukhova, Hugues Leroy et Noëlle Rollet, dans le cadre de la sortie du nouveau numéro de La moitié du fourbi "Une fois"
-
« Musica » de Giuseppe Giuranna - Traduction de la LIS vers l’italien
Le poème « Musica » du poète italien Giuseppe Giuranna a été traduit de la Langue des Signes Italienne (LIS) vers l’italien par Erika Raniolo (interprète LIS). Ici vous pouvez écouter la traduction
-
De la poésie contemporaine à la poésie quotidienne : l’expérience des pratiques d’écriture en amate…
BelinOlivierCette communication se propose d’appréhender l’expérience du poème par le biais de l’écriture en amateur
-
Des forêts d’expériences poétiques
CavelierLydieLes forêts d’Hélène Dorion engagent une quête poétique, un processus de transformation intime, pour le sujet lyrique comme pour le lecteur.
-
Poésie et musique du XXe au XXIe siècle. De la page à la scène
RoyèreAnne-ChristinePoésie et musique du XXe au XXIe siècle. De la page à la scène.
-
Introduction : l’expérience du poème XXe-XXIe siècles
La journée d’étude « L’expérience du poème XXe-XXIe siècles » (5 avril 2024 – MRSH, Université de Caen) s’est proposée de parcourir le champ de la poésie moderne et contemporaine et de mettre en