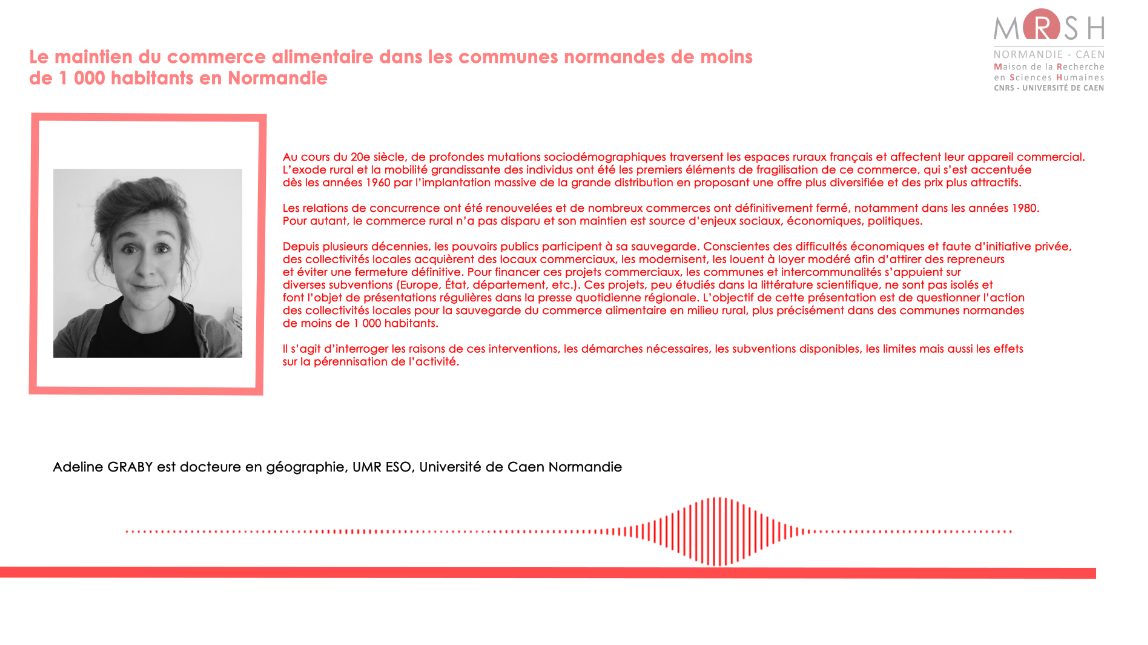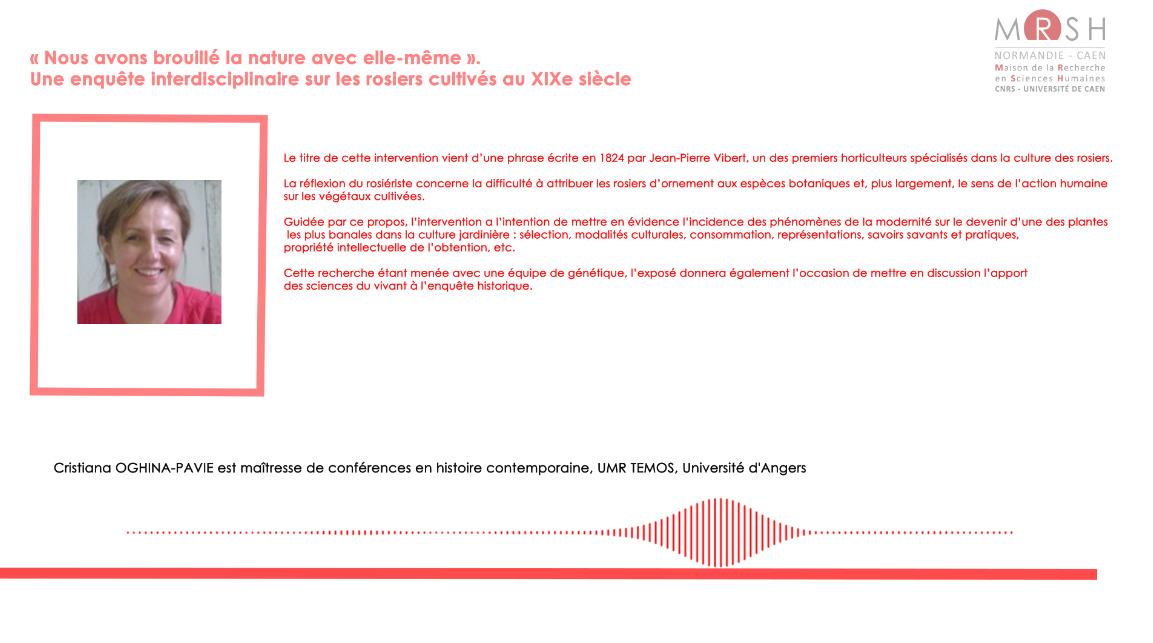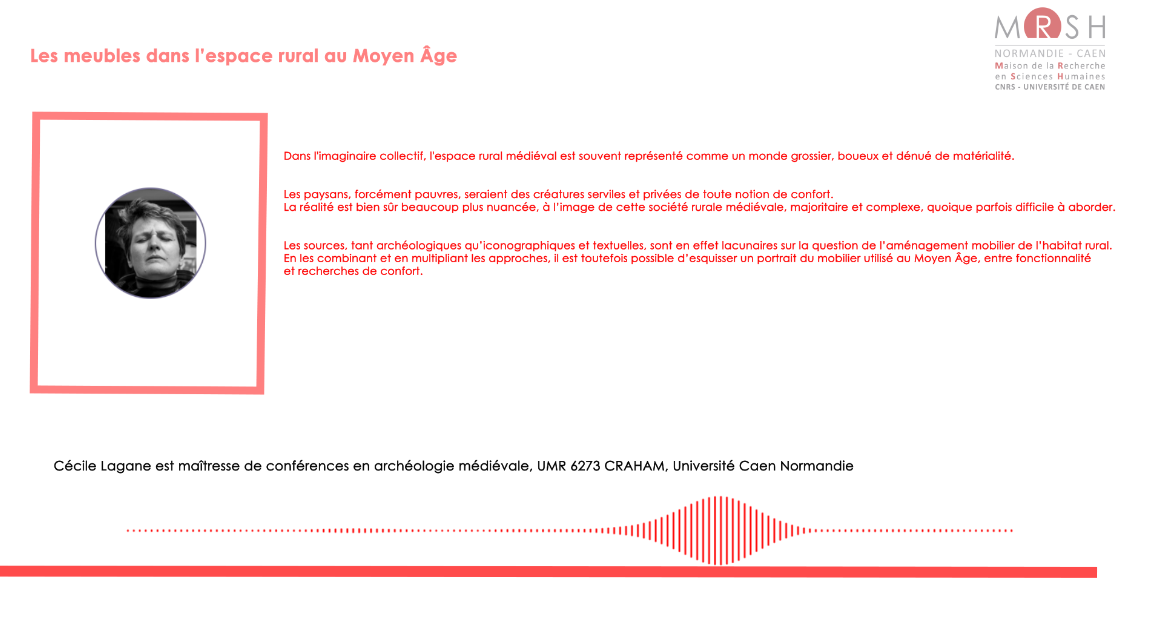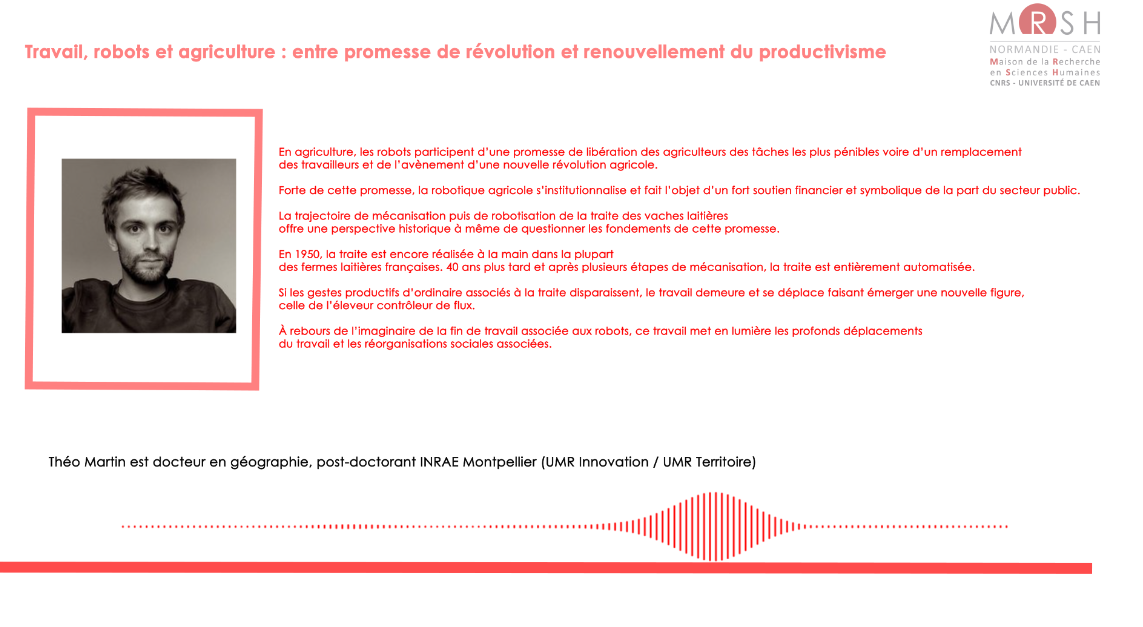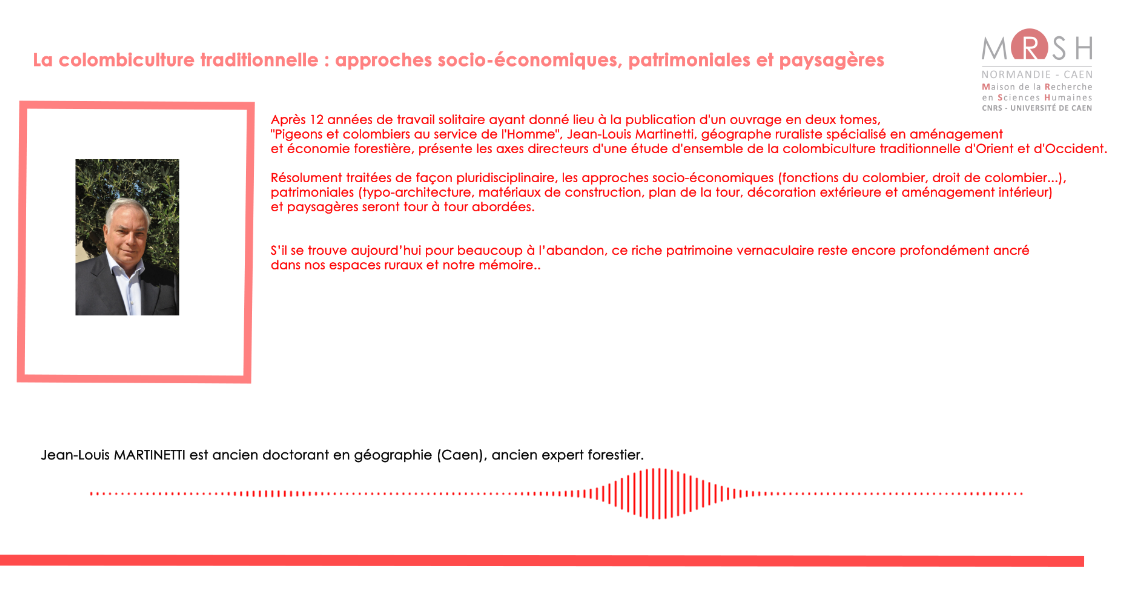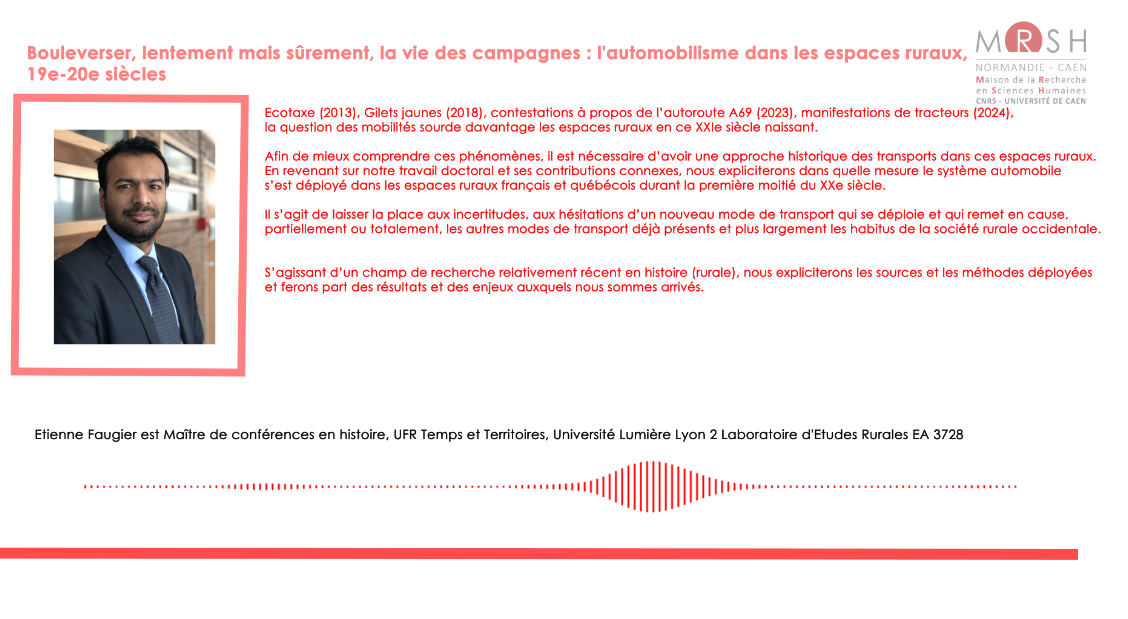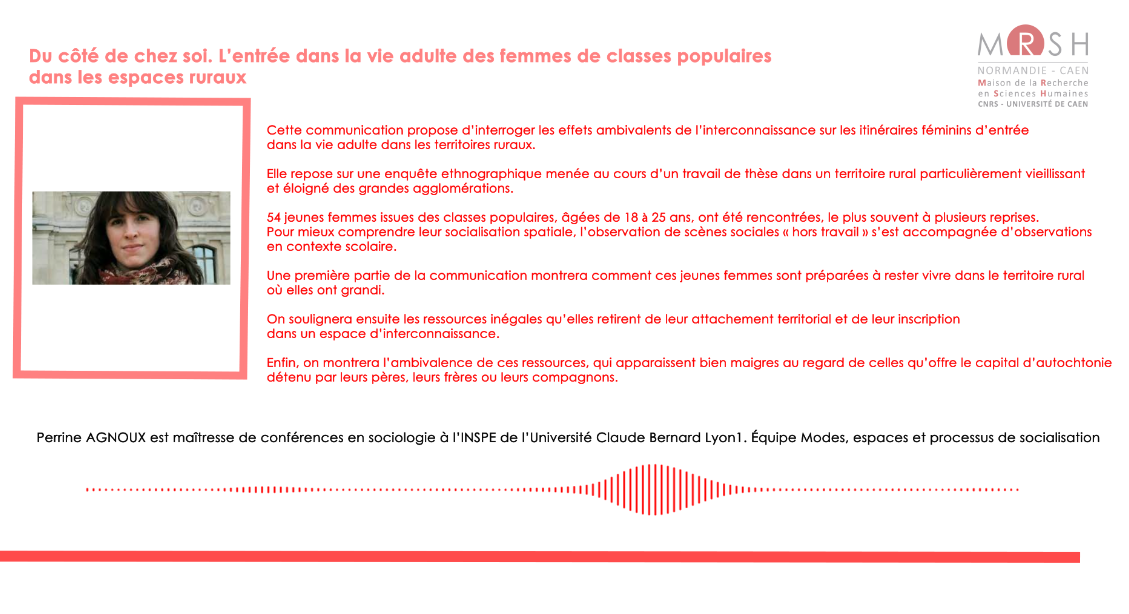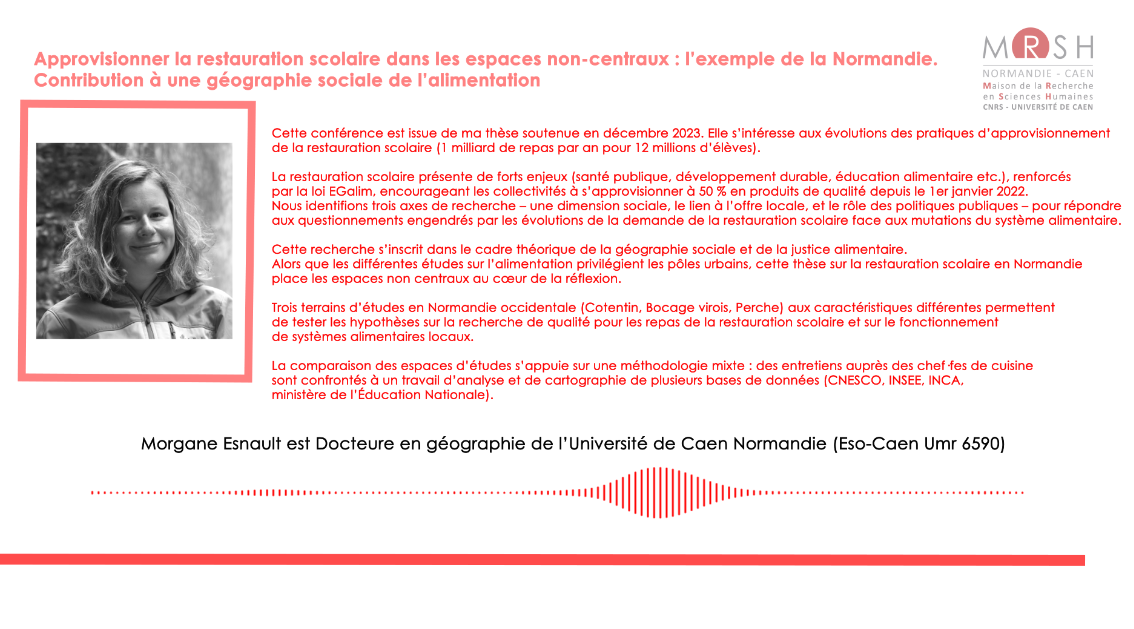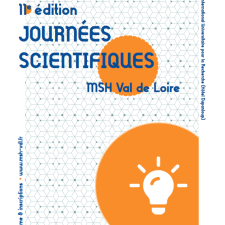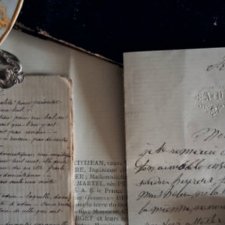Notice
Université Rennes 2
Trois siècles d'histoire rurale...
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Les historiens français et les sociétés rurales - Des caractères originaux
Dans ce discours prononcé à l'occasion du 1er colloque de l'Association d'Histoire des Sociétés Rurales, organisé à Rennes en 1994, Jean Jacquart s'efforce de retracer en 20 min deux siècles d'historiographie des sociétés rurales françaises (de Voltaire aux années 1980) tentant d'en dégager les grandes étapes et les caractères originaux. Jusqu'au XVIIIème siècle, l'histoire se désintéresse des sociétés rurales et du petit peuple en général. Dans le chapitre 30 du Siècle de Louis XIV, Voltaire ébauche les premiers éléments d'une histoire rurale, abordant le peuple des campagnes et s'intéressant à l'évolution des productions agricoles et du commerce. Mais c'est avec le mouvement du romantisme que naît véritablement l'histoire rurale.
-
Seconde moitié du XIXe siècle
L'histoire rurale est dominée par deux grands thèmes : les aspects juridiques des rapports d'exploitation et les problèmes de la propriété du sol et de sa répartition sociale. Cette première période débouche sur une première synthèse rédigée en 1854 par Dareste de la Chavanne, l'Histoire des classes agricoles françaises depuis Saint-Louis jusqu'à Louis XIV. -
Première moitié du XXe siècle
Des géographes ouvrent de nouvelles perspectives. A côté des traditionnelles analyses sur les aspects juridiques et sur les classes rurales, une attention nouvelle est prêtée aux dimensions matérielles de la vie rurale (le paysage, le parcellaire d'exploitation, l'habitat, les techniques agricoles, etc.). Le travail de Georges Lefebvre sur Les Paysans du Nord pendant la Révolution française (publié en 1924) fait figure d'œuvre de référence pour cette période. À la même époque, Marc Bloch publie, dans une indifférence relative, ce qui allait devenir un ouvrage majeur de l'histoire rurale : Les Caractères originaux de l'histoire rurale française. Il propose une mise en perspective des grandes évolutions qui ont bouleversé les sociétés rurales de l'an Mil à la révolution. Pour autant, durant l'entre-deux guerres, l'historiographie rurale française reste majoritairement dans des voies traditionnelles, restant globalement limitée et timide dans ses renouvellements thématiques. -
1945-1975 ou les "trente glorieuses" de l'histoire rurale
L'histoire rurale connaît un essor spectaculaire sous l'influence de trois facteurs : la réédition en 1952 des travaux de Marc Bloch, les travaux d'Ernest Labrousse replaçant l'économie rurale au centre de l'économie de l'Ancien régime, les travaux de Jean Meuvret qui incitent une nouvelle génération de chercheurs à ouvrir des problématiques autour de l'évolution des paysages, des rapports sociaux, de la démographie historique...D'importants renouvellements méthodologiques accompagnent cette période. C'est notamment l'époque des grandes monographies régionales (M. Agulhon, P. Bois, P. Goubert, E. Le Roy Ladurie, J. Jacquart, G. Cabourdin, etc.)
Ces années fécondes font l'objet d'une nouvelle synthèse historiographique publiée en quatre volumes sous la direction de G. Duby et A. Wallon en 1975-1976 : Histoire de la France rurale. -
Après 1980 : silence de l'histoire rurale ?
Les nouvelles recherches se dirigent vers des approches thématiques et sectorielles plutôt que régionales, délaissant les champs de l'histoire économique et sociale pour ceux de l'histoire des idées (la violence, les systèmes d'héritage, le maintien des systèmes d'exploitation familiale, etc.).
Pour conclure cette historiographie et répondre à la question d'une spécificité de l'histoire française des sociétés rurales, Jean Jacquart rappelle que les travaux de l'école française dépassent largement les frontières nationales, inscrivant ainsi l'influence de l'historiographie française à une échelle européenne.
Thème
Sur le même thème
-
S'installer à la campagne
LatouilleOphélieOphélie Latouille présente son travail de recherche doctorale consacré aux mobilités résidentielles vers les zones rurales et aux transitions professionnelles vers le non-salariat, dans des contextes
-
Le maintien du commerce alimentaire dans les communes normandes de moins de 1 000 habitants en Norm…
Au cours du 20e siècle, de profondes mutations sociodémographiques traversent les espaces ruraux français et affectent leur appareil commercial. L’exode rural et la mobilité grandissante des individus
-
« Nous avons brouillé la nature avec elle-même ». Une enquête interdisciplinaire sur les rosiers c…
Le titre de cette intervention vient d’une phrase écrite en 1824 par Jean-Pierre Vibert, un des premiers horticulteurs spécialisés dans la culture des rosiers.
-
Les meubles dans l’espace rural au Moyen Âge
Dans l'imaginaire collectif, l'espace rural médiéval est souvent représenté comme un monde grossier, boueux et dénué de matérialité.
-
Travail, robots et agriculture : entre promesse de révolution et renouvellement du productivisme
En agriculture, les robots participent d’une promesse de libération des agriculteurs des tâches les plus pénibles voire d’un remplacement des travailleurs et de l’avènement d’une nouvelle révolution
-
La colombiculture traditionnelle : approches socio-économiques, patrimoniales et paysagères
Après 12 années de travail solitaire ayant donné lieu à la publication d'un ouvrage en deux tomes, "Pigeons et colombiers au service de l'Homme", Jean-Louis Martinetti, géographe ruraliste spécialisé
-
Bouleverser, lentement mais sûrement, la vie des campagnes : l’automobilisme dans les espaces rura…
FaugierEtienneEcotaxe (2013), Gilets jaunes (2018), contestations à propos de l’autoroute A69 (2023), manifestations de tracteurs (2024), la question des mobilités sourde davantage les espaces ruraux en ce XXIe
-
Du côté de chez soi. L’entrée dans la vie adulte des femmes de classes populaires dans les espaces …
AgnouxPerrineCette communication propose d’interroger les effets ambivalents de l’interconnaissance sur les itinéraires féminins d’entrée dans la vie adulte dans les territoires ruraux.
-
Approvisionner la restauration scolaire dans les espaces non-centraux : l’exemple de la Normandie. …
EsnaultMorganeCette conférence est issue de ma thèse soutenue en décembre 2023. Elle s’intéresse aux évolutions des pratiques d’approvisionnement de la restauration scolaire (1 milliard de repas par an pour 12
-
Ruramod. Ruralité et modernité de l’entre-deux-guerres à nos jours
BonordAudeLe programme de recherche Ruramod questionne les représentations des rapports du monde rural à la modernité (technique, socio-économique et culturelle), de l’entre-deux-guerres à nos jours.
-
Des bourgeois des champs - Dans l'intimité de la recherche
BorgeaudOlivierAbrialValérieSoirée "Des bourgeois des champs", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 14 décembre 2023 au Forum de la FMSH.
-
JRSS 2022 - Dynamique des espaces ruraux, regard sur 40 ans de recherche en économie et en sociolog…
SchmittBertrandBertrand Schmitt porte son regard sur 40 ans de recherche en économie et en sociologie... « rurale » autour de la dynamique des espaces ruraux.