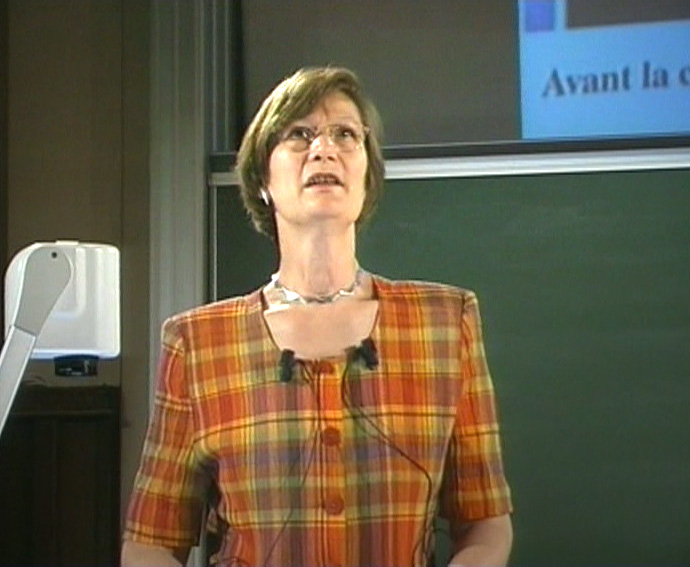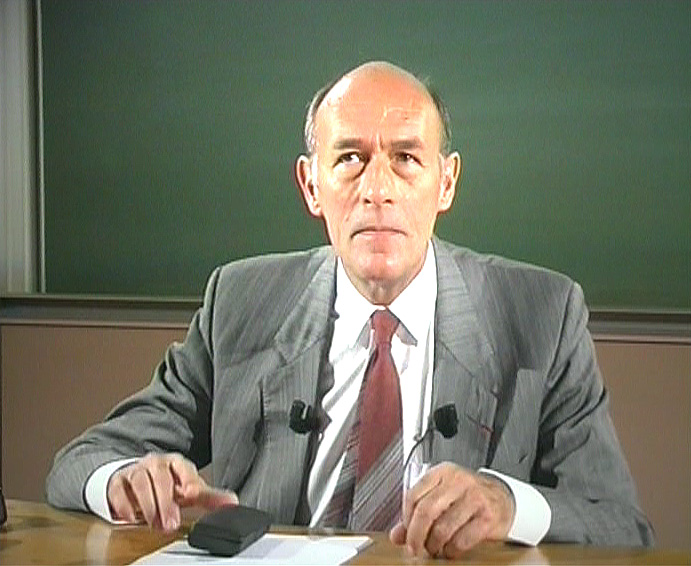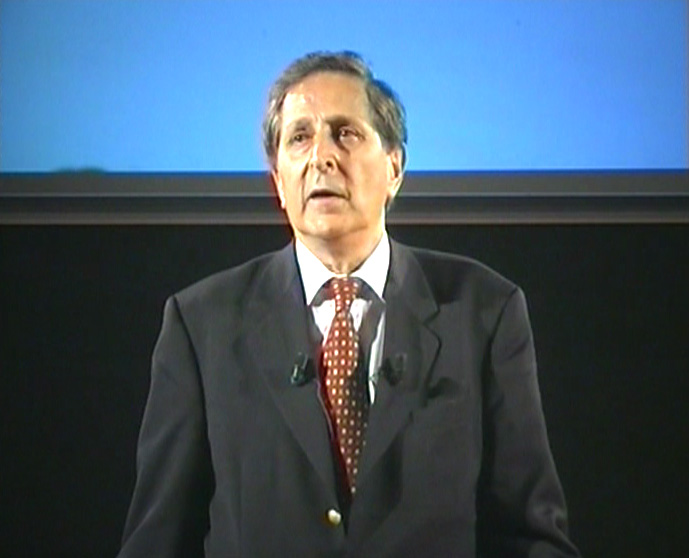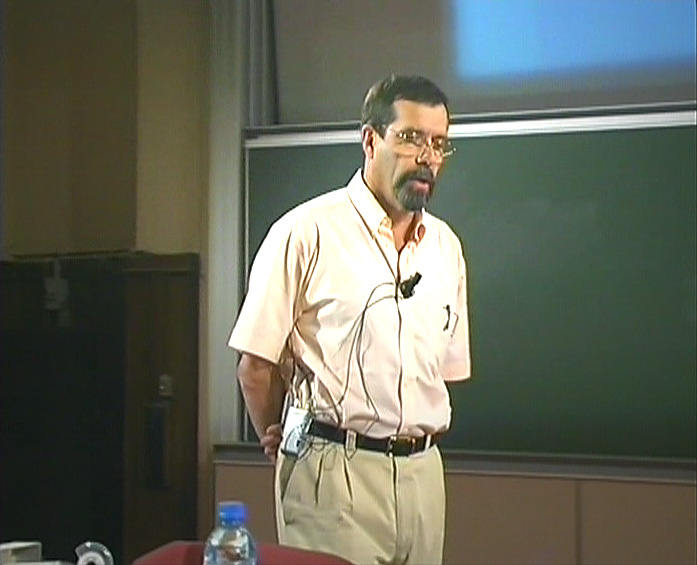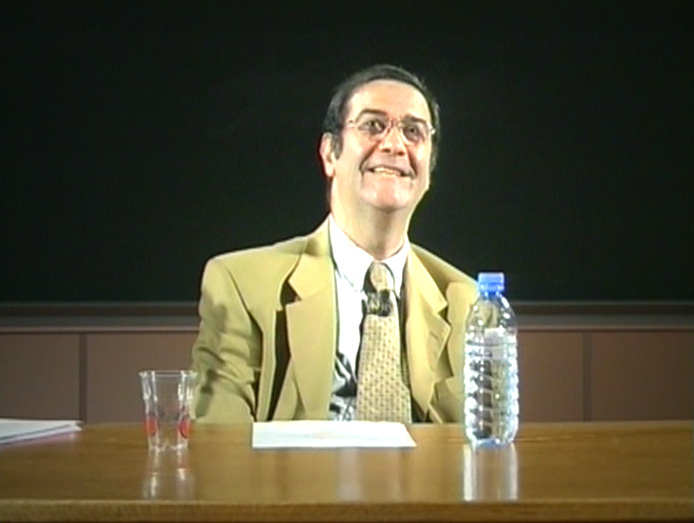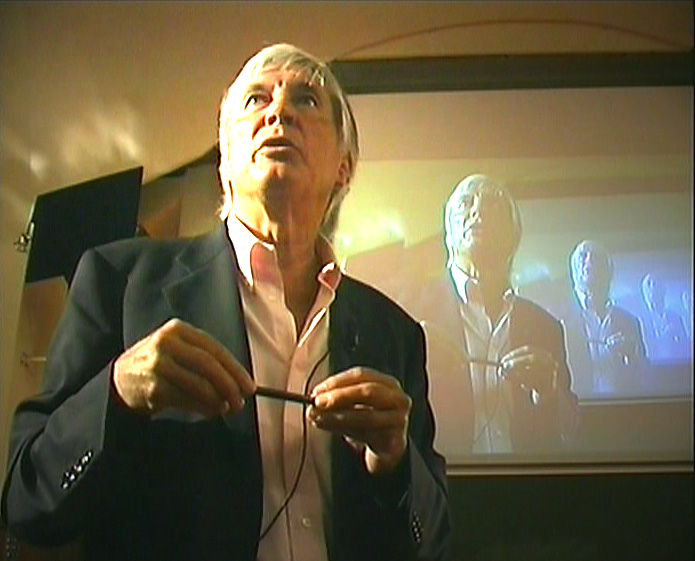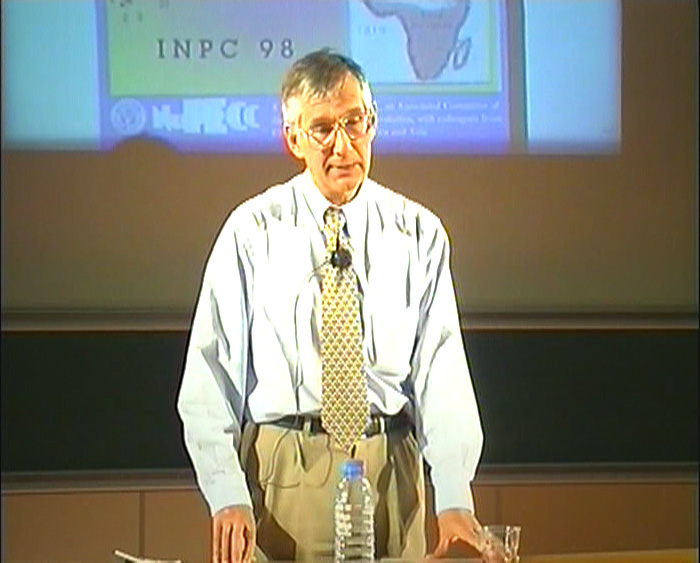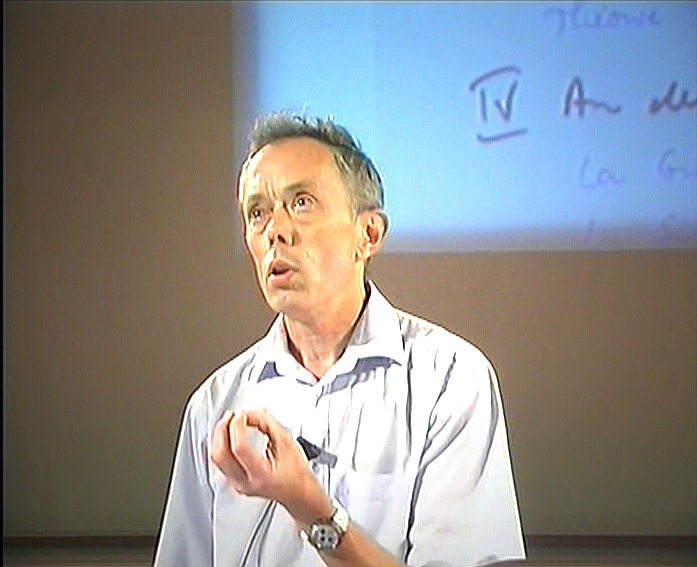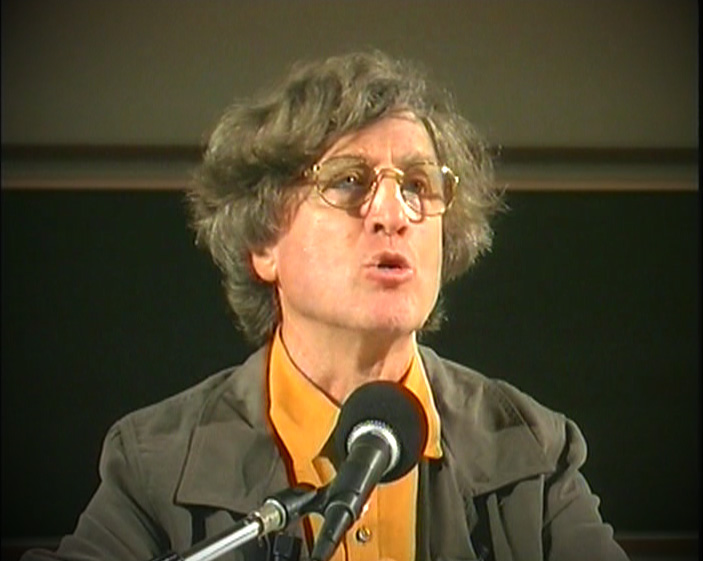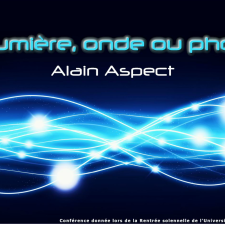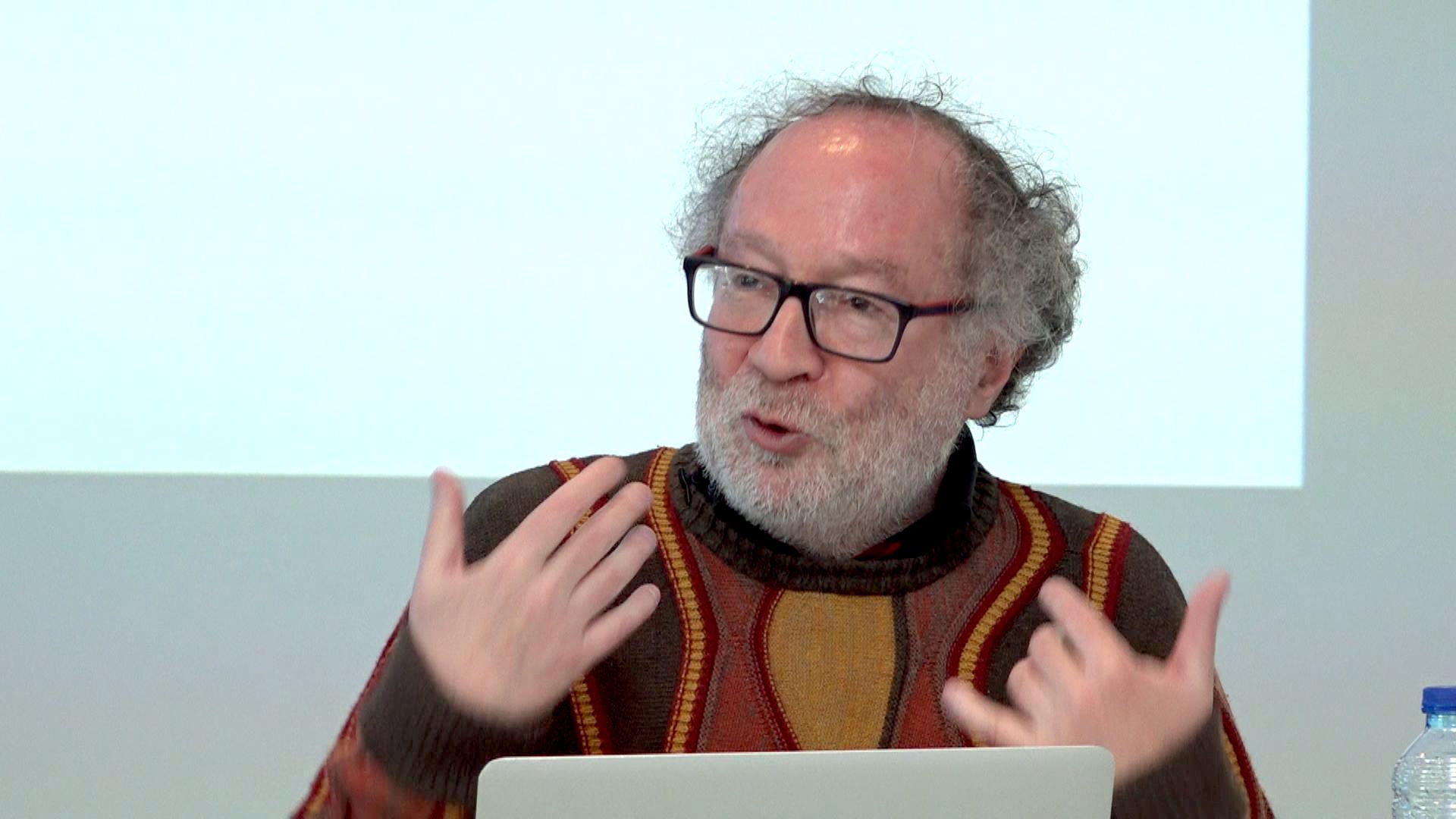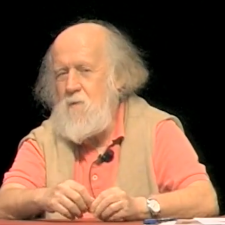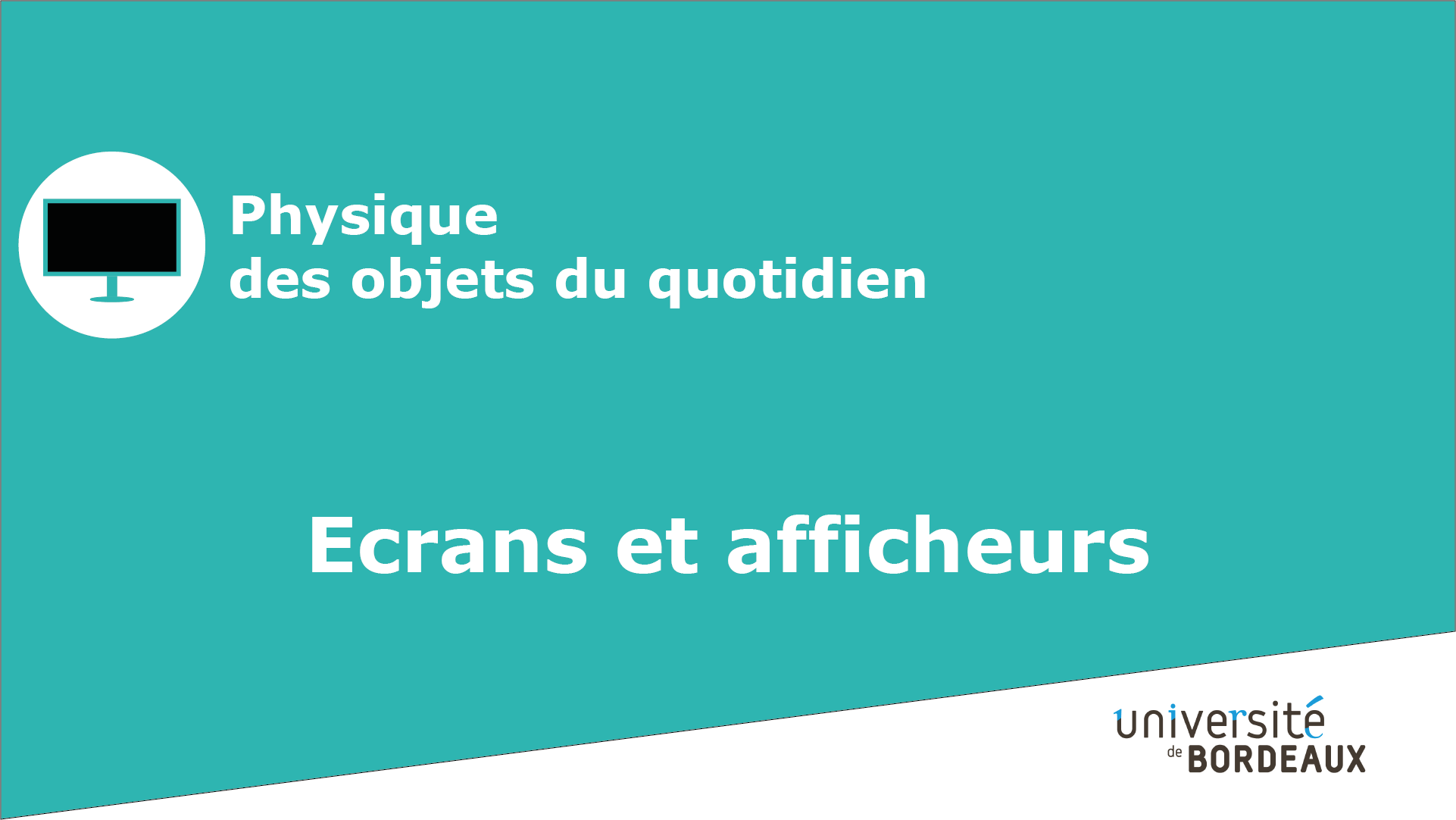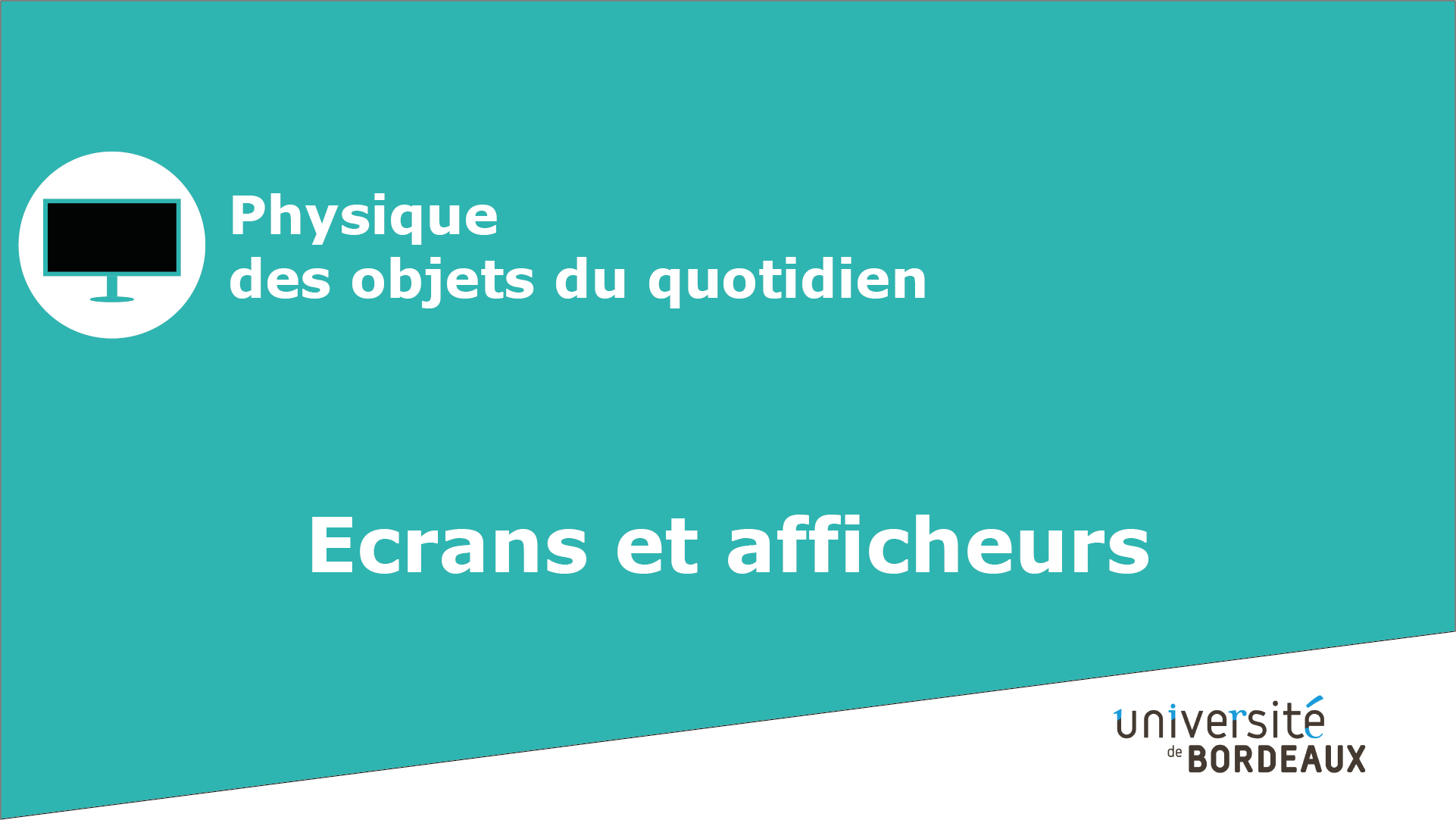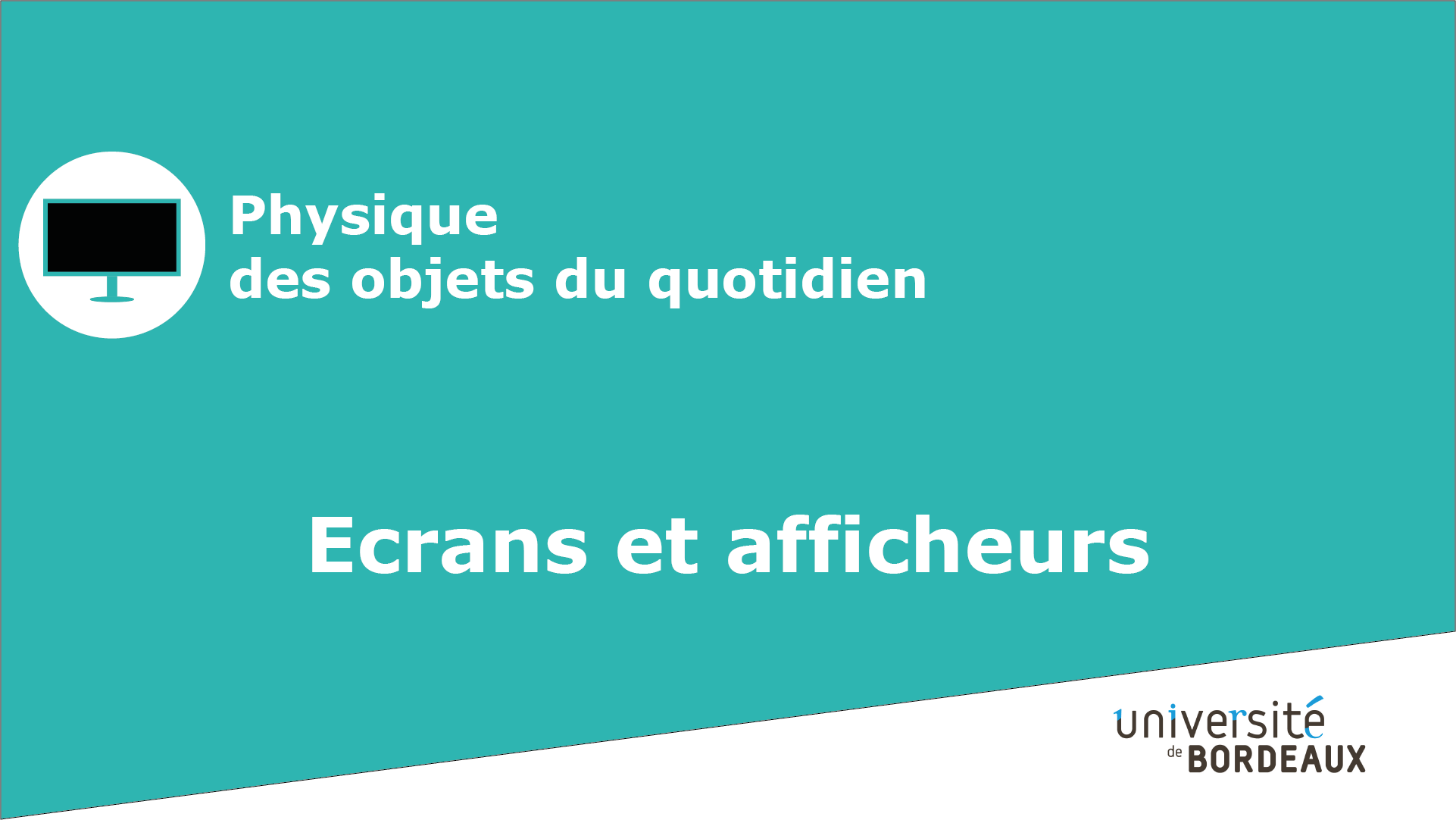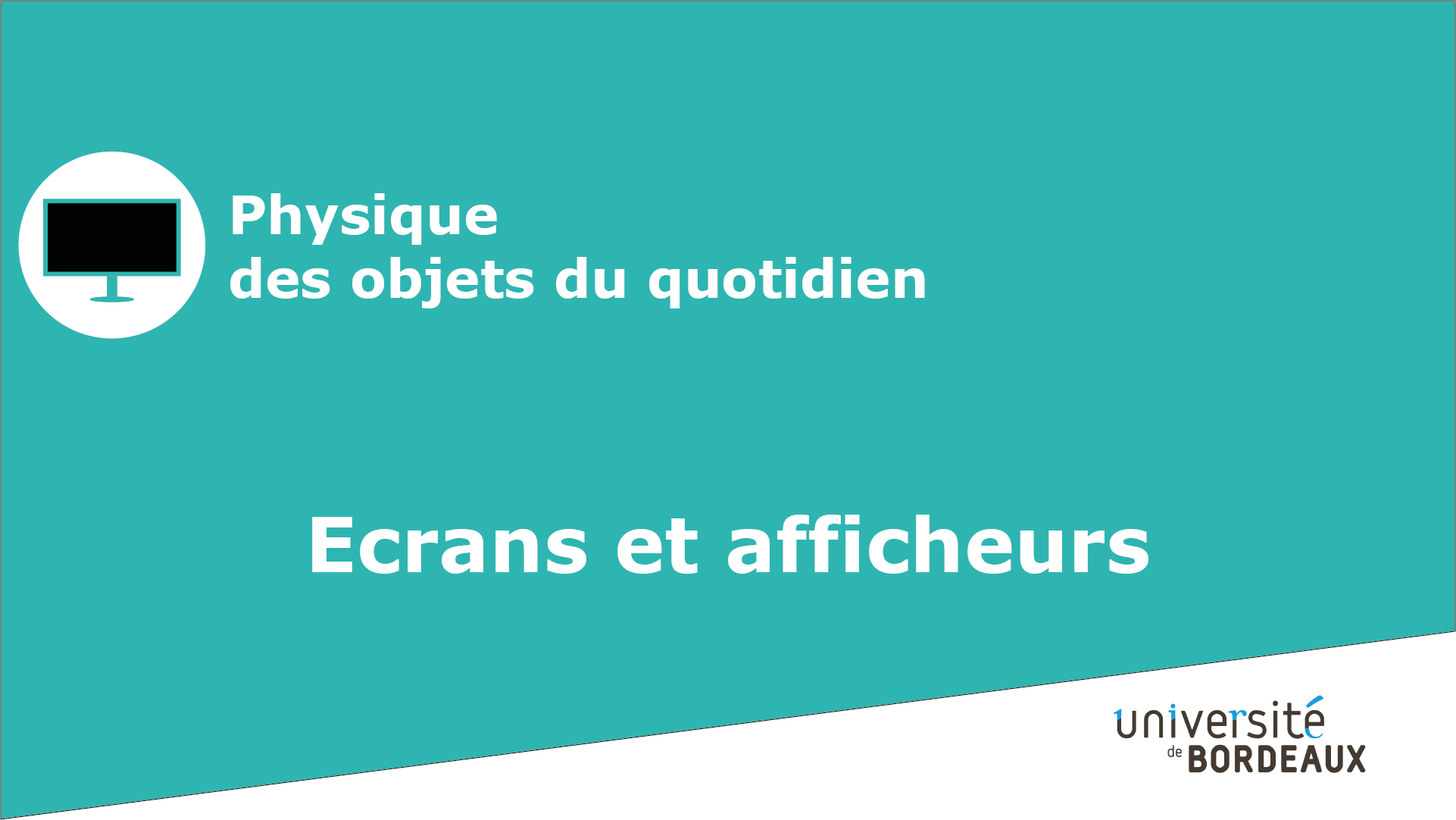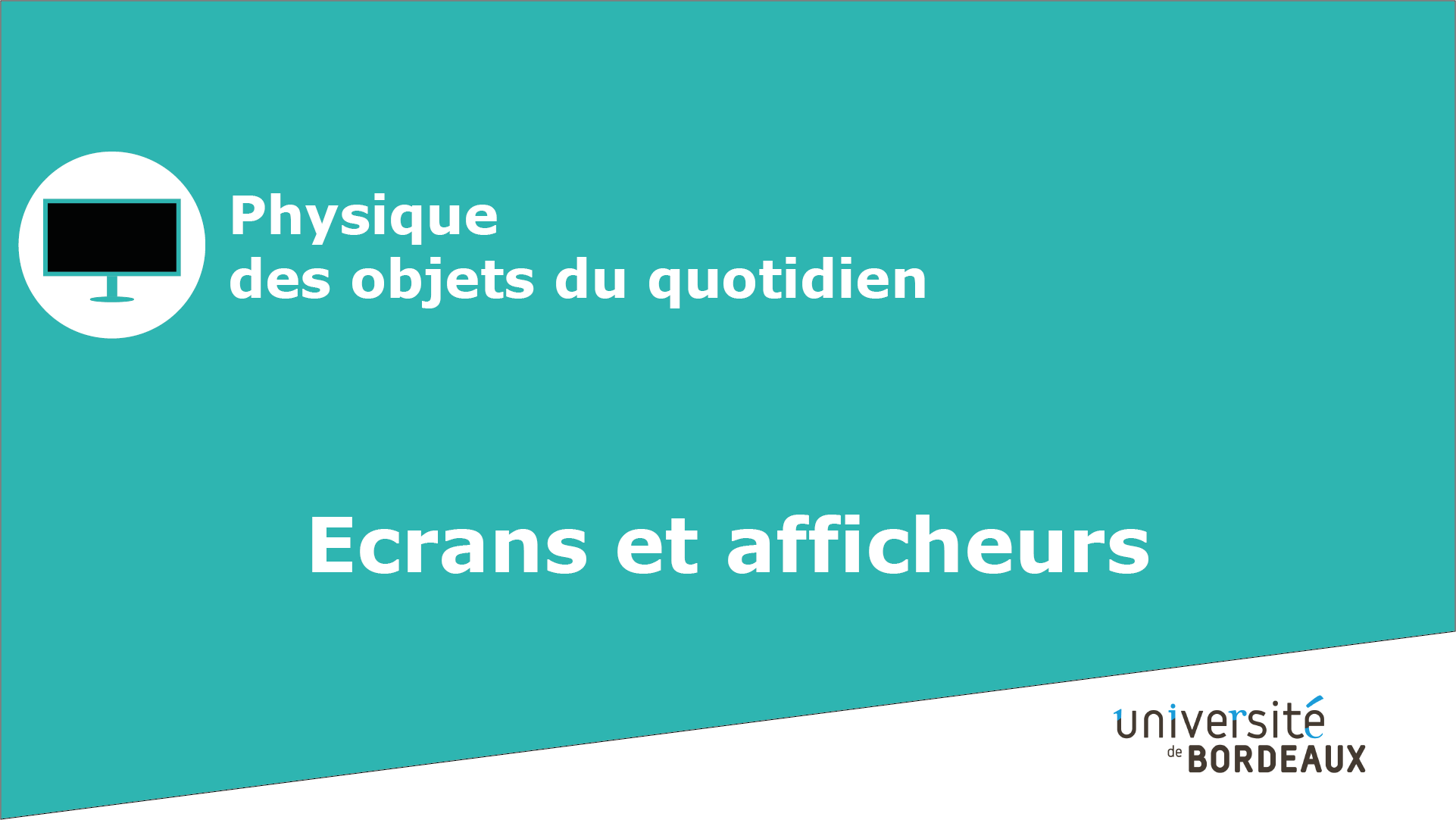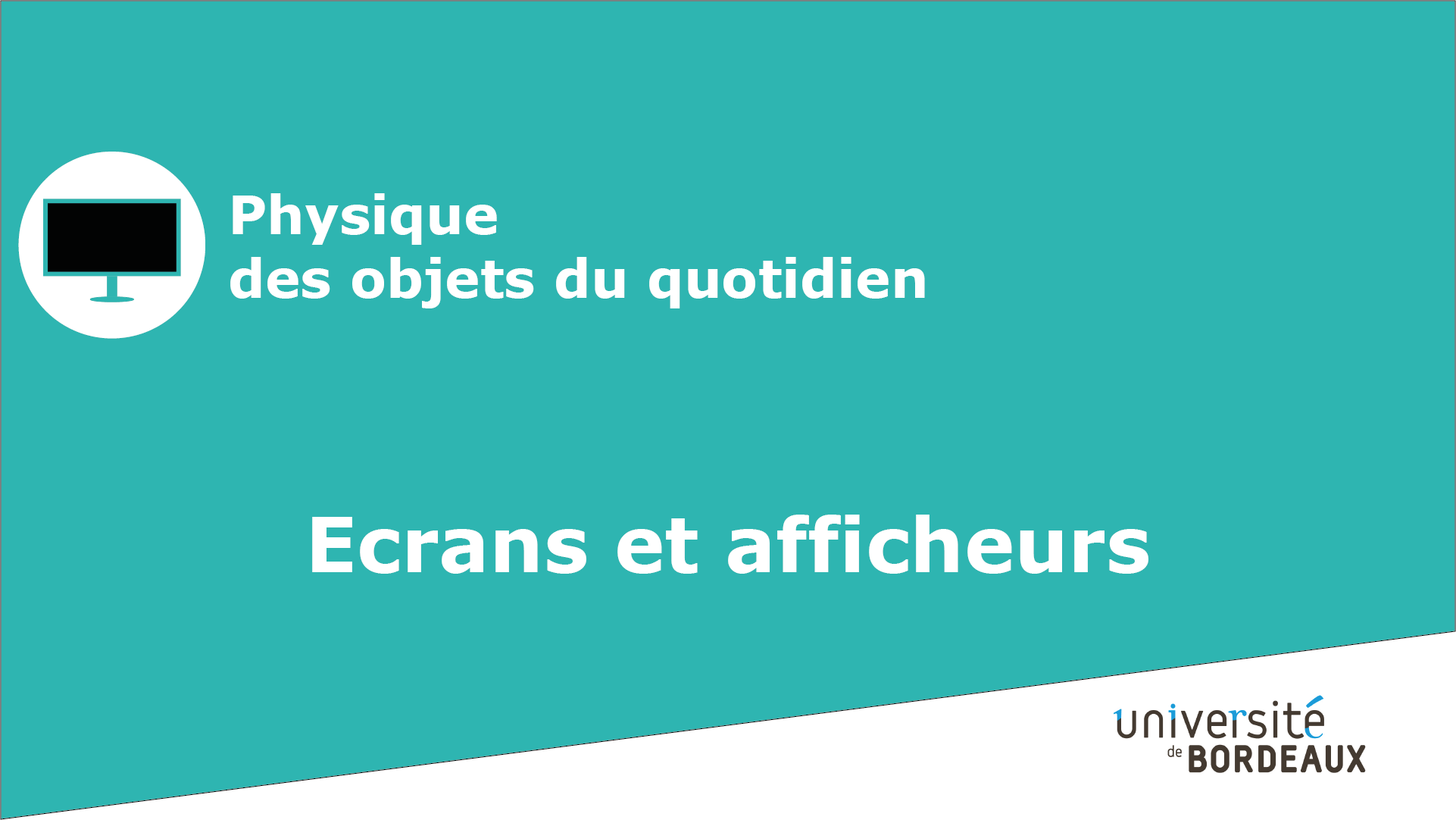Chapitres
- Présentation00'47"
- Introduction02'51"
- Description des principales caractéristiques des lasers25'26"
- Les applications des lasers: partie 102'11"
- Les applications des lasers: partie 202'11"
- Conclusion00'59"
- Questions38'20"
Notice
Les lasers
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Depuis l'invention du premier laser en 1960, la diversité des lasers en couleurs, taille ou puissance n'a fait que croître. Les plus petits lasers sont si minuscules qu'on ne peut les voir qu'au microscope, les plus gros consomment autant d'électricité qu'une ville moyenne. Tous les lasers ont la faculté d'émettre des rayons d'une lumière inconnue dans la nature, qui forment de minces pinceaux d'une couleur pure, et que l'on peut concentrer sur un petit foyer. Ils exploitent la possibilité, prévue par Einstein, de multiplier les photons, qui sont les particules formant la lumière, dans un matériau bien choisi. Les caractéristiques des lasers, fort différentes de celles des lampes ordinaires, leur ont ouvert des utilisations très variées. En délivrant sa puissance de façon localisée, l'outil laser est capable de percer, découper et souder avec vitesse et précision. Il est aussi utilisé en médecine où il remplace les bistouris les plus précis et cautérise les coupures. Ce sont des lasers circulant dans des fibres optiques, fins cheveux de verres dont le réseau couvre maintenant le globe terrestre, qui transportent maintenant les conversations téléphoniques et les données sur Internet. Le laser intervient aussi dans les analyses les plus fines, en physique, en chimie ou en biologie, où il permet soit de manipuler les atomes ou les molécules individuellement, soit de véritablement déclencher et photographier des réactions chimiques ou biologiques. Il identifie les molécules qui composent l'air et beaucoup de grandes villes s'équipent de lasers spéciaux pour détecter la pollution à distance. Les sciences et techniques d'aujourd'hui vivent à l'heure du laser. Beaucoup pensent que le XXIe sera celui de l'optique, et ceci, grâce au laser.
Intervention / Responsable scientifique
Thème
Documentation
Documents pédagogiques
Texte de la 216e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 3 août 2000.
Les lasers
par Élisabeth Giacobino
Inventé il y a quarante ans, le laser reste un instrument un peu mystérieux, voire mythique, dont la notoriété dans le grand public doit beaucoup à la guerre des étoiles. Le combat au sabre laser ou le laser rayon de la mort sont beaucoup mieux connus que d’autres utilisations, bien réelles celles-là, qui ont changé notre vie. Quand vous décrochez votre téléphone pour appeler au-delà de votre voisinage immédiat, il y a de fortes chances que votre conversation soit transmise par un laser, car les câbles téléphoniques sont maintenant en grande partie remplacés par des fibres optiques où circule la lumière laser. Sans les télécommunications par laser, capables de transmettre de très hauts débits d’information, l’expansion de l’Internet n’aurait pas été possible.
Depuis que le premier laser, un laser rouge à rubis, a fonctionné en 1960, la diversité des lasers en couleur, taille et puissance n’a fait que croître. Les plus petits lasers sont si minuscules qu’on ne peut les voir qu’au microscope, les plus gros consomment autant d’électricité qu’une ville moyenne, et nécessitent de véritables immeubles pour les abriter (Fig. 1). Leurs longueurs d’onde dépassent largement les couleurs du spectre visible pour s’étendre des rayons X à l’infrarouge lointain.
Les lasers ont en commun la faculté d’émettre des rayons très parallèles, d’une couleur pure. D’où vient cette lumière extraordinaire, inconnue dans la nature et si différente de la lumière classique émise par une lampe ?
L’émission stimulée, principe de base du laser
Comme dans une lampe ou dans un tube fluorescent, ce sont des atomes ou des molécules qui produisent la lumière. Quand les atomes sont chauffés, excités par un courant électrique ou quand ils absorbent de la lumière, leurs électrons gagnent de l’énergie. Mais ils ne peuvent stocker l’énergie que de manière très spécifique. Ainsi que l’a montré Niels Bohr en 1913, les atomes sont sur des niveaux d’énergie bien précis, dits quantifiés, entre lesquels ils peuvent transiter. Ce faisant, l’atome absorbe ou émet une particule de lumière ou photon, dont l’existence tout d’abord postulée par Max Planck en 1900, a été affirmée par Einstein en 1905 (Fig. 2). De même que les niveaux d’énergie de l’atome, l’énergie du photon échangé, et donc sa longueur d’onde et sa couleur, sont déterminées par le type d’atome ou de molécule concerné.
Dans les lampes habituelles, on fournit de l’énergie aux atomes avec un courant électrique, c’est à dire qu’on met un certain nombre de leurs électrons dans les états supérieurs ou « excités ». Ils en redescendent rapidement et retombent vers l’état de plus basse énergie en émettant de la lumière de manière spontanée et désordonnée, dans toutes les directions et sur plusieurs longueurs d’onde.
Mais outre cette émission spontanée, il existe un autre processus, découvert par Einstein en 1917, appelé émission stimulée. C’est lui qui est à la base du fonctionnement du laser. Laser est d’ailleurs un acronyme pour « Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation » (amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement). La lumière peut forcer l’atome à redescendre de son état excité en cédant son énergie : un photon frappe l’atome et deux photons en ressortent. L’intérêt de ce processus est que la lumière émise est exactement identique à la lumière incidente, elle va dans la même direction, et les deux ondes sont exactement en accord de phase. L’émission stimulée produit ainsi une multiplication de photons identiques et une amplification cohérente de l’onde.
L’idée du laser a été proposée en 1958 par deux physiciens américains, C. H. Townes et A. L. Schawlow, et à peu près dans le même temps par les soviétiques V.A. Fabrikant, A.M. Prokhorov et N.G. Basov. Townes, Basov et Prokhorov ont d’ailleurs eu le prix Nobel en 1964 pour cette invention. Schawlow l’a eu beaucoup plus tard, en 1981. Townes avait déjà inventé, quelques années auparavant, le « maser » qui est un laser fonctionnant en micro-ondes sur les mêmes idées. Mais on peut remarquer que tous les principes étaient là dans les années 1920. Est-ce à dire que le laser aurait pu être inventé bien avant ?
Le principal problème à résoudre était que l’émission stimulée est en compétition avec les autres voies d’interaction de la lumière avec les atomes. L’une d’elle est l’émission spontanée, déjà mentionnée plus haut, l’autre est l’absorption, par laquelle un photon arrivant sur un atome placé dans un certain niveau d’énergie disparaît tandis que l’atome passe dans un niveau d’énergie supérieure. Pour que l’absorption, comme d’ailleurs l’émission stimulée, se produise, il faut que l’énergie du photon corresponde exactement à l’énergie dont l’atome a besoin pour effectuer la transition entre les deux niveaux d’énergie. Les deux processus sont aussi probables l’un que l’autre, et celui qui domine dépend de la répartition des atomes entre les deux niveaux d’énergie concerné par la transition. Considérons, comme sur la Figure 1, un ensemble de photons arrivant sur un groupe d’atomes. Si les atomes situés dans le niveau inférieur de la transition sont majoritaires, il se produit plus d’absorptions que d’émissions stimulées et le nombre de photons diminue. Au contraire, si les atomes du niveau supérieur sont majoritaires, c’est l’émission stimulée qui domine, et il ressort plus de photons qu’il n’y en avait au départ (Fig. 3). Quand le nombre de photons est assez grand, l’émission stimulée devient beaucoup plus fréquente que l’émission spontanée.
En général, les atomes se trouvent dans les niveaux d’énergie les plus bas et la population dans les différents niveaux diminue au fur et à mesure que l’on monte. Pour faire fonctionner un laser, il faut mettre les molécules ou les atomes dans des conditions complètement anormales, où cette répartition est renversée. La population d’un certain niveau doit être plus grande que celle d’un des niveaux inférieurs : on parle d’inversion de population. L’émission stimulée peut alors l’emporter sur l’absorption.
Cette situation est difficile à réaliser et les scientifiques se basés sur des études de spectroscopie qui avaient été faites dans de nombreux matériaux, aussi bien gaz, liquides que solides pour déterminer ceux qui présentaient les caractéristiques les plus favorables. Dans certains lasers, on utilise un courant électrique pour porter un majorité d’atomes dans un état excité et les préparer pour l’émission stimulée, dans d’autres, c’est une source auxiliaire de lumière (une lampe, ou un autre laser) qui « pompe » les atomes vers le niveau supérieur. C’est le physicien français Alfred Kastler qui a le premier proposé l’idée du pompage optique, pour lequel il a reçu le prix Nobel de Physique en 1966.
Si l’amplification sur un passage dans le matériau en question n’est pas très forte, on peut la renforcer en refaisant passer l’onde dans le milieu avec un miroir, et même plusieurs fois avec deux miroirs, un à chaque extrémité. A chaque passage l’onde lumineuse accumule un certain gain qui dépend du nombre d’atomes portés dans l’état supérieur par le pompage. On pourrait penser que dans ces conditions l’onde est amplifiée indéfiniment. De fait, il n’en est rien. A chaque passage, l’onde subit aussi des pertes, pertes inévitables dues à l’absorption résiduelle du milieu et des autres éléments qui constituent le laser et surtout pertes à travers les miroirs pour constituer le faisceau laser utilisable à l’extérieur. L’onde grandit jusqu'à ce que le gain équilibre les pertes et le régime laser s’établit de manière stable dans la cavité formée par les deux miroirs. L’intensité du faisceau laser qui sort de cette cavité dépend à la fois du gain disponible dans le milieu matériel et de la transparence des miroirs. Le faisceau est d’autant plus parallèle et directif qu’il aura parcouru un grand trajet entre les deux miroirs de la cavité.
Des lasers de toutes sortes
Après la publication de l’article où Townes et Schawlow exposaient leur idée, une compétition féroce s’engage dans le monde entier pour mettre en évidence expérimentalement cet effet nouveau. Suivant de près le laser à rubis, mis au point par T. Maiman en juillet 1960, deux autres lasers fonctionnent cette année-là également aux Etats-Unis. L’un d’eux est le laser à hélium-néon, dont le faisceau rouge a longtemps été utilisé pour le pointage et l’alignement. Il est maintenant détrôné par le laser à semi-conducteur, qui a fonctionné pour la première fois en 1962. Ce sont des lasers à semi-conducteur qui sont utilisé dans les réseaux de télécommunications optiques. Au début des années 1960, une floraison de nouveaux lasers voit le jour, comme le laser à néodyme, infrarouge, très utilisé à l’heure actuelle pour produire des faisceaux de haute puissance, le laser à argon ionisé vert qui sert aux ophtalmologistes à traite les décollements de la rétine, ou le laser à gaz carbonique, infrarouge, instrument de base dans les découpes et les traitements de surface en métallurgie.
Après les nombreux allers-retours qu’il fait entre ses deux miroirs avant de sortir, le faisceau d’un laser est très parallèle et peut être focalisé sur une surface très petite, ce qui permet de concentrer une très grande puissance lumineuse. Comme elle est due à la multiplication de photons identiques, la lumière laser est une onde pratiquement monochromatique, d’une couleur très pure. Il existe aussi un autre mode de fonctionnement, dans lequel toute l’énergie du laser est condensée sur des séries d’impulsions extrêmement brèves. Le record du monde se situe actuellement à quelques femtosecondes, soit quelques millionièmes de milliardièmes de seconde. Pendant ce temps très court se comprime toute la puissance du laser, qui peut alors atteindre plus de 100 térawatts, ou 100 000 milliards de watts, soit la puissance que fournissent 100 000 centrales électriques. On conçoit que cette impulsion ne peut pas durer longtemps ! De fait si une telle impulsion dure 10 femtosecondes, elle ne contient qu’une énergie modeste, 1 joule, ou 1/4 calorie.
Des applications très variées
Ce sont les qualités extraordinaires de la lumière laser qui sont exploitées dans les diverses applications, aussi bien dans la vie courante que dans les domaines de haute technologie et pour la recherche. Le faisceau très parallèle émis par les lasers est utilisé aussi bien pour la lecture des disques compacts que pour le pointage et les relevés topographiques et pour le guidage des engins ou des missiles. Lorsque de plus le laser émet des impulsions brèves, il est aisé de mesurer la distance qui le sépare d’un objet éloigné : il suffit que ce dernier soit tant soit peu réfléchissant. On mesure le temps d’aller-retour d’une impulsion entre le laser et l’objet, impulsion qui se propage à la vitesse de la lumière, 300 000 kilomètres par seconde. Certaines automobiles seront bientôt porteuses d’un petit laser qui permettra de connaître la distance de la voiture précédente et de la maintenir constante. Un « profilomètre » laser en cours de développement permettra aux aveugles d’explorer les obstacles dans leur environnement bien plus efficacement qu’une canne blanche. Encore plus ambitieuse est la mesure de la distance de la Terre à la Lune : plusieurs observatoires, comme celui de la Côte d’Azur à Grasse possèdent un laser dirigé vers la Lune. Il se réfléchit à la surface de la Lune sur des réflecteurs placés là par les missions Apollo, et revient, certes très affaibli, mais encore détectable sur Terre (Fig. 4). C’est ainsi que l’on sait que la Lune s’éloigne de la Terre de 3,8 centimètres par an ! La recherche des ondes gravitationnelles prédites par Einstein en 1918, mais jamais observées directement, utilise aussi un laser. Une onde gravitationnelle passant sur Terre modifie très légèrement les longueurs. Un laser permet de comparer avec une précision incroyable la longueur de deux bras d’un appareil appelé interféromètre où le laser circule. On espère détecter une variation de longueur bien inférieure au rayon d’un noyau d’atome sur une distance de plusieurs kilomètres.
Les télécommunications optiques bénéficient aussi de cette possibilité qu’ont les lasers de former des faisceaux très fins et modulables en impulsions très brèves. Les câbles en cuivre ont été remplacés en grande partie par des câbles optiques dont le réseau s’étend aussi bien sous les océans que sur les continents. Dans ces câbles, des fibres optiques, fins cheveux de verre, guident les faisceaux lasers de l’émetteur au récepteur. Sur ces lasers sont inscrits en code numérique aussi bien les conversations téléphoniques que les données pour l’Internet. Les câbles transocéaniques les plus récents atteignent des capacités de transmission fabuleuses, équivalentes à plusieurs millions de communications téléphoniques. De nouveaux câbles assortis de lasers et de systèmes optiques de plus en plus performants vont permettre à la « toile » mondiale de continuer à se développer à un rythme toujours plus effréné.
Une fois focalisé, le faisceau laser concentre une grande énergie. C’est ce qu’utilisent les imprimantes lasers avec des puissances relativement modestes. Les capacités de découpe et de perçage des lasers de grandes énergie comme le laser à gaz carbonique, sont largement exploitées en mécanique. Les lasers ont aussi utilisés couramment pour nettoyer les monuments historiques. Le laser permet d’enlever très exactement la couche de pollution qui s’est accumulée sur la pierre sans endommager cette dernière. En chirurgie le laser fait merveille en particulier en ophtalmologie où il remplace les bistouris les plus précis et en dermatologie où il permet des traitements esthétiques ou curatifs de nombreuses affections : verrues, tatouages ou rides disparaissent grâce au laser.
A la frontière extrême des lasers de puissance se situe le projet français de laser « Mégajoule » et son équivalent américain NIF (pour National Ignition Facility), dans lequel 240 faisceaux lasers seront focalisés pendant 16 nanosecondes avec une puissance totale de 500 Térawatts sur une cible de quelques millimètres carrés. La température de la matière située au point focal est portée à plusieurs millions de degrés. L’objectif principal est de produire la fusion thermonucléaire par laser, mais ces lasers sont aussi susceptibles de contribuer à la recherche sur la matière dans les conditions extrêmes qui règnent dans les étoiles.
Le laser est devenu un instrument de choix pour nombre de recherches fondamentales. En physique, la réponse optique des atomes lorsqu’on les éclaire par un laser est souvent une signature irremplaçable de leurs propriétés et permet de détecter et d’identifier des traces infimes de produits divers. En chimie et en biologie, on assiste à la naissance d’un nouvelle discipline : la femtochimie laser. Si les réactions chimiques d’ensemble prennent parfois plusieurs secondes ou minutes, au niveau des atomes, tout se passe à l’échelle de la femtoseconde. Pour sonder ce domaine, on envoie une impulsion laser ultra-brève qui est capable de déclencher à volonté des réactions de décomposition ou de recombinaison de molécules. D’autres impulsions envoyées quelques femtosecondes plus tard permettent de suivre l’évolution du système du système et de faire de véritables photographies en temps réel de la réaction chimique.
Exploitant la connaissance, accumulée par les chercheurs, des longueurs d’onde que peuvent absorber les molécules, la détection de la pollution atmosphérique par laser est appelée à se développer largement. La méthode LIDAR (pour « light detection and ranging », détection et mesure de distance par la lumière) utilise un laser de la couleur adéquate pour révéler la présence dans l’air des molécules indésirables, comme les oxydes d’azote ou l’ozone. Le laser envoie des impulsions vers la zone polluée. Une faible partie de celles-ci est diffusée en sens inverse, et l’analyse de la lumière qui revient permet de déterminer la concentration en polluant. Le temps d’aller retour des impulsions donne quand à lui la distance et la dimension du nuage polluant (Fig. 5). En balayant le laser dans toutes les directions on peut ainsi réaliser une véritable carte à 3 dimensions de la composition atmosphérique. Des LIDAR sont déjà en fonctionnement ou en test dans plusieurs grandes villes françaises.
Le laser est issu de l’imagination de quelques chercheurs, qui voulaient avant tout mettre en évidence de nouveaux concepts scientifiques. Même si ses inventeurs avaient imaginé quelques unes des utilisations du laser, ils étaient loin de soupçonner les succès qu’il devait connaître. A l’époque, certains avaient même qualifié le laser de « solution à la recherche d’un problème ». Il aurait pu rester à ce stade. Si les sciences et les techniques vivent aujourd’hui à l’heure du laser, c’est aussi grâce au développement de techniques parallèles, comme les fibres à très faibles pertes pour les télécommunications. En revanche, des recherches purement orientées vers une application donnée n’auraient jamais donné ce résultat. Aujourd’hui, dans un monde dominé par la rentabilité à court terme, de telles inventions nous rappellent que la recherche de la connaissance peut aussi déboucher sur des développements technologiques extraordinaires.
Liens
Dans la même collection
-
L'antimatière existe : je l'ai rencontrée
ThibaultCatherineL' antimatière reste un mystère pour beaucoup d'entre nous. Elle fascine certains, elle fait éventuellement peur à d'autres. Mais, au fait, qu'est-ce que la matière ? Et qu'est-ce que l'antimatière ?
-
Chaos, imprédictibilité, hasard
RuelleDavidLe monde qui nous entoure paraît souvent imprévisible, plein de désordre et de hasard. Une partie de cette complexité du monde est maintenant devenue scientifiquement compréhensible grâce à la théorie
-
Le refroidissement d'atomes par des faisceaux laser
Cohen-TannoudjiClaudeEn utilisant des échanges quasi-résonnants d'énergie, d'impulsion et de moment cinétique entre atomes et photons, il est possible de contrôler au moyen de faisceaux laser la vitesse et la position d
-
La lumière
BlayMichelLa lumière a constitué depuis l'Antiquité un objet central de recherche. Cependant ce n'est qu'au XVIIe siècle que les théories physiques de la lumière, c'est-à-dire l'étude de la lumière et des
-
Les tests et effets de la physique quantique
AspectAlainDepuis son émergence dans les années 1920, la Mécanique Quantique n'a cessé d'interpeller les physiciens par le caractère non intuitif de nombre de ses prédictions. On connaît l'intensité du débat
-
La physique quantique (Serge Haroche)
HarocheSerge"La théorie quantique, centrale à notre compréhension de la nature, introduit en physique microscopique les notions essentielles de superpositions d'états et d'intrication quantique, qui nous
-
Pourquoi les particules ont une masse ?
TreilleDanielLe monde des particules élémentaires et de leurs interactions est décrit par ce qu'on appelle le Modèle Standard. L'auteur rappellera les propriétés des constituants de la matière, et les mystères qui
-
Suivre les réactions entre les atomes en les photographiant avec des lasers
MartinJean-Louis"Les progrès de l'optique ont conduit à des avancées significatives dans la connaissance du monde du vivant. Le développement des lasers impulsionnels n'a pas échappé à cette règle. Il a permis de
-
Jusqu'où peut-on produire des noyaux atomiques ?
FlocardHubertProduire des noyaux atomiques revêt aujourd'hui une importance considérable. Ces noyaux, le plus souvent instables, ont de nombreuses applications. Ils sont utilisés en imagerie médicale, dans des
-
Qu'est-ce qu'une particule ? (les interactions des particules)
NeveuxAndréEn principe, une particule élémentaire est un constituant de la matière (électron par exemple) ou du rayonnement (photon) qui n'est composé d'aucun autre constituant plus élémentaire. Une particule
-
Les limites de la connaissance physique
Lévy-LeblondJean-MarcIl n'est pas indifférent que dans ce cycle de conférences sur "tous les savoirs", la question des limites de la connaissance n'ait été posée qu'à la physique. C'est sans doute son statut implicite de
Sur le même thème
-
Le temps des lumières
LiltiAntoineSebastianiSilviaCallardCarolineOrainArnaudAlors que la pandémie nous a plongés dans un présent perpétuel tandis que la crise climatique bouleverse nos représentations du futur, au moment où le passé sert de refuge à certains de nos
-
Session 2 : Ambiances lumineuses : perceptions /conceptions
DrozdCélineChelkoffGrégoireRequena-RuizIgnacioDans un contexte de forte mobilisation autour des économies d’énergie, la gestion réfléchie des flux lumineux a un rôle à jouer dans les projets d’architecture. Par ailleurs, la lumière naturelle
-
La lumière, onde ou photon
AspectAlainConférence d'Alain Aspect donnée dans le cadre de la Rentrée solennelle 2007 de l'Université de Bordeaux
-
Ombre et lumière XIXe – XXe siècle: du renouvellement scientifique à la représentation picturale
IzbickiJean-LouisDans cette conférence, Jean-Louis Izbicki présente les résultats de ses travaux de thèse sur la représentation de la lumière électrique dans les oeuvres picturales du XIXe-XXe siècle. Il aborde 3
-
Manipulation et visualisation des ondes de matière
Cohen-TannoudjiClaudeLes ondes de matières constituent un nouvel état de la matière pour lequel de nombreuses recherches sont en court dans le monde entier. On peut les définir ainsi : il existe une dualité onde
-
Pourquoi il fait nuit ?
ReevesHubertLes questions les plus simples sont quelque fois les plus potentiellement riches d'informations. L'obscurité de la nuit est demeurée une énigme sans réponse jusqu'au début de ce siècle. Aujourd'hui
-
6 - Écrans et afficheurs / La nature vectorielle de la lumière (expert)
FabreBaptisteSession 3 - La polarisation de la lumière Nous allons décrire d'un point de vue mathématique l'état de polarisation d'une onde électromagnétique polarisée dans le cas le plus général, c'est à dire
-
14 - Écrans et afficheurs / Les déphaseurs et les lames d'ondes
FabreBaptisteSession 3 - Optique anisotrope Après avoir fait un rapide rappel des caractéristiques de propagation de la lumière dans les milieux anisotropes, nous étudierons le cas particulier des lames
-
9 - Écrans et afficheurs / La loi de Malus (expert)
FabreBaptisteSession 3 - La polarisation de la lumière Nous allons nous intéresser à la loi de malus obtenue après traversée de l'analyseur dans le cas où la polarisation incidente n'est pas linéaire. Ce
-
17 - Écrans et afficheurs / Optique anisotrope (suite expert)
FabreBaptisteSession 3 - Optique anisotrope Nous allons introduire le concept de l'ellipsoïde des indices qui nous permettra de caractériser les directions de polarisations des ondes ordinaire et extraordinaire
-
4 - Écrans et afficheurs / La nature vectorielle de la lumière
FabreBaptisteSession 3 - La polarisation de la lumière Nous allons approfondir la description de la lumière d'un point de vue mathématique en introduisant en particulier la composante vectorielle de l'onde
-
12 - Écrans et afficheurs / Polarisation par réflexion (expert)
FabreBaptisteSession 3 - La polarisation de la lumière Nous allons nous intéresser au phénomène de polarisation de la lumière par réflexion sur une surface vitreuse. Pour cela nous allons étudier la dépendance