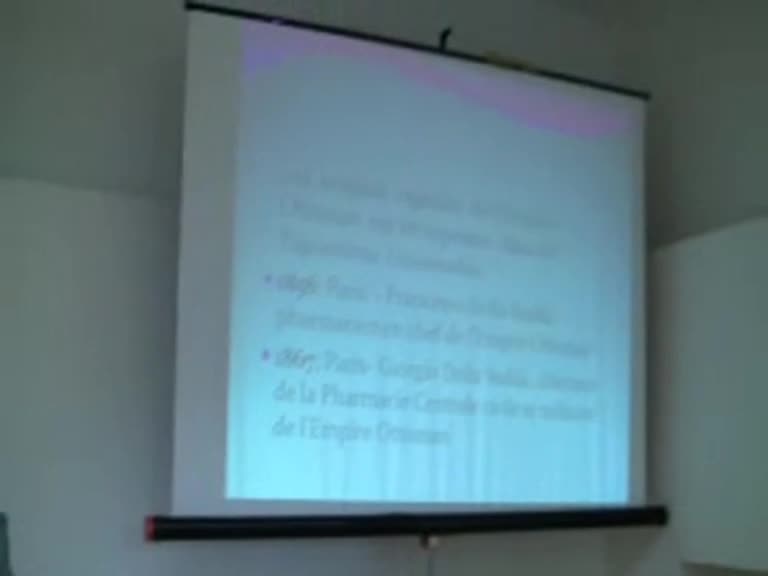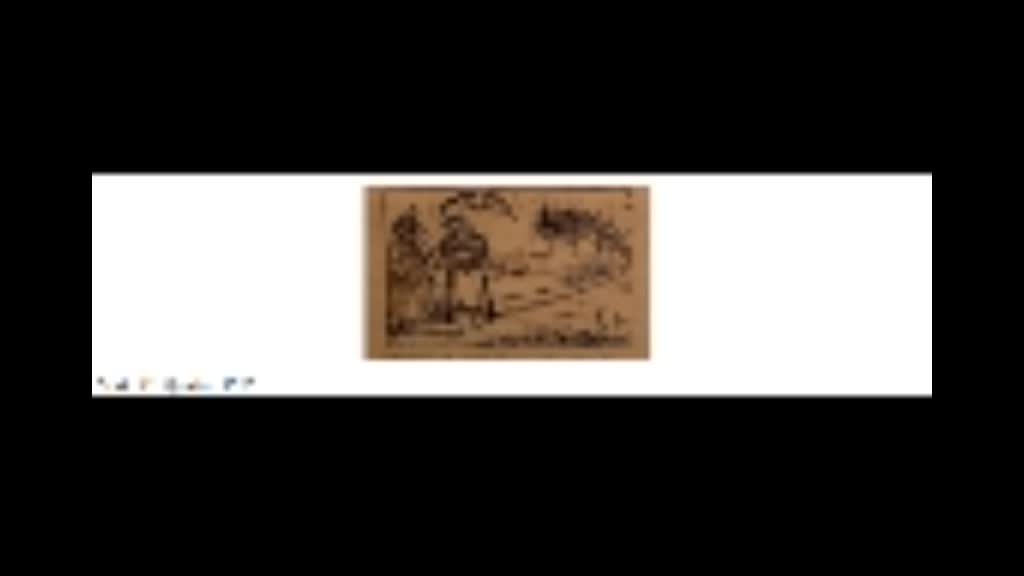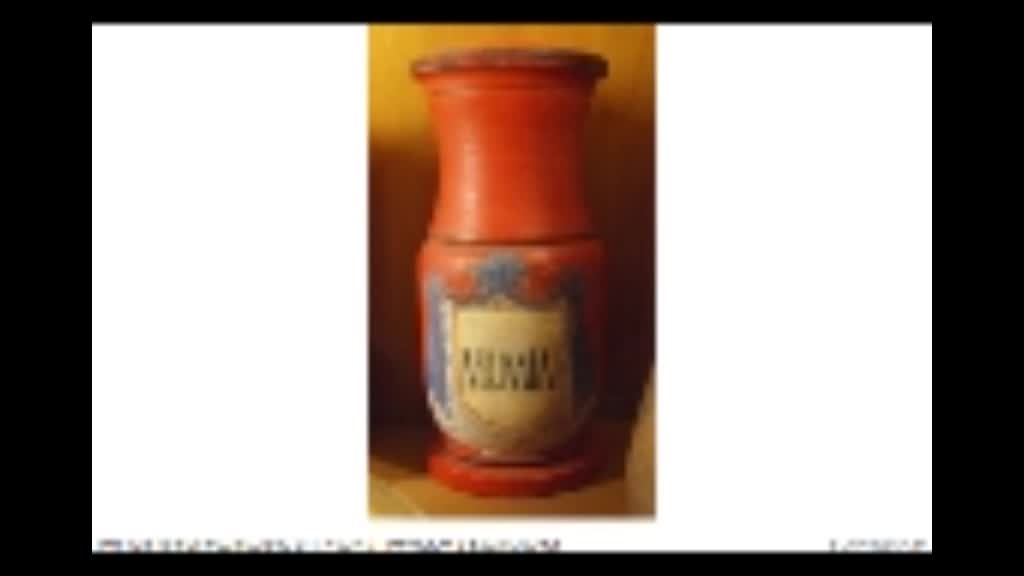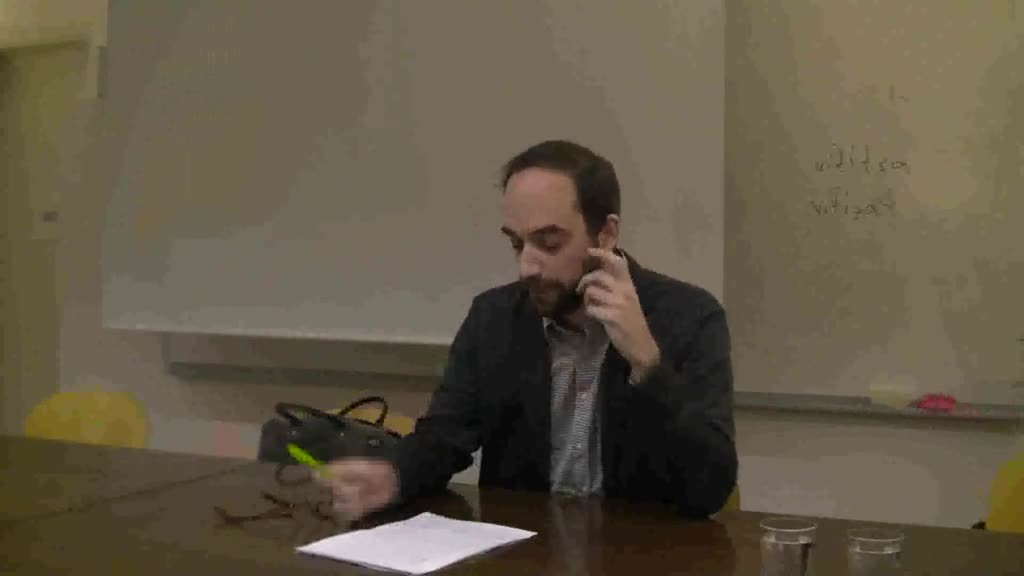Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman

Descriptif
Ce séminaire mensuel s'inscrit dans le cadre du programme de recherche Sciences et savoirs en mouvements dans les mondes ottomans et post-ottomans coordonné par Philippe BOURMAUD (IFEA / Université Lyon 3 / IFPO) et Aude Aylin de Tapia (EHESS / Université du Bosphore / IFEA / Université Koç)
À la recherche d'une généalogie ottomane des savoirs
Des Balkans à l'Afrique du nord, quelle empreinte l'Empire ottoman a-t-il laissé dans l'ordre des savoirs ? Poser la question, c'est d'emblée souligner la diversité géographique des espaces ottomans et sous-entendre le poids du cloisonnement étatique après le morcellement de l'Empire. C'est aussi poser les territoires ottomans comme espaces de réception et surtout de production de savoirs. Les savoirs de tous ordres, produits, réappropriés et transmis, circulent pour être partagés et pour former des communautés autour de la connaissance.
Nous envisageons les savoirs ottomans de manière à éviter deux écueils principaux. Le premier est de ne s'occuper que de savoirs reconnus par une élite savante. Une telle approche conduirait à mettre l'accent sur les centres de production scientifique, et tout d'abord les capitales. Le séminaire s'appuie sur une conception non normative des savoirs, au-delà des sciences structurées en disciplines et en dispositifs formels de transmission. L'Empire ottoman est-il caractérisé par la concentration des lieux de savoir, par une communauté de savoirs distribuée à travers l'Empire, ou par une différenciation, voire un cloisonnement linguistique et géographique ?
Une science ottomane commune ?
Le deuxième écueil serait de considérer l'Empire ottoman comme une unité épistémologique autonome. Il a hérité de savoirs d'origines diverses et n'a cessé de s'en approprier de nouveaux, venant de tous les horizons. La circulation des savoirs invite à dépasser la fixation, fréquente dans l'historiographie, sur l'avant et l'après des réformes du dix-neuvième siècle et sur l'occidentalisation à partir du Tanzimat. Nous nous intéresserons donc aux échanges culturels et scientifiques avec des voisinages et des ailleurs multiples et pas seulement européens. Nous mettrons également l'accent sur la dimension endogène des savoirs, produits dans l'Empire se diffusant à travers l'Empire. La circulation des savoirs engendre-t-elle un ou plusieurs mondes ottomans de la connaissance ? Comment se communiquaient les savoirs à travers l'étendue de l'Empire ? Est-ce que le démantèlement de l'Empire a mis fin à une épistémé commune ?
La circulation des savoirs pose des questions sur l'organisation technologique de l'Empire ottoman. Le monde ottoman constitue-t-il un espace propice à la circulation des savoirs tout comme, grâce au réseau des han qui jalonnent le territoire, il peut l'être pour la circulation des marchandises ? D'un côté, il existe des instances scientifiques normatives – pour les savoirs « nobles », les sciences religieuses, la médecine ou l'astronomie. D'un autre côté, les communautés de normes et de savoirs ne sont pas réellement centralisées avant le dix-neuvième siècle. Il y a un paradoxe apparent : la culture écrite ottomane d'expression turco-arabo-persane semble un outil efficace d'uniformisation des connaissances (mais avec quelles différences sociales, et quelles poches régionales?). En revanche, l'accélération de la diffusion des idées et des informations qui accompagne la généralisation de l'imprimerie démocratise la diffusion des savoirs dans des langues diverses et favorise l'éclosion de nationalismes scientifiques. Si des langues communautaires deviennent les vecteurs de la production de savoir, est-ce pour autant que cela entrave l'intercompréhension entre gens de savoirs dans le cadre politique commun de l'Empire ? Est-ce alors un facteur précoce de cloisonnement en communautés scientifiques distinctes ? Ou bien les nationalismes scientifiques se manifestent-ils par un dialogue empreint de rivalités, certes, mais plus actif que les échanges entre les communautés scientifiques séparées qui se forment dans les Etats issus du morcellement de l'Empire ottoman ?
L'idée d'un monde ottoman commun de la connaissance a une portée politique. La promotion de la recherche scientifique et l'organisation de la transmission des savoirs peuvent être des « outils d'Empire », pour promouvoir activement une intégration culturelle par l'uniformisation des apprentissages et des compétences scientifiques et techniques. Une telle perspective imprègne-t-elle l'action de l'Etat ottoman ? Si oui, cela s'explique-t-il par la bureaucratisation de l'Empire, par les mouvements nationaux et leurs efforts pour développer une culture savante, ou bien encore par la perspective de la colonisation européenne ?
Vidéos
Les drogues végétales en Anatolie
Journée d'études : Les thérapeutiques dans l'Empire ottoman le mercredi 3 juin, de 9h15 à 17h15, à l'IFEA organisé par l'IFEA (Musa Çimen) avec les interventions de: Nuran Yıldırım (Prof. à
Remèdes et guérisons populaires décrits dans l'ouvrage de Mustafa Behçet Efendi
Journée d'études : les thérapeutiques dans l'Empire ottoman
Osmanlı eczacılığının gelişme sürecinde ilaç hazırlanışı ve şatış kontrolü
Journée d'études : Les thérapeutiques dans l'Empire ottoman le mercredi 3 juin, de 9h15 à 17h15, à l'IFEA organisé par l'IFEA (Musa Çimen) avec les interventions de: Nuran Yıldırım (Prof.
Osmanlı İmparatorluğu'nda Tıpta Moderleşme
Dans le cadre du séminaire « Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman » Le XIXe siècle a constitué une période de réforme pour la société ottomane dans son ensemble ; les efforts déterminés dans le
İmparatorluk Demiryolları'nda Tren Kazaları 1858-1908
Dans le cadre du séminaire « Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman » 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren İmparatorluk sınırları içerisinde inşa edilmeye başlanan demiryolları ve çevresinde
Mūmyā: Osmanlı Tıbbında Gündelik Bir İlacın İzini Sürmek
Dans le cadre du séminaire « Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman » Yüzyıllar boyunca Avrupalı hekimler, antik Mısır mumyalarının bedenlerinden alınan bölümlerin, yani mumyalamak için üzerine
İnsan Onuru, İktidar ve Siyaset: Osmanlı İmparatorluğu’nda Ceza Hukuku Reformu ve İşkence Yasağı
dans le cadre du séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman" On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Osmanlı ceza hukukunda, bir cezalandırma pratiği ve yasal kanıt üretme yöntemi olarak
Fatma Öncel - Osmanlı'da toprak ve malumat: Teselya 1780-1880
Osmanlı kırsalı hakkında devletin bilgi toplama teknikleri, 18. yüzyılın sonundan 19. yüzyılın sonuna kadar ciddi bir dönüşüm geçirmiştir. Günümüz tarihçiliğinin odak noktasında olan Tanzimat sonrası
Ameli Elektrik Dergisi: Dersaadet Elektrik ve Tramway Şirketleri Tarafından Neşrolunan Bir Mecmua
İstanbul’un elektriğini büyük ölçüde sağlaması beklenen Silahtarağa Elektrik Fabrikası uzun süren savaş döneminden sonra 1920’lerde elektrik üretimini arttırmış ve elektrik İstanbul tramwayları
İstanbul'da Bikes ve Bimesken Kadınlar için bir Hastane: Haseki Nisa HastanesiA place in Istanbul f…
Haseki Hospital is one of the fundamentals of Ottoman health institutions with its past of more than 450 years. In the early part of the nineteenth century this hospital will be treated in the
The Novel from Commodity to Technology: Producing and Consuming Prose Fiction in the Late Ottoman E…
When we discuss the development of a culture of the novel in the late Ottoman Empire, it appears crucial to emphasize that the emergence of this particular genre in the largest urban centers of
Developing Ottoman education in Southern Transjordan in the late 19th century
In the late 19th century, the Ottoman reassertion of power in the Southern regions of the Bilâd al-Sham went along with the implementation of new educational policies fitting the reforms (Tanzimat
Learning and teaching medical sciences between Ottoman reforms and Arab cultural renaissance : Dr S…
The intellectual dynamics of the Tanzimat (Ottoman reforms) and Nahda (Arab cultural renaissance) that unfold over the nineteenth century have often been paralleled, nearly conflated into one
Intervenants et intervenantes
Maître de conférences en histoire contemporaine (Université Jean Moulin-Lyon 3). Spécialiste de l'histoire sociale de la médecine de l'Empire ottomann et des pays du Levant à l'époque mandataire.
Enseigne la littérature turque (2020)
Anthropologue des médias, Macalester College, St Paul, Minn., États-Unis (en 2016)
Historien du droit
En poste : Faculté de pharmacie, Université d'Istanbul, Beyazit, Istanbul, Turquie (en 2015)
Président de la Société turque pour l'histoire de la pharmacie (en 2015)
"Associate professor, Acıbadem University, School of Medecine, Dept. of Medical History and Ethics", chercheur associée de l'Institut Français d'Etudes Anatoliennes à Istanbul (en 2010)
Early modern Ottoman history; Medical history; Islamic manuscript culture; History of science and knowledge production.
Doctorant à l'Université de Strasbourg (2006-2012) La science médicale ottomane à la veille de la “révolution scientifique” de l’âge des réformes (à partir de 1839). Contribution à une histoire de la pensée scientifique dans l’Empire ottoman au XIXe siècle
Docteure en histoire de l'Université de Binghamton (2015)