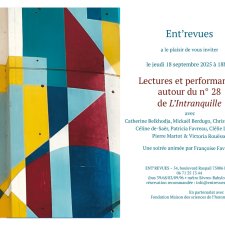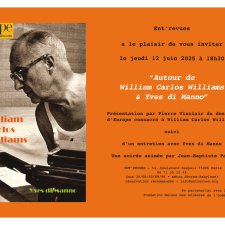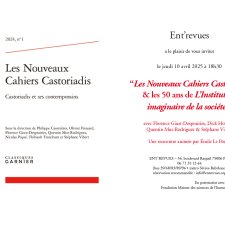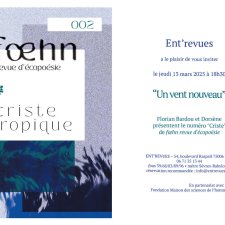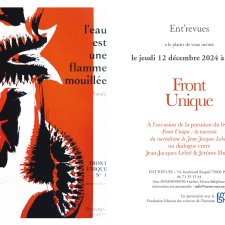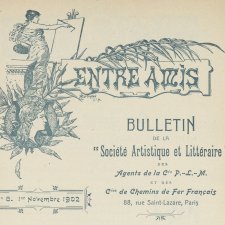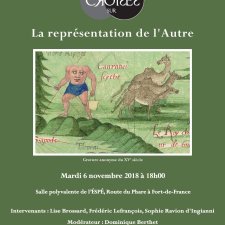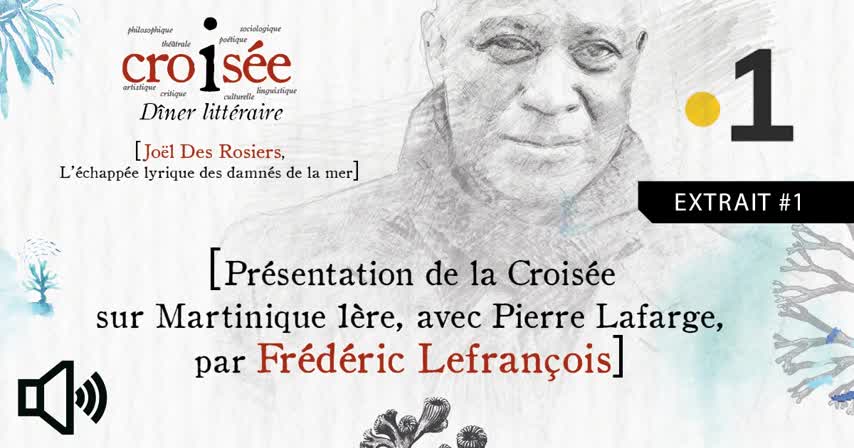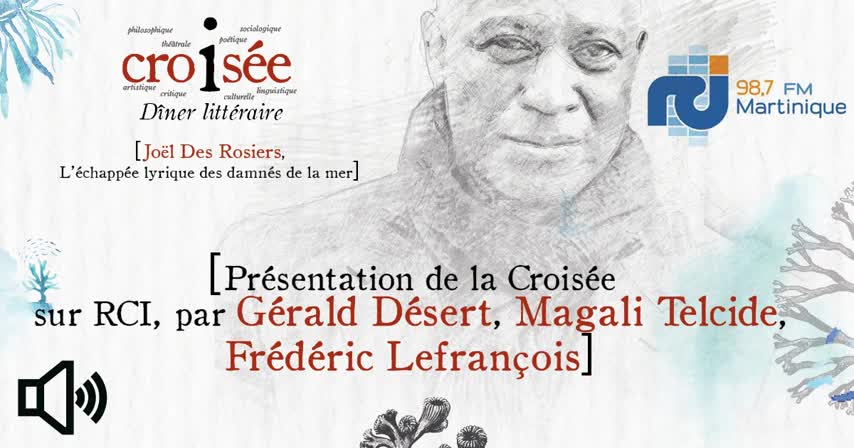Notice
CCIC, Cerisy-la-Salle
La référence prométhéenne et la question de l'altérité
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a été donnée dans le cadre du colloque intitulé Bachelard, science, poésie, une nouvelle éthique ? qui s'est tenu au Centre Culturel International de Cerisy du 25 juillet au 1er août 2012, sous la direction de Jean-Jacques WUNENBURGER.
Présentation de l'intervenant
Christian Thiboutot (Ph.D.) est professeur au département de psychologie de l'université du Québec à Montréal (UQAM), au Canada. Il s'intéresse à la psychologie existentielle et à l'herméneutique - plus précisément à la rencontre et à l'interprétation d'œuvres culturelles (littérature, cinéma, mythologie...) dans la compréhension des situations limites de l'existence. Il codirige le Cercle interdisciplinaire de recherches phénoménologiques (CIRP-UQAM), où il a édité depuis 2004 plusieurs ouvrages collectifs et numéros de périodiques scientifiques. Membre depuis 2011 de l'Editorial Board du Journal of Phenomenological Psychology (USA) et responsable de l'organisation de l'International Human Science Research Conference de 2012 (Montréal, 25-29 juin), il s'intéresse aux questions de l'altérité, de l'habitation concrète du monde et de la transmission de l'héritage culturel dans l'anthropologie de l'imaginaire et les poétiques de Bachelard.
Résumé de la communication
Il existe une tradition de commentaire du versant poétique de l'œuvre de Bachelard qui, en insistant surtout sur ses valeurs d'originalité, de créativité et d'anticonformisme, tend parfois à voiler le fait que c'est dans sa tradition et son héritage culturel que le philosophe a sans contredit trouvé sa plus grande et plus constante source d'inspiration. Cette remarque a son importance. Non seulement parce qu'elle invite à rencontrer Bachelard comme un héritier et un interprète de la culture, mais aussi parce qu'elle donne à penser que dans les images, la rêverie et la poésie, sont finalement bien plus donné à vivre qu'à concevoir ou à penser. Dans la Poétique de l'espace, par exemple, Bachelard a montré clairement son aversion à l'égard des philosophies, dit-il, qu'il n'arrive pas à vivre (1957, p. 150). Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la phénoménologie s'affirme précisément à partir de ses poétiques - celles-ci marquant en effet la mise entre parenthèses d'une approche plus méthodique de l'imagination. Il n'est pas non plus innocent que le lecteur fasse son apparition à ce même moment dans le texte de Bachelard. Nous soutiendrons donc que c'est la recherche de la rencontre, bien plus que celle de l'autorévélation subjective ou la connaissance, qui anime le philosophe dans ses poétiques. En l'occurrence, nous chercherons à faire valoir que les situations poétiques à l'intérieur desquelles Bachelard s'est engagé se présentent d'abord comme des situations éthiques d'interlocution et de transmission. À savoir comme des situations réelles d'expérience et de médiation à l'intérieur desquelles la liberté humaine, en engageant son historicité, peut s'élever à la possibilité d'être à la fois fidèle et féconde et, par là, entrer dans son pouvoir de recevoir et de donner, de transmettre la vie et la pensée.
Thème
Documentation
Présentation du colloque
Gaston Bachelard explore les deux versants de la culture moderne, la connaissance scientifique dans ses formes les plus innovantes, et l'expérience poétique, de la rêverie spontanée aux grandes créations artistiques. Il a tenu à les différencier comme des expressions antagonistes de l'esprit et à les unir comme complémentaires dans l'existence. Au-delà de ces rapports entre science et poésie, entre théorème et poème, ne pourrait-on trouver aussi, en filigrane, les lignes profondes d'une philosophie pratique, d'un humanisme et d'une sagesse? Car Bachelard parle aussi du désir et de la volonté, de l'enfant et de l'adulte, du loisir et du travail, de l'amour et de l'affrontement, de l'autorité et de la révolte, de la solitude et de la communauté, de la liberté et de la nécessité, de la vie et de la mort; autant d'entrées, condensées en certains passages ou dispersées dans l'œuvre, dans une philosophie du bien vivre et du bien être ensemble.
Actes du colloque
Gaston Bachelard. Science et poétique, une nouvelle éthique ?
Jean-Jacques Wunenburger (dir.)
Hermann Editeurs - 2013
ISBN : 978-2-7056-8744-1
Sur le même thème
-
Soirée Ent'revues : "Le contraste et l'inattendu"
RannouFrançoisKolmačkaPavelMeunierBenoîtRencontre avec Pavel Kolmačka, Benoît Meunier et François Rannou dans le cadre de la sortie du nouveau numéro de la revue L'étrangère
-
Soirée Ent'revues : Lectures et performances autour du n° 28 de L'Intranquille
MartotPierreDe SaërCélineBelkhodjaCatherineLecuelleClélieRouësséVictoriaFavreauPatriciaBerdugoMickaelFavrettoFrançoiseRencontre avec Pierre Martot, Céline De-Saër, Catherine Belkhodja, Clélie Lecuelle, Victoria Rouëssé, Patricia Favreau, Mickaël Berdugo et Françoise Favretto autour du n° 28 de L'Intranquille, qui s
-
Soirée Ent'revues : "Europe"
ParaJean-BaptisteDi MannoYvesVinclairPierreRencontre avec Jean-Baptiste Para, Pierre Vinclair et Yves di Manno, dans le cadre de la revue Europe qui propose de mettre en lumière les dossiers consacrés à William Carlos Williams et Philippe di
-
Soirée Ent'revues : "Quelle figure pour la pensée aujourd'hui ?"
Giust-DesprairiesFlorenceHowardDickMur-RodriguezQuentinVibertStéphaneLe PessotEmileRencontre avec les Nouveaux Cahiers Castoriadis dans le cadre de leur lancement
-
Soirée Ent'revues : "Un vent nouveau"
BardouFlorianDorsèneLouisRencontre avec Florian Bardou et Dorsène dans le cadre de la parution du deuxième numéro "Criste tropique" de la revue Foehn, revue d'écopoésie
-
Soirée ent'revues : "Front unique"
LebelJean-JacquesDuwaJérômeRencontre avec Jean-Jacques Lebel et Jérôme Duwa sur le thème Front unique, une traversée du surréalisme qui rend hommage au critique d'art Robert Lebel.
-
Cinquième séance du séminaire « L'altérité dans l'art »
SaadounAngéliqueDapremontThibaudCinquième séance du séminaire « L'altérité dans l'art » avec Angélique Saadoun et Thibaud Dapremont, doctorants au Centre André-Chastel.
-
La représentation de l'Autre. Discussions
LefrançoisFrédéricRavion-D'IngianniSophieBerthetDominiqueBrossardLiseEchanges et discussions faisant suite aux interventions de Lise Brossard, Sophie Ravion-D'Ingianni et Frédéric Lefrançois lors de la conférence "La représentations de l'Autre".
-
Deuxième séance du séminaire « L'altérité dans l'art »
BaNancyFordinLaureDeuxième séance du séminaire « L'altérité dans l'art » avec Nancy Ba et Laure Fordin, doctorantes au Centre André-Chastel.
-
La loi de l'attraction passionnée de Charles Fourier : un nouveau paradigme des sciences sociales
AntoineMaudeEntretien avec Maude Antoine réalisé par Nicolas Rault dans le cadre du programme pluriannuel de formation à l'audiovisuel (PPF-INOVA)
-
Entretien autour de la croisée dédiée à Joël Desrosiers avec Pierre Lafarge (Martinique 1ère)
LefrançoisFrédéricLafargePierreEntretien autour de la croisée dédiée à Joël Desrosiers avec Pierre Lafarge Martinique 1ère radio
-
Présentation de la croisée dédiée à Joël Des Rosiers (RCI)
LefrançoisFrédéricDésertGéraldTelcideMagaliPrésentation de la croisée dédiée à Joël Des Rosiers (RCI)