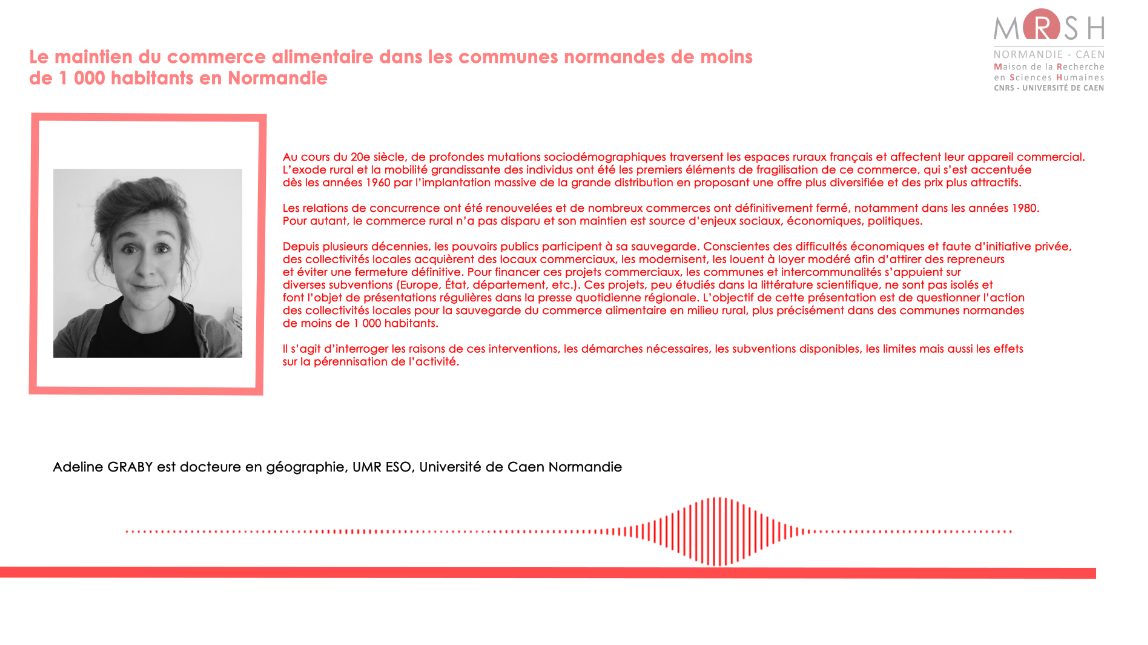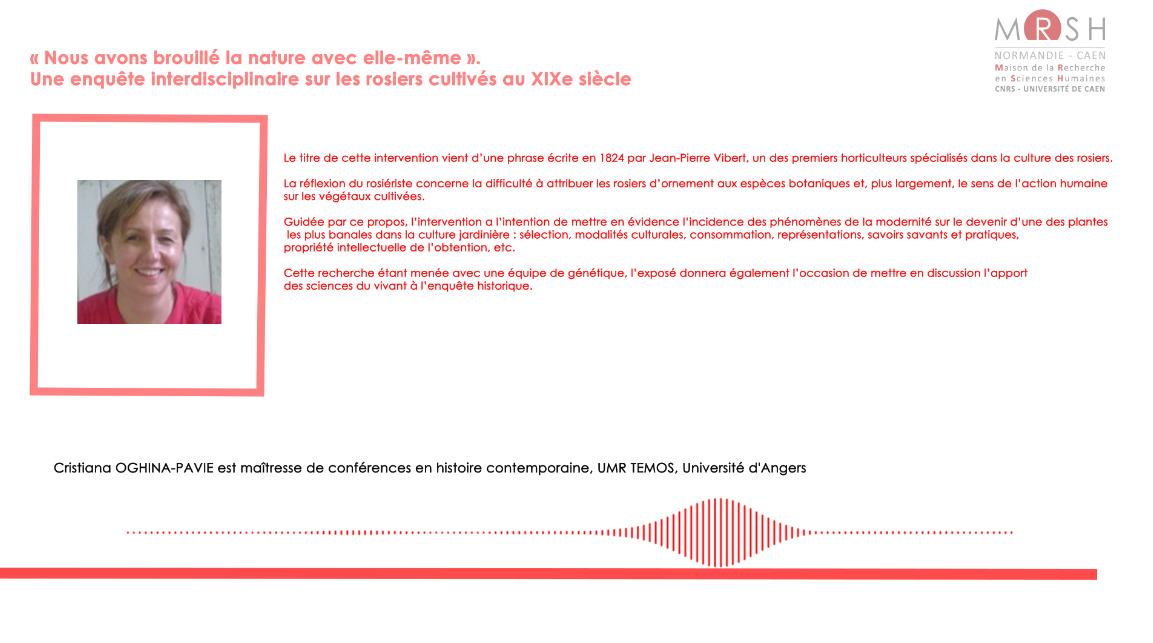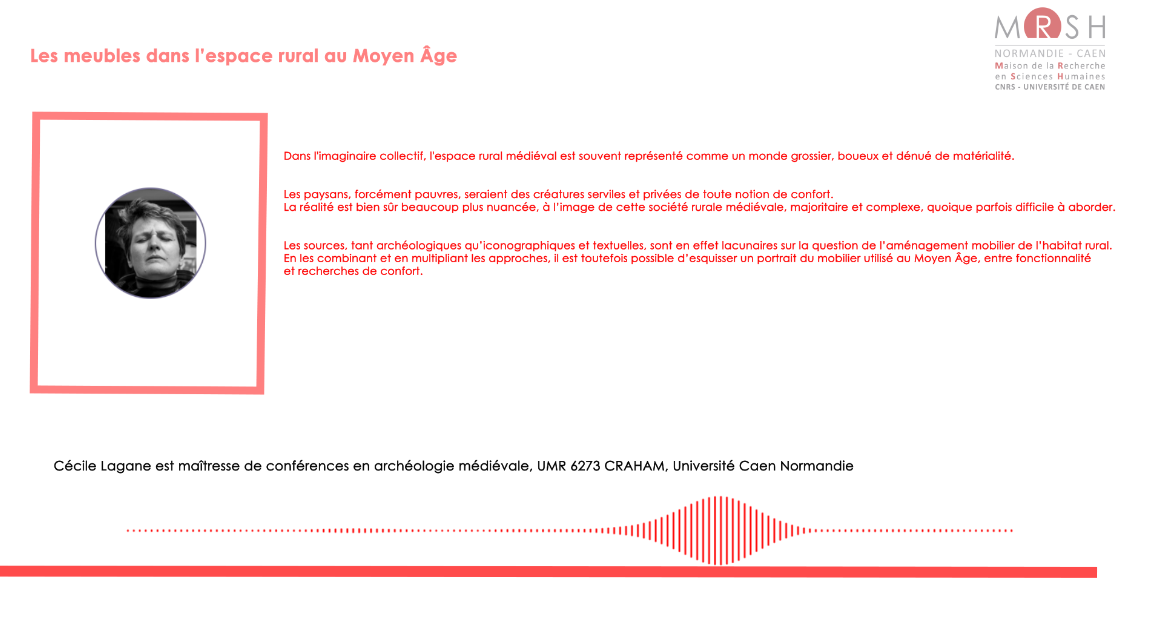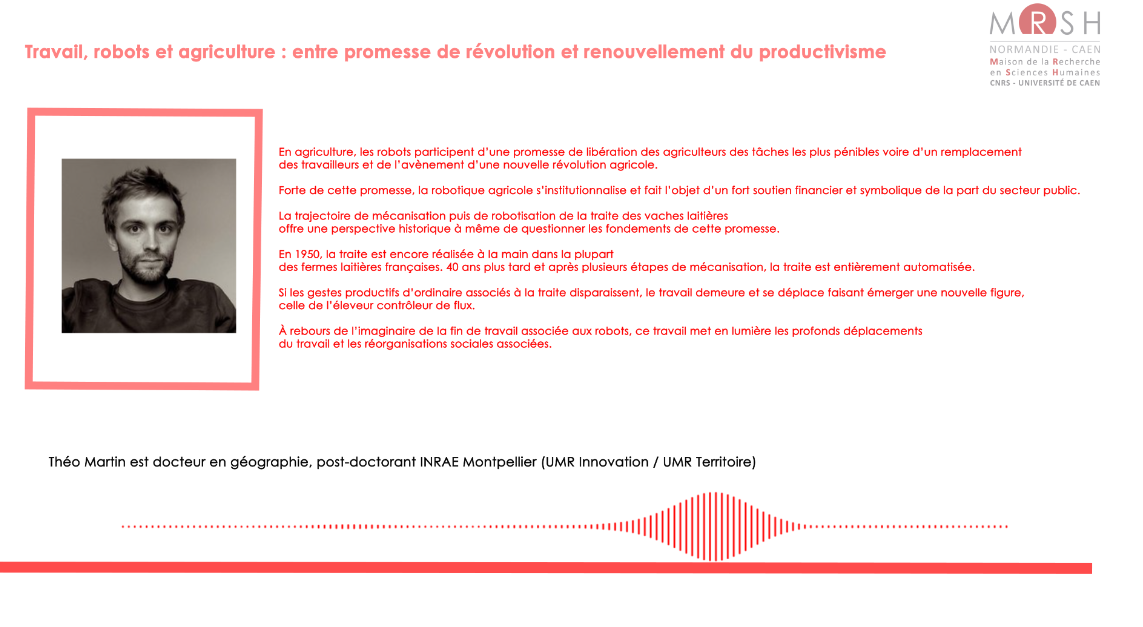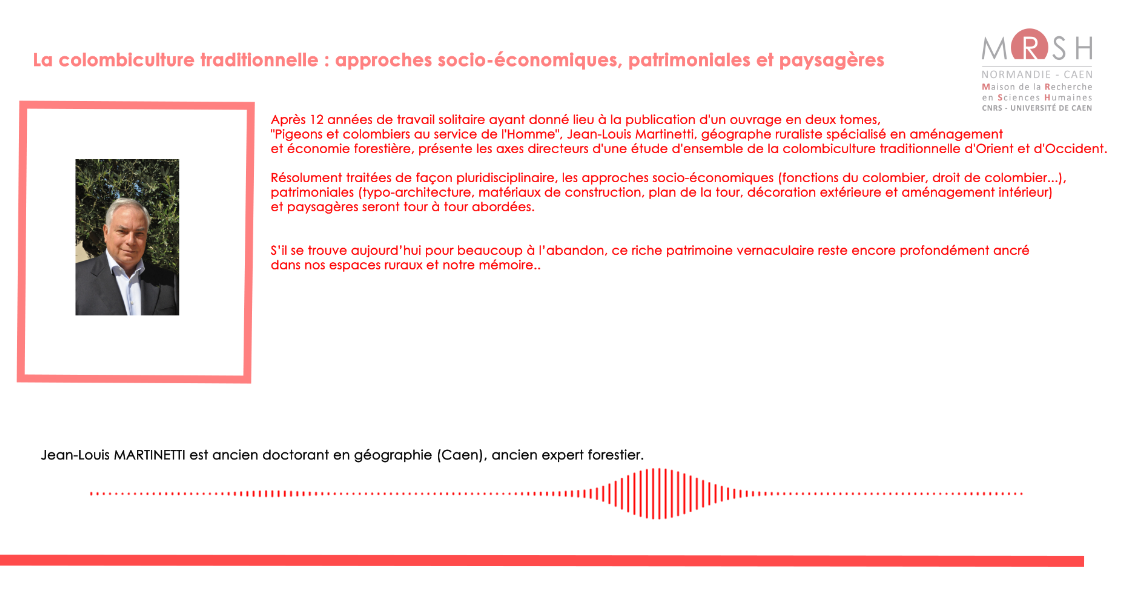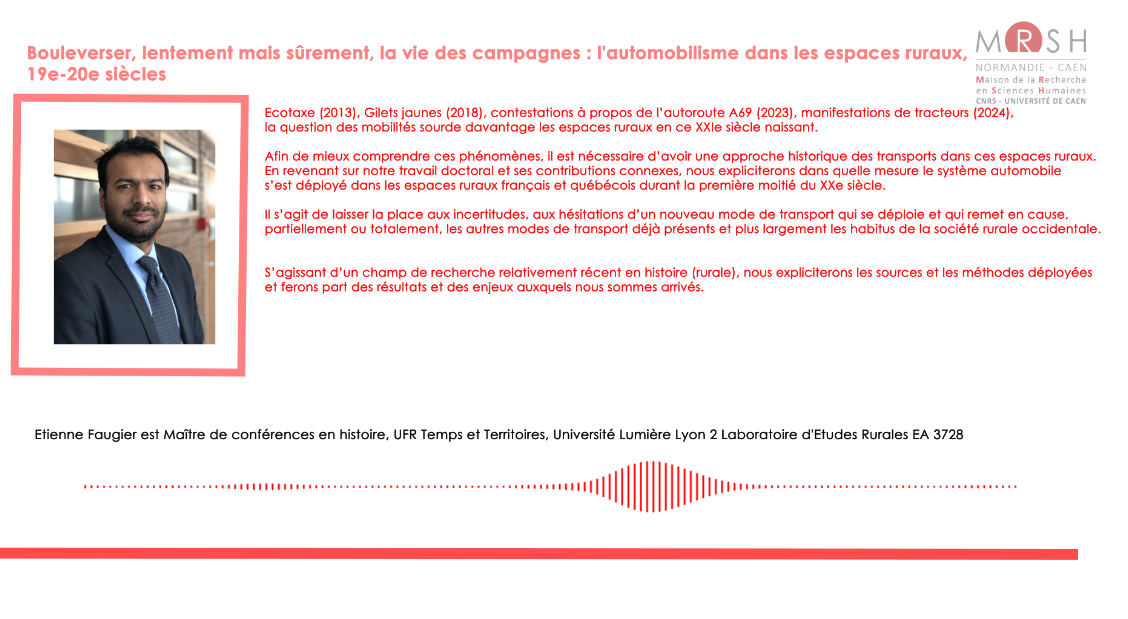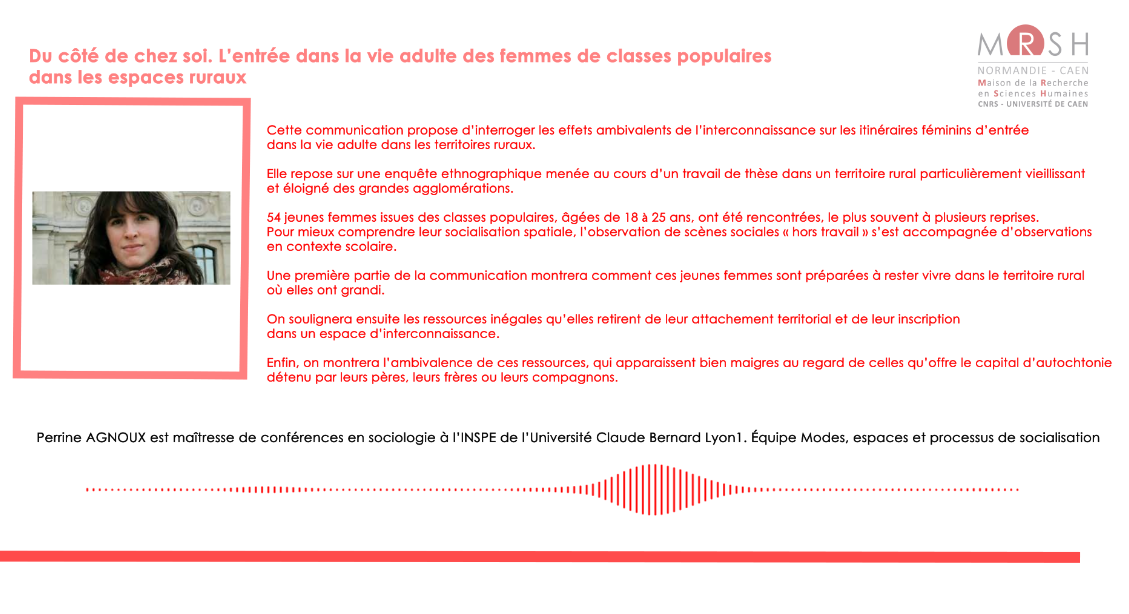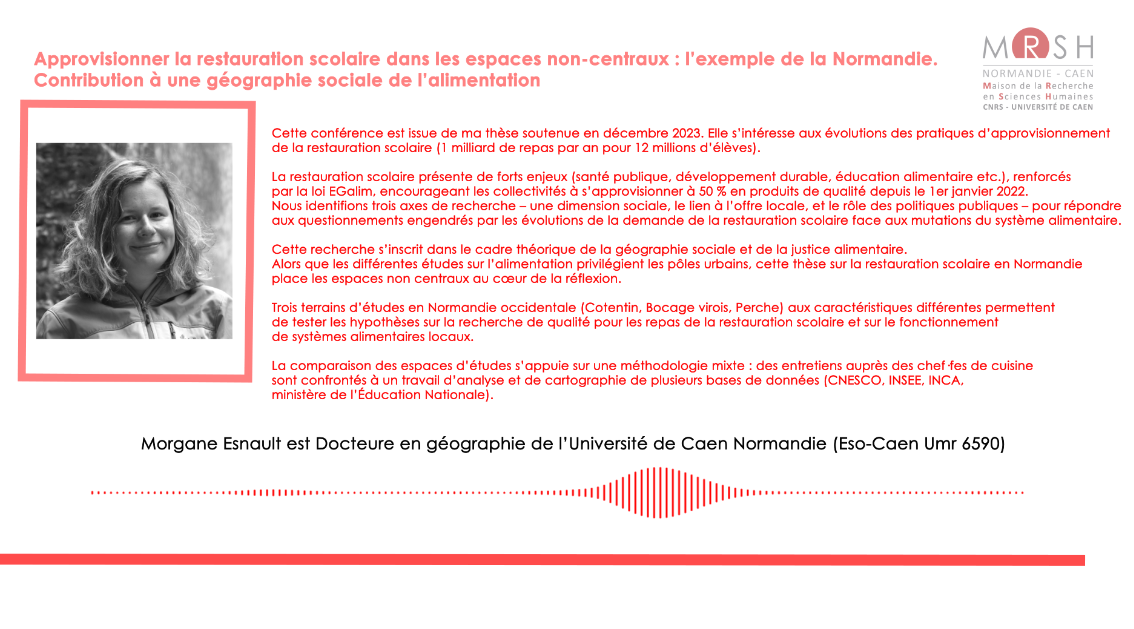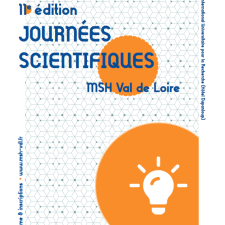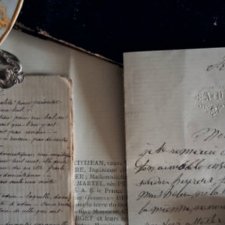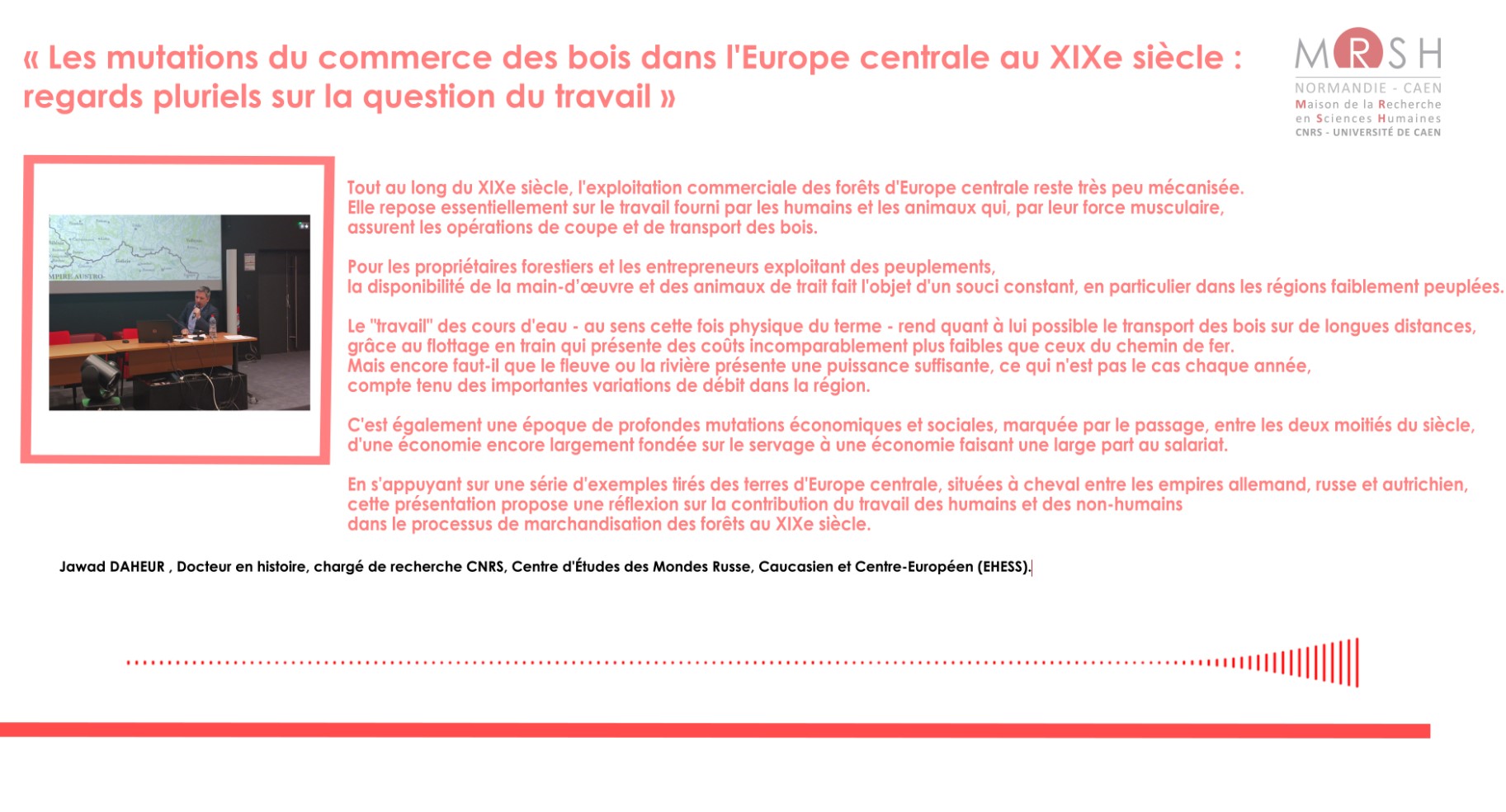Notice
MRSH Caen
Le crime à la campagne vu par les tribunaliers (1880-1940)
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
ette conférence a été enregistrée dans le cadre du séminaire annuel du pôle Sociétés et espaces ruraux de la MRSH, intitulé en 2009-2010 « Au cœur des recherches sur les sociétés et les espaces ruraux ».
Frédéric Chauvaud est Professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le sanglot judiciaire ou encore Justice et déviance à l'époque contemporaine, aux Presses Universitaires de Rennes.
Des années 1880 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les journalistes diligentés pour suivre les débats judiciaires privilégient le crime urbain ou mondain. Le monde rural est perçu comme un univers archaïque et grossier, sorte de conservatoire des mœurs du passé. De la sorte, seules certaines affaires donnent lieu à une chronique ou à un long compte-rendu. Elles deviennent des prétextes pour s'interroger sur la modernité, sur le déterminisme des lieux, sur un monde en train de disparaître, mais aussi sur les « excès de violence ». En effet, quelques affaires particulièrement abominables mettent en scène le corps des victimes, comme en 1910 dans l'affaire de la ferme sanglante, ou comme en 1929, dans le procès de « deux jeunes monstres », domestiques de ferme, loués à l'année, âgés, au moment du carnage, l'un de 16 ans, l'autre de 18 ans. En quelques instants tout le personnel de l'exploitation, pour l'essentiel familiale, est anéanti. Après le massacre, les tueurs s'offrent cinq jours de félicité. Ils font la « bombe avec cinq mille francs dans leurs poches ». Le choix des procès n'est pas anodin. En rendre compte revient à revivifier des clichés et à imposer l'idée qu'il existe une violence résiduelle et des invariants du crime. De la sorte, les principaux tribunaliers, en s'interrogeant sur le mystère du passage à l'acte, contribuent à construire des figures de l'altérité radicale.
Thème
Sur le même thème
-
Le maintien du commerce alimentaire dans les communes normandes de moins de 1 000 habitants en Norm…
Au cours du 20e siècle, de profondes mutations sociodémographiques traversent les espaces ruraux français et affectent leur appareil commercial. L’exode rural et la mobilité grandissante des individus
-
« Nous avons brouillé la nature avec elle-même ». Une enquête interdisciplinaire sur les rosiers c…
Le titre de cette intervention vient d’une phrase écrite en 1824 par Jean-Pierre Vibert, un des premiers horticulteurs spécialisés dans la culture des rosiers.
-
Les meubles dans l’espace rural au Moyen Âge
Dans l'imaginaire collectif, l'espace rural médiéval est souvent représenté comme un monde grossier, boueux et dénué de matérialité.
-
Travail, robots et agriculture : entre promesse de révolution et renouvellement du productivisme
En agriculture, les robots participent d’une promesse de libération des agriculteurs des tâches les plus pénibles voire d’un remplacement des travailleurs et de l’avènement d’une nouvelle révolution
-
La colombiculture traditionnelle : approches socio-économiques, patrimoniales et paysagères
Après 12 années de travail solitaire ayant donné lieu à la publication d'un ouvrage en deux tomes, "Pigeons et colombiers au service de l'Homme", Jean-Louis Martinetti, géographe ruraliste spécialisé
-
Bouleverser, lentement mais sûrement, la vie des campagnes : l’automobilisme dans les espaces rura…
FaugierEtienneEcotaxe (2013), Gilets jaunes (2018), contestations à propos de l’autoroute A69 (2023), manifestations de tracteurs (2024), la question des mobilités sourde davantage les espaces ruraux en ce XXIe
-
Du côté de chez soi. L’entrée dans la vie adulte des femmes de classes populaires dans les espaces …
AgnouxPerrineCette communication propose d’interroger les effets ambivalents de l’interconnaissance sur les itinéraires féminins d’entrée dans la vie adulte dans les territoires ruraux.
-
Approvisionner la restauration scolaire dans les espaces non-centraux : l’exemple de la Normandie. …
EsnaultMorganeCette conférence est issue de ma thèse soutenue en décembre 2023. Elle s’intéresse aux évolutions des pratiques d’approvisionnement de la restauration scolaire (1 milliard de repas par an pour 12
-
Ruramod. Ruralité et modernité de l’entre-deux-guerres à nos jours
BonordAudeLe programme de recherche Ruramod questionne les représentations des rapports du monde rural à la modernité (technique, socio-économique et culturelle), de l’entre-deux-guerres à nos jours.
-
Des bourgeois des champs - Dans l'intimité de la recherche
BorgeaudOlivierAbrialValérieSoirée "Des bourgeois des champs", dans le cadre d'une conversation « Dans l’intimité de la recherche», qui a eu lieu le 14 décembre 2023 au Forum de la FMSH.
-
JRSS 2022 - Dynamique des espaces ruraux, regard sur 40 ans de recherche en économie et en sociolog…
SchmittBertrandBertrand Schmitt porte son regard sur 40 ans de recherche en économie et en sociologie... « rurale » autour de la dynamique des espaces ruraux.
-
« Les mutations du commerce des bois dans l'Europe centrale au XIXe siècle : regards pluriels sur l…
DaheurJawadTout au long du XIXe siècle, l'exploitation commerciale des forêts d'Europe centrale reste très peu mécanisée. Elle repose essentiellement sur le travail fourni par les humains et les animaux qui, par