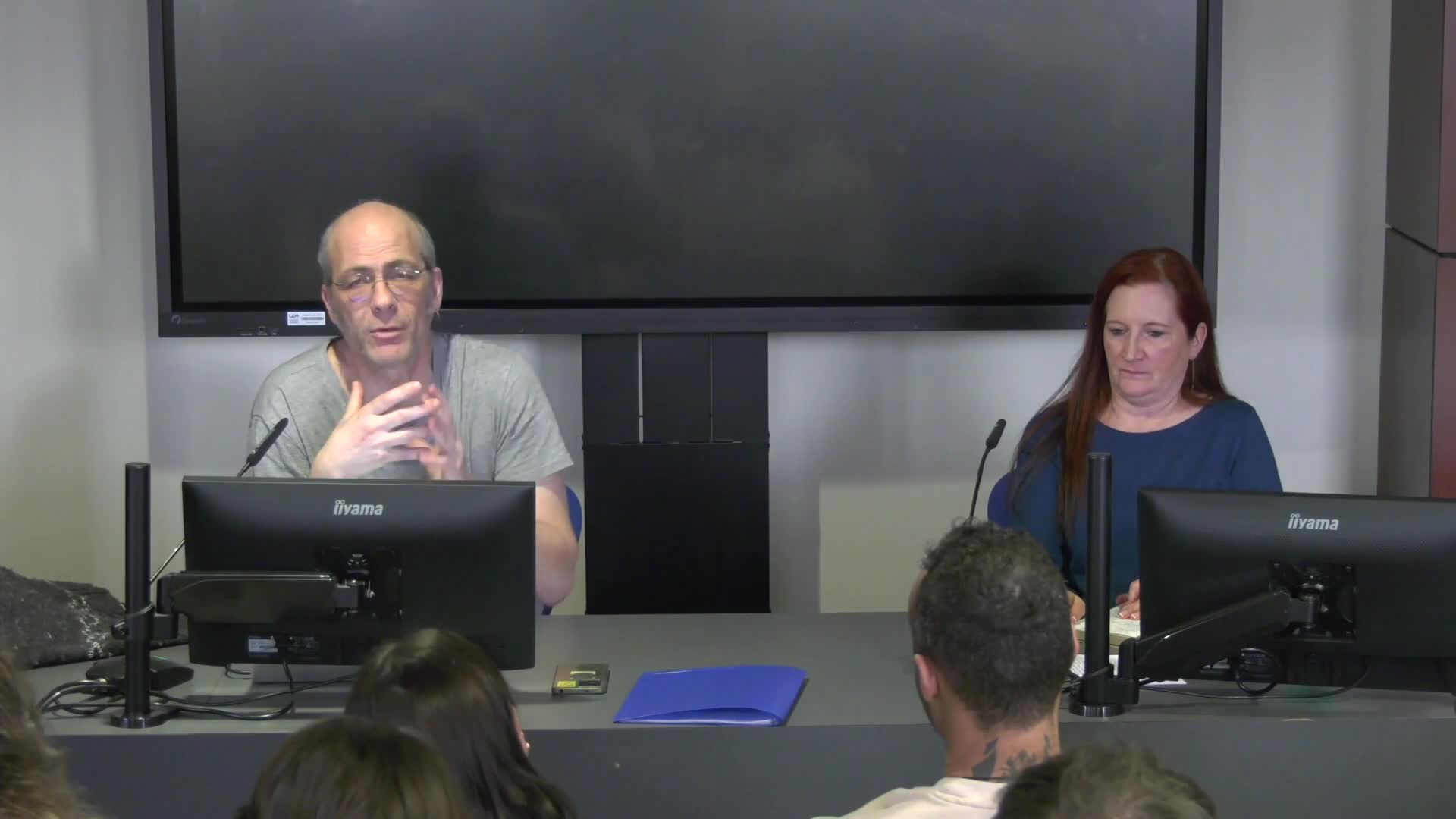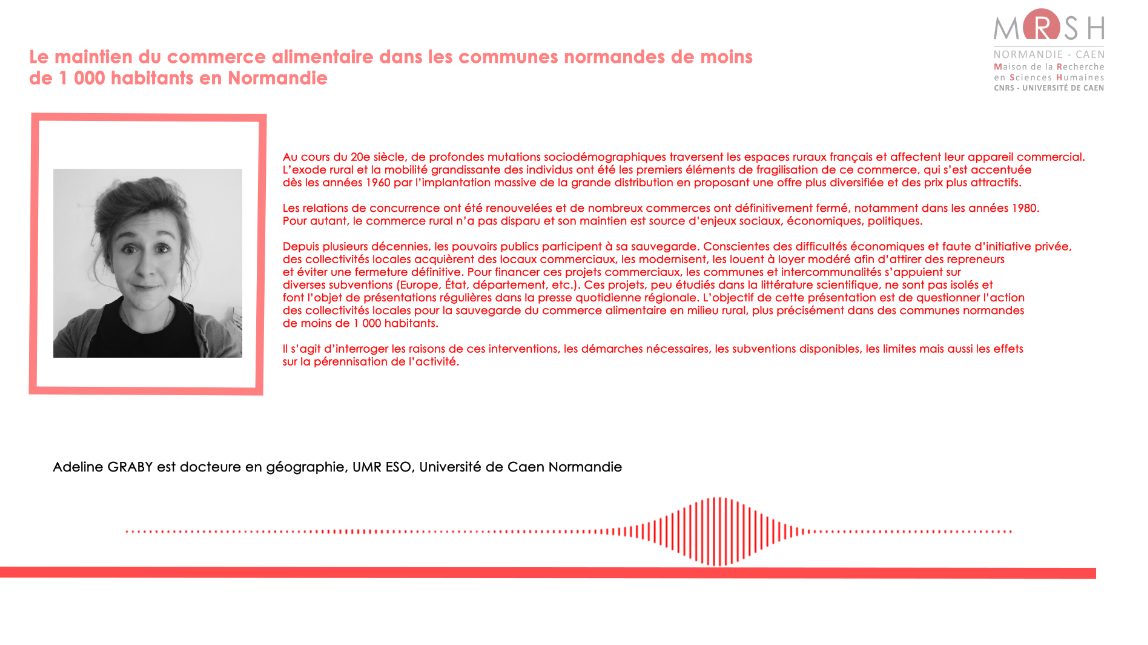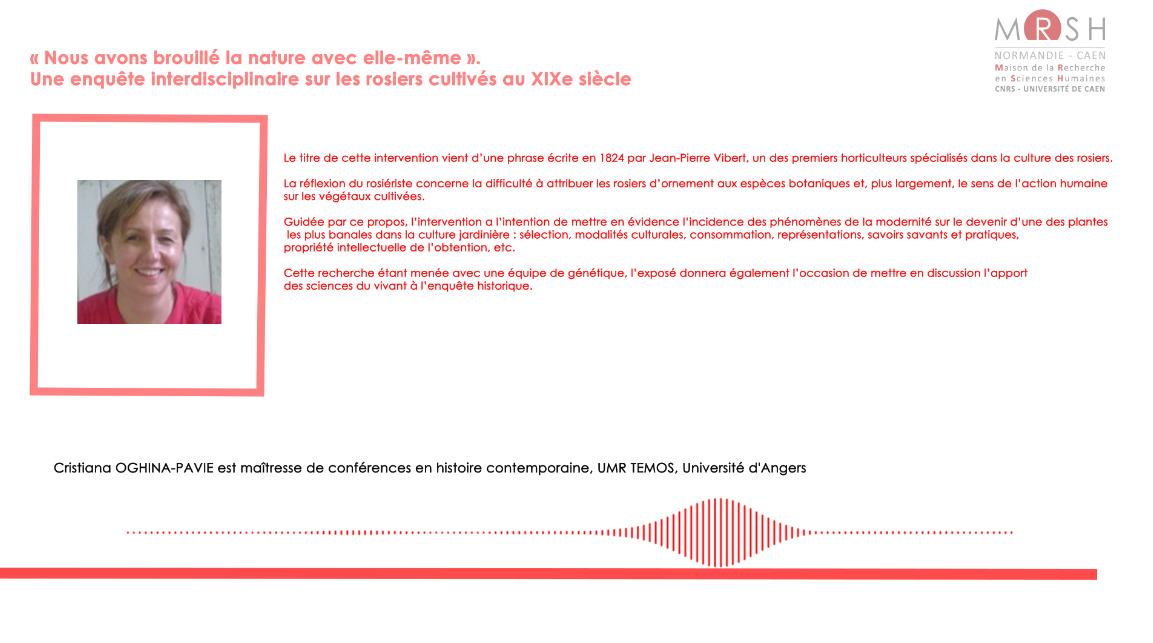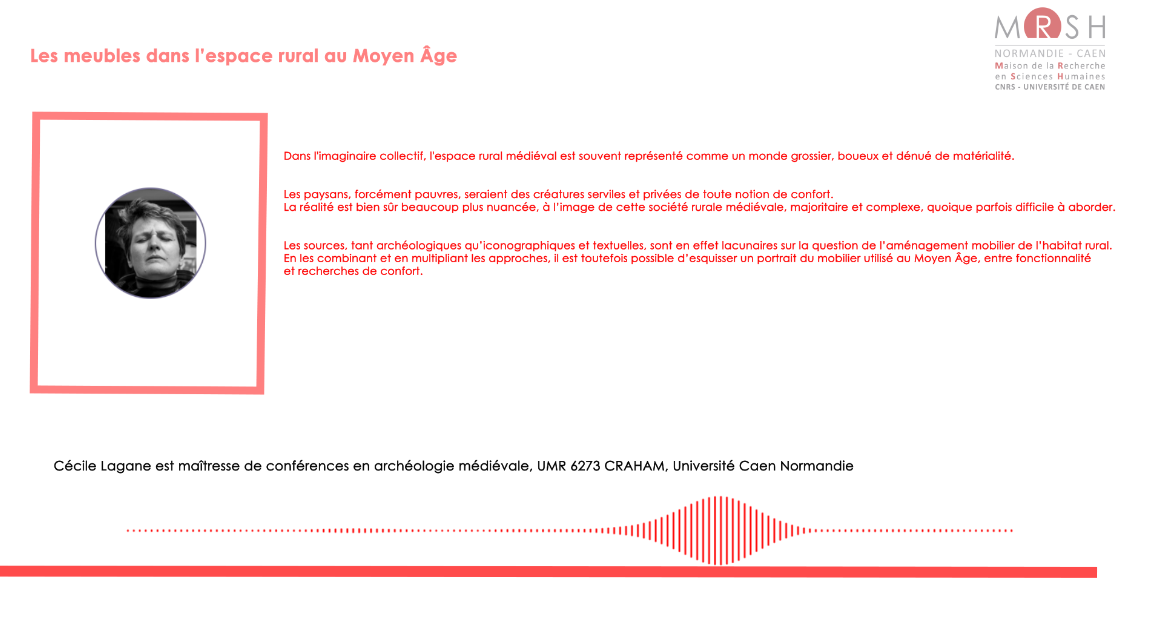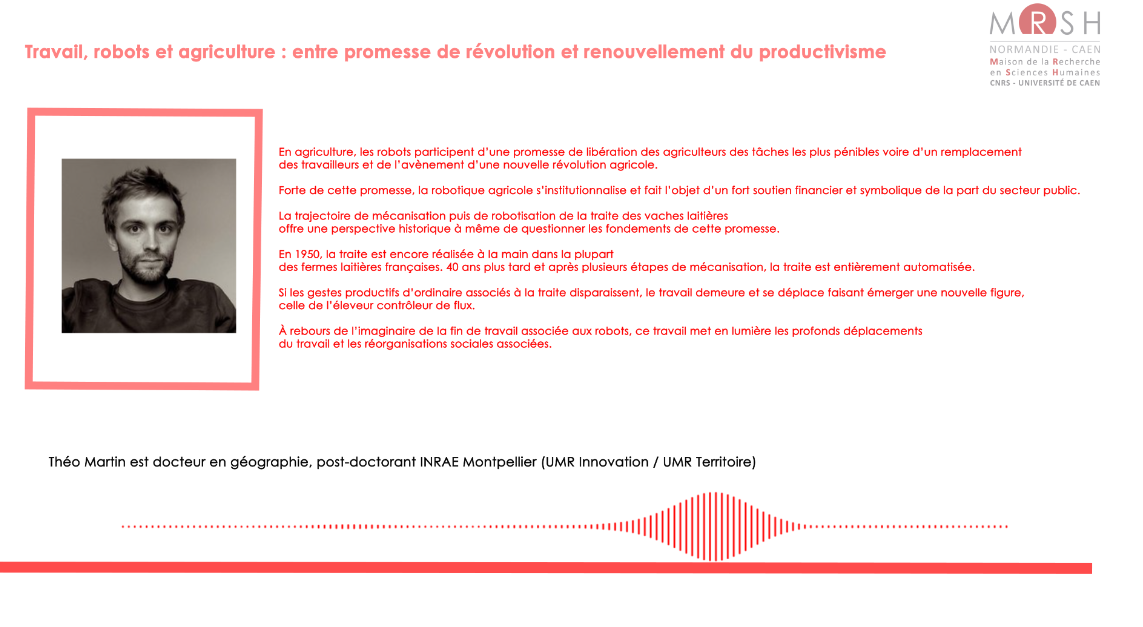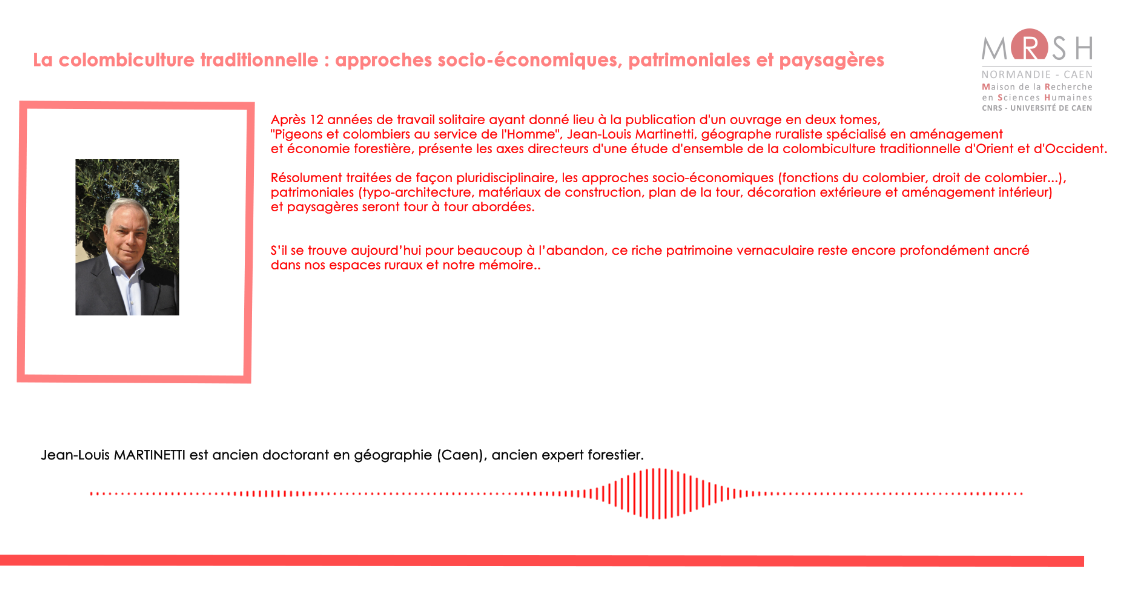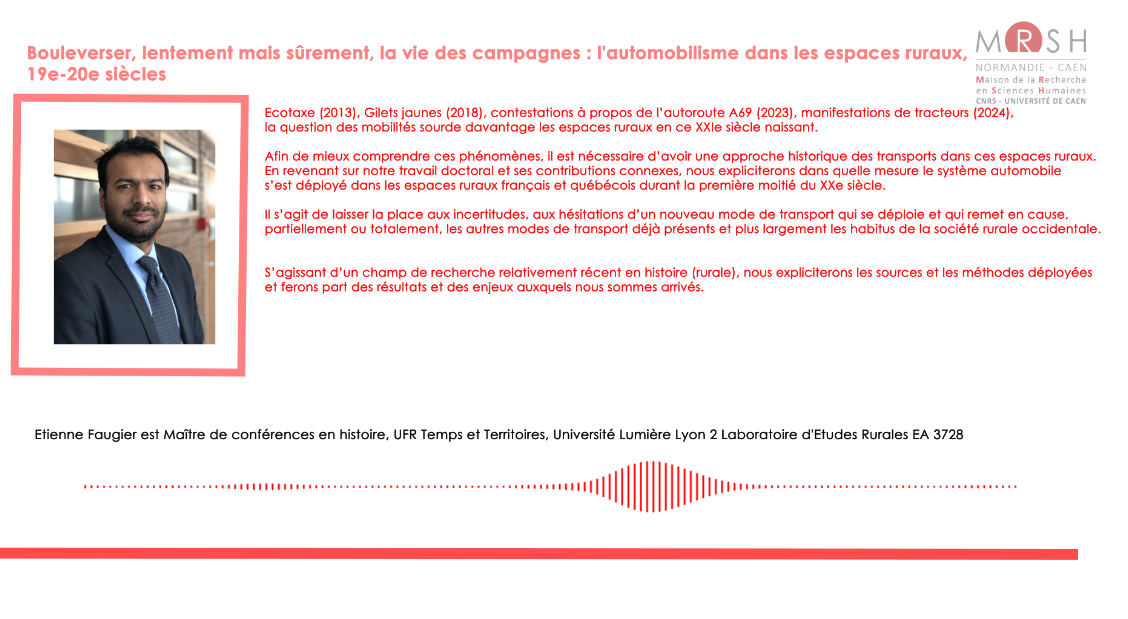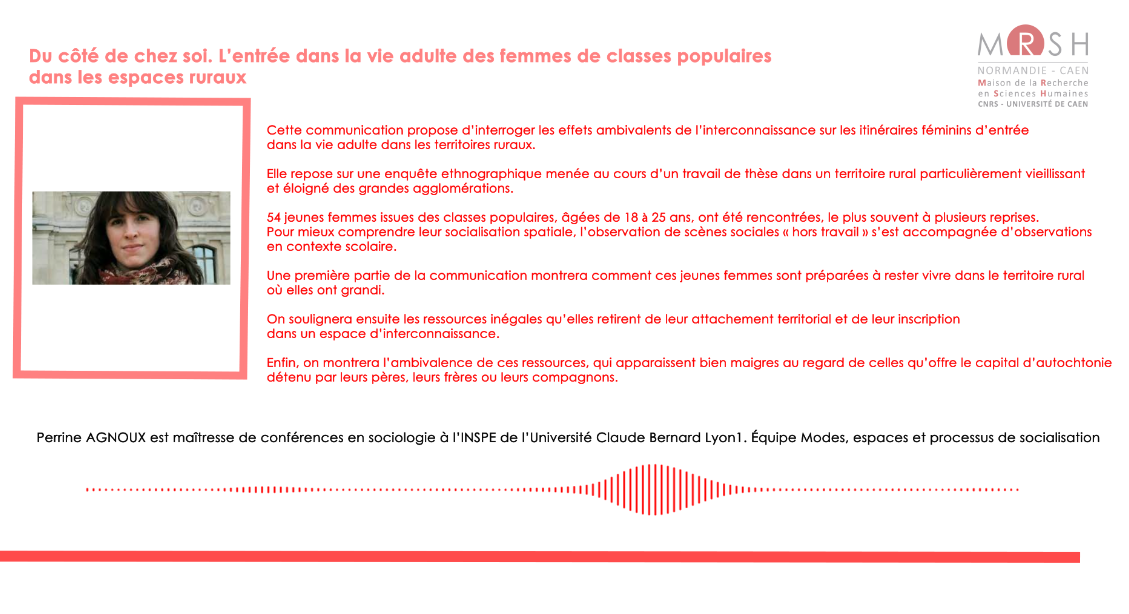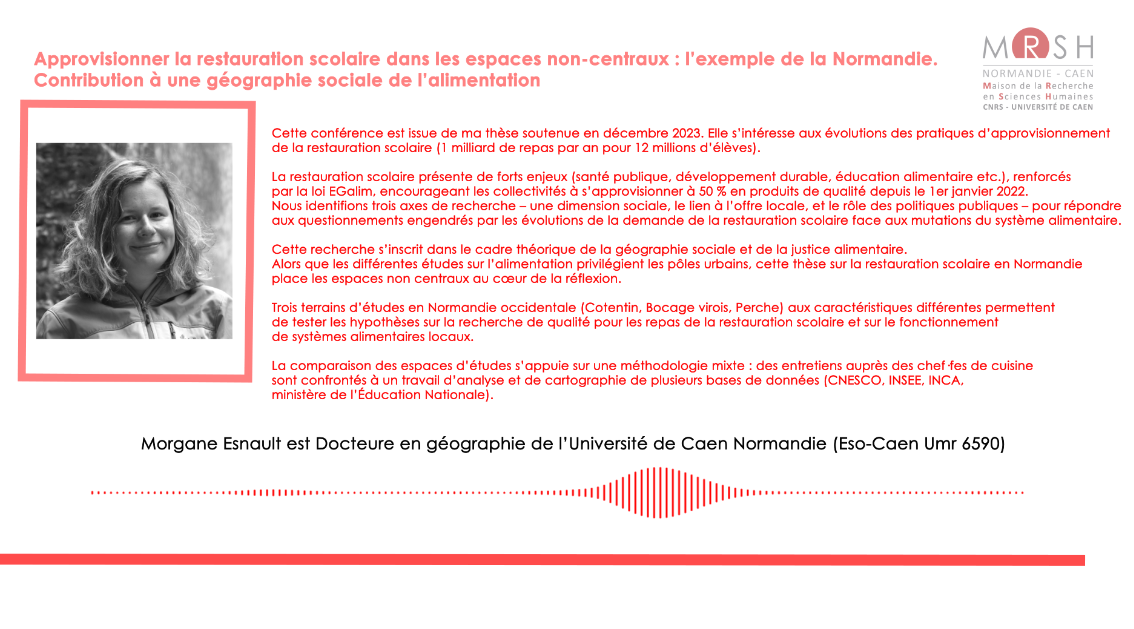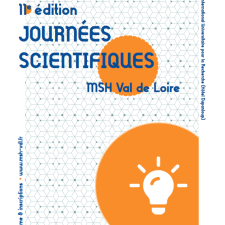Notice
MRSH Caen
Le faire-valoir indirect au Canada au XVIIIe siècle
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a été enregistrée dans le cadre du séminaire annuel du pôle Sociétés et espaces ruraux de la MRSH, intitulé en 2011-2012 « Conflits et violences dans les campagnes ».
Sylvie Dépatie s'intéresse à l'histoire économique et sociale du Canada pré-industriel et, plus particulièrement, à l'histoire des campagnes de cette période. Depuis le début de sa carrière professorale, elle se préoccupe de la formation au premier cycle. Elle a exercé la direction des programmes multidisciplinaires de la Faculté des Sciences humaines entre 2003 et 2007 et, entre 2006 et 2009, elle a été co-éditrice de la Canadian Historical Review.
Le faire-valoir indirect au Canada sous le régime français a été peu étudié. Compte tenu du supposé libre-accès à la terre et de la prépondérance de la propriété paysanne, l'histoire rurale a privilégié l'étude des propriétaires exploitants. Dans ce contexte, les preneurs des exploitations agricoles apparaissent comme des propriétaires en puissance, choisissant de devenir locataires tandis qu'ils amorcent le défrichement de leur propriété ou qu'ils accumulent un capital pour acheter une terre déjà productive. Pourtant, certains indices laissent croire que les laboureurs ou fermiers ne sont pas toujours des jeunes gens, en voie d'accéder à la propriété. Au XVIIIe siècle, il y a, en effet, une grande diversité dans la nature des biens ruraux faisant l'objet de location et chaque type de biens attire des locataires différents. À côté des terres de dimensions modestes susceptibles d'être louées par des individus dénués de capital, la prise à ferme de grosses exploitations exige des moyens financiers importants. Sans être dominant, ce phénomène apparaît courant dans les zones de colonisation ancienne. Progressivement, des laboureurs ont choisi de cultiver la terre d'autrui et, par cette stratégie, ils ont atteint une certaine aisance économique. Il y aurait alors différenciation à l'intérieur du groupe des locataires de biens ruraux, les laboureurs aisés côtoyant des individus dont le niveau de fortune s'apparente à celui des journaliers. Pour vérifier cette hypothèse, nous examinons d'abord la nature des exploitations louées et les modalités de location de plus de 500 baux touchant l'île de Montréal. Nous suivrons ensuite le cursus de certaines de familles de laboureurs sur trois générations.
Thème
Sur le même thème
-
S'installer à la campagne
LatouilleOphélieOphélie Latouille présente son travail de recherche doctorale consacré aux mobilités résidentielles vers les zones rurales et aux transitions professionnelles vers le non-salariat, dans des contextes
-
Se souvenir et continuer à se transformer. La mémoire longue d'une contre-élite ouvrière
RenahyNicolasVieillir et résister dans le monde ouvrier... Le sociologue Nicolas Renahy revient sur le parcours et le présent d'anciens militants de Peugeot à Sochaux-Montbéliard.
-
Le sorgho de saison sèche au Cameroun
TourneuxHenryLe bassin du lac Tchad et la région camerounaise de l’Extrême-Nord où s’inscrit le Diamaré disposent de terres particulières que l’on peut cultiver en saison sèche sans avoir besoin d’irriguer. Ces
-
Le maintien du commerce alimentaire dans les communes normandes de moins de 1 000 habitants en Norm…
Au cours du 20e siècle, de profondes mutations sociodémographiques traversent les espaces ruraux français et affectent leur appareil commercial. L’exode rural et la mobilité grandissante des individus
-
« Nous avons brouillé la nature avec elle-même ». Une enquête interdisciplinaire sur les rosiers c…
Le titre de cette intervention vient d’une phrase écrite en 1824 par Jean-Pierre Vibert, un des premiers horticulteurs spécialisés dans la culture des rosiers.
-
Les meubles dans l’espace rural au Moyen Âge
Dans l'imaginaire collectif, l'espace rural médiéval est souvent représenté comme un monde grossier, boueux et dénué de matérialité.
-
Travail, robots et agriculture : entre promesse de révolution et renouvellement du productivisme
En agriculture, les robots participent d’une promesse de libération des agriculteurs des tâches les plus pénibles voire d’un remplacement des travailleurs et de l’avènement d’une nouvelle révolution
-
La colombiculture traditionnelle : approches socio-économiques, patrimoniales et paysagères
Après 12 années de travail solitaire ayant donné lieu à la publication d'un ouvrage en deux tomes, "Pigeons et colombiers au service de l'Homme", Jean-Louis Martinetti, géographe ruraliste spécialisé
-
Bouleverser, lentement mais sûrement, la vie des campagnes : l’automobilisme dans les espaces rura…
FaugierEtienneEcotaxe (2013), Gilets jaunes (2018), contestations à propos de l’autoroute A69 (2023), manifestations de tracteurs (2024), la question des mobilités sourde davantage les espaces ruraux en ce XXIe
-
Du côté de chez soi. L’entrée dans la vie adulte des femmes de classes populaires dans les espaces …
AgnouxPerrineCette communication propose d’interroger les effets ambivalents de l’interconnaissance sur les itinéraires féminins d’entrée dans la vie adulte dans les territoires ruraux.
-
Approvisionner la restauration scolaire dans les espaces non-centraux : l’exemple de la Normandie. …
EsnaultMorganeCette conférence est issue de ma thèse soutenue en décembre 2023. Elle s’intéresse aux évolutions des pratiques d’approvisionnement de la restauration scolaire (1 milliard de repas par an pour 12
-
Ruramod. Ruralité et modernité de l’entre-deux-guerres à nos jours
BonordAudeLe programme de recherche Ruramod questionne les représentations des rapports du monde rural à la modernité (technique, socio-économique et culturelle), de l’entre-deux-guerres à nos jours.