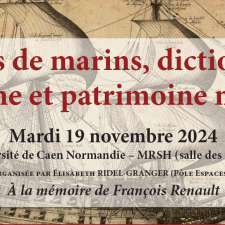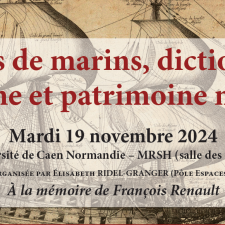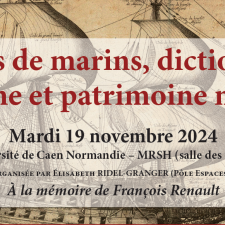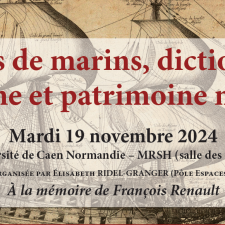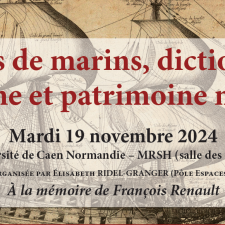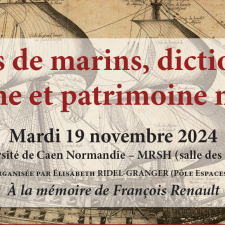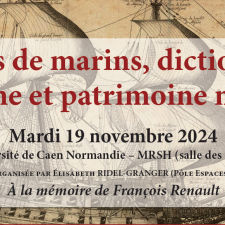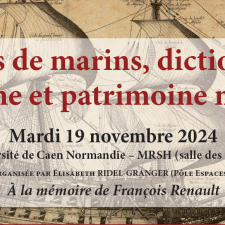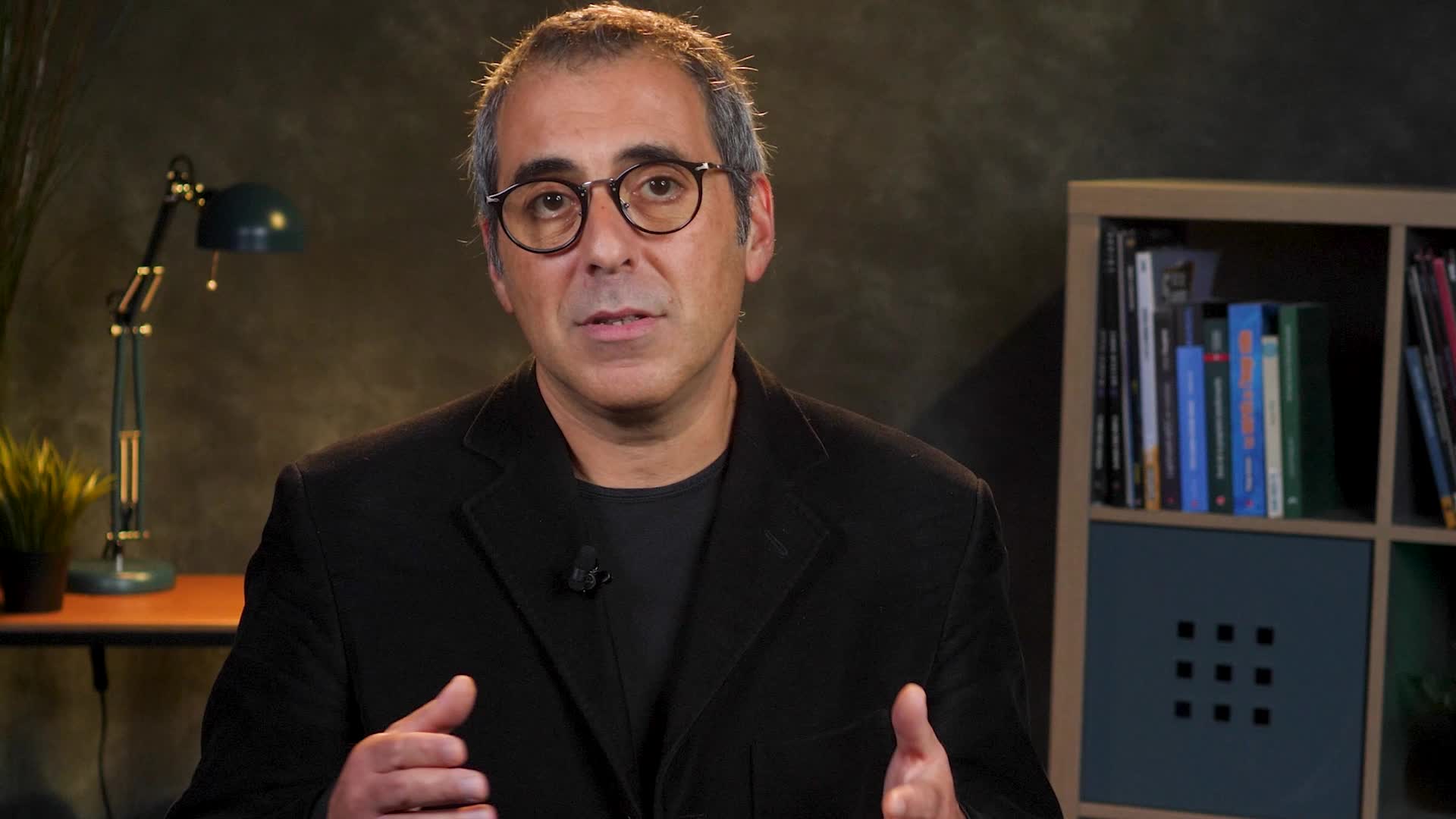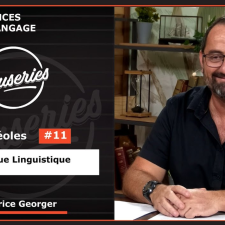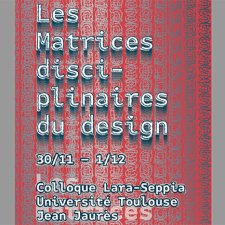Notice
Saint-Vaast-la-Hougue
Le vocabulaire maritime des premiers Grecs : les noms de la mer et le lexique mycénien qui en dérive
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette communication a été donnée à Saint-Vaast-la-Hougue, dans le cadre d'une journée d'études organisée par le pôle Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires de la MRSH, journée consacrée au vocabulaire maritime et aux dictionnaires.
Après avoir été professeur de français, latin et grec dans l'enseignement secondaire français de 1974 à 1988, Nicole Guilleux enseigne depuis 1989 la langue et la linguistique grecques à l'université de Caen (Basse-Normandie). Elle s'est spécialisée en linguistique historique et comparative, soutenant en 1983, une thèse de doctorat portant sur des Problèmes de flexion nominale en grec mycénien. Elle s'est aussi intéressée à la langue de l'épopée homérique et de la tragédie, ainsi qu'à la lexicologie, principalement grecque, mais aussi latine et française.
Résumé de la communication
Le vocabulaire maritime des premiers Grecs se caractérise par un paradoxe. Alors que les Indo-Européens possèdent un nom de la mer (latin mare, d'où notamment français mer ; breton mor, irlandais muir... ; allemand Meer ; russe, bulgare, slovène... morje, polonais morze...), les Grecs ignorent ce mot et, à la place, en utilisent quatre autres. Cette bizarrerie lexicale peut s'expliquer si l'on adopte le point de vue des nouveaux arrivants, en considérant les différentes expériences qu'ils ont pu avoir de la mer, dont ils ignoraient tout. Cet élément nouveau s'est révélé à eux sous des espèces variées : « eau salée » (hē háls), « vaste plaine » liquide du large (tò pélagos) ou « espace dangereux à traverser » (ho póntos), sans compter le nom générique, hē thálassa, probablement emprunté aux habitants du cru.
Dans le second versant de la conférence, l'accent est mis sur la documentation grecque la plus ancienne, celles des archives des palais mycéniens (Cnossos, Pylos, Mycènes...). Malgré l'aspect fragmentaire des textes rédigés en linéraire B et la difficulté à les interpréter, on y trouve, clairement attestés, plusieurs mots reposant sur háls et sur póntos. Ces témoignages écrits, même s'ils sont peu nombreux, confirment ce que le reste des données archéologiques donne à voir : les Grecs de l'époque mycénienne, qui vécurent entre continent et Crète dans la seconde moitié du deuxième millénaire avant notre ère, s'étant mis à l'école de leurs prédécesseurs Minoens, savaient tirer profit de la mer dans les zones côtières, aussi bien que naviguer en Méditerranée.
Sur le même thème
-
Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…
CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...
-
Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.
Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.
-
Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du …
Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du Dictionnaire de marine de Nicolas Desroches (1687) annoté au XVIIIe siècle par un élève officier.
-
L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.
L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.
-
Les marins, leurs langues et leurs dictionnaires : un tour d’horizons.
Les marins, leurs langues et leurs dictionnaires : un tour d’horizons.
-
DicoMarine. Bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine 17e-19e siècles.
DicoMarine. Bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine 17e-19e siècles.
-
Du matériel à l’immatériel, « la chose et le mot » : archéologie et dictionnaires de marine.
Du matériel à l’immatériel, « la chose et le mot » : archéologie et dictionnaires de marine.
-
Le lexique maritime dans les parlers normands.
Le lexique maritime dans les parlers normands.
-
L’argot de l’École navale : technolecte et sociolecte.
L’argot de l’École navale : technolecte et sociolecte.
-
1 – Evolution des paradigmes culturels. 1
NobileLuca"Evolution des paradigmes culturels (1)" par Luca Nobile, Université de Bourgogne
-
Langue et culture créoles : Politique linguistique
ChadyShimeen-KhanGeorgerFabriceSciences du langage - Langue et culture créoles #11 - Politique linguistique
-
Proposition de réflexion sur le lexique comme matrice des pratiques du design
LingLucieLe terme de design est aujourd’hui revendiqué dans de nombreuses pratiques (design thinking, design management, design strategy, design innovation), au point que l’on peut se demander ce qui constitue