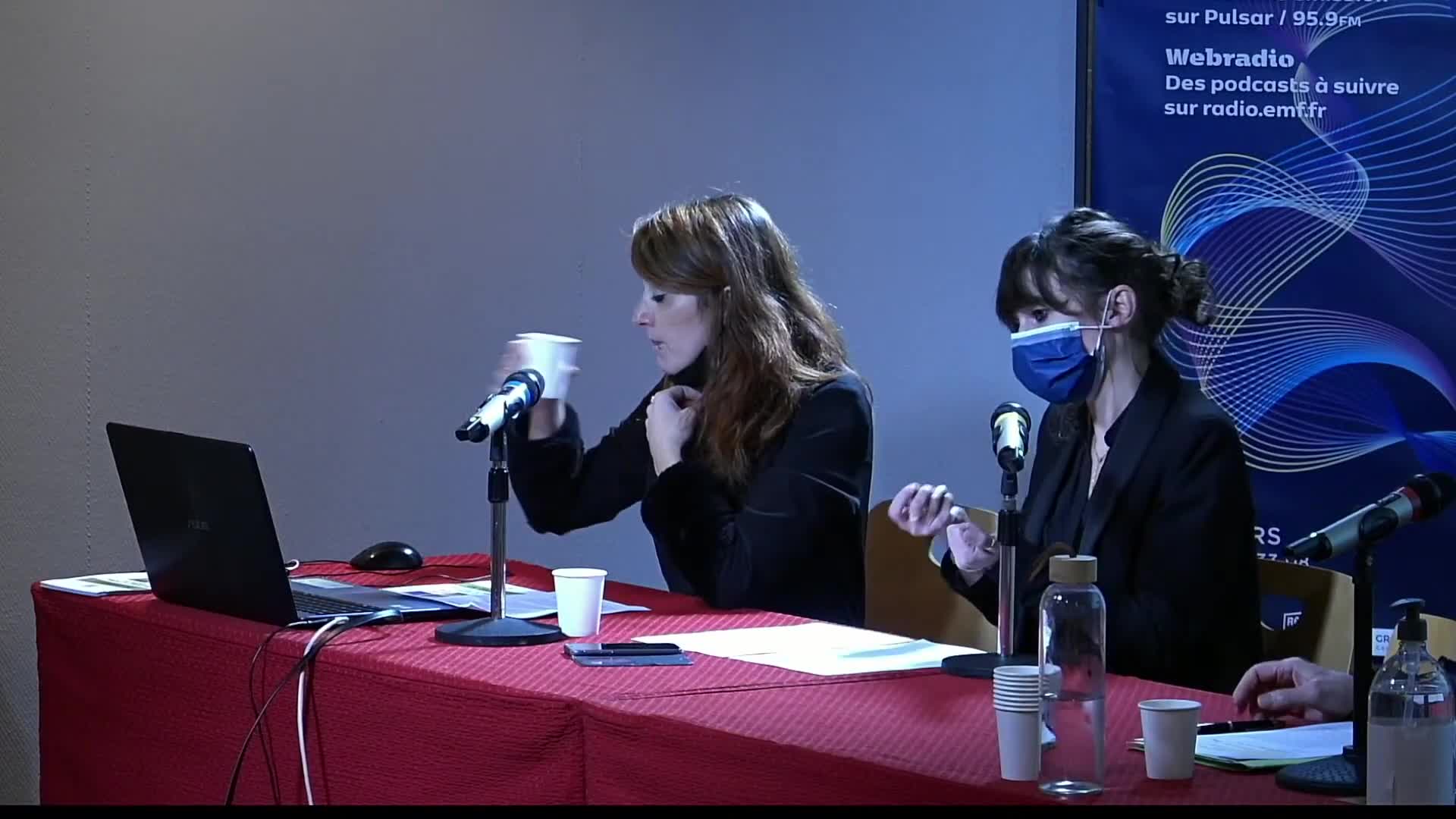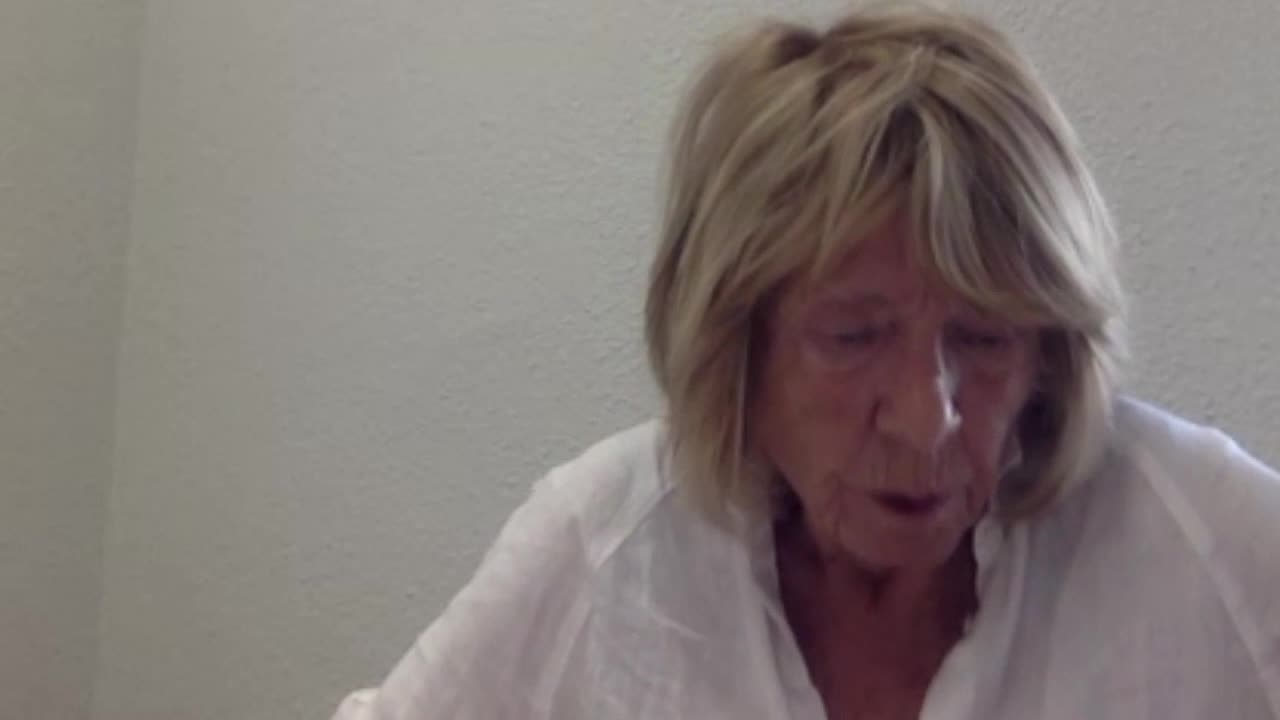Notice
Normes de parenté et structuralisme
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette conférence a pour titre : « Normes de parenté et structuralisme ». Elle a été filmée le 7 décembre 2010 dans le cadre du séminaire annuel « Risques et vulnérabilités sociales », au programme du Master recherche de Sociologie de l'Université de Caen. Initié dans les années 1990, ce séminaire est actuellement dirigé par Salvador Juan, professeur de sociologie à l'Université de Caen.
Emmanuel Désveaux est un anthropologue français, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Profondément influencé par la pensée de Claude Lévi-Strauss, il a travaillé comme ethnologue dans le Grand Nord canadien, étudiant notamment les Ojibwa et les Algonquins. Il a été directeur scientifique du musée du quai Branly de 2001 à 2006. Après avoir travaillé deux ans à Berlin (Humboldt Universität et Freie Universität), il fonde avec Michel de Fornel en 2010 le LIAS, centre de linguistique anthropologique et sociolinguistique, au sein de l'Institut Marcel Mauss (EHESS/CNRS). Il fait partie de l'équipe de rédaction du Journal de la société des américanistes.
La parenté, bien qu'étant au cœur de toute organisation sociale, reste le domaine « réservé » de l'anthropologie ; celle-ci l'a défini et étudié plus que toute autre discipline. Emmanuel Désveaux retrace l'histoire de ce champ de la parenté. Morgan, au XIXème siècle, constate que le croisement de sexe (le phénomène des cousins-croisés) est signifié dans de nombreuses sociétés et qu'il renvoie probablement à des règles de mariage spécifiques. De là construit-il un objet scientifique nouveau : la nomenclature de parenté, soit l'ensemble des termes désignant la totalité des personnes susceptibles d'être apparentés à l'individu. Morgan éclaira ainsi deux aspects de la parenté qui structureront la recherche en la matière : la parenté comme nomenclature (aspect linguistico-cognitif) et/ou comme système matrimonial (aspect sociologique). Kroeber illustra le premier courant, soulignant les huit critères distinctifs s'exprimant potentiellement dans toute nomenclature, donc dans les relations de parenté. Rivers, fonctionnaliste, s'attacha à montrer que le phénomène des cousins-croisés s'explique par une forme de mariage ; ici, c'est l'impératif sociologique qui fonde la nomenclature et non l'inverse. Lévi-Strauss, dans le sillage riversien, présume dans toute société une règle définissant le choix du conjoint. Le mariage représente à ses yeux le lien social fondamental en tant que règle d'échange (plus ou moins intériorisée) fondant la solidarité et le respect mutuel. Le conférencier s'inscrit quant à lui dans la lignée linguistico-cognitive. Il suppose que la désignation parentale par nomenclature et l'attribution de noms propres sont universelles. Il différencie le rapport métonymique par lequel l'enfant s'approprie sa famille du rapport métaphorique par lequel les parents s'approprient l'enfant. Il suggère pour terminer que les types de règles matrimoniales dépendent de la connaissance ou non de la séquence procréative et des représentations inhérentes à chaque société.
Thème
Sur le même thème
-
Ecole, famille, quartier
Dans le centre-ville de Marseille, entre stéréotypes, différences culturelles et inégalités, quel accompagnement à la scolarité ?
-
Des archives du féminicide, à son destin en situation de confinement
ChauvaudFrédéricPelladeauÉliseApproches psychologiques, sociologiques, historiques du lien conjugal violent.
-
Catherine Quiminal : La République et ses étrangers. Cinquante années de rencontre avec l’immigrati…
QuiminalCatherineIntervention de Catherine Quiminal lors du séminaire Migrations et altérités (Urmis Nice) : "La République et ses étrangers. Cinquante années de rencontre avec l’immigration malienne en France"
-
Entre écoles et familles : la confrontation des modèles d'enfance
A l'échelle de la planète, quelques modèles forts se dessinent à l'aide desquels on peut analyser les situations rencontrées par les enfants ainsi que les représentations que les sociétés se sont
-
Entre Venise et l’Empire. La noblesse du Frioul et les opportunités de la frontière à l’époque mode…
Alors que l'étude des actes des « Stati provinciali goriziani » (assemblée des Etats du comté de Gorizia) fait apparaître une série d'interdictions et de restrictions liées au problème posé par la
-
Créer un lignage de toutes pièces : les stratégies sociales d’une famille andalouse au XVIIe siècle
Dans l’Espagne moderne, l’anoblissement par privilège du roi (Ejecutoria de Hidalguía) constituait le mode d’accès à la noblesse le moins estimé. Pour ceux qui ambitionnaient de créer une Maison
-
Dynasties marchandes, migrations et familles entre Rouen et le monde ibérique
Rouen, la seconde ville du royaume de France, accueille dès le XVIe siècle de nombreux Ibériques formant une communauté d’une grande importance au siècle suivant. Se pose alors la question des modes d
-
Perspective féministe sur la lesboparentalité : Être une «bonne mère» lesbienne en pleine controver…
Au moment du débat public sur le "Mariage pour tou·tes" (2012-2013), les familles lesboparentales sont prises entre une légitimité accrue due à l’institutionnalisation progressive de l’homoparentalité
-
Parcours dans l'histoire rurale
Trois « promenades » se succèdent durant cette séance au cours de laquelle le silence est à l’honneur. Le silence non pas comme une absence de bruit mais comme un objet historique. Fidèle à l’histoire
-
La famille normande sous l'Ancien Régime
J.L. Viret saisit et décrit les dynamiques sociales de reproduction, dans un bourg normand, du début du XVIIIe siècle aux premières années de la Révolution. Les femmes et les filles en présence de
-
Les laboureurs de Vieille Castille aux XVIe - XVIIe siècles : des limites à l'accumulation des rich…
Francis BRUMONT est professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Toulouse Le Mirail. Ses recherches portent essentiellement sur les relations entre la France méridionale et l´Espagne du
-
Les livres de raison du XVIe au XVIIIe siècle : apports à l'histoire rurale
La mémoire familiale est fragile : retenue par la parole pendant deux ou trois générations tout au plus, elle ne résiste au temps qu'à la condition d'être inscrite. Journaux, /diaires/, mémoires,