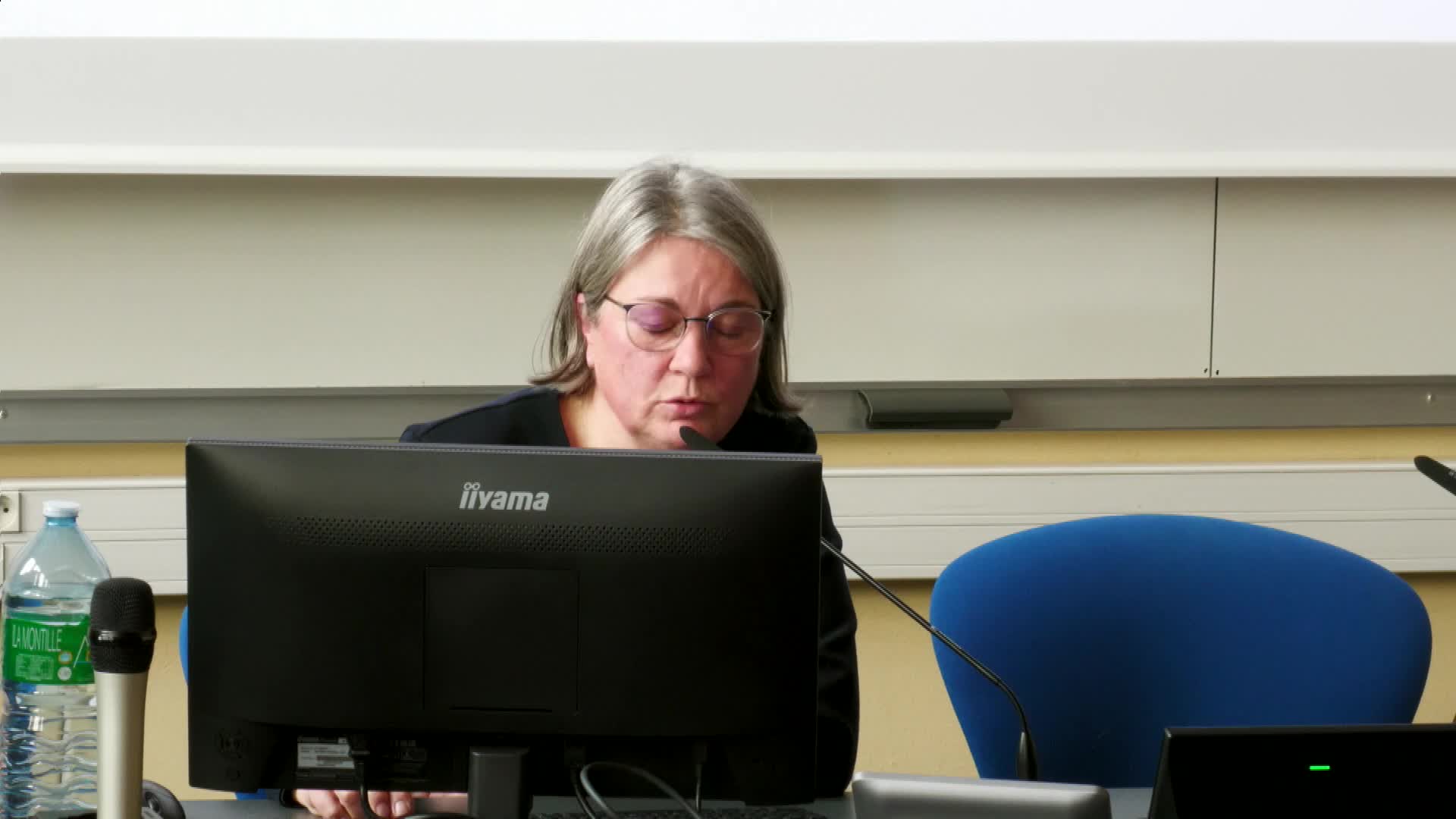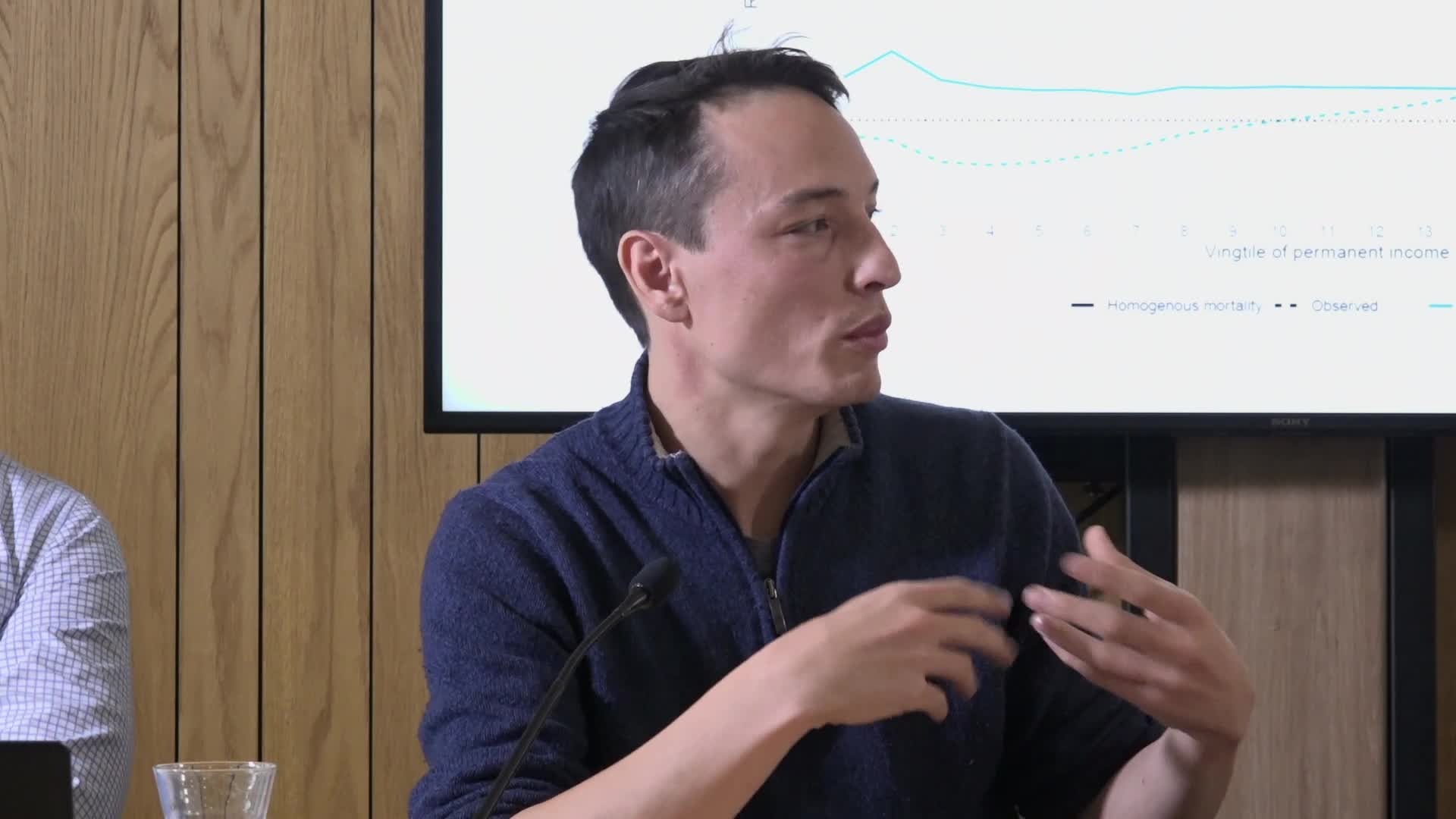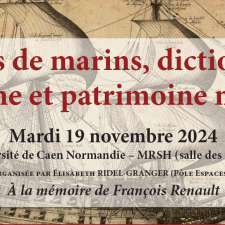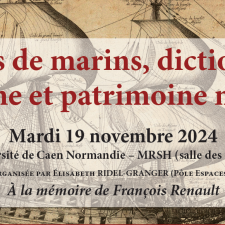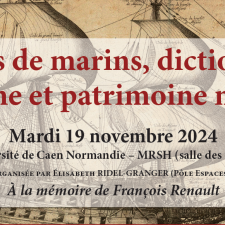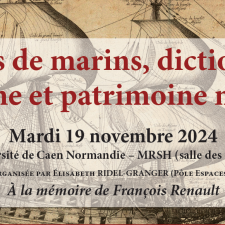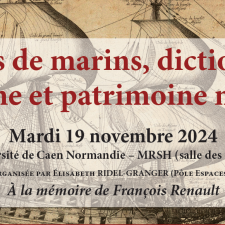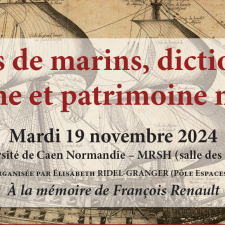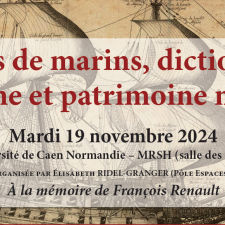Notice
MRSH Caen
Vauban et la défense du littoral en Bretagne et en Basse-Normandie
- document 1 document 2 document 3
- niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif
Cette communication a été donnée dans le cadre d'une journée d'études organisée par le pôle Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires de la MRSH, journée intitulée Le littoral : contrôle, surveillance et usage des côtes.
Annick Perrot a été très impliquée dans le dossier d'inscription des tours Vauban de Saint-Vaast-la-Hougue à l'Unesco. Gràce à elle, l'inscription a été actée en 2008, dans le cadre du réseau des sites majeurs de Vauban. Elle prépare actuellement une thèse de doctorat en histoire moderne, sous la direction du professeur Alain Hugon, intitulée Gens de mer et gens du littoral dans le Val de Saire, au siècle des Lumières.
Résumé de la communication
Bien qu'il ait rédigé deux traités concernant l'attaque et la défense des places, Vauban s'est toujours refusé à produire un traité de fortification, déclarant que chacune de ses réalisations étant adaptée aux conditions particulières de chaque place, la fortification est donc une affaire de bon sens. Il a cependant écrit, en 1705, un « traité de la fortification de campagne » où il consacre, curieusement, quelques pages aux retranchements de la 6e espèce qui « sont ceux qui se font pour opposer aux descentes des armées navales sur les côtes », avec toute une série d'indications sur la fortification des côtes et les formes à lui donner, comme les redoutes ou les tours à canon. Vauban précise, toutefois, qu'il est bien difficile d'empêcher une descente parce que l'armée navale est mobile et que si elle s'aperçoit que la partie est mal engagée pour elle, elle peut lever l'ancre et se présenter alors où on ne l'attend pas.
Comment a-t-il donc procédé pour mettre en défense le littoral, de Brest au Cotentin ? Vauban et ses ingénieurs se sont efforcés, à partir de 1683, de fortifier le littoral breton et normand, en mettant en place un système défensif associant différents types d'ouvrages fortifiés aptes à refouler l'assaillant, grâce au tir croisé des batteries. Les solutions architecturales retenues pour défendre la côte sont essentiellement de cinq types :
-
l'enceinte urbaine, telle celle de Brest édifiée sous Vauban ;
-
les batteries côtières dont le dispositif repose sur le croisement des feux : goulet de Brest ou redoutes de la côte de la Hougue ;
-
la tour de surveillance et de défense : à batterie basse (Camaret) ou à batterie haute (La Hougue et Tatihou) ;
-
le fort à la mer : classique, avec occupation totale du rocher (le Taureau, en baie de Morlaix) ou hybride de la batterie de côte (baie de Saint-Malo) ;
-
l'île fort : ensemble fortifié de grandes dimensions : le fort Cézon, à Landéda.
Les historiens sont partagés quant à l'efficacité de cette défense côtière, mais si on prend l'exemple du site de la Hougue, lieu de débarquement favori des Anglais pendant des siècles, force est de constater qu'ils ont boudé ce rivage après la tentative avortée de débarquement de 1708, l'ennemi ayant été repoussé par le tir croisé des tours (édifiées de 1694 à 1699) et des batteries côtières. Ces ouvrages sont donc, très certainement, un moyen efficace de dissuasion et de défense, mais aussi... de propagande, car le Roi doit montrer sa puissance aux ennemis venus de la mer ainsi qu'aux gens du rivage qui attendent de lui d'être défendus.
Orientation bibliographique :
-
LECUILLIER Guillaume, La Route des fortifications en Bretagne et Normandie, les étoiles de Vauban,Editions du Huitième Jour, 2006, 168 p.
-
PERROT Annick, avec la collaboration de GRIMBERT Gérard, THIN Edmond, ZYSBERG André, Les Tours Vauban de Saint-Vaast-la-Hougue, patrimoine mondial de l'Humanité, Saint-Vaast-La-Hougue, Imprimerie Charon, 2009, 104 p.
Thème
Sur le même thème
-
EVOLUTION DES PRATIQUES ET ACTIVITÉS AVEC L'AVANCÉE EN ÂGE
SÉANCE FLASH 1 : VIEILLISSEMENT, ÉVOLUTION DES CONTEXTES ET DES PRATIQUES
-
CHeaR - Croiser les Histoires des écoles d’architecture en Région (2024-2026)
LavenuMathildeMathilde Lavenu, membre de l'UMR Ressources, présente le projet CHeaR.
-
Le Bauhaus, 1919-1933 à aujourd’hui
MenginChristineChristine Mengin décrit l'histoire du mouvement architectural allemand du Bauhaus, de Weimar 1919 à Dessau 1933.
-
Table ronde 2 "La dimension hybride et transversale des démarches démocratiques en architecture et …
MacaireÉliseLongeotLéaLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d
-
ANR X EHESS : Penser la cohésion sociale (2-2)
KiesowRainer MariaBrunoAnne-SophieBaudotPierre-YvesRainhornJudithTôMaximeCussetPierre-YvesA l’occasion de la sortie du Cahier de l’ANR consacré au bilan de près de deux décennies de recherche sur les inégalités et les vulnérabilités dans notre société...
-
Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.
Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.
-
Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du …
Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du Dictionnaire de marine de Nicolas Desroches (1687) annoté au XVIIIe siècle par un élève officier.
-
L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.
L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.
-
Les marins, leurs langues et leurs dictionnaires : un tour d’horizons.
Les marins, leurs langues et leurs dictionnaires : un tour d’horizons.
-
DicoMarine. Bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine 17e-19e siècles.
DicoMarine. Bibliothèque virtuelle des dictionnaires de marine 17e-19e siècles.
-
Du matériel à l’immatériel, « la chose et le mot » : archéologie et dictionnaires de marine.
Du matériel à l’immatériel, « la chose et le mot » : archéologie et dictionnaires de marine.
-
Le lexique maritime dans les parlers normands.
Le lexique maritime dans les parlers normands.